
Né(e) : 1975
Lionel Ruffel est maître de conférences de littérature générale et comparée à l’Université Paris VIII "Vincennes-Saint-Denis".
Lionel Ruffel est par ailleurs directeur scientifique des programmes parisiens de Boston University, pour qui il a notamment élaboré le "Program in Contemporary Studies" et le "London-Paris Art and Architecture Summer Program".
Il a fondé et codirigé (2000-2007) la revue électronique de littérature "Chaoïd" et co-dirige la collection "Chaoïd" des éditions Verdier.
Il est membre fondateur du collectif "L'école de littérature".
Vendredi 9 août 2019, dans le cadre du banquet d'été "Transformer, transfigurer" qui s'est déroulé à Lagrasse du 2 au 9 août 2019, Lionel Ruffel tenait la conférence "L'épreuve du feu" Rien ne transforme plus que le feu et les fictions. Et peut-être les fictions ne sont-elles qu'une manière de conjurer la puissance terrifiante du feu, la puissance qu'a acquise celui qui l'a domestiqué. Comme toute domestication, celle-ci est réversible et entraîne une dépendance. Domestiqués par le feu, les anciens formaient des cercles narratifs autour du foyer pour tromper la nuit, qui jusque-là, leur imposait ses rythmes. Puis l'on s'est mis à tracer des lignes, écritures, codes, frontières, voies de circulation et d'échange et ces lignes ont produit une immense accélération, une propulsion, une incandescence. Le feu est désormais partout, il nous appartient d'en faire l'épreuve
(Le peuple post-exotique) ne s’inscrit ni dans une vision sociologique, ni dans une vision ontologique et substantialiste. Il est ailleurs, évidemment. Mais cet ailleurs n’est pas sans rapport avec notre humanité ; ni sans relation avec les données politiques du vingtième et du vingt-et-unième siècles. C’est l’originalité de cette vision de l’individu et du collectif, des singularités et de la communauté, bref du peuple, que je me propose d’étudier dans ce dernier chapitre.
Cette phrase, quand l’ai-je lue pour la première fois ? Il y a vingt ans probablement. Je ne me souviens pas du jour ni de l’heure, ni des conditions dans lesquelles je l’ai découverte. Pourtant j’ai su instantanément qu’elle serait ma phrase préférée. Je ne saurais dire quel est mon film préféré ni mon livre préféré, pas même mon album ou ma série préférés, et surtout pas mon plat préféré. Mais je connais ma phrase : « Il y aurait, là-bas, à l’autre bout du monde, une île. » C’est un sentiment étrange et puissant lorsqu’on la reconnaît, vous devriez essayer, c’est comme si tout en nous résonnait. Il y a quelque chose du doudou dans la phrase préférée, on sait qu’on peut toujours compter sur elle, on gagne en stabilité, on peut y recourir dès que le besoin se fait sentir de la faire résonner à nouveau. Et c’est mieux qu’un doudou, car on n’a pas à s’en séparer. Pour toujours, I mean, forever.
J’aime tout, dans cette phrase. Particulièrement, mais pas seulement, la radicalité de son excès, et exactement dans le même temps, la radicalité de sa simplicité. Tout y est en tension, surtout l’espace et le temps, le réel si l’on veut ; et c’est en quelques mots très doux, très contrôlés, très cadrés, que cela se passe. On y lit l’inouï de ce que peut le langage, de ce que peuvent la ponctuation et la conjugaison. Cette virgule après le conditionnel, voyez-vous, rien n’y contraint sinon d’insister sur la folie du conditionnel qui n’est rien d’autre que celle du langage, de la fiction et de l’humanité. Jamais ferme à processeurs produisant des bitcoins en Islande (« il y aurait, là-bas, à l’autre bout du monde, une île ») ne parviendra à la promesse technologique de cette virgule.
Mais à l’autre bout du monde, là-bas, ça finit souvent mal, et même très mal, que ce soit sur W, l’île inventée par Georges Perec, l’auteur de cette phrase, ou dans les fermes islandaises. On commence alors à redouter les virgules, les conditionnels, leurs prouesses technologiques. Mais rien à faire, et malgré la peur, on ne peut quand même pas s’en passer, ça continue à résonner, tout est plus clair lorsqu’on lit cette phrase. « Il y aurait, là-bas, à l’autre bout du monde, une île. » Ça résonnait à Tarnac en 2008, ça résonne à Florence en 1348 ou à Königsberg en 1795, ça résonne dans la chambre nuptiale de Shahryar et de Shéhérazade, ça résonne en after dans les années quatre-vingt-dix du vingtième siècle, ça résonne en janvier 2017 dans cette ancienne imprimerie où nous nous retrouvions alors.
Un an plus tard, j’ai souhaité vous y conduire vous aussi. Pour reprendre là où nous nous étions arrêtés avec vos prédécesseurs l’année dernière : ressentir à nouveau cela, cette résonance, refaire un cercle, recommencer et voir où ça nous mène. Installez-vous.
Ça ne résonne pas exactement pareil, mais toujours on retrouve ces mêmes étapes : fin d’un monde, départ, dope ou fiction partagée, commune. « Escapism ? » Si on veut, en tout cas si on ne voit pas plus loin que le bout présent de ses pieds. Scénario anthropologique plutôt, sécessionnisme, qui traverse l’histoire des fictions et des communautés humaines et qui se présente à nous, à nouveau, avec une intensité rarement atteinte. Il se laisse résumer ainsi : « Il y aurait là-bas, à l’autre bout du monde, une île. » Il se répète et devient obsédant. On ne voit plus que lui, derrière les lignes et les images. On ne voit plus que lui dans les zones à défendre, les zones d’autonomie temporaire, les cabanes, les communes, les raves, chez nos amis ; dans les camps et les jungles subis et parfois réinventés ; mais aussi chez nos ennemis, sur leurs îles artificielles et bientôt sur Mars. On ne voit plus que lui dans le cercle narratif du samar, au beau milieu du désert, ou auprès d’un foyer réconfortant, on ne voit plus que lui dans les théâtres, les salles de projection, les lieux de culte et ici même dans cette ancienne imprimerie où nous avons trouvé refuge ; et c’est encore lui qui se trame dans ces objets addictifs et souvent rectangulaires que sont nos livres ou nos écrans. On ne voit peut-être que lui, mais on n’y voit pas beaucoup plus clair.
La lecture des monstres dérange et provoque parfois des malentendus. Leur étrangeté peut les exclure du système de reconnaissance. Cette exclusion ne résiste pas au temps car s’il va de soi qu’une époque s’étudie grâce à des phénomènes de régularité, elle se comprend aussi par les phénomènes de rareté. Il faut être attentif aux monstres bien que l’époque ne les aime plus guère. Leur étude est un défi, car il faut toujours tenir ce rapport de la singularité et de l’exemplarité, et toujours tenir que l’exemplarité se mesure à force de singularité. Le post-exotisme pourrait beaucoup dire du temps présent, nous le dire sans vraiment nous en parler, de manière oblique.
Ils souhaitaient en finir avec l’humanité littéraire dont ce musée porte un témoignage, mes amis, cette humanité fondée par des liens et des attachements, cette humanité que la mortelle pestilence a ravagée. Et si le sécessionnisme m’a toujours fasciné, ce n’est pas à eux que je le dois, non, ils me font horreur alors qu’un autre sécessionnisme est possible. Je pense par exemple à ces petits groupes se détachant d’une plus large communauté pour faire bande à part, un peu comme dans un film de Takeshi Kitano. On y voit des bandes d’éclopés de la vie qui ne choisissent même pas vraiment de faire un bout de chemin ensemble, mais se retrouvent là par hasard, sur un chemin qui les mène à une plage, où ils commencent à jouer à un jeu d’échecs à taille humaine, et c’est tellement beau qu’on aimerait être avec eux, sur la plage abandonnés. Non je ne dois rien aux transhumanistes. Si le sécessionnisme me fascine, c’est que j’ai été biberonné à une autre de ses formes, lorsqu’on a traversé la nuit et atteint le point du jour, lorsque les substances nous ont aidés à suspendre le cours d’un temps qui pourrait durer mille et une années – en after. Cette suspension ne tient qu’à un fil si j’ose dire, le fil de nos liens, des liens temporaires et fragiles. C’est cela qu’on recherche, plus encore que la drogue, et si c’est la drogue qu’on recherche, alors rien ne va plus. Ce que j’aime, c’est le temps suspendu, la mort que l’on trompe, et ce sécessionnisme-là n’a rien à voir avec ceux qui veulent l’annuler, la mort, ces Prométhée de pacotille.
Si je m’autorise une note personnelle, je dois reconnaître un goût particulier pour la dernière fresque que nous découvrons enfin, à la fois plus iconophile et plus iconoclaste. On passera vite, voulez-vous, sur certains détails de la fresque pour nous attarder sur son trope dominant : le feu. Le feu partout, dessiné et écrit, prenant dans les arbres ou sur le bout incandescent d’une allumette, le feu apaisant du foyer et celui, effrayant, de l’incendie. La fresque joue de cette dichotomie entre maladie et guérison, feu et contre-feu, qui travaille les occupants.
Le risque, c’est la brûlure, du premier au dixième degré. Mais ces dix degrés sont aussi les dix étapes d’un manuel qui nous est offert et qu’il nous appartient de réinvestir. Car si la fin, la disparition, l’extinction semblent omniprésentes, et annoncées par cette inscription que je n’avais pas encore remarquée mais qui tout à coup me paraît bien significative : « or perish », « ou périr », le désir de survivre n’est pas moins fort, le désir de vivre malgré les virus, ou avec eux, malgré les flux ou avec eux.
« Trompe-la-mort », lit-on enfin, ici on trompe la mort, on la sait inévitable, on parle depuis elle, on parle déjà mort, mais depuis trois-quatre mille ans qu’on sait l’extinction inévitable, on sait aussi la tromper, on sait lui faire face, on sait la déjouer, c’est presque devenu instinctif : on reforme des liens perdus ou imaginaires, on se met à plusieurs, comme alors et comme aujourd’hui, et on se raconte des histoires. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Mais ne croyez pas que c’est un petit truc sympa, blablabla, on se raconte des histoires, c’est mignon ces humains qui croient guérir d’eux-mêmes en se racontant des histoires. On ne met pas de pansements sur une écorchure.
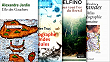
Voyager dans une couverture
Isacom
80 livres
Harry Potter à l'école des sorciers (très difficile)
Quel était le coffre où se trouvait la pierre philosophale ?
3762 lecteurs ont répondu



























