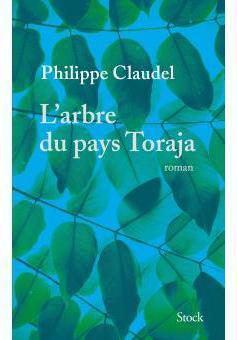>
Critique de nilebeh
Il existe en Indonésie un peuple, les Torajas, qui ont la particularité de confier leurs enfants morts aux branches d'un grand arbre, les cousant littéralement entre elles au moyen de bandes de tissus, les confiant en quelque sorte à la Mère-Terre pour qu'ils vivent encore à travers elle.
Ainsi le narrateur conçoit-il la mort de son ami, son frère de toujours, son complice, son producteur – car il est cinéaste – Eugène, mort d'un cancer idiot et têtu, « tueur à gages » qui a voulu se propager du poumon au reste de son corps. Eugène, que le cinéaste voit partout l'accompagnant, l'aidant de son regard désormais immobile et muet, tandis qu'il tourne son film : « La fabrique intérieure ». L'inscrivant entre les lignes de son texte, les images de son film, il l'insère dans le grand mouvement de la Vie, comme les petits Torajas.
La mort est omniprésente dans ce livre qui n'est sans doute pas qu'un roman. Et en contre-chant, la vie, qui gagne toujours, obstinée elle aussi surtout quand elle prend les traits de l'amante jeune et délicieuse, Elena, blessée aussi, jeune Croate venue en France, aujourd'hui chercheur en anthropologie comportementale. Longue méditation sur ce corps qui, de rayonnant et complice pendant une vingtaine d'années, devient « hostile, inamical, souffrant et enfin perdu : les étapes s'enchaînent, inexorablement, jusqu'à la mort. » « L'homme n'est homme apaisé que pendant une vingtaine, disons maintenant une trentaine d'années. Avant, et surtout après, il lutte. »
Déchéance du corps masculin, tandis que « Le corps des jeunes femmes fait songer à des pierres parfaites, polies, sans défauts, scandaleusement intactes. Celui des femmes possède le parfum patiné des jours innombrables où s'amalgament, sensuels, les moments de plaisir et ceux de l'attente. Il devient le velours assoupli des années. »
Captivante réflexion sur cette notion de distance, jamais la bonne, qui nous tient éloigné de l'être cher, trop loin, trop près, comment trouver la bonne distance entre les êtres ? Florence, son ex-femme avec laquelle il a encore de tendres rendez-vous, Elena son amante aujourd'hui, semblent toujours captées par une caméra mal réglée, la focale ne va jamais. Sauf en de rares moments de grâce où le cadrage est enfin le bon.
Florence, entre eux un enfant « mort-né », encore une question de distance : naître mort, n'est-ce pas le effroyable des oxymores se demande ce quinquagénaire, à mi-distance des deux échéances les plus fondamentales de la vie ?
Ce livre est un salutaire et délicieux moment de pause, de réflexion, d'intériorisation de ce qui fait notre plus grande préoccupation en tant qu'humains. Philippe Claudel convoque les gisants de marbre de la fondation Pinault, la lumière de la côte almafitaine, la douceur et la profondeur de Milan Kundera et celles de Michel Piccoli, les strophes mélancoliques de « Mysteries » chantées par Beth Gibbons, le tout en un mouvement lent et profond, très cinématographique, riche et nourri de références littéraires, en une écriture limpide et ciselée, où on a l'impression qu'on ne saurait, sans appauvrir et trahir la pensée, l'amputer d'une seule phrase.
Un beau livre, grave, sensible, qui nous arrache aussi un sourire parfois, à lire, à relire.
Ainsi le narrateur conçoit-il la mort de son ami, son frère de toujours, son complice, son producteur – car il est cinéaste – Eugène, mort d'un cancer idiot et têtu, « tueur à gages » qui a voulu se propager du poumon au reste de son corps. Eugène, que le cinéaste voit partout l'accompagnant, l'aidant de son regard désormais immobile et muet, tandis qu'il tourne son film : « La fabrique intérieure ». L'inscrivant entre les lignes de son texte, les images de son film, il l'insère dans le grand mouvement de la Vie, comme les petits Torajas.
La mort est omniprésente dans ce livre qui n'est sans doute pas qu'un roman. Et en contre-chant, la vie, qui gagne toujours, obstinée elle aussi surtout quand elle prend les traits de l'amante jeune et délicieuse, Elena, blessée aussi, jeune Croate venue en France, aujourd'hui chercheur en anthropologie comportementale. Longue méditation sur ce corps qui, de rayonnant et complice pendant une vingtaine d'années, devient « hostile, inamical, souffrant et enfin perdu : les étapes s'enchaînent, inexorablement, jusqu'à la mort. » « L'homme n'est homme apaisé que pendant une vingtaine, disons maintenant une trentaine d'années. Avant, et surtout après, il lutte. »
Déchéance du corps masculin, tandis que « Le corps des jeunes femmes fait songer à des pierres parfaites, polies, sans défauts, scandaleusement intactes. Celui des femmes possède le parfum patiné des jours innombrables où s'amalgament, sensuels, les moments de plaisir et ceux de l'attente. Il devient le velours assoupli des années. »
Captivante réflexion sur cette notion de distance, jamais la bonne, qui nous tient éloigné de l'être cher, trop loin, trop près, comment trouver la bonne distance entre les êtres ? Florence, son ex-femme avec laquelle il a encore de tendres rendez-vous, Elena son amante aujourd'hui, semblent toujours captées par une caméra mal réglée, la focale ne va jamais. Sauf en de rares moments de grâce où le cadrage est enfin le bon.
Florence, entre eux un enfant « mort-né », encore une question de distance : naître mort, n'est-ce pas le effroyable des oxymores se demande ce quinquagénaire, à mi-distance des deux échéances les plus fondamentales de la vie ?
Ce livre est un salutaire et délicieux moment de pause, de réflexion, d'intériorisation de ce qui fait notre plus grande préoccupation en tant qu'humains. Philippe Claudel convoque les gisants de marbre de la fondation Pinault, la lumière de la côte almafitaine, la douceur et la profondeur de Milan Kundera et celles de Michel Piccoli, les strophes mélancoliques de « Mysteries » chantées par Beth Gibbons, le tout en un mouvement lent et profond, très cinématographique, riche et nourri de références littéraires, en une écriture limpide et ciselée, où on a l'impression qu'on ne saurait, sans appauvrir et trahir la pensée, l'amputer d'une seule phrase.
Un beau livre, grave, sensible, qui nous arrache aussi un sourire parfois, à lire, à relire.