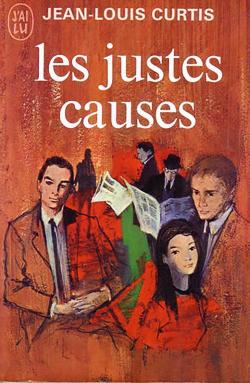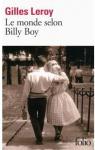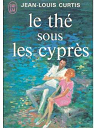Jean-Louis Curtis
EAN : 9780121095925
J'ai lu (05/10/2006)
/5
5 notes
J'ai lu (05/10/2006)
Résumé :
Quatre jeunes Français : François Donadieu, engagé dans les Forces Françaises Libres; Roland Oyarzun, patriote fourfoyé dans le pétainisme; Bernard, brillant directeur d'un hebdomadaire de gauche; Nicolas Gaudie, qui a été jusqu'à porter l'uniforme allemand.
Quatre amis aussi, qui on été camarades de classe, qui, ensemble, on joué, étudié, aimé.
Mais leurs destins qui se croisent et s'enchevêtrent, sont à l'image des destinées de leur p... >Voir plus
Quatre amis aussi, qui on été camarades de classe, qui, ensemble, on joué, étudié, aimé.
Mais leurs destins qui se croisent et s'enchevêtrent, sont à l'image des destinées de leur p... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les Justes CausesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Jean-Louis Curtis répond à la définition courante et traditionnelle du romancier. Il est notamment quelqu'un pour qui « le social » existe ; on s'en est aperçu à la lecture des Jeunes Hommes, des Forêts de la nuit, des Chers corbeaux. Il faut à ses personnages un milieu, une époque, des événements auxquels ils participent, et cette peinture, ailleurs souvent négligée ou tenue pour secondaire, requiert au contraire tous ses soins. Un individu, semble-t-il penser, ne se définit pas seulement par ses rapports avec d'autres individus, mais autant et plus par ceux qui le lient à toutes les collectivités, et ce, dès la famille et le lycée. Les problèmes qu'il doit résoudre, les décisions qu'il doit prendre ne l'intéressent jamais seul, se réfèrent toujours par quelque côté aux « autres » pris en bloc. Il est même très souvent façonné par le social.
Pourtant, si Curtis constate le fait, il ne le divinise pas. A la différence des réalistes de toute obédience, il ne pense pas que dissoudre un individu dans un type social, un milieu, un métier, une classe, une époque, suffise à constituer la tâche du romancier. Elle se définit bien plutôt à l'inverse, dans un désembourbement de ses héros de tout ce qui les fait ressembler aux autres, et on n'a jamais vu un romancier si pénétré de l'importance du social se dégager de cette emprise avec autant de causticité et d'esprit. L'ennemi, c'est finalement le social dans la mesure où il nivelle, égalise, généralise et banalise ; Curtis ne l'admet que comme générateur et miroir de drames intimes. Il semble nous dire en même temps, mais c'est une leçon qu'on peut discuter, que le social a ses lois propres et indépendantes de toutes les illusions qu'ont les hommes de les produire ou de les modifier. Par suite, c'est à la fois nécessité et folie que de participer à quelque forme que ce soit de vie collective qui n'est pas directement imposée.
Comme dans Les Jeunes hommes et Les Forêts de la nuit, Il se donne ici une vaste scène, une période significative, des personnages diversifiés. C'est la Libération (et les cinq à six années qui la suivent), vécue avec ses drames, ses déceptions et les changements qu'elle opère dans les destins particuliers, par une demi-douzaine de moins de trente ans : un ex-collaborateur, vichyssois et fasciste, Roland Oyarzun, un résistant du maquis, intellectuel israélite de bonne famille, Odilon Bernard, un résistant de Londres, huguenot provincial. François Donadieu, sa femme Catherine, actrice qui a joué devant les Allemands, un jeune réactionnaire, Thibault Fontanes, trop jeune pour avoir pris parti durant la guerre mais qui s'est engagé dans l'armée qui, en 1945, donne la chasse aux Allemands, plus divers comparses. Ils ont chacun leur propre histoire, qui ne recoupe pas toujours celle des autres, et ce pourrait être autant de monographies à la façon de celles que publient parfois Les Temps modernes, si le romancier n'intervenait pour organiser ces divers destins les uns par rapport aux autres, ne les faisait concourir au dessein d'ensemble qui est le sien et ne privilégiait un de ses personnages, François Donadieu, qui joue le rôle d'agent de liaison et de confesseur. Cela ne l'empêche pas d'intervenir en tant qu'auteur, de donner son avis et de faire ses réflexions, de prendre à partie le lecteur ou de s'en faire un complice. Tout cela est remarquablement construit et organisé, une vraie partition d'orchestre.
L'aventure de chacun est typique et banale ; résumée, elle n'offre aucun intérêt. Ce qui, par contre, retient, ce sont les raisons avouées ou obscures pour lesquelles chacun a choisi sa route grâce aux circonstances ou en dépit d'elles. Pourquoi Roland Oyarzun, fils de commandant d'artillerie, royaliste, raciste et antidémocrate, nationaliste avant tout, s'est-il vu plus d'affinités avec Hitler ou Pétain qu'avec De Gaulle, et pourquoi Bernard, ex-anarchiste de salon, internationaliste et pacifiste, s'est-il découvert une patrie et des motifs de se battre ? Pourquoi également Donadieu, qui s'est trouvé du « bon côté », et ce n'est pas un hasard, juge-t-il qu'en fin de compte les uns ne valent pas mieux que les autres, qu'on ne peut pas plus condamner ceux-ci qu'exalter ceux-là et qu'il est hypocrite de porter tout le bien d'un certain côté, tout le mal de l'autre. Jean-Louis Curtis ne vise pas à susciter une nuit où tous les chats sont gris et où, toutes les actions s'équivalent, mais, à la façon du romancier qui s'interdit d'être un partisan, à dépasser les raisons premières des uns et des autres pour déceler leurs raisons secondes qui sont, en général, les raisons profondes. Il remonte dans l'enfance de ses personnages, dans le milieu familial des premières années, dans leur vie scolaire ou locale, s'efforce d'analyser et de comprendre. Il se trouve qu'ils sont pour la plupart d'anciens condisciples du collège religieux de Sault-en-Labourd, et que si le germe de leur vie politique a été déposé en eux par les événements du 6 février 1934, il a donné des fruits différents pour avoir prospéré dans des terrains différents. C'est cette germination qui est importante et qui intéresse le romancier.
Ce retour en arrière, après une éblouissante peinture de la Libération de Paris, rompt un peu l'intérêt du récit, mais rétablit le roman dans ses droits. Il faut que nous sachions d'où vient François qui retrouve sa femme pour la quitter, pourquoi le lieutenant Bernard joue les personnages à la Malraux avant de diriger un hebdomadaire politique de gauche, et pour quelles raisons Oyarzun, qui purge trois mois de prison à Fresnes et se trouve condamné à cinq ans d'indignité nationale, s'adresse à François, son ennemi politique, comme à son seul ami. Pour l'observateur ou le simple chroniqueur il n'y aurait rien là que d'attendu et de banal. En nous faisant pénétrer dans l'intimité de chacun, le romancier refait de chaque comportement une aventure unique, dramatique et particulière. En nous obligeant à la vivre il nous oblige à nous identifier à elle, et si nous nous identifions nous ne pouvons plus juger. Cela devient aussi notre aventure. Je ne dirais pas que Jean-Louis Curtis soit parvenu tout à fait à ce résultat, mais il est sûr qu'à propos de ses créatures on substitue l'adjectif imbécile à l'épithète criminel, théâtral à héroïque, scrupuleux à tiède, bref le moral ou qui relève du caractère au politique. Ce qui veut dire, d'autre façon, que sous le partisan diversement coloré qu'on était prêt à juger d'emblée selon sa couleur on retrouve d'une part l'individu, de l'autre l'homme. C'est cela rétablir le roman dans ses droits, et parce que seul le lecteur de romans peut s'apitoyer sur la pauvre ganache de Roland Oyarzun, sympathiser avec le fastueux Bernard, comprendre les scrupules de l'hésitant François.
Le curieux est que les sentiments du romancier à l'égard des êtres qu'il a créés soient tout autres. Il n'en montre aucun qui soit franchement sympathique, et il les considère à peu près tous comme des imbéciles pour avoir cru ou croire encore aux « dieux de la cité », ces dieux qui se sont battus par l'entremise des hommes avant de trinquer en paix à la préparation de nouveaux carnages. Seuls les hommes en lutte croient aux « justes causes », à « la cause », quelle qu'elle soit. Les dieux, ou les sages, qui ont un champ de vision plus large (et leurs derrières assurés) savent que toutes les causes se valent et sont équivalentes, fussent-elles antinomiques jusqu'à vouloir se détruire l'une l'autre. Par définition elles sont toutes justes, ce qui revient à dire qu'il n'en est aucune qui vaille la peine qu'on se sacrifie pour elle. Si c'était là la seule philosophie de l'ouvrage, on aurait le droit de la trouver facile et un peu courte. C'est pourtant elle qui permet à Jean-Louis Curtis de réussir un grand nombre de ses effets par la répartie, la pointe, le calembour, la rosserie, la constatation ironique, tout ce qui relève de cette causticité seigneuriale (une seigneurie de l'intelligence) à laquelle il nous a habitués et qui sait se tenir entre la désinvolture niaise de quelques-uns de ses cadets, l'insolence gratuite de quelques-uns de ses aînés, pour préciser, entre Nimier et Montherlant. Toutefois, comme cette verve ne procède pas d'un point de vue « supérieur » sur l'humanité et ses vaines agitations, elle réjouit et réchauffe. La moquerie et le sarcasme sont chez lui d'assez bons déguisements de la pudeur.
Ils ne s'exercent pas le plus férocement en effet à l'égard des individus qui, si petits soient-ils, si ridicules ou si touchants, possèdent trop de nos traits communs pour que nous leur en voulions beaucoup, mais à propos des fonctions et des rôles sociaux qu'ils se donnent dans tous les genres de collectivités. C'est l'esprit de sérieux, en même temps que la frivolité, que Curtis attaque dans l'éditorialiste qui refait le monde tous les matins, dans l'auteur dramatique qui cherche des effets propres à terroriser ou exalter son public, dans la dame du monde qui se donne de l'esprit en tenant un salon littéraire, dans le revanchard de la Collaboration ou le Justicier de la Résistance, bref dans tous ceux qui ne pourront jamais se contenter d'assumer leur seule personne et qui ont charge d'âmes comme d'autres sont pères de famille. Parler en son seul nom, agir selon ses propres idées, ne pas se mêler des affaires des autres tant qu'elles ne deviennent pas les nôtres, voilà la deuxième leçon, d'une hygiène sociale assez simple, que nous donne l'auteur.
On peut la récuser comme la première, et à l'aide des mêmes arguments. Mais se joignant à la première elle découvre une question d'importance Que débat au fond l'ouvrage de Curtis : celle qui vise notre insertion dans le social. Qu'est-ce qui va mal en effet pour tous les personnages dont il nous parle, sur lesquels il s'apitoie (sans le montrer) ou dont il rit ? La façon qu'ils ont de se tenir dans le monde et qui ne correspond ni à ce que le monde attend d'eux ni à ce qu'ils attendent d'eux-mêmes. Ils sont tous en train de jouer « le malentendu » dès qu'au sein de la famille Ils apprennent à parler, et c'est un malentendu qui s'aggrave avec les années et avec les collectivités auxquelles ils appartiennent. La division, le déchirement, l'angoisse s'installent alors au-dedans d'eux-mêmes. L'auteur nous laisse le soin de désigner les responsables. Ce n'est pas une tâche facile.
La fresque d'époque, vaste, diversifiée et brillante, un peu fastidieuse aussi dans la mesure où elle nous apprend ce que nous savons déjà, se recompose ainsi par touches larges ou légères : événements, pensées et sentiments particuliers brodés sur les grands désirs et événements collectifs, problèmes communs à des milieux suffisamment étendus pour qu'ils deviennent significatifs, pittoresque passager de ce que « jamais on ne verra deux fois », permanence des grandes composantes sociales ou humaines. Elle réussit à n'être ni superficielle, ni didactique. Si elle n'est pas non plus flatteuse, il ne faut pas s'en prendre au peintre.
Video de Jean-Louis Curtis (9)
Voir plusAjouter une vidéo
Jeux de mémoire
Bernard PIVOT reçoit Friedrich DURRENMATT, écrivain suisseallemand, Alain ROBBE-GRILLET, Philippe SOLLERS et Jean-Louis CURTIS qui ont publié chacun un roman autobiographique. Bernard PIVOT s'entretient d'abord avec Jean Louis Curtis à propos de "Une éducation d'écrivain" dans lequel il est question de l'éveil d'un enfant à la littérature qui devient passion d'écrire. Jean Louis CURTIS...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean-Louis Curtis (30)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3661 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3661 lecteurs ont répondu