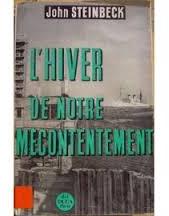>
Critique de Nastasia-B
C'est drôle, j'ai le sentiment que je pourrais commencer toutes mes critiques des livres de John Steinbeck par exactement la même formule : « Et BING ! encore un chef-d'oeuvre signé Steinbeck ! » Bon, mais comme j'ai l'impression de l'avoir déjà utilisée un certain nombre de fois et que j'aurais peur de vous lasser par un trop grand manque de variété, je vais essayer d'innover un peu aujourd'hui.
J'ai beaucoup d'amies qui me disent avec un fond de dégoût dans la voix : « Ooohh ! les westerns !… Je déteste ça, c'est nul. C'est toujours pareil, ça ne m'intéresse pas. » Erreur, les filles, erreur ! Même si je reconnais qu'à 95 % vous avez probablement raison, j'ose prétendre qu'il existe un terrain cinématographique où vous auriez tort de ne pas poser votre petit mufle dédaigneux. Il y a les westerns et il y a les westerns de Sergio Leone, qui, selon mes critères, sont légèrement au-dessus des autres (d'environ quatorze têtes).
Et parmi ces westerns de Sergio Leone, il en est un qui est particulièrement intéressant, c'est Il Était Une Fois Dans L'Ouest. Je vous fais grâce de tous les passages musclés, musicaux ou balistiques, qui sont peut-être un peu appuyés à mon goût mais qui ravissent manifestement le public masculin. Non, ce qui me titille particulièrement dans ce film, ce sont les personnages de Morton (le patron des chemins de fer handicapé) joué par Gabriele Ferzetti et le tueur à gages Frank, campé à l'écran par Henry Fonda.
J'ai essayé en vain de retrouver la vieille interview de Sergio Leone, je crois que c'était un entretien avec Noël Simsolo, où il qualifiait son film par une formule de ce genre : « J'ai filmé le passage d'un monde d'hommes, viril et sauvage, à un monde sans couille, dominé par l'argent. » le personnage de Morton symbolisant la pourriture de ce type de personnes n'hésitant pas à corrompre ou à payer des gens pour faire ce dont ils sont eux-mêmes incapables.
Il me semble que Henry Fonda, s'adressant à Morton (je cite tout de mémoire donc les aficionados me pardonneront les inexactitudes) envoie une réplique du genre : « J'ai vu cette pourriture sèche vous bouffer un peu plus chaque jour. » Puis, vers la fin du film, Charles Bronson lance à Henry Fonda quelque chose comme : « En somme, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas un homme d'affaires.
— Non, je ne serai jamais un homme d'affaires… un homme, tout simplement. (Henry Fonda)
— C'est une race très ancienne… Mais d'autres Norton viendront, qui essaieront de l'éteindre. (Charles Bronson) »
Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis en train de vous ennuyer avec cette histoire d'Il Était Une Fois Dans L'Ouest alors qu'il eût été si simple de vous parler de la véritable source d'inspiration du livre de John Steinbeck, à savoir, Richard III de Shakespeare ? N'ayez crainte, j'y viens, j'y viens, mais je vous ai promis de faire dans l'originalité aujourd'hui et vais tâcher de m'y tenir.
Le film de Sergio Leone dépeint très bien, je trouve le passage d'une époque à une autre, les cow-boys « old school » n'y auront bientôt plus leur place ni le droit de cité. La « civilisation » arrive, le « progrès » arrive, et donc, on ne peut plus se faire justice soi-même avec son six-coups. Vient le temps des réglementations, des chicanes administratives, des procès, des dommages et intérêts, etc., etc. Tout ce qui n'existait pas du temps du six-coups.
Alors de deux choses l'une : soit l'on s'adapte et l'on accepte docilement les nouvelles règles, soit l'on reste soi-même, c'est-à-dire, très vite un homme (ou une femme) du passé, amené à être marginalisé socialement, sans aucune chance aucune de retrouver jamais son statut d'autrefois. S'adapter ou mourir, quitte à y laisser son âme. Telle pourrait être la devise du film et c'est assurément l'un des propos du livre.
John Steinbeck, encore une fois, nous sert un roman plein d'intelligence et d'humour, riche, profond, fin, subtil, complexe et qui suscite la réflexion bien au-delà du domaine qu'il explore. J'ai lu deux ou trois sombres abrutis qui pour présenter cet ouvrage parlent d'un auteur « en déclin ». Franchement dit, j'aimerais bien décliner comme ça et j'imagine que bon nombre de nos petits auteurs de pacotille aimeraient bien s'approcher dans leurs grands moments du déclin d'un Steinbeck. Surtout, surtout, mesdames et messieurs de chez Gallimard & consorts, ne changez rien, mettez-moi du D'Ormesson en pléiade et en tête de gondole et parallèlement, laissez moisir cet auteur en déclin qu'est Steinbeck. Bande de nazes ! J'aime autant changer de sujet parce que j'en deviendrais vite ordurière…
Mais encore avant de vous parler réellement du fond de l'oeuvre, permettez-moi encore une toute petite digression qui fait le lien entre ces merveilleux éditeurs et le Richard III de tout à l'heure. le titre original de ce roman, The Winter Of Our Discontent, est issu de l'incipit de la pièce de Shakespeare, dans la bouche de Gloucester, futur roi Richard :
« Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this sun of York;
And all the clouds that lour'd upon our house
In the deep bosom of the ocean buried. »
Steinbeck est coutumier du fait ; il aime bien puiser ses titres d'autres oeuvres en rapport avec son travail. Il avait choisi pour titre Les Raisins de la Colère (The Grapes Of Wrath) issu de l'Hymne de Bataille de la République, texte engagé écrit par Julia Ward Howe ; il avait choisi En Un Combat Douteux du poème de John Milton, le Paradis Perdu ; il avait choisi À L'Est D'Éden de la Bible, et le voici donc venu piocher chez Shakespeare, comme Faulkner (Le Bruit Et La Fureur) ou Huxley (Le Meilleur Des Mondes) avant lui, pour ne citer que ces deux-là.
Voilà pourquoi j'aimerais dire deux mots de la traduction. En ce qui me concerne, j'ai lu la traduction de Jean Rosenthal de 1970. Il en existe une plus récente, de 1995 d'Anouk Neuhoff qui ne m'a absolument pas plu. La traduction du titre est à l'image du reste : elle a complètement perdu l'esprit (Une Saison Amère). Cette traduction publiée chez le livre de poche est probablement plus moderne, plus actuelle, mais… je n'y reconnais pas l'écriture de Steinbeck, alors que je la reconnais fort bien chez Jean Rosenthal. Donc, si vous avez la possibilité, vous savez ce qui vous reste à faire…
Cette première tirade de Richard III colle à merveille au propos que souhaite véhiculer l'auteur. Voilà un homme, John Steinbeck, qui est né, qui a grandi et vécu une bonne partie de sa vie en Californie du début du XXe jusqu'après la seconde guerre mondiale. La tragédie, pour lui, c'est qu'entre temps, son pays est devenu la première puissance mondiale, sa population a explosé et son mode de vie s'est métamorphosé du tout au tout. La Californie agricole de son enfance n'est plus qu'un très lointain souvenir ; désormais, c'est le temple du high tech, du business et de la superficialité.
Il ne s'y reconnaît probablement plus beaucoup au début des années 1960 (voir à ce propos des mutations survenues en Californie durant l'entre-deux-guerres le roman graphique d'Emmanuel Guibert, L'Enfance D'Alan) de sorte qu'il finit même par s'installer sur la côte Est, celle des origines de son pays.
Il ne faut donc probablement pas s'étonner si l'auteur choisit pour établissement de son dernier grand roman une ville imaginaire, New Baytown, mais qu'il est aisé de situer sur Long Island, en tant qu'ancienne ville baleinière, une ville de pionniers totalement dépassée par le mouvement des années 1960. Au passage, l'auteur fait très certainement un clin d'oeil à Moby Dick, un type d'ouvrage qui lui aussi appartient au passé, du temps des glorieux pionniers de l'Amérique.
Le narrateur et personnage principal, Ethan Hawley, est issu d'une des anciennes grandes familles de la ville. Son père a perdu toute la fortune de la famille ; ne subsiste que le nom (mais ce qui est déjà mieux que rien). Ce faisant, Ethan est désormais garçon d'épicerie au service d'un émigré italien de première génération, ce qui est une sorte de relégation sociale indéniable.
Ethan s'en accommoderait assez bien s'il ne tenait qu'à lui. C'est un employé modèle, honnête et travailleur, qui fait l'ébahissement de son patron italien qui se demande toujours, avec son regard suspicieux qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière une telle incompréhensible honnêteté.
Ethan, homme de la quarantaine, est marié avec une femme qu'il aime et qui le lui rend bien. Ils ont deux grands enfants de l'âge de l'adolescence. Malgré tous les sentiments qui unissent Ethan à sa famille, il sent bien dans leur regard qu'un peu d'argent supplémentaire et une situation professionnelle et sociale supérieure leur conviendrait mieux et le grandiraient à leurs yeux.
Le problème d'Ethan, c'est qu'il est à la fois intelligent, lucide et moral. le sang Hawley qui coule dans ses veines vient souvent lui rappeler qu'il est issu de fiers marins besogneux : des gens francs avec des valeurs. Derrière son comptoir, Ethan observe tout, comprend tout, et comprend surtout qu'il n'a pas l'âme d'un homme d'affaire.
Les compromissions, les entourloupes, les coups bas pour arriver à tirer son épingle du jeu le révulsent. Pourtant, il voit tout, il sent tout, il est capable comme Gloucester de devenir Richard III, mais que va-t-il devoir abandonner ou trahir pour se hisser sur le trône qui lui ouvre les bras ?
John Steinbeck nous offre en guise de testament littéraire une sensationnelle réflexion sur la réussite, économique et sociale, sur la notoriété, sur la possession et l'argent. Pour lui, comme pour Georges Brassens, les trompettes de la renommée sont vraiment très mal embouchées. Pourtant, c'est le visage de son Amérique : la réussite à tout prix, quel qu'en soit le prix ; quitte à tricher, quitte à tuer discrètement, quitte à écraser autrui, quitte à voler mais en conservant toujours la face en se réfugiant derrière un joli tampon officiel de légalité.
Voici l'argent, voici le trésor, voici la récompense, elle ne vous appartient pas mais vous pourriez aisément mettre la main dessus discrètement en toute dignité. Pour cela, il suffit juste d'aider un mourant à rejoindre rapidement sa tombe, ou de passer un petit coup de fil aux services de répression pour attirer l'attention sur les affaires d'untel ou d'untel. Que dit votre âme ?
L'auteur, avec son sens de l'humour et de la facétie, utilise la parabole, et même la parabole dans la parabole, au travers d'un jeu-concours comme seule l'Amérique des années 1960 peut en organiser : faire un texte sur « Combien j'aime l'Amérique », une compétition à laquelle les deux enfants d'Ethan vont participer et dont les résultats sont très certainement à l'image de ce que l'auteur pense de son pays, du moins de ce qu'il est devenu.
Je termine la boucle avec le cinéma, car l'on connaît les liens qui unissent John Steinbeck avec l'immense réalisateur John Ford. Ce dernier a dit dans le livre de Peter Bogdanovich qui lui est consacré : « Si nos ancêtres pouvaient nous voir, ils seraient salement honteux. » Voilà, c'est sans doute à peu près le message que nous délivre L'Hiver de Notre Déplaisir, un livre à ne pas rater (mais à ne pas lire dans sa traduction bidon Une Saison Amère), assurément l'un de mes coups de coeur de l'année.
Bien entendu, tout ceci n'est que mon avis, en espérant qu'il ne fera pas votre déplaisir en cette saison d'hiver, car, somme toute, il ne représente pas grand-chose.
J'ai beaucoup d'amies qui me disent avec un fond de dégoût dans la voix : « Ooohh ! les westerns !… Je déteste ça, c'est nul. C'est toujours pareil, ça ne m'intéresse pas. » Erreur, les filles, erreur ! Même si je reconnais qu'à 95 % vous avez probablement raison, j'ose prétendre qu'il existe un terrain cinématographique où vous auriez tort de ne pas poser votre petit mufle dédaigneux. Il y a les westerns et il y a les westerns de Sergio Leone, qui, selon mes critères, sont légèrement au-dessus des autres (d'environ quatorze têtes).
Et parmi ces westerns de Sergio Leone, il en est un qui est particulièrement intéressant, c'est Il Était Une Fois Dans L'Ouest. Je vous fais grâce de tous les passages musclés, musicaux ou balistiques, qui sont peut-être un peu appuyés à mon goût mais qui ravissent manifestement le public masculin. Non, ce qui me titille particulièrement dans ce film, ce sont les personnages de Morton (le patron des chemins de fer handicapé) joué par Gabriele Ferzetti et le tueur à gages Frank, campé à l'écran par Henry Fonda.
J'ai essayé en vain de retrouver la vieille interview de Sergio Leone, je crois que c'était un entretien avec Noël Simsolo, où il qualifiait son film par une formule de ce genre : « J'ai filmé le passage d'un monde d'hommes, viril et sauvage, à un monde sans couille, dominé par l'argent. » le personnage de Morton symbolisant la pourriture de ce type de personnes n'hésitant pas à corrompre ou à payer des gens pour faire ce dont ils sont eux-mêmes incapables.
Il me semble que Henry Fonda, s'adressant à Morton (je cite tout de mémoire donc les aficionados me pardonneront les inexactitudes) envoie une réplique du genre : « J'ai vu cette pourriture sèche vous bouffer un peu plus chaque jour. » Puis, vers la fin du film, Charles Bronson lance à Henry Fonda quelque chose comme : « En somme, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas un homme d'affaires.
— Non, je ne serai jamais un homme d'affaires… un homme, tout simplement. (Henry Fonda)
— C'est une race très ancienne… Mais d'autres Norton viendront, qui essaieront de l'éteindre. (Charles Bronson) »
Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis en train de vous ennuyer avec cette histoire d'Il Était Une Fois Dans L'Ouest alors qu'il eût été si simple de vous parler de la véritable source d'inspiration du livre de John Steinbeck, à savoir, Richard III de Shakespeare ? N'ayez crainte, j'y viens, j'y viens, mais je vous ai promis de faire dans l'originalité aujourd'hui et vais tâcher de m'y tenir.
Le film de Sergio Leone dépeint très bien, je trouve le passage d'une époque à une autre, les cow-boys « old school » n'y auront bientôt plus leur place ni le droit de cité. La « civilisation » arrive, le « progrès » arrive, et donc, on ne peut plus se faire justice soi-même avec son six-coups. Vient le temps des réglementations, des chicanes administratives, des procès, des dommages et intérêts, etc., etc. Tout ce qui n'existait pas du temps du six-coups.
Alors de deux choses l'une : soit l'on s'adapte et l'on accepte docilement les nouvelles règles, soit l'on reste soi-même, c'est-à-dire, très vite un homme (ou une femme) du passé, amené à être marginalisé socialement, sans aucune chance aucune de retrouver jamais son statut d'autrefois. S'adapter ou mourir, quitte à y laisser son âme. Telle pourrait être la devise du film et c'est assurément l'un des propos du livre.
John Steinbeck, encore une fois, nous sert un roman plein d'intelligence et d'humour, riche, profond, fin, subtil, complexe et qui suscite la réflexion bien au-delà du domaine qu'il explore. J'ai lu deux ou trois sombres abrutis qui pour présenter cet ouvrage parlent d'un auteur « en déclin ». Franchement dit, j'aimerais bien décliner comme ça et j'imagine que bon nombre de nos petits auteurs de pacotille aimeraient bien s'approcher dans leurs grands moments du déclin d'un Steinbeck. Surtout, surtout, mesdames et messieurs de chez Gallimard & consorts, ne changez rien, mettez-moi du D'Ormesson en pléiade et en tête de gondole et parallèlement, laissez moisir cet auteur en déclin qu'est Steinbeck. Bande de nazes ! J'aime autant changer de sujet parce que j'en deviendrais vite ordurière…
Mais encore avant de vous parler réellement du fond de l'oeuvre, permettez-moi encore une toute petite digression qui fait le lien entre ces merveilleux éditeurs et le Richard III de tout à l'heure. le titre original de ce roman, The Winter Of Our Discontent, est issu de l'incipit de la pièce de Shakespeare, dans la bouche de Gloucester, futur roi Richard :
« Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this sun of York;
And all the clouds that lour'd upon our house
In the deep bosom of the ocean buried. »
Steinbeck est coutumier du fait ; il aime bien puiser ses titres d'autres oeuvres en rapport avec son travail. Il avait choisi pour titre Les Raisins de la Colère (The Grapes Of Wrath) issu de l'Hymne de Bataille de la République, texte engagé écrit par Julia Ward Howe ; il avait choisi En Un Combat Douteux du poème de John Milton, le Paradis Perdu ; il avait choisi À L'Est D'Éden de la Bible, et le voici donc venu piocher chez Shakespeare, comme Faulkner (Le Bruit Et La Fureur) ou Huxley (Le Meilleur Des Mondes) avant lui, pour ne citer que ces deux-là.
Voilà pourquoi j'aimerais dire deux mots de la traduction. En ce qui me concerne, j'ai lu la traduction de Jean Rosenthal de 1970. Il en existe une plus récente, de 1995 d'Anouk Neuhoff qui ne m'a absolument pas plu. La traduction du titre est à l'image du reste : elle a complètement perdu l'esprit (Une Saison Amère). Cette traduction publiée chez le livre de poche est probablement plus moderne, plus actuelle, mais… je n'y reconnais pas l'écriture de Steinbeck, alors que je la reconnais fort bien chez Jean Rosenthal. Donc, si vous avez la possibilité, vous savez ce qui vous reste à faire…
Cette première tirade de Richard III colle à merveille au propos que souhaite véhiculer l'auteur. Voilà un homme, John Steinbeck, qui est né, qui a grandi et vécu une bonne partie de sa vie en Californie du début du XXe jusqu'après la seconde guerre mondiale. La tragédie, pour lui, c'est qu'entre temps, son pays est devenu la première puissance mondiale, sa population a explosé et son mode de vie s'est métamorphosé du tout au tout. La Californie agricole de son enfance n'est plus qu'un très lointain souvenir ; désormais, c'est le temple du high tech, du business et de la superficialité.
Il ne s'y reconnaît probablement plus beaucoup au début des années 1960 (voir à ce propos des mutations survenues en Californie durant l'entre-deux-guerres le roman graphique d'Emmanuel Guibert, L'Enfance D'Alan) de sorte qu'il finit même par s'installer sur la côte Est, celle des origines de son pays.
Il ne faut donc probablement pas s'étonner si l'auteur choisit pour établissement de son dernier grand roman une ville imaginaire, New Baytown, mais qu'il est aisé de situer sur Long Island, en tant qu'ancienne ville baleinière, une ville de pionniers totalement dépassée par le mouvement des années 1960. Au passage, l'auteur fait très certainement un clin d'oeil à Moby Dick, un type d'ouvrage qui lui aussi appartient au passé, du temps des glorieux pionniers de l'Amérique.
Le narrateur et personnage principal, Ethan Hawley, est issu d'une des anciennes grandes familles de la ville. Son père a perdu toute la fortune de la famille ; ne subsiste que le nom (mais ce qui est déjà mieux que rien). Ce faisant, Ethan est désormais garçon d'épicerie au service d'un émigré italien de première génération, ce qui est une sorte de relégation sociale indéniable.
Ethan s'en accommoderait assez bien s'il ne tenait qu'à lui. C'est un employé modèle, honnête et travailleur, qui fait l'ébahissement de son patron italien qui se demande toujours, avec son regard suspicieux qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière une telle incompréhensible honnêteté.
Ethan, homme de la quarantaine, est marié avec une femme qu'il aime et qui le lui rend bien. Ils ont deux grands enfants de l'âge de l'adolescence. Malgré tous les sentiments qui unissent Ethan à sa famille, il sent bien dans leur regard qu'un peu d'argent supplémentaire et une situation professionnelle et sociale supérieure leur conviendrait mieux et le grandiraient à leurs yeux.
Le problème d'Ethan, c'est qu'il est à la fois intelligent, lucide et moral. le sang Hawley qui coule dans ses veines vient souvent lui rappeler qu'il est issu de fiers marins besogneux : des gens francs avec des valeurs. Derrière son comptoir, Ethan observe tout, comprend tout, et comprend surtout qu'il n'a pas l'âme d'un homme d'affaire.
Les compromissions, les entourloupes, les coups bas pour arriver à tirer son épingle du jeu le révulsent. Pourtant, il voit tout, il sent tout, il est capable comme Gloucester de devenir Richard III, mais que va-t-il devoir abandonner ou trahir pour se hisser sur le trône qui lui ouvre les bras ?
John Steinbeck nous offre en guise de testament littéraire une sensationnelle réflexion sur la réussite, économique et sociale, sur la notoriété, sur la possession et l'argent. Pour lui, comme pour Georges Brassens, les trompettes de la renommée sont vraiment très mal embouchées. Pourtant, c'est le visage de son Amérique : la réussite à tout prix, quel qu'en soit le prix ; quitte à tricher, quitte à tuer discrètement, quitte à écraser autrui, quitte à voler mais en conservant toujours la face en se réfugiant derrière un joli tampon officiel de légalité.
Voici l'argent, voici le trésor, voici la récompense, elle ne vous appartient pas mais vous pourriez aisément mettre la main dessus discrètement en toute dignité. Pour cela, il suffit juste d'aider un mourant à rejoindre rapidement sa tombe, ou de passer un petit coup de fil aux services de répression pour attirer l'attention sur les affaires d'untel ou d'untel. Que dit votre âme ?
L'auteur, avec son sens de l'humour et de la facétie, utilise la parabole, et même la parabole dans la parabole, au travers d'un jeu-concours comme seule l'Amérique des années 1960 peut en organiser : faire un texte sur « Combien j'aime l'Amérique », une compétition à laquelle les deux enfants d'Ethan vont participer et dont les résultats sont très certainement à l'image de ce que l'auteur pense de son pays, du moins de ce qu'il est devenu.
Je termine la boucle avec le cinéma, car l'on connaît les liens qui unissent John Steinbeck avec l'immense réalisateur John Ford. Ce dernier a dit dans le livre de Peter Bogdanovich qui lui est consacré : « Si nos ancêtres pouvaient nous voir, ils seraient salement honteux. » Voilà, c'est sans doute à peu près le message que nous délivre L'Hiver de Notre Déplaisir, un livre à ne pas rater (mais à ne pas lire dans sa traduction bidon Une Saison Amère), assurément l'un de mes coups de coeur de l'année.
Bien entendu, tout ceci n'est que mon avis, en espérant qu'il ne fera pas votre déplaisir en cette saison d'hiver, car, somme toute, il ne représente pas grand-chose.