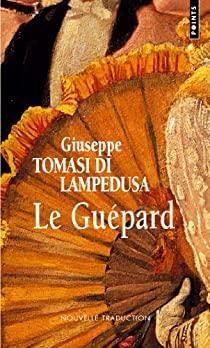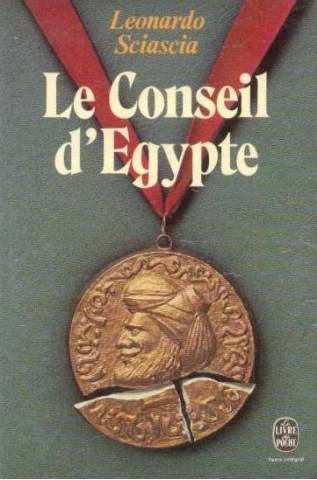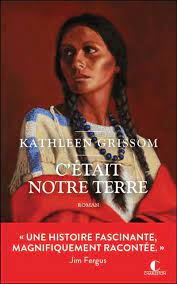Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Fanette Roche-Pézard (Traducteur)Vincenzo Consolo (Préfacier, etc.)/5 1121 notes
Fanette Roche-Pézard (Traducteur)Vincenzo Consolo (Préfacier, etc.)/5 1121 notes
Résumé :
Dans la Sicile de 1860, une famille de la haute aristocratie subit le changement de régime de l'île. Le prince Salina, d'abord pris de vertige devant la "stupéfiante accélération de l'Histoire", se laisse peu à peu gagner par une indolente et puissante nostalgie contre laquelle il ne sied plus de lutter. Son pétillant neveu, Tancrède Falconeri, incarne la force nouvelle qui ébranle son pays et devant laquelle il a l'intelligence de s'incliner. Avec son humour savour... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le GuépardVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (137)
Voir plus
Ajouter une critique
Il faut le voir, ce prince de Salina, géant au regard jupitérien toujours courroucé, dominer son monde peuplé de nains qui s'agitent tout autour de lui ! Il faut la voir, cette illustre famille sicilienne traverser les siècles avec autant d'aisance et d'orgueil que Don Fabrizio, son dernier rejeton, quand il traverse les salles de son palais encombrées de meubles chargés d'Histoire et d'ancestrales tapisseries bariolées ! On pourrait la croire immortelle, cette famille de colosses qui a choisi le guépard comme emblème, et qui règne sans partage, avec quelques autres, sur ces terres de Sicile flagellées par le soleil.
Mais derrière cette façade faîte de puissance et d'éternité se cache les premiers doutes et les premières lézardes. Don Fabrizio a dans ses gênes toute l'expérience de ses aïeux, et le scepticisme fondamental des grands seigneurs. Il sait qu'il appartient à une « génération malheureuse à cheval entre les temps anciens et nouveaux ». Il sent ces ondes négatives qui tourbillonnent autour de lui et de sa famille ; il voit ces « mauvaises choses, des petites pierres qui courent et précèdent l'éboulement ». le point de bascule arrive en ce mois de mai 1860. Les petites pierres courent, courent, courent… Les chemises rouges de Garibaldi débarquent en Sicile. Tancrède, le neveu favori du prince, rejoint la rébellion et participe à cette guerre d'opérette. Opportuniste, il se marie avec la sublime Angelica, fille de Don Calogero, un parvenu, un rustre qui, à la faveur de cette révolution, détient désormais le pouvoir. Et pendant tout ce temps, les trois filles de Don Fabrizio s'enfoncent dans la bigoterie, et la poussière s'accumule dans les pièces désertées du palais du dernier des princes de Salina…
Un grand roman classique au style flamboyant. Un roman poignant où l'on ressent toute l'amertume et l'impuissance de Don Fabrizio qui voit son monde s'effacer aussi facilement que poussière au vent tandis que la vieille Sicile écrasée de soleil, farouche et misérable, reste immuable.
Un roman sur la décadence. Un roman sur la mort et la fin d'un monde. Un immense roman enfin qui rejoint l'universel. Tous les Hommes ont été à un moment de leur vie ce Don Fabrizio, ce géant orgueilleux, avant de voir ces petites pierres qui roulent les unes après les autres, avant de voir leur monde s'effriter et de s'effacer presque incognito pour rejoindre un coin d'ombre.
J'ai lu en commun ce livre avec mon amie Srafina. Autant vous dire que cette histoire bouleversante et pathétique nous a tous deux faits frémir. Je vous invite à lire son billet.
Mais derrière cette façade faîte de puissance et d'éternité se cache les premiers doutes et les premières lézardes. Don Fabrizio a dans ses gênes toute l'expérience de ses aïeux, et le scepticisme fondamental des grands seigneurs. Il sait qu'il appartient à une « génération malheureuse à cheval entre les temps anciens et nouveaux ». Il sent ces ondes négatives qui tourbillonnent autour de lui et de sa famille ; il voit ces « mauvaises choses, des petites pierres qui courent et précèdent l'éboulement ». le point de bascule arrive en ce mois de mai 1860. Les petites pierres courent, courent, courent… Les chemises rouges de Garibaldi débarquent en Sicile. Tancrède, le neveu favori du prince, rejoint la rébellion et participe à cette guerre d'opérette. Opportuniste, il se marie avec la sublime Angelica, fille de Don Calogero, un parvenu, un rustre qui, à la faveur de cette révolution, détient désormais le pouvoir. Et pendant tout ce temps, les trois filles de Don Fabrizio s'enfoncent dans la bigoterie, et la poussière s'accumule dans les pièces désertées du palais du dernier des princes de Salina…
Un grand roman classique au style flamboyant. Un roman poignant où l'on ressent toute l'amertume et l'impuissance de Don Fabrizio qui voit son monde s'effacer aussi facilement que poussière au vent tandis que la vieille Sicile écrasée de soleil, farouche et misérable, reste immuable.
Un roman sur la décadence. Un roman sur la mort et la fin d'un monde. Un immense roman enfin qui rejoint l'universel. Tous les Hommes ont été à un moment de leur vie ce Don Fabrizio, ce géant orgueilleux, avant de voir ces petites pierres qui roulent les unes après les autres, avant de voir leur monde s'effriter et de s'effacer presque incognito pour rejoindre un coin d'ombre.
J'ai lu en commun ce livre avec mon amie Srafina. Autant vous dire que cette histoire bouleversante et pathétique nous a tous deux faits frémir. Je vous invite à lire son billet.
À LA TOUTE FIN, L'ÉTERNITÉ.
Nous sommes en Juillet 1957. Un homme presque totalement inconnu du public vient de rendre l'âme, il n'avait que 60 ans. Dans son testament rédigé fin mai de la même année - l'homme se savait atteint d'un cancer du poumon - voici, entre autre, ce que ces proches découvrent :
«Je désire que tout ce qui est possible soit fait pour que le "Guépard" soit publié (le texte valable est celui qui a été recueilli dans un seul manuscrit) ; cela ne signifie pas évidemment qu'il doit être publié aux frais de mes héritiers ; je considérerai cela comme une grande humiliation. [...]»
L'ultime voeu de cet homme un peu étrange, relativement reclus, fin lettré passionné de littérature anglaise et française (langues qu'il connaissait à la perfection), donnant à quelques jeunes étudiants, sur les dernières années de sa vie, des genres de leçons particulières consacrées à ses auteurs favoris (Shakespeare, Byron, Flaubert et, surtout, Stendhal), n'ayant jusque-là que quelques rares textes publiés, pour l'essentiel des critiques, cet ultime voeu, le Prince Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne le verra donc pas de son vivant à quelques trois malheureux mois prêt. Pas plus qu'il n'aura connu la gloire incommensurable, tant populaire que critique, que ce texte écrit tardivement mais dans une certaine urgence obtiendra tant en Italie qu'à l'international, succès dont il faut admettre qu'il fut encore plus éclatant après le succès du film de Luchino Visconti, Palme d'Or à Cannes en 1963, demeurant d'ailleurs sans aucun doute la réalisation la plus fameuse du cinéaste italien. (Pour la petite histoire, jamais un roman italien n'avait obtenu un tel succès dans son propre pays depuis cent ans. Il faudra attendre le Nom de la rose d'Umberto Eco, en 1980, pour atteindre de tels scores d'édition !).
Mais que peut bien cacher un tel roman pour obtenir un tel déluge de superlatifs, un tel succès, une telle reconnaissance tant par les lecteurs que par la critique académique - ce qui est, reconnaissons-le, un phénomène des plus rares - ?
Tout d'abord, une histoire servie par un homme en tout point fascinant : Don Fabrizio Salina, éminent prince d'une Sicile connaissant les grands bouleversements politiques et sociaux de son époque - les années 1860 - et surtout, de la future nation italienne avec les tourments révolutionnaires du "risorgimento" (mot que l'on peut traduire par "renaissance" ou "résurrection"), voulue de longue date par le Comte de Cavour, sous l'égide du futur roi Victor-Emmanuel II aidé de son bras armé (surtout en ce qui concerne le Royaume de Sicile), le célèbre Garibaldi. Ainsi, cet homme déjà entré dans ce qu'il est coutume de nommer "la force de l'âge" a-t-il déjà une longue expérience des êtres, et une immémoriale histoire derrière lui (sa famille serait née des ébats d'un empereur romain !). Personnage à la stature imposante «Non qu'il fût gros : il n'était qu'immense et très fort ;[...]», «le teint rosé, les poils couleur de miel», se décrivant lui-même comme un détonnant mélange d'origine germanique, autoritaire, hautain et cédant aux délices de l'intellectualisme, par sa mère, de «sensualité et de laisser-aller» par son père sicilien, «le Prince Fabrizio vivait dans un mécontentement perpétuel, malgré son regard jupitérien courroucé, et il contemplait la ruine de sa classe et de son patrimoine sans rien faire pour y porter remède ni en avoir la moindre envie». Voila comment nous est présenté, dès les premières pages, cet homme dont nous allons suivre, avec délectation, avec une incroyable attention, les pensées les plus intimes, les engouements et les détestations, les longs et puissants moments de contemplation - le Prince n'est-il pas un astronome reconnu de ses pairs, ses talents de scientifique lui ayant même valu, jadis, la remise d'une médaille d'honneur par le grand savant et homme d'état français François Arago -. Car il est ainsi, Don Fabrizio : les pieds et l'ironie bien sur cette terre mais les pensées proches des étoiles.
Dès la première scène - la fin de la récitation du rosaire - de la première partie, qui a lieu en mai 1860, di Lampedusa nous emporte, avec une maestria invraisemblable, dans ce petit royaume en perpétuel déclin, en état de déréliction presque imperceptible mais pourtant si présente tout au long de l'ouvrage. Ainsi en est-il, dans les quelques pages qui suivent la présentation de cet hôte colossal, de la description, fascinante, du jardin de la propriété, pas totalement à l'abandon, pas non plus absolument impeccable, et où la nature semble cependant reprendre peu à peu ses droits. Apparaît d'ailleurs dès l'incipit une sorte de méta personnage, un chien, un immense et jeune dogue répondant au nom de Bendicò qui apparaîtra bientôt comme le seul élément simplement gai et heureux de cette histoire épique, qui ponctuera régulièrement certaines des scènes les plus importantes de l'ouvrage, jusqu'à son ultime conclusion, mais n'allons pas trop vite.
Très vite les personnages principaux du roman vont nous être présentés, la plupart du temps sous le regard mordant, cynique et désabusé de Don Fabrizio, de temps à autres par le biais d'un narrateur extérieur omniscient - ne serait-ce que pour permettre l'existence de moments dans lesquels le Prince n'apparaît pas en personne. Souvent pour donner un autre angle à ce que l'histoire intériorisée par le principal personnage nous fait découvrir, parfois pour prolonger le temps de l'histoire avec des temps plus contemporains, souvent pour appuyer encore un peu plus sur le décadentisme irréversible de ce qui est décrit -. Il y a, bien entendu, les proches immédiats : Stella, l'épouse très pieuse, glaciale, trompée (qui n'a, soyons sincère, qu'un rôle très secondaire). Les enfants, à commencer par Concetta, l'une des trois filles, jeune demoiselle soumise à son père, naïve, facilement revêche mais sans méchanceté ni calcul, l'exacte antithèse de l'autre jeune femme du roman. Il y a les fils, à commencé par l'aîné, Paolo, pour lequel son père n'a qu'une sympathie très mesurée, le trouvant mou, lourd, sans grandeur ni vision, n'aimant guère que la compagnie des chevaux (dont, ironie sublime, il mourra) lui-même étant pour ainsi dire l'antithèse de l'autre personnage essentiel, quoi que légèrement décalé narrativement parlant, du Guépard, le jeune Prince Tancrède, son neveu désargenté mais ambitieux, fin, drôle de cette ironie qui plait tant à cet oncle terrible ; pour le dire en un seul mot : aristocratique, comme lui l'est, sans doute l'un des derniers de son clan, de sa race, de son temps. Avec ce petit quelque chose que le prince vieillissant n'a pas, n'a plus : une ambition politique absolument dévorante, dont on comprendra vers la fin qu'elle fut plus forte que son ménage avec sa sublissime épouse...
Car l'époque est aux grands bouleversement, dans cette péninsule cis-alpine en mal de rassemblement. Déjà, l'ancien Royaume de Sardaigne a-t-il adopté une constitution de type libérale en 1848. Mais c'est le débarquement des "Mille" sous les ordres de Giuseppe Garibaldi, les fameuses "Chemises rouges", qui accélérera, dans cette Sicile royale, le mouvement révolutionnaire déjà à l'oeuvre sur le continent. L'intelligence de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, concernant ces moments connus et reconnus de tout italien qui se respecte, c'est de n'avoir évoqué, abordé ces faits historiques d'importance que par le biais de digressions, parfois d'évocations anodines au cours d'une conversation, à d'autre instants par l'arrivée brutale et tout aussi brutalement résumé des conséquences immédiates de ces troubles ; ainsi de ce jeune soldat royaliste trouvé mort dans le jardin de la propriété princière. Parce que le Guépard n'est pas un roman historique - mais bien plutôt se penche sur les conséquences de faits historiques, sur L Histoire en général, et leurs répercussions sur des histoires particulières - il évite ainsi les travers factuels de ce type d'oeuvre, l'ouvrant à un universel auquel un texte contant les péripéties et autres batailles des uns ou des autres lors cette période n'aurait probablement pas pu prétendre. Car si Lampedusa use, avec une finesse étonnante, toujours étincelante, de ces moments cruciaux de l'Histoire moderne de l'Italie, c'est d'abord, et même avant tout, pour nous faire toucher d'aussi près que possible les états d'âme languides mais cyniques d'un grand sceptique, mêlant une certaine apathie à l'impossibilité de jamais vraiment pouvoir exprimer la moindre vraie colère - tandis que le personnage est incroyablement colérique ! -, la moindre réaction vive face à ce monde qui s'écroule sous ses yeux (ce qu'il voit, sait, comprend), mais aussi, d'une certaine manière, en son propre for intérieur, nous faisant approcher d'une manière rarement atteinte en littérature les soubresauts, les supplices de l'angoisse lorsqu'elle tend à l'existentiel. La sixième partie de l'ouvrage, modestement intitulée "La fin du prince" en est un exemple sublime, palpitant, d'une émotion inouïe autant que surprenante rarement lue par ailleurs.
Toute l'intelligence, le raffinement, l'intuition de di Lampedusa de ce monde en décapilotade apparaît à travers ce personnage ainsi que par le biais de binôme, parfois en bonne intelligence comme celui formé par Don Fabrizio et Tancredi, s'excerçant plus souvent par le biais de rapports presque strictement antithétiques comme c'est le cas entre le Prince et le futur beau-père de Tancrède, Calogero Sedàra, le prototype de l'homme nouveau dans cette atmosphère de fin du monde, de fin d'UN monde qui peine à l'admettre malgré les évidences, Sedàra, un homme roué, malin, intelligent même, mais qui confond beauté et valeur pécuniaire de cette beauté, un être que l'on ne peut même pas qualifier de vil, tant son destin et ses entreprises semblent clairs comme de cette eau pourtant si rare en Sicile - à moins qu'elle ne se mette subitement à tomber sans discontinuer sous forme d'orage cataclysmique -, un parfait homme d'affaire, fils d'un paysan illettré et repoussant, tout dévoué au culte de Mammon, aujourd'hui on parlerait sans aucun doute d'un parvenu ; seulement cet homme-là est le père heureux d'une merveille, sa fille - qui réalise un autre binôme, toujours dans l'antithèse exacte, avec Concetta, Angelica au prénom prédestiné - même si angélique elle est loin de l'être tout à fait - et plutôt que de tenter de la décrire, avec maladresse, laissons l'auteur nous présenter sa première apparition dans le salon du château princier de Donnafugata :
«L'instant dura cinq minutes ; puis la porte s'ouvrit et Angelica entra. La première impression fut de surprise éblouie. Les Salina restèrent le souffle coupé ; Tancredi senti même battre les veines de ses tempes. Devant l'impétuosité de sa beauté les hommes furent incapables d'en remarquer, en les analysant, les défauts qui n'étaient pas rares ; et nombreuses étaient les personnes qui ne seraient jamais capables de cette élaboration critique. Elle était grande et bien faite, sur la base de critères généreux ; sa carnation devait posséder la saveur de la crème fraîche à laquelle elle ressemblait, sa bouche enfantine celle des fraises. Sous la masse des cheveux couleur de nuit enroulés en d'exquises ondulations, il y avait l'aube de ses yeux verts, immobiles comme ceux des statues et, comme eux, un peu cruels. Elle avançait lentement, en faisant tournoyer sa large jupe blanche et portait sur sa personne la sérénité, l'invincibilité de la femme sûre de sa beauté. Ce n'est que bien des mois plus tard que l'on sut qu'au moment de son entrée triomphale elle avait été sur le point de s'évanouir d'anxiété.»
Le lecteur remarquera sans doute, au passage, que Lampedusa ne dit finalement pas tant ce qu'est cette beauté : la carnation de la peau et des lèvres, sa chevelure, ses yeux un peu plus ; une démarche. Il n'omet pas même une certaine réalité : qu'elle n'est pas une pure perfection. Mais, quand bien même nous n'assistons pas directement à cette scène d'où le temps semble s'être d'ailleurs un instant retiré, les impressions, les regards des autres - soyons francs : des hommes pour l'essentiels - , par lesquels nous admirons Angelica nous donnent plus à imaginer qu'aucune description complète de ce physique n'aurait jamais pu le faire. Si le lecteur s'est laissé subjuguer, au détour de ces quelques lignes extraites du roman, par cette évanescente beauté apparue dans la torpeur d'un salon mondain, exprimé par ce style qui prend son temps, tout en évoquant beaucoup, qu'il imagine seulement l'effet que peuvent avoir quelques trois cent pages de ce niveau, de cette sidération permanente, de, osons l'affirmer, ce chef d'oeuvre absolu d'une densité rare, d'une tension permanente dans son apparente ataraxie, un roman où les réflexions les plus fondamentales sur le pouvoir, sur la beauté, sur la politique, sur le temps qui passe, sur les rapports entre hommes et femmes, sur les buts mêmes d'une existence, sur la mort, peuvent surgir d'une simple et champêtre scène de chasse, de quelques instants de songerie dans le creux d'un canapé, d'une discussion à bâtons rompus avec un émissaire de la jeune Monarchie Constitutionnelle, etc.
Les grands textes contant la fin d'une époque, la fin d'un monde, de tout un monde, ne sont pas si rares. Quelques-uns atteignent au génie - nous pensons plus précisément à ce roman incontournable de la "Mittel Europa" naissante, "La Marche de Radetzky" du grand écrivain autrichien (mort en 1939 à Paris, presque oublié) Joseph Roth. Nous ne pouvons omettre "A la Recherche du temps perdu" de notre illustre Marcel Proust dont certaines thématiques ne sont évidemment pas sans rappeler celles présentes dans le Guépard, même s'il faut reconnaître que cette correspondance sera encore plus approfondie dans ce chef d'oeuvre du cinéma mondial que Visconti fit quelques années plus tard du roman -. Celui de Lampedusa est incontestablement de ces immenses textes-là, à moins de s'arrêter à cette trompeuse apparence d'un livre axé sur la seule décadence d'un monde - l'aristocratie dans la Sicile du Roi François II- déjà en perdition depuis des années, en Italie comme presque partout ailleurs dans l'Europe de la seconde moitié du XIXème siècle. C'est aussi un livre qui s'amuse - avec mordant et une certaine lucidité rogue - de l'émergence du monde nouveau bientôt seul à l'oeuvre. Pour mieux répéter le passé, ainsi que le prévoit et le prédit le jeune Tancrède, dans une formulation demeurée célèbre, et qui donne l'une des clés possibles - certainement pas la seule - à ce roman allégorique : « Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change». N'est-ce pas ce que les supposées alternances politiques nous promettent régulièrement ? Ce à quoi elles aboutissent invariablement...?
On aurait pu s'arrêter sur quelques autres personnages, tel ce prêtre, le fidèle Père Pirrone, dont le nom est celui d'un curé ayant réellement existé et qui fut le chapelain de l'arrière grand-père dont l'auteur s'est assez largement inspiré - même s'il estimait qu'il l'avait rendu plus intelligent que ne l'avait jamais été le véridique aïeul ! -, ou encore ce compagnon de chasse - presque devenu un ami, malgré la différence de classe et de condition -, organiste de l'église du village, homme secret un peu bourru mais dont le sens de l'honneur, sans faille tout autant que vain, semble appartenir à un monde encore plus ancien que celui de Don Fabrizio. Il y a aussi ce chien un peu fou qui, dans les dernières pages du roman, va représenter une espèce de parabole aux ultimes dérisoires instants de ce monde définitivement mort.
Tout est là, dans ce récit au mille stratagèmes narratifs - comment expliquer sinon que l'on croit, par exemple, d'autant plus à l'assurance du mariage éclatant des deux amants, Tancredi et Angelica, qu'à aucun moment l'auteur ne nous y fera assister ? Que les rumeurs de la révolution suffisent amplement à nous en donner toute l'importance, quand bien même il eût été aisé d'en faire quelque description bien sentie - et l'art de Lampédusa eut certainement su décrire un tel type de "vérité" -, mieux, que c'est parce que nous n'assistons à aucune de ces péripéties militaires, autrement que par le biais de conversations, de détails postérieurs à leur effectivité, des souvenirs, que nous sommes subjugués par la force de leurs conséquences ? Est-il vraiment indispensable d'ajouter que l'oeuvre tient, pour une part, de Stendhal (principalement de la Chartreuse de Parme) dont l'auteur était un excellent connaisseur, pour une autre part du roman "vériste" Les Princes de Francalanza de de Roberto pour la description de la ruine de l'aristocratie sicilienne ? C'est indubitablement exact, et ne saurait pourtant expliquer qu'une fraction du génie tant inspiré de cette oeuvre si profonde, si personnelle, où l'on devine aisément que, derrière ce Prince de la fin du XIXème siècle, c'est incidemment le Prince écrivain lui-même qui peut se lire en creux dans le portrait de cet homme Ô ! combien solitaire (malgré son entourage) et désabusé.
Mais toutes les explications consacrées à un texte qui n'en finit pas d'être pressé, déconstruit, analysé par ses innombrables exégètes ne peuvent parfaitement rendre compte de la magie - de la pure magie - du style de Lampedusa (et le lecteur français lambda ne dispose pourtant "que" de la magistrale traduction de Jean-Paul Maganaro dont le travail, probablement héroïque, homérique même, est à porter au zénith de la traduction littéraire), un style intensément baroque, imperceptiblement allusif, pratiquant un art de la métaphore à des niveaux rarement atteints, sachant manier un verbe que l'on pourrait qualifier d'aristocratique si le terme n'était aussi galvaudé voire honni, jouant sans cesse de l'allusion et de l'hyperbole, travaillant les mots comme un véritable orfèvre de la langue, n'hésitant pas à essouffler le lecteur de ses phrases parfois interminables (et d'un lyrisme souvent étrange, arythmique), pour mieux le laisser exsangue sur une réflexion emportant tout sur son passage, un instantané de pure grâce, un moment captivant où espace et temps semblent demeurer suspendus dans l'imagination en fusion de qui les reçoit. Une langue belle, belle et inquiétante comme on peut le ressentir de l'observation de l'oiseau de proie en suspension au dessus de sa future proie. Un roman monde, un roman intemporel mais d'une temporalité romanesque construite - et déconstruite à la fois - avec la sapience d'un grand architecte, un roman fusion, qui nous en dit autant de ce que nous sommes que de ce que peut être le monde alentour, par-delà les différences temporelles, sociales et géographiques... Un roman hommage, enfin, à cette terre revêche, jaunie par le soleil, asséchée par le souvenir des embruns, dure sans nulle doute, sauvage certainement, difficilement compréhe
Nous sommes en Juillet 1957. Un homme presque totalement inconnu du public vient de rendre l'âme, il n'avait que 60 ans. Dans son testament rédigé fin mai de la même année - l'homme se savait atteint d'un cancer du poumon - voici, entre autre, ce que ces proches découvrent :
«Je désire que tout ce qui est possible soit fait pour que le "Guépard" soit publié (le texte valable est celui qui a été recueilli dans un seul manuscrit) ; cela ne signifie pas évidemment qu'il doit être publié aux frais de mes héritiers ; je considérerai cela comme une grande humiliation. [...]»
L'ultime voeu de cet homme un peu étrange, relativement reclus, fin lettré passionné de littérature anglaise et française (langues qu'il connaissait à la perfection), donnant à quelques jeunes étudiants, sur les dernières années de sa vie, des genres de leçons particulières consacrées à ses auteurs favoris (Shakespeare, Byron, Flaubert et, surtout, Stendhal), n'ayant jusque-là que quelques rares textes publiés, pour l'essentiel des critiques, cet ultime voeu, le Prince Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne le verra donc pas de son vivant à quelques trois malheureux mois prêt. Pas plus qu'il n'aura connu la gloire incommensurable, tant populaire que critique, que ce texte écrit tardivement mais dans une certaine urgence obtiendra tant en Italie qu'à l'international, succès dont il faut admettre qu'il fut encore plus éclatant après le succès du film de Luchino Visconti, Palme d'Or à Cannes en 1963, demeurant d'ailleurs sans aucun doute la réalisation la plus fameuse du cinéaste italien. (Pour la petite histoire, jamais un roman italien n'avait obtenu un tel succès dans son propre pays depuis cent ans. Il faudra attendre le Nom de la rose d'Umberto Eco, en 1980, pour atteindre de tels scores d'édition !).
Mais que peut bien cacher un tel roman pour obtenir un tel déluge de superlatifs, un tel succès, une telle reconnaissance tant par les lecteurs que par la critique académique - ce qui est, reconnaissons-le, un phénomène des plus rares - ?
Tout d'abord, une histoire servie par un homme en tout point fascinant : Don Fabrizio Salina, éminent prince d'une Sicile connaissant les grands bouleversements politiques et sociaux de son époque - les années 1860 - et surtout, de la future nation italienne avec les tourments révolutionnaires du "risorgimento" (mot que l'on peut traduire par "renaissance" ou "résurrection"), voulue de longue date par le Comte de Cavour, sous l'égide du futur roi Victor-Emmanuel II aidé de son bras armé (surtout en ce qui concerne le Royaume de Sicile), le célèbre Garibaldi. Ainsi, cet homme déjà entré dans ce qu'il est coutume de nommer "la force de l'âge" a-t-il déjà une longue expérience des êtres, et une immémoriale histoire derrière lui (sa famille serait née des ébats d'un empereur romain !). Personnage à la stature imposante «Non qu'il fût gros : il n'était qu'immense et très fort ;[...]», «le teint rosé, les poils couleur de miel», se décrivant lui-même comme un détonnant mélange d'origine germanique, autoritaire, hautain et cédant aux délices de l'intellectualisme, par sa mère, de «sensualité et de laisser-aller» par son père sicilien, «le Prince Fabrizio vivait dans un mécontentement perpétuel, malgré son regard jupitérien courroucé, et il contemplait la ruine de sa classe et de son patrimoine sans rien faire pour y porter remède ni en avoir la moindre envie». Voila comment nous est présenté, dès les premières pages, cet homme dont nous allons suivre, avec délectation, avec une incroyable attention, les pensées les plus intimes, les engouements et les détestations, les longs et puissants moments de contemplation - le Prince n'est-il pas un astronome reconnu de ses pairs, ses talents de scientifique lui ayant même valu, jadis, la remise d'une médaille d'honneur par le grand savant et homme d'état français François Arago -. Car il est ainsi, Don Fabrizio : les pieds et l'ironie bien sur cette terre mais les pensées proches des étoiles.
Dès la première scène - la fin de la récitation du rosaire - de la première partie, qui a lieu en mai 1860, di Lampedusa nous emporte, avec une maestria invraisemblable, dans ce petit royaume en perpétuel déclin, en état de déréliction presque imperceptible mais pourtant si présente tout au long de l'ouvrage. Ainsi en est-il, dans les quelques pages qui suivent la présentation de cet hôte colossal, de la description, fascinante, du jardin de la propriété, pas totalement à l'abandon, pas non plus absolument impeccable, et où la nature semble cependant reprendre peu à peu ses droits. Apparaît d'ailleurs dès l'incipit une sorte de méta personnage, un chien, un immense et jeune dogue répondant au nom de Bendicò qui apparaîtra bientôt comme le seul élément simplement gai et heureux de cette histoire épique, qui ponctuera régulièrement certaines des scènes les plus importantes de l'ouvrage, jusqu'à son ultime conclusion, mais n'allons pas trop vite.
Très vite les personnages principaux du roman vont nous être présentés, la plupart du temps sous le regard mordant, cynique et désabusé de Don Fabrizio, de temps à autres par le biais d'un narrateur extérieur omniscient - ne serait-ce que pour permettre l'existence de moments dans lesquels le Prince n'apparaît pas en personne. Souvent pour donner un autre angle à ce que l'histoire intériorisée par le principal personnage nous fait découvrir, parfois pour prolonger le temps de l'histoire avec des temps plus contemporains, souvent pour appuyer encore un peu plus sur le décadentisme irréversible de ce qui est décrit -. Il y a, bien entendu, les proches immédiats : Stella, l'épouse très pieuse, glaciale, trompée (qui n'a, soyons sincère, qu'un rôle très secondaire). Les enfants, à commencer par Concetta, l'une des trois filles, jeune demoiselle soumise à son père, naïve, facilement revêche mais sans méchanceté ni calcul, l'exacte antithèse de l'autre jeune femme du roman. Il y a les fils, à commencé par l'aîné, Paolo, pour lequel son père n'a qu'une sympathie très mesurée, le trouvant mou, lourd, sans grandeur ni vision, n'aimant guère que la compagnie des chevaux (dont, ironie sublime, il mourra) lui-même étant pour ainsi dire l'antithèse de l'autre personnage essentiel, quoi que légèrement décalé narrativement parlant, du Guépard, le jeune Prince Tancrède, son neveu désargenté mais ambitieux, fin, drôle de cette ironie qui plait tant à cet oncle terrible ; pour le dire en un seul mot : aristocratique, comme lui l'est, sans doute l'un des derniers de son clan, de sa race, de son temps. Avec ce petit quelque chose que le prince vieillissant n'a pas, n'a plus : une ambition politique absolument dévorante, dont on comprendra vers la fin qu'elle fut plus forte que son ménage avec sa sublissime épouse...
Car l'époque est aux grands bouleversement, dans cette péninsule cis-alpine en mal de rassemblement. Déjà, l'ancien Royaume de Sardaigne a-t-il adopté une constitution de type libérale en 1848. Mais c'est le débarquement des "Mille" sous les ordres de Giuseppe Garibaldi, les fameuses "Chemises rouges", qui accélérera, dans cette Sicile royale, le mouvement révolutionnaire déjà à l'oeuvre sur le continent. L'intelligence de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, concernant ces moments connus et reconnus de tout italien qui se respecte, c'est de n'avoir évoqué, abordé ces faits historiques d'importance que par le biais de digressions, parfois d'évocations anodines au cours d'une conversation, à d'autre instants par l'arrivée brutale et tout aussi brutalement résumé des conséquences immédiates de ces troubles ; ainsi de ce jeune soldat royaliste trouvé mort dans le jardin de la propriété princière. Parce que le Guépard n'est pas un roman historique - mais bien plutôt se penche sur les conséquences de faits historiques, sur L Histoire en général, et leurs répercussions sur des histoires particulières - il évite ainsi les travers factuels de ce type d'oeuvre, l'ouvrant à un universel auquel un texte contant les péripéties et autres batailles des uns ou des autres lors cette période n'aurait probablement pas pu prétendre. Car si Lampedusa use, avec une finesse étonnante, toujours étincelante, de ces moments cruciaux de l'Histoire moderne de l'Italie, c'est d'abord, et même avant tout, pour nous faire toucher d'aussi près que possible les états d'âme languides mais cyniques d'un grand sceptique, mêlant une certaine apathie à l'impossibilité de jamais vraiment pouvoir exprimer la moindre vraie colère - tandis que le personnage est incroyablement colérique ! -, la moindre réaction vive face à ce monde qui s'écroule sous ses yeux (ce qu'il voit, sait, comprend), mais aussi, d'une certaine manière, en son propre for intérieur, nous faisant approcher d'une manière rarement atteinte en littérature les soubresauts, les supplices de l'angoisse lorsqu'elle tend à l'existentiel. La sixième partie de l'ouvrage, modestement intitulée "La fin du prince" en est un exemple sublime, palpitant, d'une émotion inouïe autant que surprenante rarement lue par ailleurs.
Toute l'intelligence, le raffinement, l'intuition de di Lampedusa de ce monde en décapilotade apparaît à travers ce personnage ainsi que par le biais de binôme, parfois en bonne intelligence comme celui formé par Don Fabrizio et Tancredi, s'excerçant plus souvent par le biais de rapports presque strictement antithétiques comme c'est le cas entre le Prince et le futur beau-père de Tancrède, Calogero Sedàra, le prototype de l'homme nouveau dans cette atmosphère de fin du monde, de fin d'UN monde qui peine à l'admettre malgré les évidences, Sedàra, un homme roué, malin, intelligent même, mais qui confond beauté et valeur pécuniaire de cette beauté, un être que l'on ne peut même pas qualifier de vil, tant son destin et ses entreprises semblent clairs comme de cette eau pourtant si rare en Sicile - à moins qu'elle ne se mette subitement à tomber sans discontinuer sous forme d'orage cataclysmique -, un parfait homme d'affaire, fils d'un paysan illettré et repoussant, tout dévoué au culte de Mammon, aujourd'hui on parlerait sans aucun doute d'un parvenu ; seulement cet homme-là est le père heureux d'une merveille, sa fille - qui réalise un autre binôme, toujours dans l'antithèse exacte, avec Concetta, Angelica au prénom prédestiné - même si angélique elle est loin de l'être tout à fait - et plutôt que de tenter de la décrire, avec maladresse, laissons l'auteur nous présenter sa première apparition dans le salon du château princier de Donnafugata :
«L'instant dura cinq minutes ; puis la porte s'ouvrit et Angelica entra. La première impression fut de surprise éblouie. Les Salina restèrent le souffle coupé ; Tancredi senti même battre les veines de ses tempes. Devant l'impétuosité de sa beauté les hommes furent incapables d'en remarquer, en les analysant, les défauts qui n'étaient pas rares ; et nombreuses étaient les personnes qui ne seraient jamais capables de cette élaboration critique. Elle était grande et bien faite, sur la base de critères généreux ; sa carnation devait posséder la saveur de la crème fraîche à laquelle elle ressemblait, sa bouche enfantine celle des fraises. Sous la masse des cheveux couleur de nuit enroulés en d'exquises ondulations, il y avait l'aube de ses yeux verts, immobiles comme ceux des statues et, comme eux, un peu cruels. Elle avançait lentement, en faisant tournoyer sa large jupe blanche et portait sur sa personne la sérénité, l'invincibilité de la femme sûre de sa beauté. Ce n'est que bien des mois plus tard que l'on sut qu'au moment de son entrée triomphale elle avait été sur le point de s'évanouir d'anxiété.»
Le lecteur remarquera sans doute, au passage, que Lampedusa ne dit finalement pas tant ce qu'est cette beauté : la carnation de la peau et des lèvres, sa chevelure, ses yeux un peu plus ; une démarche. Il n'omet pas même une certaine réalité : qu'elle n'est pas une pure perfection. Mais, quand bien même nous n'assistons pas directement à cette scène d'où le temps semble s'être d'ailleurs un instant retiré, les impressions, les regards des autres - soyons francs : des hommes pour l'essentiels - , par lesquels nous admirons Angelica nous donnent plus à imaginer qu'aucune description complète de ce physique n'aurait jamais pu le faire. Si le lecteur s'est laissé subjuguer, au détour de ces quelques lignes extraites du roman, par cette évanescente beauté apparue dans la torpeur d'un salon mondain, exprimé par ce style qui prend son temps, tout en évoquant beaucoup, qu'il imagine seulement l'effet que peuvent avoir quelques trois cent pages de ce niveau, de cette sidération permanente, de, osons l'affirmer, ce chef d'oeuvre absolu d'une densité rare, d'une tension permanente dans son apparente ataraxie, un roman où les réflexions les plus fondamentales sur le pouvoir, sur la beauté, sur la politique, sur le temps qui passe, sur les rapports entre hommes et femmes, sur les buts mêmes d'une existence, sur la mort, peuvent surgir d'une simple et champêtre scène de chasse, de quelques instants de songerie dans le creux d'un canapé, d'une discussion à bâtons rompus avec un émissaire de la jeune Monarchie Constitutionnelle, etc.
Les grands textes contant la fin d'une époque, la fin d'un monde, de tout un monde, ne sont pas si rares. Quelques-uns atteignent au génie - nous pensons plus précisément à ce roman incontournable de la "Mittel Europa" naissante, "La Marche de Radetzky" du grand écrivain autrichien (mort en 1939 à Paris, presque oublié) Joseph Roth. Nous ne pouvons omettre "A la Recherche du temps perdu" de notre illustre Marcel Proust dont certaines thématiques ne sont évidemment pas sans rappeler celles présentes dans le Guépard, même s'il faut reconnaître que cette correspondance sera encore plus approfondie dans ce chef d'oeuvre du cinéma mondial que Visconti fit quelques années plus tard du roman -. Celui de Lampedusa est incontestablement de ces immenses textes-là, à moins de s'arrêter à cette trompeuse apparence d'un livre axé sur la seule décadence d'un monde - l'aristocratie dans la Sicile du Roi François II- déjà en perdition depuis des années, en Italie comme presque partout ailleurs dans l'Europe de la seconde moitié du XIXème siècle. C'est aussi un livre qui s'amuse - avec mordant et une certaine lucidité rogue - de l'émergence du monde nouveau bientôt seul à l'oeuvre. Pour mieux répéter le passé, ainsi que le prévoit et le prédit le jeune Tancrède, dans une formulation demeurée célèbre, et qui donne l'une des clés possibles - certainement pas la seule - à ce roman allégorique : « Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change». N'est-ce pas ce que les supposées alternances politiques nous promettent régulièrement ? Ce à quoi elles aboutissent invariablement...?
On aurait pu s'arrêter sur quelques autres personnages, tel ce prêtre, le fidèle Père Pirrone, dont le nom est celui d'un curé ayant réellement existé et qui fut le chapelain de l'arrière grand-père dont l'auteur s'est assez largement inspiré - même s'il estimait qu'il l'avait rendu plus intelligent que ne l'avait jamais été le véridique aïeul ! -, ou encore ce compagnon de chasse - presque devenu un ami, malgré la différence de classe et de condition -, organiste de l'église du village, homme secret un peu bourru mais dont le sens de l'honneur, sans faille tout autant que vain, semble appartenir à un monde encore plus ancien que celui de Don Fabrizio. Il y a aussi ce chien un peu fou qui, dans les dernières pages du roman, va représenter une espèce de parabole aux ultimes dérisoires instants de ce monde définitivement mort.
Tout est là, dans ce récit au mille stratagèmes narratifs - comment expliquer sinon que l'on croit, par exemple, d'autant plus à l'assurance du mariage éclatant des deux amants, Tancredi et Angelica, qu'à aucun moment l'auteur ne nous y fera assister ? Que les rumeurs de la révolution suffisent amplement à nous en donner toute l'importance, quand bien même il eût été aisé d'en faire quelque description bien sentie - et l'art de Lampédusa eut certainement su décrire un tel type de "vérité" -, mieux, que c'est parce que nous n'assistons à aucune de ces péripéties militaires, autrement que par le biais de conversations, de détails postérieurs à leur effectivité, des souvenirs, que nous sommes subjugués par la force de leurs conséquences ? Est-il vraiment indispensable d'ajouter que l'oeuvre tient, pour une part, de Stendhal (principalement de la Chartreuse de Parme) dont l'auteur était un excellent connaisseur, pour une autre part du roman "vériste" Les Princes de Francalanza de de Roberto pour la description de la ruine de l'aristocratie sicilienne ? C'est indubitablement exact, et ne saurait pourtant expliquer qu'une fraction du génie tant inspiré de cette oeuvre si profonde, si personnelle, où l'on devine aisément que, derrière ce Prince de la fin du XIXème siècle, c'est incidemment le Prince écrivain lui-même qui peut se lire en creux dans le portrait de cet homme Ô ! combien solitaire (malgré son entourage) et désabusé.
Mais toutes les explications consacrées à un texte qui n'en finit pas d'être pressé, déconstruit, analysé par ses innombrables exégètes ne peuvent parfaitement rendre compte de la magie - de la pure magie - du style de Lampedusa (et le lecteur français lambda ne dispose pourtant "que" de la magistrale traduction de Jean-Paul Maganaro dont le travail, probablement héroïque, homérique même, est à porter au zénith de la traduction littéraire), un style intensément baroque, imperceptiblement allusif, pratiquant un art de la métaphore à des niveaux rarement atteints, sachant manier un verbe que l'on pourrait qualifier d'aristocratique si le terme n'était aussi galvaudé voire honni, jouant sans cesse de l'allusion et de l'hyperbole, travaillant les mots comme un véritable orfèvre de la langue, n'hésitant pas à essouffler le lecteur de ses phrases parfois interminables (et d'un lyrisme souvent étrange, arythmique), pour mieux le laisser exsangue sur une réflexion emportant tout sur son passage, un instantané de pure grâce, un moment captivant où espace et temps semblent demeurer suspendus dans l'imagination en fusion de qui les reçoit. Une langue belle, belle et inquiétante comme on peut le ressentir de l'observation de l'oiseau de proie en suspension au dessus de sa future proie. Un roman monde, un roman intemporel mais d'une temporalité romanesque construite - et déconstruite à la fois - avec la sapience d'un grand architecte, un roman fusion, qui nous en dit autant de ce que nous sommes que de ce que peut être le monde alentour, par-delà les différences temporelles, sociales et géographiques... Un roman hommage, enfin, à cette terre revêche, jaunie par le soleil, asséchée par le souvenir des embruns, dure sans nulle doute, sauvage certainement, difficilement compréhe
Il y a 63 ans, le 23 juillet 1957, Giuseppe Tomasi di Lampedusa décédait à l'hôpital sans être parvenu à convaincre deux éditeurs de publier son unique roman qui se verra attribuer, un an après, à titre posthume, le Prix Strega.
C'est donc avec beaucoup d'attention que je rédige ces quelques modestes lignes eu égard à ce chef d'oeuvre de la littérature italienne et à tous ses acteurs qui ne sont plus et qui nous ont précédés.
« Nous fûmes les guépards, les lions ; ceux qui nous remplaceront seront les chacals et les hyènes ».
C'est en ces termes que s'exprime Don Fabrizio, totalement désabusé, devant les inévitables changements sociétaux qui se préparent, engendrés par la période du Risorgimento.
C'est avec tristesse que j'ai refermé ce livre écrit par Giuseppe Tomasi di Lampedusa qui s'est inspiré de la vie de son arrière grand-père, Giulio Fabrizio di Lampedusa, tout en lui prêtant ses propres réflexions. L'écriture classique est très raffinée, on sent l'homme lettré, cultivé. Il y a de très belles pages, notamment un fragment sur le chien Bendico (mon côté SPA ou BB). Personnellement, j'ai ressenti qu'une émotion se dégageait de l'écriture de l'auteur. Elle se diffuse tout au long de la lecture. L'auteur a dû certainement beaucoup admirer ou idéaliser son aïeul, c'est ce qui émane de la lecture. Giuseppe a toujours rêvé d'écrire sur la vie de son arrière grand-père avec, pour toile de fond, cette période extrêmement féconde en bouleversements qu'est le Risorgimento et pour l'aristocratie italienne, une forme de banalisation de leur position, avant de parvenir à l'unification de l'Italie contemporaine.
Le récit débute avec le débarquement, en mai 1860, de Garibaldi à Marsala afin de conquérir la Sicile pour la rattacher au Royaume de Piémont-Sardaigne. L'unification de l'Italie progresse sous l'autorité du Roi Victor-Emmanuel de Savoie. L'ombre de la Révolution française plane encore au-dessus des têtes de l'aristocratie italienne. Mais Don Fabrizio tente de se préserver de cet avenir incertain, en se passionnant pour les mathématiques, l'astronomie ; les étoiles lui parlent, il se sent apaisée sous la voûte étoilée comme il apprécie la chasse en compagnie de l'organiste, Ciccio Tumeo et des chiens.
Mais l'Histoire bouscule les indécis sur son passage. Et le désordre s'incarne en la personne de son neveu, noble désargenté mais très ambitieux, audacieux, Tancredi Falconeri dont il est le tuteur légal. Ce dernier s'est engagé dans les troupes garibaldiennes afin d'être au plus près des évènements. Il justifie sa décision par cette phrase marquante du récit :
« Si nous ne sommes pas là nous non plus, ils vont nous arranger une république. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Est-ce clair ? ».
Tancredi préserve son intérêt personnel avant tout. C'est toujours dans cette optique qu'il épouse la très belle Angelica, fille du maire Calogero Sedara, lui-même en pleine ascension sociale, richissime, symbole de la nouvelle classe sociale émergeante « les nouveaux riches ». Bien que les conventions, l'éducation, la culture soient à mille lieues des codes de la noblesse, qu'importe, tout s'apprend même si le côté parvenu incommode parfois.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa dépeint avec réalisme, l'atmosphère de ces magnifiques palais siciliens. On imagine aisément ce prince au port altier, grand, dépassant d'une tête tout son entourage, coléreux aussi, pouvant parfois effleurer de sa tête les lustres placés chez le commun des mortels, se promenant dans le palais de Donnafugata chargé du passé de cette illustre famille. La tête se lève, le regard scrute le plafond vers les fresques qui représentent les divinités, cet Olympe d'où « descend » la famille Salina et dont l'emblème est le Guépard.
On croit entendre le frottement des robes de soie des jeunes femmes qui se déplacent et remettent les plis de leur robe en place.
C'est la Sicile, écrasée sous le soleil, qui luit sous nos yeux avec son tempérament insulaire, sculpté par les invasions successives auxquelles elle a dû faire face mais c'est aussi la misère dans les rues, derrière les murs lépreux où s'entassent des mères en deuil, inquiète pour la santé de leurs enfants tant l'insalubrité est présente et des animaux faméliques qui cherchent la nourriture dans les détritus qui jonchent les rues.
Et pourtant, ce Prince, je l'ai compris, je m'y suis attachée, j'ai éprouvé ses regrets, ses tourments, lui qui voit, pressent, son monde s'écrouler sous ses yeux, le déclin de celui-ci entraînant la fin de certaines valeurs, d'une façon de vivre voire d'un art de vivre. Cet avenir inconnu que réserve-t-il à cette noblesse ? Toujours cette Révolution française qui plane dans l'atmosphère.
Don Fabrizio partage avec nous, ses méditations sur la mort, son désenchantement. « La mort d'un monde donne la vie à un autre ». Il lui faut accepter la perte de ses repères et son cortège d'angoisses, le temps que d'autres références deviennent habitude, une manière de lâcher-prise. le dernier chapitre sur les reliques du temps passé comme la symbolique du geste accompli par Concetta, la fille de Don Fabrizio, est poignant et cruel.
Roman sur le temps qui passe, l'auteur nous offre une fresque remplie de nostalgie. Giuseppe Tomasi devient un auteur de la mémoire. Il se range au côté de Zweig, Maraï, Roth pour nous offrir une image d'une époque révolue.
C'est donc ce futur qui défile sous nos yeux depuis 1860 jusqu'à 1910. le roman est construit sur plusieurs séquences et pour bien suivre l'Histoire de cette famille qui se confond avec l'Histoire de l'Italie, il est utile de tenir compte de la date de chaque chapitre pour mieux appréhender le contexte.
L'écriture est très agréable mais par moment, le sens des réflexions de Don Fabrizio me devenait abscons, je serais incapable d'expliquer ce que Don Fabrizio reproche aux siciliens.
Je terminerai par cet encart de Paris-Match : il a attendu la soixantaine pour le faire. Se savait-il malade ? Il est pris de frénésie en remplissant ses pages. Il les propose à de nombreux éditeurs qui tous refusent le manuscrit. Lorsque sa femme reçoit la lettre enthousiaste de Feltrinelli – l'éditeur qui révéla « le Docteur Jivago » - grâce à un lecteur – éditeur d'exception, Georgio Bassani, futur auteur du chef d'oeuvre, le Jardin des Finzi-Contini. Il repose depuis trois semaines au cimetière de Palerme près de son aïeul et héros.
Avoir Georgio Bassani comme protecteur, ce roman possédait déjà les atouts d'une destinée exceptionnelle et comme protectrice « michfred » ce qui lui prédit une longue vie parmi les lectrices et lecteurs.
C'est donc avec beaucoup d'attention que je rédige ces quelques modestes lignes eu égard à ce chef d'oeuvre de la littérature italienne et à tous ses acteurs qui ne sont plus et qui nous ont précédés.
« Nous fûmes les guépards, les lions ; ceux qui nous remplaceront seront les chacals et les hyènes ».
C'est en ces termes que s'exprime Don Fabrizio, totalement désabusé, devant les inévitables changements sociétaux qui se préparent, engendrés par la période du Risorgimento.
C'est avec tristesse que j'ai refermé ce livre écrit par Giuseppe Tomasi di Lampedusa qui s'est inspiré de la vie de son arrière grand-père, Giulio Fabrizio di Lampedusa, tout en lui prêtant ses propres réflexions. L'écriture classique est très raffinée, on sent l'homme lettré, cultivé. Il y a de très belles pages, notamment un fragment sur le chien Bendico (mon côté SPA ou BB). Personnellement, j'ai ressenti qu'une émotion se dégageait de l'écriture de l'auteur. Elle se diffuse tout au long de la lecture. L'auteur a dû certainement beaucoup admirer ou idéaliser son aïeul, c'est ce qui émane de la lecture. Giuseppe a toujours rêvé d'écrire sur la vie de son arrière grand-père avec, pour toile de fond, cette période extrêmement féconde en bouleversements qu'est le Risorgimento et pour l'aristocratie italienne, une forme de banalisation de leur position, avant de parvenir à l'unification de l'Italie contemporaine.
Le récit débute avec le débarquement, en mai 1860, de Garibaldi à Marsala afin de conquérir la Sicile pour la rattacher au Royaume de Piémont-Sardaigne. L'unification de l'Italie progresse sous l'autorité du Roi Victor-Emmanuel de Savoie. L'ombre de la Révolution française plane encore au-dessus des têtes de l'aristocratie italienne. Mais Don Fabrizio tente de se préserver de cet avenir incertain, en se passionnant pour les mathématiques, l'astronomie ; les étoiles lui parlent, il se sent apaisée sous la voûte étoilée comme il apprécie la chasse en compagnie de l'organiste, Ciccio Tumeo et des chiens.
Mais l'Histoire bouscule les indécis sur son passage. Et le désordre s'incarne en la personne de son neveu, noble désargenté mais très ambitieux, audacieux, Tancredi Falconeri dont il est le tuteur légal. Ce dernier s'est engagé dans les troupes garibaldiennes afin d'être au plus près des évènements. Il justifie sa décision par cette phrase marquante du récit :
« Si nous ne sommes pas là nous non plus, ils vont nous arranger une république. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Est-ce clair ? ».
Tancredi préserve son intérêt personnel avant tout. C'est toujours dans cette optique qu'il épouse la très belle Angelica, fille du maire Calogero Sedara, lui-même en pleine ascension sociale, richissime, symbole de la nouvelle classe sociale émergeante « les nouveaux riches ». Bien que les conventions, l'éducation, la culture soient à mille lieues des codes de la noblesse, qu'importe, tout s'apprend même si le côté parvenu incommode parfois.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa dépeint avec réalisme, l'atmosphère de ces magnifiques palais siciliens. On imagine aisément ce prince au port altier, grand, dépassant d'une tête tout son entourage, coléreux aussi, pouvant parfois effleurer de sa tête les lustres placés chez le commun des mortels, se promenant dans le palais de Donnafugata chargé du passé de cette illustre famille. La tête se lève, le regard scrute le plafond vers les fresques qui représentent les divinités, cet Olympe d'où « descend » la famille Salina et dont l'emblème est le Guépard.
On croit entendre le frottement des robes de soie des jeunes femmes qui se déplacent et remettent les plis de leur robe en place.
C'est la Sicile, écrasée sous le soleil, qui luit sous nos yeux avec son tempérament insulaire, sculpté par les invasions successives auxquelles elle a dû faire face mais c'est aussi la misère dans les rues, derrière les murs lépreux où s'entassent des mères en deuil, inquiète pour la santé de leurs enfants tant l'insalubrité est présente et des animaux faméliques qui cherchent la nourriture dans les détritus qui jonchent les rues.
Et pourtant, ce Prince, je l'ai compris, je m'y suis attachée, j'ai éprouvé ses regrets, ses tourments, lui qui voit, pressent, son monde s'écrouler sous ses yeux, le déclin de celui-ci entraînant la fin de certaines valeurs, d'une façon de vivre voire d'un art de vivre. Cet avenir inconnu que réserve-t-il à cette noblesse ? Toujours cette Révolution française qui plane dans l'atmosphère.
Don Fabrizio partage avec nous, ses méditations sur la mort, son désenchantement. « La mort d'un monde donne la vie à un autre ». Il lui faut accepter la perte de ses repères et son cortège d'angoisses, le temps que d'autres références deviennent habitude, une manière de lâcher-prise. le dernier chapitre sur les reliques du temps passé comme la symbolique du geste accompli par Concetta, la fille de Don Fabrizio, est poignant et cruel.
Roman sur le temps qui passe, l'auteur nous offre une fresque remplie de nostalgie. Giuseppe Tomasi devient un auteur de la mémoire. Il se range au côté de Zweig, Maraï, Roth pour nous offrir une image d'une époque révolue.
C'est donc ce futur qui défile sous nos yeux depuis 1860 jusqu'à 1910. le roman est construit sur plusieurs séquences et pour bien suivre l'Histoire de cette famille qui se confond avec l'Histoire de l'Italie, il est utile de tenir compte de la date de chaque chapitre pour mieux appréhender le contexte.
L'écriture est très agréable mais par moment, le sens des réflexions de Don Fabrizio me devenait abscons, je serais incapable d'expliquer ce que Don Fabrizio reproche aux siciliens.
Je terminerai par cet encart de Paris-Match : il a attendu la soixantaine pour le faire. Se savait-il malade ? Il est pris de frénésie en remplissant ses pages. Il les propose à de nombreux éditeurs qui tous refusent le manuscrit. Lorsque sa femme reçoit la lettre enthousiaste de Feltrinelli – l'éditeur qui révéla « le Docteur Jivago » - grâce à un lecteur – éditeur d'exception, Georgio Bassani, futur auteur du chef d'oeuvre, le Jardin des Finzi-Contini. Il repose depuis trois semaines au cimetière de Palerme près de son aïeul et héros.
Avoir Georgio Bassani comme protecteur, ce roman possédait déjà les atouts d'une destinée exceptionnelle et comme protectrice « michfred » ce qui lui prédit une longue vie parmi les lectrices et lecteurs.
Il n'est pas évident de rédiger un avis sur une oeuvre aussi riche que "Le Guépard", seul et unique roman d'un auteur pas tout à fait comme les autres ; d'abord parce que sicilien, ensuite parce que prince et qu'en Sicile, un Prince, c'est tout un monde.
Un monde en marche, en mutation ; un monde qui change vite et inexorablement, malmené par les coups de boutoir de Garibaldi et de ses soldats, bien déterminés à opérer l'unité de l'Italie jusque sur cette île à l'identité séculaire, ravagée par le soleil méditerranéen.
Nous sommes donc en Sicile et la narration débute en 1860, peu de temps avant le débarquement des garibaldiens à Marsala, pour s'achever en 1910. Roman politique, roman sociologique, "Le Guépard" prend tour à tour des accents romanesques, érotiques et romantiques. Écrit en 1956, on peut légitimement le qualifier de roman historique, voire de témoignage, Giuseppe Tomasi di Lampedusa s'étant librement inspiré de la vie de son grand-père pour créer le personnage principal, son fameux guépard, le prince Fabrizio Salina.
Tout d'abord moins accessible que je l'imaginais, ce récit, quoiqu'assez court, est d'une richesse si foisonnante que le lecteur met quelque temps à comprendre où l'auteur veut en venir avant de finalement lâcher prise, enivré par le spectacle de cette Sicile aristocratique et rurale superbement retranscrit, et de se laisser entraîner dans le tourbillon du temps où les nouveaux riches libéraux viennent inexorablement balayer sous la chaleur caniculaire les traditions d'un peuple perpétuellement assommé par le soleil vertical, l'antique patrimoine et la débilité congénitale siciliens.
Je ressors de cette lecture presque aussi fascinée qu'épuisée ; l'histoire de l'unité italienne était une des lacunes de ma culture historique, elle est désormais en partie comblée. Je garderai sans doute longtemps en mémoire la galerie de portraits à la psychologie finement travaillée qui rend ce roman si fulgurant et néanmoins si attachant.
Challenge ABC 2014 - 2015
Un monde en marche, en mutation ; un monde qui change vite et inexorablement, malmené par les coups de boutoir de Garibaldi et de ses soldats, bien déterminés à opérer l'unité de l'Italie jusque sur cette île à l'identité séculaire, ravagée par le soleil méditerranéen.
Nous sommes donc en Sicile et la narration débute en 1860, peu de temps avant le débarquement des garibaldiens à Marsala, pour s'achever en 1910. Roman politique, roman sociologique, "Le Guépard" prend tour à tour des accents romanesques, érotiques et romantiques. Écrit en 1956, on peut légitimement le qualifier de roman historique, voire de témoignage, Giuseppe Tomasi di Lampedusa s'étant librement inspiré de la vie de son grand-père pour créer le personnage principal, son fameux guépard, le prince Fabrizio Salina.
Tout d'abord moins accessible que je l'imaginais, ce récit, quoiqu'assez court, est d'une richesse si foisonnante que le lecteur met quelque temps à comprendre où l'auteur veut en venir avant de finalement lâcher prise, enivré par le spectacle de cette Sicile aristocratique et rurale superbement retranscrit, et de se laisser entraîner dans le tourbillon du temps où les nouveaux riches libéraux viennent inexorablement balayer sous la chaleur caniculaire les traditions d'un peuple perpétuellement assommé par le soleil vertical, l'antique patrimoine et la débilité congénitale siciliens.
Je ressors de cette lecture presque aussi fascinée qu'épuisée ; l'histoire de l'unité italienne était une des lacunes de ma culture historique, elle est désormais en partie comblée. Je garderai sans doute longtemps en mémoire la galerie de portraits à la psychologie finement travaillée qui rend ce roman si fulgurant et néanmoins si attachant.
Challenge ABC 2014 - 2015
Tandis que le prince de Salina se meurt,dans une chambre, à Palerme, on jette par la fenêtre de sa villa de Donnafugata ses chiens de chasse empaillés et mangés aux mites. Ils volent un court instant dans le ciel impitoyablement bleu de Sicile...Image saisissante et emblématique.
Le Guépard raconte la disparition d' un monde aristocratique, plein de songes d'honneur et de rêves de gloire, mais douloureusement impuissant, assigné à une oisiveté distinguée et mélancolique, face aux forces montantes de la bourgeoisie.
Place aux arrivistes! Place au beau Tancrède, le neveu de Salina - d'abord garibaldien, pour le panache, et surtout pour l'opportunité du pouvoir à cueillir au bout du fusil dans les heures troubles de la révolution, mais qui très vite tournera casaque et troquera sa chemise rouge pour un habit plus convenable..Il a très vite compris que pour durer et peser, il faut intriguer, courtiser, composer...et épouser!
Place aux nouveaux riches: au maire, un paysan madré, et à Angélica, sa ravissante fille, aussi pulpeuse qu'une orange sicilienne, mais inculte, sauvage, sans passé, toute pleine d'un grand appétit de vivre. Elle est riche, belle, jeune: Tancrède n'en demande pas plus. Elle fera le lien entre la vieille famille aristocratique déclinante dont il est le dernier rejeton et la souche populaire et vivace des paysans dont elle est issue.
Derrière eux, tout autour, frémit et brûle la Sicile, écrasée de chaleur, ceinte par le bleu intense de la mer qui l'isole du monde et la rattache aux légendes grecques.
La famille Salina, y a ses rituels- la chasse, les bals, les fêtes votives, les moissons- , ses palais, ses résidences d'été et d'hiver, et pour le Prince, l'humble maison de sa maîtresse palermitaine.
Depuis toujours. Mais pas pour toujours: l'Histoire brusquement fait irruption dans ce temps arrêté, fait basculer ce monde mythique et ritualisé dans un temps historique qui va tout balayer, bousculer, chambouler.
Ce qui rend ce livre majeur si fort, si puissant - je ne peux lire l'épisode des chiens empaillés sans avoir la gorge serrée, c'est une des pages les plus bouleversantes que je connaisse- c'est bien cet emballement de l'histoire face à la lenteur résignée du déclin et à l'approche inéluctable de la mort.
Écrit dans une langue magnifique- trop difficile, hélas, pour l'apprécier en V.O.-- Le Guépard est un livre qui se lit et se relit avec la même délectation, et auquel Visconti a su donner une impérissable adaptation, d'une parfaite fidélité : lente, superbe, hypnotique, comme les vibrations de l'air brûlant au-dessus des champs de blé siciliens..
Le Guépard raconte la disparition d' un monde aristocratique, plein de songes d'honneur et de rêves de gloire, mais douloureusement impuissant, assigné à une oisiveté distinguée et mélancolique, face aux forces montantes de la bourgeoisie.
Place aux arrivistes! Place au beau Tancrède, le neveu de Salina - d'abord garibaldien, pour le panache, et surtout pour l'opportunité du pouvoir à cueillir au bout du fusil dans les heures troubles de la révolution, mais qui très vite tournera casaque et troquera sa chemise rouge pour un habit plus convenable..Il a très vite compris que pour durer et peser, il faut intriguer, courtiser, composer...et épouser!
Place aux nouveaux riches: au maire, un paysan madré, et à Angélica, sa ravissante fille, aussi pulpeuse qu'une orange sicilienne, mais inculte, sauvage, sans passé, toute pleine d'un grand appétit de vivre. Elle est riche, belle, jeune: Tancrède n'en demande pas plus. Elle fera le lien entre la vieille famille aristocratique déclinante dont il est le dernier rejeton et la souche populaire et vivace des paysans dont elle est issue.
Derrière eux, tout autour, frémit et brûle la Sicile, écrasée de chaleur, ceinte par le bleu intense de la mer qui l'isole du monde et la rattache aux légendes grecques.
La famille Salina, y a ses rituels- la chasse, les bals, les fêtes votives, les moissons- , ses palais, ses résidences d'été et d'hiver, et pour le Prince, l'humble maison de sa maîtresse palermitaine.
Depuis toujours. Mais pas pour toujours: l'Histoire brusquement fait irruption dans ce temps arrêté, fait basculer ce monde mythique et ritualisé dans un temps historique qui va tout balayer, bousculer, chambouler.
Ce qui rend ce livre majeur si fort, si puissant - je ne peux lire l'épisode des chiens empaillés sans avoir la gorge serrée, c'est une des pages les plus bouleversantes que je connaisse- c'est bien cet emballement de l'histoire face à la lenteur résignée du déclin et à l'approche inéluctable de la mort.
Écrit dans une langue magnifique- trop difficile, hélas, pour l'apprécier en V.O.-- Le Guépard est un livre qui se lit et se relit avec la même délectation, et auquel Visconti a su donner une impérissable adaptation, d'une parfaite fidélité : lente, superbe, hypnotique, comme les vibrations de l'air brûlant au-dessus des champs de blé siciliens..
critiques presse (2)
La finesse psychologique dans la description des âmes, mêlée à l’analyse historique, donne un roman d’une puissance évocatrice inégalable : on accède à un microcosme qui ouvre, pourtant, sur l’univers entier. Un roman parfait, simple, d’une économie remarquable. Un régal.
Lire la critique sur le site : LeJournaldeQuebec
C’est un livre qui raconte l’annexion de la Sicile par l’Italie en 1861 du point de vue d’un noble qui voit tout son univers bouleversé. C’est non seulement un roman historique instructif, mais aussi une réflexion psychologique et sociale lucide de la Sicile et de ses habitants, qui ont toujours été conquis par d’autres peuples. Très solide.
Lire la critique sur le site : LeJournaldeQuebec
Citations et extraits (229)
Voir plus
Ajouter une citation
La salle de bal était toute d'or : lisse sur les corniches, tarabiscoté aux chambranles, damasquiné clair presque argenté sur des teintes moins claires sur les portes et sur les volets qui fermaient les fenêtres et les annulaient conférant ainsi au décor une orgueilleuse signification d'écrin qui excluait toute référence à l'extérieur indigne. Ce n'était pas la dorure voyante qu'étalent aujourd'hui les décorateurs, mais un or usé, aussi pâle que les cheveux de certaines fillettes du Nord, s'attachant à cacher sa valeur sous une pudeur désormais perdue de matière précieuse pour montrer sa beauté et faire oublier son prix ; çà et là sur les panneaux des nœuds de fleurs rococo d'une couleur si passée qu'elle ne semblait qu'une rougeur éphémère due aux reflets des lustres.
Cette tonalité solaire, la jaspure de scintillements et d'ombres firent cependant souffrir le cœur de Don Fabrizio qui se tenait noir et raide dans l'embrasure d'une porte : dans ce salon éminemment patricien des images champêtres lui venaient à l'esprit : le timbre chromatique était celui des emblavures à perte de vue autour de Donnafugata, extatiques, implorant la clémence sous la tyrannie du soleil : dans ce salon, comme dans les fiefs à la mi-Août, la récolte s'était achevée depuis longtemps, avait été emmagasinée ailleurs et, comme là, il n'en restait que le souvenir dans la couleur des chaumes ; brûlées d'ailleurs et inutiles. La valse dont les notes traversaient l'air chaud ne lui semblaient qu'une stylisation du passage incessant des vents qui font des arpèges de leur deuil sur les surfaces assoiffées, hier, aujourd'hui, demain, toujours, toujours, toujours. La foule des danseurs parmi lesquels il comptait tant de ses proches par la chair sinon par le cœur finit par lui sembler irréelle, composée de cette matière dont sont tissés les souvenirs périssables, encore plus éphémère que celle qui nous trouble dans les rêves. Au plafond les Dieux, penchés sur leurs sièges dorés, regardaient en bas, souriants et inexorables comme le ciel d'été. Ils se croyaient éternels : une bombe fabriquée à Pittsburgh, Penn., leur prouverait le contraire en 1943.
«C'est beau, Prince, c'est beau ! Des choses comme ça on n'en fait plus désormais; au prix actuel de l'or pur !» Sedàra s'était placé près de lui, ses petits yeux vifs parcouraient le décor, insensible à la grâce, attentif à la valeur monétaire.
Don Fabrizio sentit soudainement qu'il le haïssait ; c'était à son affirmation personnelle, à celle de cent autres qui lui ressemblaient, à leurs obscures intrigues, à leur avarice et à leur avidité tenaces que l'on devait le sentiment de mort qui assombrissait maintenant ces palais ; c'est à lui, à ses compères, à leurs rancœurs, à leur sentiment d'infériorité, à leur échec à s'épanouir que l'on devait le fait que lui aussi maintenant, Don Fabrizio, voyait dans les habits noirs des danseurs des corneilles qui planaient, à la recherche de proies corrompues, au-dessus des vallons perdus. Il eut envie de lui répondre méchamment, de l'inviter à s'en aller hors de sa vue. Mais ce n'était pas possible : c'était un hôte, le père de la chère Angelica. C'était peut-être un malheureux comme les autres.
«C'est beau, don Calogero, c'est beau. Mais ce qui dépasse tout ce sont nos deux enfants.»
Cette tonalité solaire, la jaspure de scintillements et d'ombres firent cependant souffrir le cœur de Don Fabrizio qui se tenait noir et raide dans l'embrasure d'une porte : dans ce salon éminemment patricien des images champêtres lui venaient à l'esprit : le timbre chromatique était celui des emblavures à perte de vue autour de Donnafugata, extatiques, implorant la clémence sous la tyrannie du soleil : dans ce salon, comme dans les fiefs à la mi-Août, la récolte s'était achevée depuis longtemps, avait été emmagasinée ailleurs et, comme là, il n'en restait que le souvenir dans la couleur des chaumes ; brûlées d'ailleurs et inutiles. La valse dont les notes traversaient l'air chaud ne lui semblaient qu'une stylisation du passage incessant des vents qui font des arpèges de leur deuil sur les surfaces assoiffées, hier, aujourd'hui, demain, toujours, toujours, toujours. La foule des danseurs parmi lesquels il comptait tant de ses proches par la chair sinon par le cœur finit par lui sembler irréelle, composée de cette matière dont sont tissés les souvenirs périssables, encore plus éphémère que celle qui nous trouble dans les rêves. Au plafond les Dieux, penchés sur leurs sièges dorés, regardaient en bas, souriants et inexorables comme le ciel d'été. Ils se croyaient éternels : une bombe fabriquée à Pittsburgh, Penn., leur prouverait le contraire en 1943.
«C'est beau, Prince, c'est beau ! Des choses comme ça on n'en fait plus désormais; au prix actuel de l'or pur !» Sedàra s'était placé près de lui, ses petits yeux vifs parcouraient le décor, insensible à la grâce, attentif à la valeur monétaire.
Don Fabrizio sentit soudainement qu'il le haïssait ; c'était à son affirmation personnelle, à celle de cent autres qui lui ressemblaient, à leurs obscures intrigues, à leur avarice et à leur avidité tenaces que l'on devait le sentiment de mort qui assombrissait maintenant ces palais ; c'est à lui, à ses compères, à leurs rancœurs, à leur sentiment d'infériorité, à leur échec à s'épanouir que l'on devait le fait que lui aussi maintenant, Don Fabrizio, voyait dans les habits noirs des danseurs des corneilles qui planaient, à la recherche de proies corrompues, au-dessus des vallons perdus. Il eut envie de lui répondre méchamment, de l'inviter à s'en aller hors de sa vue. Mais ce n'était pas possible : c'était un hôte, le père de la chère Angelica. C'était peut-être un malheureux comme les autres.
«C'est beau, don Calogero, c'est beau. Mais ce qui dépasse tout ce sont nos deux enfants.»
Fabrice Salina et l'astronomie :
p . 18 Dans une lignée qui, au cours des siècles, n'avait su faire ni l'addition de ses dépenses ni la soustraction de ses dettes, il était le premier ( et le dernier) à posséder de fortes et réelles dépositions mathématiques; il les avait appliquées à l'astronomie et en avait tiré bon nombre de succès publics ainsi que des joie privée savoureuses. L'orgueil et l'analyse mathématique s'étaient si étroitement unis en lui qu'il se flattait de voir les astres obéir à ses calculs; et de fait, il semblait en être ainsi. Il pensait de bonne foi qui les deux petites planètes qu'il avait découvertes (il les avait nommées Salina et Svelto, en hommage à son fief et en souvenir d'une braque inoubliable) propageaient la renommée de sa maison entre Mars et Jupiter, à travers les espaces stériles du firmament. Les fresques de la villa exprimaient à son avis une prophétie, bien plus que l'adulation d'une peintre courtisan.
p. 38 … l'astronomie, la morphine de Salina, était d'une espèce plus raffinée. Il chassa les image de Ragattisi perdue, d'Argivocale menacé et se plongea dans la lecture du plus récent numéro du Journal des Savants.
p. 46 Fabrice et le père Pirrone : Tous les deux, apaisés, se mirent à discuter d'un rapport qu'il fallait envoyer au plus tôt à un observatoire étranger, celui d'Arcetri. Soutenus et guidés par les nombres, invisibles à cette heure mais présent, les astres rayaient l'éther de leur exacte trajectoire. Fidèle aux rendez-vous, les comètes s'étaient habituées à se présenter ponctuellement, à une seconde près, devant qui les observait. Elles n'étaient pas messagères de catastrophes, comme Stella [l'épouse de Fabrice] le croyait : leur apparition était au contraire le triomphe de la raison humaine, qui se projetait dans les cieux et prenait part à leur sublime normalité. "Peu importe si en bas les Bendico [le chien de Fabrice] poursuivent des proies rustique, si le couteau du cuisinier triture la chair d'animaux innocents. A la hauteur de l'observatoire, les fanfaronnades de l'un, l'activité sanguinaire de l'autre se fondent en une tranquille harmonie. Le vrai problème est de continuer à vivre la vie de l'esprit, dans ses moments les plus sublimes, les plus semblables à la mort."
Ainsi raisonnait le Prince, oubliant ses perpétuelles lubies, ses caprices charnels de la veille.
p. 82 Les étoiles semblaient troubles, leur rayons avaient peine à traverser la couche de chaleur suffocante.
L'âme du Prince s'élança vers elles, les intouchables, les inabordables, celles qui donnent la joie, sans rien exiger en échange. Une fois de plus, il rêva du moment ou il pourrait enfin se trouver dans ces espaces glacés, pur intellect armé d'un carnet de calcules, : calculs bien difficiles, mais qui tomberaient toujours justes.
"Ce sont les seules qui soient pures, il n'est pas de personnes plus distinguées, pensa-t-il, en ce style mondain qui lui était habituel; qui aurait l'idée de se préoccuper de la dot des Pléiades, de la carrière politique de Sirius, des secrets d'alcôve de Véga?"
La journée avait été mauvaise, il le sentait mieux maintenant, non seulement à cette pression dans son estomac, mais aussi à ce qui lui disaient les étoiles. Au lieu de les voir former leurs signes habituels, il découvrait, chaque fois qu'il levait les yeux, un unique diagramme : deux étoiles en haut, les yeux ; une en dessous, la pointe du menton. C'était le schéma ironique, le visage triangulaire que son âme projetait dans les constellations, lorsqu'il était troublé. Le frac de don Calogero [un roturier enrichit], les amours de Concetta [elle pensait imminentes ses fiançailles à Tancrède - neveu de Fabrice Salina], l'emballement de Tancrède [pour Angélique fille de don Calogero], sa propre pusillanimité [devant les événement politique - chute de la couronne bourbonienne et avènement du roi piémontais Victor Emmanuel, roi d'une Italie unifiée], et jusqu'à la beauté menaçante d'Angélique; autant de complications, autant de petites pierres roulantes qui annoncent l'éboulement. Et ce Tancrède! Il avait raison, d'accord, et on l'aiderait, mais on ne pouvait nier qui' fut un tantinet ignoble. Au reste, Salina ne valait pas mieux que Tancrède. "Ça suffit, allons dormir."
Bendica, dans l'ombre, frottait sa grosse tête contre le genou de son maître.
Tu vois, Bendico, tu es un peu comme les étoiles, toi: une heureuse énigme, incapable d'engendrer l'angoisse.
Il souleva la tête du chien, presque invisible dans la nuit.
Mais avec tes yeux au niveau du nez et ton absence de menton, ta caboche peut évoquer des spectres mauvais dans le ciel.
p . 18 Dans une lignée qui, au cours des siècles, n'avait su faire ni l'addition de ses dépenses ni la soustraction de ses dettes, il était le premier ( et le dernier) à posséder de fortes et réelles dépositions mathématiques; il les avait appliquées à l'astronomie et en avait tiré bon nombre de succès publics ainsi que des joie privée savoureuses. L'orgueil et l'analyse mathématique s'étaient si étroitement unis en lui qu'il se flattait de voir les astres obéir à ses calculs; et de fait, il semblait en être ainsi. Il pensait de bonne foi qui les deux petites planètes qu'il avait découvertes (il les avait nommées Salina et Svelto, en hommage à son fief et en souvenir d'une braque inoubliable) propageaient la renommée de sa maison entre Mars et Jupiter, à travers les espaces stériles du firmament. Les fresques de la villa exprimaient à son avis une prophétie, bien plus que l'adulation d'une peintre courtisan.
p. 38 … l'astronomie, la morphine de Salina, était d'une espèce plus raffinée. Il chassa les image de Ragattisi perdue, d'Argivocale menacé et se plongea dans la lecture du plus récent numéro du Journal des Savants.
p. 46 Fabrice et le père Pirrone : Tous les deux, apaisés, se mirent à discuter d'un rapport qu'il fallait envoyer au plus tôt à un observatoire étranger, celui d'Arcetri. Soutenus et guidés par les nombres, invisibles à cette heure mais présent, les astres rayaient l'éther de leur exacte trajectoire. Fidèle aux rendez-vous, les comètes s'étaient habituées à se présenter ponctuellement, à une seconde près, devant qui les observait. Elles n'étaient pas messagères de catastrophes, comme Stella [l'épouse de Fabrice] le croyait : leur apparition était au contraire le triomphe de la raison humaine, qui se projetait dans les cieux et prenait part à leur sublime normalité. "Peu importe si en bas les Bendico [le chien de Fabrice] poursuivent des proies rustique, si le couteau du cuisinier triture la chair d'animaux innocents. A la hauteur de l'observatoire, les fanfaronnades de l'un, l'activité sanguinaire de l'autre se fondent en une tranquille harmonie. Le vrai problème est de continuer à vivre la vie de l'esprit, dans ses moments les plus sublimes, les plus semblables à la mort."
Ainsi raisonnait le Prince, oubliant ses perpétuelles lubies, ses caprices charnels de la veille.
p. 82 Les étoiles semblaient troubles, leur rayons avaient peine à traverser la couche de chaleur suffocante.
L'âme du Prince s'élança vers elles, les intouchables, les inabordables, celles qui donnent la joie, sans rien exiger en échange. Une fois de plus, il rêva du moment ou il pourrait enfin se trouver dans ces espaces glacés, pur intellect armé d'un carnet de calcules, : calculs bien difficiles, mais qui tomberaient toujours justes.
"Ce sont les seules qui soient pures, il n'est pas de personnes plus distinguées, pensa-t-il, en ce style mondain qui lui était habituel; qui aurait l'idée de se préoccuper de la dot des Pléiades, de la carrière politique de Sirius, des secrets d'alcôve de Véga?"
La journée avait été mauvaise, il le sentait mieux maintenant, non seulement à cette pression dans son estomac, mais aussi à ce qui lui disaient les étoiles. Au lieu de les voir former leurs signes habituels, il découvrait, chaque fois qu'il levait les yeux, un unique diagramme : deux étoiles en haut, les yeux ; une en dessous, la pointe du menton. C'était le schéma ironique, le visage triangulaire que son âme projetait dans les constellations, lorsqu'il était troublé. Le frac de don Calogero [un roturier enrichit], les amours de Concetta [elle pensait imminentes ses fiançailles à Tancrède - neveu de Fabrice Salina], l'emballement de Tancrède [pour Angélique fille de don Calogero], sa propre pusillanimité [devant les événement politique - chute de la couronne bourbonienne et avènement du roi piémontais Victor Emmanuel, roi d'une Italie unifiée], et jusqu'à la beauté menaçante d'Angélique; autant de complications, autant de petites pierres roulantes qui annoncent l'éboulement. Et ce Tancrède! Il avait raison, d'accord, et on l'aiderait, mais on ne pouvait nier qui' fut un tantinet ignoble. Au reste, Salina ne valait pas mieux que Tancrède. "Ça suffit, allons dormir."
Bendica, dans l'ombre, frottait sa grosse tête contre le genou de son maître.
Tu vois, Bendico, tu es un peu comme les étoiles, toi: une heureuse énigme, incapable d'engendrer l'angoisse.
Il souleva la tête du chien, presque invisible dans la nuit.
Mais avec tes yeux au niveau du nez et ton absence de menton, ta caboche peut évoquer des spectres mauvais dans le ciel.
Tous étaient tranquilles et contents. Tous, sauf Concetta. Elle avait bien sûr embrassé et serré dans ses bras Angelica, elle avait même refusé le "vous" que l'autre lui donnait et prétendu au "tu" de leur enfance, mais là, sous son corsage bleu pâle, son cœur était tenaillé ; en elle se réveillait le sang violent des Salina et sous son front lisse s'ourdissaient des rêves d'empoisonnement. Tancredi était assis entre elle et Angelica et avec la politesse pointilleuse de celui qui se sent en faute, il partageait équitablement regards, compliments et facéties entre ses deux voisines ; mais Concetta sentait, elle le sentait animalement, le courant de désir qui passait de son cousin vers l'intruse, et son petit air courroucé entre le front et le nez s'exacerbait ; elle désirait autant tuer qu'elle désirait mourir. Parce qu'elle était femme, elle se cramponnait aux détails ; elle remarquait la grâce vulgaire du petit doigt de la main droit d'Angelica levé vers le haut quand elle tenait son verre ; elle remarquait un grain de beauté rougeâtre sur la peau du cou, elle remarquait la tentative, retenue à moitié, d'enlever avec la main un petit morceau de nourriture resté entre les dents très blanches, elle remarquait encore plus vivement une certaine dureté d'esprit et elle s'accrochait à ces détails en réalité insignifiants parce qu'ils étaient réduits en fumée par le charme sensuel, confiante et désespérée comme un maçon qui tombe s'accroche à une gouttière de plomb ; elle espérait que Tancredi les remarquerait lui aussi et serait dégoûté devant ces traces évidentes de la différence d'éducation. Mais Tancredi les avait déjà remarqués et hélas ! sans aucune résultat.
Pages 9é/93
Pages 9é/93
Leurs contacts plus fréquents à la suite de l'accord nuptial firent naître chez Don Fabrizio une curieuse admiration pour les mérites de Sedàara. L'habitude finit par l'accoutumer aux joues mal rasées, à l'accent plébéien, aux vêtements farfelus et à l'odeur persistante de la sueur, et il eut ainsi tout loisir de se rendre compte de la rare intelligence de l'homme ; bien des problèmes qui semblaient insolubles au Prince étaient démêlés en moins de deux par don Calogero ; étant affranchi de certaines entraves que l'honnêteté, la décence et peut-être la bonne éducation imposent aux actions de beaucoup d'autres hommes, il avançait dans la forêt de la vie avec l'assurance d'un éléphant qui, déracinant les arbres et piétinant les tanières, progresse en ligne droite, sans prêter attention aux griffures des épines et aux gémissements des écrasés. Élevé, au contraire, dans des vallées amènes parcourues par des zéphyrs courtois des «S'il te plaît», «je te serais reconnaissant», «me ferais-tu la faveur», «tu as été très aimable», le Prince, maintenant, quand il parlait avec don Calogero se trouvait à découvert sur une lande balayée par des vents de sécheresse et, tout en continuant à préférer en son for intérieur les anfractuosités montagnes, il ne pouvait s'empêcher d'admirer l'impétuosité de ces courants d'air qui tiraient des chênes-lièges et des cèdres de Donnafugata des arpèges jamais entendus auparavant.
"C'est beau, don Calogero, c'est beau. Mais ce qui dépasse tout ce sont nos deux enfants." Angelica et Tancredi passaient en ce moment devant eux, la main droite gantée du jeune homme posée à la hauteur de la taille d'Angelica, les bras tendus et entrelacés, les yeux de chacun fixés dans ceux de l'autre. Le noir du frac, le rose de la robe, mêlés, formaient un étrange bijou. Ils offraient le plus pathétiques des spectacles, celui de deux très jeunes amoureux qui dansent ensemble, aveugles à leurs défauts respectifs, sourds aux avertissements du destin, dans l'illusion que tout le chemin de la vie sera aussi lisse que les dalles du salon, acteurs inconscients qu'un metteur en scène fait jouer dans les rôles de Roméo et Juliette en cachant la crypte et le poison, déjà prévus dans l’œuvre. Ni l'un ni l'autre n'était bon, chacun était plein de calculs, gros de visées secrètes ; mais ils étaient tous les deux aimables et émouvants tandis que leurs ambitions, peu limpides mais ingénues, étaient effacées par les mots de joyeuse tendresse qu'il lui murmurait à l'oreille, par le parfum de ses cheveux à elle, par l'étreinte réciproque de leurs corps destinés à mourir.
Les deux jeunes gens s'éloignaient, d'autres couples passaient, moins beaux, tout aussi émouvants, chacun plongé dans sa cécité passagère. Don Fabrizio sentit son cœur perdre sa dureté : son dégoût faisait place à la compassion pour ces êtres éphémères qui cherchaient à jouir du mince rayon de lumière qui leur avait été accordé entre les deux ténèbres, avant le berceau, après les dernières saccades.
Les deux jeunes gens s'éloignaient, d'autres couples passaient, moins beaux, tout aussi émouvants, chacun plongé dans sa cécité passagère. Don Fabrizio sentit son cœur perdre sa dureté : son dégoût faisait place à la compassion pour ces êtres éphémères qui cherchaient à jouir du mince rayon de lumière qui leur avait été accordé entre les deux ténèbres, avant le berceau, après les dernières saccades.
Videos de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (3)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Quel grand classique de la littérature est resté dans les tiroirs de son auteur qui jamais ne parvint à le faire éditer puisque c'est un an après sa mort qu'il fut enfin publié ?
« le Guépard » de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, c'est à lire en poche chez Points/Seuil.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Quel grand classique de la littérature est resté dans les tiroirs de son auteur qui jamais ne parvint à le faire éditer puisque c'est un an après sa mort qu'il fut enfin publié ?
« le Guépard » de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, c'est à lire en poche chez Points/Seuil.
Dans la catégorie :
Romans, contes, nouvellesVoir plus
>Littérature (Belles-lettres)>Littérature italienne, roumaine et rhéto-romane>Romans, contes, nouvelles (653)
autres livres classés : Sicile (Italie)Voir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (5)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le Guépard - Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Dans quelle région italienne se passe le récit ?
En Lombardie
En Sicile
En Toscane
10 questions
61 lecteurs ont répondu
Thème : Le Guépard de
Giuseppe Tomasi di LampedusaCréer un quiz sur ce livre61 lecteurs ont répondu