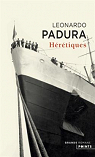étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Mémoires de prisonVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Armando Valladares qui a passé 22 années de sa vie dans les prisons, les camps de concentration et les camps de travaux forcés du régime Totalitaire Communiste Castriste à Cuba, commence ainsi son effroyable témoignage, publié en 1985 :
(Page 7) :
« A la mémoire de mes compagnons torturés et assassinés dans les prisons de Fidel Castro et aux milliers de prisonniers qui y agonisent actuellement ».
(Page 9) :
« L'homme est l'être merveilleux de la Nature. le torturer, le détruire, l'exterminer pour ses idées est plus qu'une violation des droits de l'homme ; c'est un crime contre l'Humanité ».
Dans la nuit du 28 décembre 1960, Armando Valladares fut donc arrêté arbitrairement par la Police Politique Castriste, un an seulement, après le coup d'État militaire perpétré par les frères Castro, Fidel et Raul, ainsi qu'Ernesto Guevara (surnommé le Che).
Armando Valladares introduit son témoignage en prévenant l'Humanité tout entière…, mais en vain… (page 11) :
« Dans mon pays, il y a quelque chose que les défenseurs les plus fervents de la révolution cubaine ne peuvent nier : c'est le fait d'une dictature qui existe depuis plus d'un quart de siècle. Or un dictateur ne peut se maintenir au pouvoir pendant autant de temps sans violer les Droits de l'Homme, sans persécutions, sans détenus politiques et sans prisons.
En ce moment, il y a à Cuba plus de deux cents établissements pénitentiaires, depuis les prisons de haute sécurité et les camps de concentration jusqu'à ce qu'on appelle là-bas les granges et les fronts « ouverts », où les prisonniers sont condamnés aux travaux forcés.
Dans chacune de ces deux cents prisons, il s'est passé et se passe assez de choses pour écrire de nombreux livres. Aussi le témoignage que voici est-il à peine une esquisse de leur terrible réalité.
Un jour viendra où l'on connaîtra leur histoire dans ses détails, et l'humanité sera frappée d'horreur comme elle le fut en découvrant les crimes de Staline. »
Armando Valladares fut arrêté, interrogé et emprisonné sur le simple fait de ne pas être Communiste. Dès lors, la population Cubaine allait subir les affres terribles de l'adhésion de Fidel Castro à l'Idéologie Marxiste-Léniniste du Communisme (Page 17) :
« Ce fut ainsi que les révolutionnaires qui gardaient envers et contre tout l'espoir de voir Fidel Castro mettre fin à l'emprise croissante des communistes se trouvèrent incapables d'admettre, tant que le gouvernement ne proclama pas ouvertement son attachement au marxisme, que les expropriations forcées, les confiscations de terres, les nationalisations, le transfert à l'État des moyens de production appartenant aux particuliers, les exécutions et les exhortations constantes à la haine ainsi que la glorification de la lutte des classes n'étaient, sans contredit possible, que des applications pratiques de la doctrine communiste. »
A Cuba, la Police Politique se nomme la Sûreté de l'État. Elle est l'équivalent de la Tcheka (futur N.K.V.D. puis K.G.B.) Soviétique. La Police Politique décida donc, une nuit, de perquisitionner le domicile d'Armando Valladares. Il fut ensuite conduit au siège de la Sûreté de L'État, le Complexe G-2 (toujours l'équivalent du siège de la Tcheka Soviétique : la Loubianka), 14 rue Cinquième Avenue dans le quartier de Miramar.
Interrogé dans la foulée de son arrestation, on l'accusa, sans aucun fondement, d'être : un « ennemi du peuple », « un contre-révolutionnaire » et, summum de l'infamie, d'avoir fait ses « études dans une école religieuse ». Il s'agit des classiques accusations des bourreaux de l'univers Totalitaire Communiste, leur permettant d'enfermer ou d'exécuter n'importe qui, sans raisons… !
Armando Valladares fut emmené à la Cabana, la prison principale pour prisonniers politiques de l'île (page 23) :
« Après la victoire de la révolution, elle était devenue une prison pour politiques, et les exécutions se succédaient dans ses fossés. Elle s'élève sur une colline de l'autre côté de la baie et est toutefois isolée, entourée de vastes terrains d'exercice et de polygones de tir : c'est là que se trouvait autrefois l'école d'artillerie. »
Dès lors, les horribles exécutions sommaires s'enchaînèrent (pages 25 et 26) :
« Un grand escalier descendait jusque dans le fossé. Là, à un mètre du mur, il y avait un poteau de bois où on l'a attaché. Avant, Julio avait serré la main à chacun des gardes qui composaient le peloton d'exécution en leur disant qu'il leur pardonnait.
– PELOTON, GARDE A VOUS ! EN JOUE… ! FEU !
– A BAS LE COMMU… !
Le cri de Julio Antonio Yebra s'interrompit à jamais. Il n'y avait pas eu de salve véritable, mais des coups de feu qui s'engrenaient en désordre. Puis une détonation sèche, celle du coup de grâce derrière l'oreille. Jamais je n'oublierai ce claquement isolé, mortel.
Dans la prison, le silence était pesant, dramatique. Nous avons ensuite écouté les chocs des marteaux qui clouaient le couvercle de l'humble cercueil en bois de pin. »
Parmi les innombrables suppliciés, de nombreux courageux criaient des slogans contre le régime Totalitaire Communiste, avant d'être fusillés. Désormais, pour les faire taire définitivement avant leur assassinat, les victimes furent bâillonnées avant les exécutions (pages 28, 30 et 31) :
« Dès 1963, les condamnés à mort descendirent bâillonnés au supplice. Nos geôliers avaient peur de ces cris. Ils ne pouvaient tolérer une dernière exclamation virile de la part de ceux qui allaient mourir. Ce geste de rébellion, de défi, dans un instant suprême, cette manifestation de courage et de détermination à l'instant qui précédait la mort pouvait être un mauvais exemple pour les soldats : un exemple qui les ferait réfléchir.
(…) Avec ces fusillades, la prison de la Cabana était devenue la plus terrible de toutes, et pour nous tenir sous la terreur, les gardes commencèrent à perquisitionner dès l'aube. Leurs pelotons, armés de gourdins, de chaînes, de baïonnettes et de tout ce qui pouvait servir à nous battre, faisaient irruption dans les galeras en criant et en frappant au hasard, sans ménagement.
(…) Chaque matin, la Cabana se réveillait en se posant la même question : « Qui vont-ils fusiller aujourd'hui ? ».
Puis Armando Valladares fut transféré ailleurs, comprenant qu'il risquait d'être fusillé n'importe quand (pages 32, 33 et 37) :
« Une petite pluie fine commença à tomber. Nous avons traversé les fossés, laissant la prison derrière nous. J'ai tourné la tête. J'ai vu pour la dernière fois la vieille muraille moisie et les grilles des galeries ; à ma gauche, c'était le fossé des exécutions : le madrier où l'on attachait les condamnés, et derrière lui, le mur garni de sacs de sable dont certains étaient troués par les balles qui traversaient les corps des fusillés. Au pied du poteau, parmi les taches de sang, des poules picoraient, peut-être, les restes de la cervelle d'un supplicié de la nuit. le Yankee qui commandait la garnison se faisait accompagner lors des exécutions par un chien qui léchait le sang des cadavres.
(…) le 21 janvier [1960] exactement, Castro devait déclarer :
– Les sbires que nous sommes en train de fusiller ne seront pas plus de quatre cents, mais beaucoup plus nombreux sont ceux qui sont déjà tombés face aux pelotons [d'exécution] pendant ces jours de barbarie et de mort.
Le 12 janvier, sur le champ de tir situé dans une petite vallée dite de San Juan, à l'extrémité de l'île, dans la province d'Oriente, des centaines de soldats de l'armée vaincue de Batista durent s'agenouiller dans une fosse de plus de cinquante mètres de long, les mains liées derrière le dos, avant d'y être abattus à la mitrailleuse. Puis on combla la fosse au bulldozer. Tout cela sans même un jugement. Beaucoup de ces soldats étaient des adolescents entrés dans l'armée pour des raisons économiques. Ce massacre fut ordonné par Raul Castro, qui y assista en personne. Et ce ne fut pas là un cas isolé. D'autres officiers des guérilleros de Castro fusillèrent en masse les ex-soldats de l'armée, sans jugement, sans qu'il existât contre eux la moindre charge, dans une série d'opérations de simples représailles contre les vaincus. »
Armando Valladares nous fait, encore et encore, vivre l'effroi du processus d'exécution qui le traumatisait chaque nuit, attendant l'insondable angoisse de la mort, à chaque instant, dans l'indifférence générale et l'anonymat (page 43) :
« Et nous frémissions à l'idée que ce peloton pourrait venir pour nous. Je me voyais les mains liées, bâillonné, conduit au fossé… Je descends ces marches, des projecteurs éclairent le poteau planté devant le mur de sacs de sable… des gardiens me poussent en avant, une corde me lie la taille au poteau… les fusils se lèvent et c'est un éclair, un bruit assourdissant retentit dans les fossés… Voilà ce qui pouvait m'arriver et je m'y attendais. Toutes les nuits, j'ai suivi ce chemin, je le voyais les yeux fermés, j'en connaissais par coeur le tracé, chaque marche, le poteau de bois…
Après le coup de grâce, il y avait toujours parmi nous quelqu'un pour sangloter. Nous entendions grincer la grille de l'entrée, et l'un de nous s'avançait jusqu'à la porte pour voir son ami et lui crier un ultime adieu. Nous ne pouvions plus nous rendormir.
Nulle part, il n'y avait un atome de respect pour les condamnés. Si l'homme qui marchait à la mort n'avançait pas à la vitesse exigée par les gardiens, ils le faisaient avancer à coups de crosse, ou ils le traînaient à terre comme un colis avant de le lier au poteau.
L'écho répercute dans les fossés le bruit des marteaux qui clouaient le cercueil de bois. On ne livre jamais le cadavre à ses proches pour qu'ils puissent le veiller et l'accompagner au cimetière. Un petit fourgon aux initiales de l'I.N.R.A. (Instituto nacional de reforma agraria) et où se trouvent déjà un membre de la Police politique et plusieurs soldats l'emporte jusqu'à l'une des fosses communes à l'intérieur d'une parcelle réservée à cet effet par le ministre de l'Intérieur dans le cimetière de Colon. Pas un indice, pas une pancarte, rien n'identifie le mort. Les membres de sa famille n'ont même pas le privilège de connaître l'endroit où l'on a enterré celui qu'ils chérissaient. »
La prison de la Cabana étant surchargée de prisonniers, Armando Valladares, avec des centaines d'autres prisonniers, fut transféré dans l'effroyable et gigantesque bagne de l'île des Pins (pages 53 et 57) :
« Nous avions tous entendu parler des horreurs du bagne qui était notre destination : travaux forcés dans les carrières, inspections dont le nom seul faisait frémir car chaque fois quelques prisonniers mouraient et des centaines d'autres en sortaient blessés à coups de baïonnette. Nous étions tous renseignés sur les quartiers spéciaux et les cellules où l'on enfermait quiconque osait protester contre les injustices et les abus de pouvoir dont il était victime, ou simplement parce qu'un geôlier prenait plaisir à voir un malheureux complètement nu, couché à même le sol dur et froid et à pouvoir refermer sur lui une porte que l'on soudait pour n'avoir plus à l'ouvrir. Ces malheureux passaient là plusieurs mois de suite, et leurs gardiens avaient l'habitude de les arroser quotidiennement d'eau glacée et d'excréments. Celui qui parvenait à garder le contrôle de son esprit et qui ne sortait pas de là diminué mentalement n'en était pas moins atteint à mort de tuberculose, les poumons détruits…
(…) A coups de baïonnette dans les fesses, les gardiens les obligeaient à augmenter sans cesse l'allure. Nous les avons vu s'éloigner. Déjà, le sang ruisselait le long de leurs cuisses, teignait de sombre leur pantalon. L'un d'eux trébucha, tomba. Les gardiens le piétinèrent de leurs lourdes bottes jusqu'à ce qu'il perdît connaissance dans une mare de sang. Ils l'enlevèrent de là en le traînant par les bras. Nous devions apprendre par la suite que c'était là une des distractions favorites de nos matons. Pour nous, sur le moment, ce spectacle avait quelque chose de dantesque. Nous n'imaginions pas encore que nous assisterions fréquemment, depuis nos cellules, à cette manière d'accueillir ceux qui débarquaient dans l'île. »
Régulièrement, des exécutions publiques étaient organisées en pleine ville (pages 83 et 84) :
« Si les condamnés à mort étaient fusillés dans des forteresses, des casernes ou d'autres lieux qui convenaient mieux à des exécutions capitales, seul un petit nombre de personnes était alors au courant ; les familles elles-mêmes, terrorisées, essayaient de dissimuler qu'on venait de fusiller l'un des leurs pour ne pas attirer sur elles encore plus de persécutions, de représailles et d'hostilités acharnées. L'objectif de la Police politique était de transformer chaque exécution en châtiment exemplaire. Il fallait donc que tous fussent au courant pour se convaincre qu'on fusillait tout opposant à la révolution. Ces exécutions publiques n'avaient qu'un objectif : répandre la terreur dans la population.
Dans le village choisi, on élevait dans le parc central [A Cuba, le parc central est la place principale, plantée d'arbres, de la localité. (N.d.T.)] un mur de sacs de sable et un poteau : on improvisait ainsi un paredon. On prévenait les organismes des masses. La Police politique, dont les membres étaient toujours en civil, se chargeait d'ameuter la foule. Ces hommes se répandaient par les rues, invitant tout le monde à assister à l'exécution publique d'un criminel : les comités de défense de la Révolution avaient pour mission d'amener sur place le plus grand nombre possible d'habitants, y compris les enfants. S'abstenir, c'était montrer qu'on était contre le gouvernement, et la police interprétait cette absence comme la preuve de la sympathie qu'on avait pour le condamné à mort. Ces foules s'assemblaient donc sur le lieu du supplice en criant : « Paredon ! Viva Fidel ! »
Beaucoup ne savaient même pas quel était le fusillé ni pourquoi il fallait le tuer. Ce fut le cas d'une femme du village de Santiago de las Vegas, proche de la Havane ; en arrivant au parc central, elle apprit avec horreur qu'elle réclamait la mort de son propre fils.
Le condamné était conduit au parc les mains attachées dans le dos. Un membre de la section régionale du parti prononçait un discours menaçant, dirigé contre tous. Il commençait par une apologie de la révolution et tonnait contre les ennemis du peuple, vendus à l'impérialisme yankee, en insistant sur le fait que la justice révolutionnaire serait implacable contre ceux qui trahiraient la classe ouvrière. Puis on procédait à l'exécution en présence de tous. »
Dans cette horrible prison de l'île des Pins, les conditions, d'un point de vue sanitaire, étaient innommables (pages 84 et 85) :
« Sans installation sanitaire dans les cellules et sans eau courante, nous devions utiliser nécessairement les services des étages ; les cuvettes des W.-C. s'y trouvaient encore, mais s'en servir était indescriptiblement répugnant. Les excréments en débordaient. Les portes ayant disparu elles aussi, rien ne les avait remplacées, aucun rideau n'isolait l'utilisateur ni ne le séparait, même partiellement, de la longue queue de ceux qui attendaient leur tour. Il fallait déféquer dans ces conditions, comme si l'on se trouvait en pleine rue, en plein midi. de plus, le fait de placer les pieds sur le rebord de la cuvette constituait à lui seul un grand danger pour l'intéressé : il lui arrivait sans cesse de glisser d'un pied et de se retrouver enfoncé jusqu'à mi-jambe dans un marécage d'excréments.
(…) A chaque débordement d'excréments, il fallait intervenir avec des pelles et des seaux. Dans toute société ou dans tout groupe humains, il y a toujours des hommes qui acceptent les tâches les plus désagréables. Ceux d'entre nous qui se chargeaient d'évacuer les excréments méritaient une admiration et une reconnaissance sans bornes. Mais que pouvaient-ils faire, sinon les déverser de tous les étages dans la cour intérieure, pour les entasser en un monticule de quatre à cinq mètres de diamètre, sur lequel pullulaient des millions de mouches ? D'en haut, on aurait cru que cette montagne se mouvait, couverte qu'elle était constamment par une carapace d'insectes. Quand on s'approchait, cet essaim se soulevait comme une nuée noire. La puanteur était insupportable et empestait toute la circulaire. Pour nous déplacer, nous recherchions le côté d'où soufflait le vent et où il y avait un peu d'air pur et respirable. le soir ou à l'heure des repas, si, au hasard d'une saute de vent, cette fétidité déferlait sur nous, il nous arrivait d'en vomir.
(…) le risque de maladies et d'épidémies était grand, et nous prenions toutes les mesures possibles contre leur propagation, spécialement à l'égard de l'hépatite virale que nous transmettaient les mouches. Nous gardions nos assiettes et nos couverts dans des sacs de plastique et nous nous efforcions de ne laisser à leur portée aucun récipient, aucun aliment. Même avec ces précautions, il y avait des épidémies, des morts à la suite de typhoïdes. Les cas de diarrhées, de vomissements et d'infections intestinales étaient fréquents et se succédaient sans arrêt ».
Très intelligemment, Armando Valladares analyse les modes de fonctionnement des gardiens vis-à-vis des prisonniers. Ces bourreaux devaient être à la fois, extrêmement conditionnés, et, devaient déshumaniser les prisonniers pour pouvoir s'autoriser à agir de manières aussi ignobles avec eux (page 86) :
« Les gardiens criaient comme toujours ; c'était chez eux un mécanisme grâce auquel ils s'enhardissaient, s'excitaient. Il n'est probablement pas simple, même pour des êtres totalement inhumains, de frapper d'autres hommes sans raison valable, sans motif. Ces gardiens étaient mariés, ils avaient des enfants. Certains vivaient dans des petites maisons situées à la sortie du pénitencier. Ils arrivaient sur place, sortant de la chaleur du foyer, engourdis encore de sommeil, et on leur distribuait des baïonnettes, des chaînes et des bâtons pour qu'ils attaquent des hommes avec qui ils n'avaient échangé ni un cri, ni une injure. Que ressentaient-ils donc quand ils voyaient les premiers prisonniers apparaître à la grille, pleins d'effroi, et quand ils devaient lever leur baïonnette et l'abattre sur eux ? Je pense que pour accomplir un tel acte, un être humain doit justifier ce qu'il fait, s'inventer une motivation intérieure, et quand il ne la trouve pas normalement, la rechercher dans une soûlerie de cris et d'insultes. Certes, il existe des criminels-nés, des individus chez qui frapper n'importe qui suscite un plaisir sadique. Après avoir passé la grille, les prisonniers poursuivaient leur course entre deux files de gardiens qui assénaient leurs coups au hasard. »
P.S. : Vous pouvez consulter ce commentaire, dans son intégralité, sur mon blog :
Lien : https://communismetotalitari..
(Page 7) :
« A la mémoire de mes compagnons torturés et assassinés dans les prisons de Fidel Castro et aux milliers de prisonniers qui y agonisent actuellement ».
(Page 9) :
« L'homme est l'être merveilleux de la Nature. le torturer, le détruire, l'exterminer pour ses idées est plus qu'une violation des droits de l'homme ; c'est un crime contre l'Humanité ».
Dans la nuit du 28 décembre 1960, Armando Valladares fut donc arrêté arbitrairement par la Police Politique Castriste, un an seulement, après le coup d'État militaire perpétré par les frères Castro, Fidel et Raul, ainsi qu'Ernesto Guevara (surnommé le Che).
Armando Valladares introduit son témoignage en prévenant l'Humanité tout entière…, mais en vain… (page 11) :
« Dans mon pays, il y a quelque chose que les défenseurs les plus fervents de la révolution cubaine ne peuvent nier : c'est le fait d'une dictature qui existe depuis plus d'un quart de siècle. Or un dictateur ne peut se maintenir au pouvoir pendant autant de temps sans violer les Droits de l'Homme, sans persécutions, sans détenus politiques et sans prisons.
En ce moment, il y a à Cuba plus de deux cents établissements pénitentiaires, depuis les prisons de haute sécurité et les camps de concentration jusqu'à ce qu'on appelle là-bas les granges et les fronts « ouverts », où les prisonniers sont condamnés aux travaux forcés.
Dans chacune de ces deux cents prisons, il s'est passé et se passe assez de choses pour écrire de nombreux livres. Aussi le témoignage que voici est-il à peine une esquisse de leur terrible réalité.
Un jour viendra où l'on connaîtra leur histoire dans ses détails, et l'humanité sera frappée d'horreur comme elle le fut en découvrant les crimes de Staline. »
Armando Valladares fut arrêté, interrogé et emprisonné sur le simple fait de ne pas être Communiste. Dès lors, la population Cubaine allait subir les affres terribles de l'adhésion de Fidel Castro à l'Idéologie Marxiste-Léniniste du Communisme (Page 17) :
« Ce fut ainsi que les révolutionnaires qui gardaient envers et contre tout l'espoir de voir Fidel Castro mettre fin à l'emprise croissante des communistes se trouvèrent incapables d'admettre, tant que le gouvernement ne proclama pas ouvertement son attachement au marxisme, que les expropriations forcées, les confiscations de terres, les nationalisations, le transfert à l'État des moyens de production appartenant aux particuliers, les exécutions et les exhortations constantes à la haine ainsi que la glorification de la lutte des classes n'étaient, sans contredit possible, que des applications pratiques de la doctrine communiste. »
A Cuba, la Police Politique se nomme la Sûreté de l'État. Elle est l'équivalent de la Tcheka (futur N.K.V.D. puis K.G.B.) Soviétique. La Police Politique décida donc, une nuit, de perquisitionner le domicile d'Armando Valladares. Il fut ensuite conduit au siège de la Sûreté de L'État, le Complexe G-2 (toujours l'équivalent du siège de la Tcheka Soviétique : la Loubianka), 14 rue Cinquième Avenue dans le quartier de Miramar.
Interrogé dans la foulée de son arrestation, on l'accusa, sans aucun fondement, d'être : un « ennemi du peuple », « un contre-révolutionnaire » et, summum de l'infamie, d'avoir fait ses « études dans une école religieuse ». Il s'agit des classiques accusations des bourreaux de l'univers Totalitaire Communiste, leur permettant d'enfermer ou d'exécuter n'importe qui, sans raisons… !
Armando Valladares fut emmené à la Cabana, la prison principale pour prisonniers politiques de l'île (page 23) :
« Après la victoire de la révolution, elle était devenue une prison pour politiques, et les exécutions se succédaient dans ses fossés. Elle s'élève sur une colline de l'autre côté de la baie et est toutefois isolée, entourée de vastes terrains d'exercice et de polygones de tir : c'est là que se trouvait autrefois l'école d'artillerie. »
Dès lors, les horribles exécutions sommaires s'enchaînèrent (pages 25 et 26) :
« Un grand escalier descendait jusque dans le fossé. Là, à un mètre du mur, il y avait un poteau de bois où on l'a attaché. Avant, Julio avait serré la main à chacun des gardes qui composaient le peloton d'exécution en leur disant qu'il leur pardonnait.
– PELOTON, GARDE A VOUS ! EN JOUE… ! FEU !
– A BAS LE COMMU… !
Le cri de Julio Antonio Yebra s'interrompit à jamais. Il n'y avait pas eu de salve véritable, mais des coups de feu qui s'engrenaient en désordre. Puis une détonation sèche, celle du coup de grâce derrière l'oreille. Jamais je n'oublierai ce claquement isolé, mortel.
Dans la prison, le silence était pesant, dramatique. Nous avons ensuite écouté les chocs des marteaux qui clouaient le couvercle de l'humble cercueil en bois de pin. »
Parmi les innombrables suppliciés, de nombreux courageux criaient des slogans contre le régime Totalitaire Communiste, avant d'être fusillés. Désormais, pour les faire taire définitivement avant leur assassinat, les victimes furent bâillonnées avant les exécutions (pages 28, 30 et 31) :
« Dès 1963, les condamnés à mort descendirent bâillonnés au supplice. Nos geôliers avaient peur de ces cris. Ils ne pouvaient tolérer une dernière exclamation virile de la part de ceux qui allaient mourir. Ce geste de rébellion, de défi, dans un instant suprême, cette manifestation de courage et de détermination à l'instant qui précédait la mort pouvait être un mauvais exemple pour les soldats : un exemple qui les ferait réfléchir.
(…) Avec ces fusillades, la prison de la Cabana était devenue la plus terrible de toutes, et pour nous tenir sous la terreur, les gardes commencèrent à perquisitionner dès l'aube. Leurs pelotons, armés de gourdins, de chaînes, de baïonnettes et de tout ce qui pouvait servir à nous battre, faisaient irruption dans les galeras en criant et en frappant au hasard, sans ménagement.
(…) Chaque matin, la Cabana se réveillait en se posant la même question : « Qui vont-ils fusiller aujourd'hui ? ».
Puis Armando Valladares fut transféré ailleurs, comprenant qu'il risquait d'être fusillé n'importe quand (pages 32, 33 et 37) :
« Une petite pluie fine commença à tomber. Nous avons traversé les fossés, laissant la prison derrière nous. J'ai tourné la tête. J'ai vu pour la dernière fois la vieille muraille moisie et les grilles des galeries ; à ma gauche, c'était le fossé des exécutions : le madrier où l'on attachait les condamnés, et derrière lui, le mur garni de sacs de sable dont certains étaient troués par les balles qui traversaient les corps des fusillés. Au pied du poteau, parmi les taches de sang, des poules picoraient, peut-être, les restes de la cervelle d'un supplicié de la nuit. le Yankee qui commandait la garnison se faisait accompagner lors des exécutions par un chien qui léchait le sang des cadavres.
(…) le 21 janvier [1960] exactement, Castro devait déclarer :
– Les sbires que nous sommes en train de fusiller ne seront pas plus de quatre cents, mais beaucoup plus nombreux sont ceux qui sont déjà tombés face aux pelotons [d'exécution] pendant ces jours de barbarie et de mort.
Le 12 janvier, sur le champ de tir situé dans une petite vallée dite de San Juan, à l'extrémité de l'île, dans la province d'Oriente, des centaines de soldats de l'armée vaincue de Batista durent s'agenouiller dans une fosse de plus de cinquante mètres de long, les mains liées derrière le dos, avant d'y être abattus à la mitrailleuse. Puis on combla la fosse au bulldozer. Tout cela sans même un jugement. Beaucoup de ces soldats étaient des adolescents entrés dans l'armée pour des raisons économiques. Ce massacre fut ordonné par Raul Castro, qui y assista en personne. Et ce ne fut pas là un cas isolé. D'autres officiers des guérilleros de Castro fusillèrent en masse les ex-soldats de l'armée, sans jugement, sans qu'il existât contre eux la moindre charge, dans une série d'opérations de simples représailles contre les vaincus. »
Armando Valladares nous fait, encore et encore, vivre l'effroi du processus d'exécution qui le traumatisait chaque nuit, attendant l'insondable angoisse de la mort, à chaque instant, dans l'indifférence générale et l'anonymat (page 43) :
« Et nous frémissions à l'idée que ce peloton pourrait venir pour nous. Je me voyais les mains liées, bâillonné, conduit au fossé… Je descends ces marches, des projecteurs éclairent le poteau planté devant le mur de sacs de sable… des gardiens me poussent en avant, une corde me lie la taille au poteau… les fusils se lèvent et c'est un éclair, un bruit assourdissant retentit dans les fossés… Voilà ce qui pouvait m'arriver et je m'y attendais. Toutes les nuits, j'ai suivi ce chemin, je le voyais les yeux fermés, j'en connaissais par coeur le tracé, chaque marche, le poteau de bois…
Après le coup de grâce, il y avait toujours parmi nous quelqu'un pour sangloter. Nous entendions grincer la grille de l'entrée, et l'un de nous s'avançait jusqu'à la porte pour voir son ami et lui crier un ultime adieu. Nous ne pouvions plus nous rendormir.
Nulle part, il n'y avait un atome de respect pour les condamnés. Si l'homme qui marchait à la mort n'avançait pas à la vitesse exigée par les gardiens, ils le faisaient avancer à coups de crosse, ou ils le traînaient à terre comme un colis avant de le lier au poteau.
L'écho répercute dans les fossés le bruit des marteaux qui clouaient le cercueil de bois. On ne livre jamais le cadavre à ses proches pour qu'ils puissent le veiller et l'accompagner au cimetière. Un petit fourgon aux initiales de l'I.N.R.A. (Instituto nacional de reforma agraria) et où se trouvent déjà un membre de la Police politique et plusieurs soldats l'emporte jusqu'à l'une des fosses communes à l'intérieur d'une parcelle réservée à cet effet par le ministre de l'Intérieur dans le cimetière de Colon. Pas un indice, pas une pancarte, rien n'identifie le mort. Les membres de sa famille n'ont même pas le privilège de connaître l'endroit où l'on a enterré celui qu'ils chérissaient. »
La prison de la Cabana étant surchargée de prisonniers, Armando Valladares, avec des centaines d'autres prisonniers, fut transféré dans l'effroyable et gigantesque bagne de l'île des Pins (pages 53 et 57) :
« Nous avions tous entendu parler des horreurs du bagne qui était notre destination : travaux forcés dans les carrières, inspections dont le nom seul faisait frémir car chaque fois quelques prisonniers mouraient et des centaines d'autres en sortaient blessés à coups de baïonnette. Nous étions tous renseignés sur les quartiers spéciaux et les cellules où l'on enfermait quiconque osait protester contre les injustices et les abus de pouvoir dont il était victime, ou simplement parce qu'un geôlier prenait plaisir à voir un malheureux complètement nu, couché à même le sol dur et froid et à pouvoir refermer sur lui une porte que l'on soudait pour n'avoir plus à l'ouvrir. Ces malheureux passaient là plusieurs mois de suite, et leurs gardiens avaient l'habitude de les arroser quotidiennement d'eau glacée et d'excréments. Celui qui parvenait à garder le contrôle de son esprit et qui ne sortait pas de là diminué mentalement n'en était pas moins atteint à mort de tuberculose, les poumons détruits…
(…) A coups de baïonnette dans les fesses, les gardiens les obligeaient à augmenter sans cesse l'allure. Nous les avons vu s'éloigner. Déjà, le sang ruisselait le long de leurs cuisses, teignait de sombre leur pantalon. L'un d'eux trébucha, tomba. Les gardiens le piétinèrent de leurs lourdes bottes jusqu'à ce qu'il perdît connaissance dans une mare de sang. Ils l'enlevèrent de là en le traînant par les bras. Nous devions apprendre par la suite que c'était là une des distractions favorites de nos matons. Pour nous, sur le moment, ce spectacle avait quelque chose de dantesque. Nous n'imaginions pas encore que nous assisterions fréquemment, depuis nos cellules, à cette manière d'accueillir ceux qui débarquaient dans l'île. »
Régulièrement, des exécutions publiques étaient organisées en pleine ville (pages 83 et 84) :
« Si les condamnés à mort étaient fusillés dans des forteresses, des casernes ou d'autres lieux qui convenaient mieux à des exécutions capitales, seul un petit nombre de personnes était alors au courant ; les familles elles-mêmes, terrorisées, essayaient de dissimuler qu'on venait de fusiller l'un des leurs pour ne pas attirer sur elles encore plus de persécutions, de représailles et d'hostilités acharnées. L'objectif de la Police politique était de transformer chaque exécution en châtiment exemplaire. Il fallait donc que tous fussent au courant pour se convaincre qu'on fusillait tout opposant à la révolution. Ces exécutions publiques n'avaient qu'un objectif : répandre la terreur dans la population.
Dans le village choisi, on élevait dans le parc central [A Cuba, le parc central est la place principale, plantée d'arbres, de la localité. (N.d.T.)] un mur de sacs de sable et un poteau : on improvisait ainsi un paredon. On prévenait les organismes des masses. La Police politique, dont les membres étaient toujours en civil, se chargeait d'ameuter la foule. Ces hommes se répandaient par les rues, invitant tout le monde à assister à l'exécution publique d'un criminel : les comités de défense de la Révolution avaient pour mission d'amener sur place le plus grand nombre possible d'habitants, y compris les enfants. S'abstenir, c'était montrer qu'on était contre le gouvernement, et la police interprétait cette absence comme la preuve de la sympathie qu'on avait pour le condamné à mort. Ces foules s'assemblaient donc sur le lieu du supplice en criant : « Paredon ! Viva Fidel ! »
Beaucoup ne savaient même pas quel était le fusillé ni pourquoi il fallait le tuer. Ce fut le cas d'une femme du village de Santiago de las Vegas, proche de la Havane ; en arrivant au parc central, elle apprit avec horreur qu'elle réclamait la mort de son propre fils.
Le condamné était conduit au parc les mains attachées dans le dos. Un membre de la section régionale du parti prononçait un discours menaçant, dirigé contre tous. Il commençait par une apologie de la révolution et tonnait contre les ennemis du peuple, vendus à l'impérialisme yankee, en insistant sur le fait que la justice révolutionnaire serait implacable contre ceux qui trahiraient la classe ouvrière. Puis on procédait à l'exécution en présence de tous. »
Dans cette horrible prison de l'île des Pins, les conditions, d'un point de vue sanitaire, étaient innommables (pages 84 et 85) :
« Sans installation sanitaire dans les cellules et sans eau courante, nous devions utiliser nécessairement les services des étages ; les cuvettes des W.-C. s'y trouvaient encore, mais s'en servir était indescriptiblement répugnant. Les excréments en débordaient. Les portes ayant disparu elles aussi, rien ne les avait remplacées, aucun rideau n'isolait l'utilisateur ni ne le séparait, même partiellement, de la longue queue de ceux qui attendaient leur tour. Il fallait déféquer dans ces conditions, comme si l'on se trouvait en pleine rue, en plein midi. de plus, le fait de placer les pieds sur le rebord de la cuvette constituait à lui seul un grand danger pour l'intéressé : il lui arrivait sans cesse de glisser d'un pied et de se retrouver enfoncé jusqu'à mi-jambe dans un marécage d'excréments.
(…) A chaque débordement d'excréments, il fallait intervenir avec des pelles et des seaux. Dans toute société ou dans tout groupe humains, il y a toujours des hommes qui acceptent les tâches les plus désagréables. Ceux d'entre nous qui se chargeaient d'évacuer les excréments méritaient une admiration et une reconnaissance sans bornes. Mais que pouvaient-ils faire, sinon les déverser de tous les étages dans la cour intérieure, pour les entasser en un monticule de quatre à cinq mètres de diamètre, sur lequel pullulaient des millions de mouches ? D'en haut, on aurait cru que cette montagne se mouvait, couverte qu'elle était constamment par une carapace d'insectes. Quand on s'approchait, cet essaim se soulevait comme une nuée noire. La puanteur était insupportable et empestait toute la circulaire. Pour nous déplacer, nous recherchions le côté d'où soufflait le vent et où il y avait un peu d'air pur et respirable. le soir ou à l'heure des repas, si, au hasard d'une saute de vent, cette fétidité déferlait sur nous, il nous arrivait d'en vomir.
(…) le risque de maladies et d'épidémies était grand, et nous prenions toutes les mesures possibles contre leur propagation, spécialement à l'égard de l'hépatite virale que nous transmettaient les mouches. Nous gardions nos assiettes et nos couverts dans des sacs de plastique et nous nous efforcions de ne laisser à leur portée aucun récipient, aucun aliment. Même avec ces précautions, il y avait des épidémies, des morts à la suite de typhoïdes. Les cas de diarrhées, de vomissements et d'infections intestinales étaient fréquents et se succédaient sans arrêt ».
Très intelligemment, Armando Valladares analyse les modes de fonctionnement des gardiens vis-à-vis des prisonniers. Ces bourreaux devaient être à la fois, extrêmement conditionnés, et, devaient déshumaniser les prisonniers pour pouvoir s'autoriser à agir de manières aussi ignobles avec eux (page 86) :
« Les gardiens criaient comme toujours ; c'était chez eux un mécanisme grâce auquel ils s'enhardissaient, s'excitaient. Il n'est probablement pas simple, même pour des êtres totalement inhumains, de frapper d'autres hommes sans raison valable, sans motif. Ces gardiens étaient mariés, ils avaient des enfants. Certains vivaient dans des petites maisons situées à la sortie du pénitencier. Ils arrivaient sur place, sortant de la chaleur du foyer, engourdis encore de sommeil, et on leur distribuait des baïonnettes, des chaînes et des bâtons pour qu'ils attaquent des hommes avec qui ils n'avaient échangé ni un cri, ni une injure. Que ressentaient-ils donc quand ils voyaient les premiers prisonniers apparaître à la grille, pleins d'effroi, et quand ils devaient lever leur baïonnette et l'abattre sur eux ? Je pense que pour accomplir un tel acte, un être humain doit justifier ce qu'il fait, s'inventer une motivation intérieure, et quand il ne la trouve pas normalement, la rechercher dans une soûlerie de cris et d'insultes. Certes, il existe des criminels-nés, des individus chez qui frapper n'importe qui suscite un plaisir sadique. Après avoir passé la grille, les prisonniers poursuivaient leur course entre deux files de gardiens qui assénaient leurs coups au hasard. »
P.S. : Vous pouvez consulter ce commentaire, dans son intégralité, sur mon blog :
Lien : https://communismetotalitari..
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Armando Valladares (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
QUIZ LIBRE (titres à compléter)
John Irving : "Liberté pour les ......................"
ours
buveurs d'eau
12 questions
287 lecteurs ont répondu
Thèmes :
roman
, littérature
, témoignageCréer un quiz sur ce livre287 lecteurs ont répondu