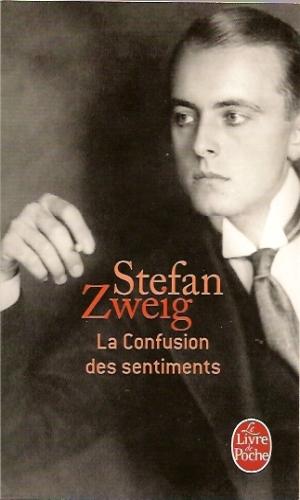>
Critique de Ocian
La confusion des sentiments, S. Zweig
Tout commence avec le récit débonnaire d'un retour sur
un passé de publications, au détour d'une compilation universitaire réalisée à l'adresse d'un enseignant sur le départ. Un professeur honoraire renoue avec ses articles, préfaces, opus égrenés au long d'une vie de littérature ; mise en lumière réalisée avec minutie par ses élèves, et qui ne manqua pas de lui arracher un souvenir ému. Mais il ne s'y retrouva pas.
Ces pages parlaient bien de lui – elles avaient été écrites de sa main quel que fût le procédé – pourtant il manquait une chose de l'indicible que lui seul connaissait et que Stendhal avait résumé en son temps au travers de la formule heureuse de la cristallisation de la sève en la fleur fraîchement éclose. Manquait l'origine de sa vocation, la cause inhérente à son acharnement réflexif, à sa passion dévorante pour les lettres.
Seule, en effet, importe une seule seconde au vécu ; celle de la décision heurtante d'une intériorité à s'embringuer courageusement sur l'itinéraire de sa plénitude, de ce pour quoi elle était faite au fond, dans une forme d'ellipse grammaticale.
Et cette cause initiale, originelle était inconnue de ses semblables, du moins à ce moment de l'écriture. Elle remontait, non pas à ses années de collège, comme soutenue avec fatuité par un autre conseiller honoraire ; mais à sa seconde expérience de l'Université et la rencontre d'un maître, dont continûment on taira le nom. Ce maître, enflammé et passionné quand il s'agissait de discourir de littérature Élisabéthaine – Shakespeare et les autres, pour résumer – n'en était pas moins froid et distant dans le flot magistral d'enseignements, donnés au tout-venant. Il donna à notre narrateur, comme premier conseil, de quitter le sérieux d'une retraite, d'une étude, pour embrasser la passion d'un effluve, d'une pensée bien vivante : le choc du ressenti, avant – ou serait-ce toujours à la place – de la redite et de l'apprentissage. Alors seulement doit venir la plénitude, comme une conséquence inféodée à l'enthousiasme : le terme « bouillonnant » revient, je crois, plusieurs fois pour décrire le sang tapant les veines, les lèvres, piquant, et le teint empourprant… comme s'il n'aurait pu en aller autrement d'une vie dédiée à l'abord des textes via, dans ce cas d'espèce, le sommital recours à une poignée d'artistes qui s'étaient donnés pour seul but de créer et de produire au mépris d'autrui et d'un fat respect de leurs pairs. C'était eux le climax et l'énergie de l'égérie d'une production littéraire, qui retombera bien vite. Ils ne se donnaient pas en exemple oiseux comme des littérateurs, mais comme des être volant au concret ses lambeaux de beau, ses tirades de superbe, s'aguichant de ses exploits du verbe ; un verbe triomphant bien sûr.
Commencez par Elisabeth, donc. Et y revenir toujours, l'extase accomplie.
Qui du ‘maître' ou du ‘texte' pénétra le plus violemment la conscience du narrateur ? les deux le firent, probablement… Sans le substrat, sans le catalyseur, il n'y aurait peut-être pas eu narrateur révisant sur la fin de sa vie sa carrière, rien qu'un atone et frustre anonyme occupé à trousser ses camarades féminines en arrière-cour d'une sorte de tripot berlinois, à l'image de sa première vie du genre après l'obtention de son Baccalauréat. de ce fait, et dans la continuité, c'est l'intervention subreptice d'un père, mal à-propos certes, mais Ô combien salvatrice, dans le temps ! qui fit grand bien au personnage de roman de S. Zweig quand d'étudiant arrogant, il se découvrit patachon un peu surcoté dans son estime, et surtout nouveau fomenteur d'une honte toute naturelle à entretenir un tel fils.
Alors pourquoi ce titre de la Confusion des sentiments ? il y a comme l'idée que l'on erre et piétine toujours irrémédiablement à deux pas de son réel, qui reste un supposé, et qu'il est bien difficile d'entrer en contact avec le vrai d'une situation de faits ou de pensées, car au fond, les attendus, éléments de contexte et contraintes extérieures sont multiples pour un même objet de pensée ! Il y a aussi l'idée que la haine affleure l'amour, que l'une et l'autre conjoignent en des couples soudés, que le sentiment et son contraire sourdent et sont appelés à la même grâce en un sens, pour peu que leur antinomie soit convoquée dans le ressort d'un être. La pluralité, le pluriel des particules, explique en partie cela, tout comme il aide, pousse à la roue de cet insatiable labeur de temps, de cette imprécision bercée de croyance du juste. Mais il est bien question de confusion des sentiments ici. Et un trouble jeu va s'instaurer entre le narrateur, son maître et … sa femme, dans une maison qui prit des airs de huis clos et dont les vantaux et escaliers en bois grinçaient à s'y méprendre. Et puis, il y avait les excursions, les absences incessantes de ce maître qui partait sans un mot, revenait quand bon lui chantait… l'aigreur de sa femme, sa froide distance mêlée de défi, quand, elle feignait que tout ceci fût normal et qu'il fallait « cesser de faire l'enfant ». Les rapports se distendirent, se tissèrent, s'intriquèrent de nouveau entre ces personnages jusqu'à la scène finale de l'aveu, un aveu sentimental et inconvenant, perpétré dans l'obscurité la plus totale. Tous ces êtres se sont aimés, mais dans des postures sociales et des rôles qui bien évidemment ne le leur permettaient pas. Les conventions étaient là, les convenances plus ordinaires aussi dans l'antre de la demeure du maître. Et comme il fut déchirant ce rejet de l'amitié du maître par son élève ayant découvert l'espionnage de la femme du logis à leur endroit ! Chacun en ressortit détruit, le lecteur peut-être aussi… car comment rester insensible à ce déballage de violences, certes, mais aussi de touchante et confondante sincérité ? La confusion des sentiments résulte du fait que l'on veuille aimer, par inclination de corps et de chairs, mais qu'un obstacle, moral ou social vient très vite à contrecarrer ses vues, voire les dresse à ses yeux propres comme abjectes. Où est le vouloir et que devient-il en pareil cas ? un sujet tout Freudien, à n'en pas douter.
Alors, revenons à Elisabeth et à ses pulsions (!)
Levons le voile : au premier quart du roman, on pouvait croire qu'il était question de S. Zweig se racontant (c'était mon doute, mon souhait aussi) mais chacun le savait confusément mort sous le fascisme – et mort jeune, disons-le ; en aucun cas, pour les méconnaissants, professeur honoraire d'une école de pensée allemande en dépit de ses écrits. Il faut alors se souvenir qu'il s'agit là d'un roman et que ces personnages, si vivants soient-ils, n'en sont pas moins que les créatures d'une pensée vibrionnante et particulièrement allègre. Il n'est nulle question d'autobiographie, et c'est là le tour de force. Il a « simplement » déniché et amené le prétexte à l'introspection et à la rétrospection… Stefan Zweig est l'homme de la seconde guerre et son roman fut reconnu et célébré par S. Freud. Ce texte à la langue châtiée, mais virevoltante, au langage aussi précis que sobre se veut d'un rendu enfiévré, mais il a de l'apprentissage, de l'austérité aussi. Son vocabulaire intuitif est pur et s'écrit en toutes libéralité en accord au magma des affects qui nous anime … Somme toute, il ne laisse de dépeindre non pas des rapports sociaux – ce n'est pas le souci premier de S. Zweig, non pas des situations politiques, mais l'éternité d'une relation d'un maître à son élève et réciproquement. Ingénieusement, des tableaux de maîtres viennent se glisser dans la discussion : c'est l'Ecole d'Athènes, de Raphaël. Et c'est incidemment que Socrate passe le bout de son nez, ou plutôt l'aplat de son front, à travers l'embrasure du visuel se répétant avec le crâne de ce maître décidément bien mystérieux. On y verra aussi des êtres inquiets d'eux-mêmes...
Tout commence avec le récit débonnaire d'un retour sur
un passé de publications, au détour d'une compilation universitaire réalisée à l'adresse d'un enseignant sur le départ. Un professeur honoraire renoue avec ses articles, préfaces, opus égrenés au long d'une vie de littérature ; mise en lumière réalisée avec minutie par ses élèves, et qui ne manqua pas de lui arracher un souvenir ému. Mais il ne s'y retrouva pas.
Ces pages parlaient bien de lui – elles avaient été écrites de sa main quel que fût le procédé – pourtant il manquait une chose de l'indicible que lui seul connaissait et que Stendhal avait résumé en son temps au travers de la formule heureuse de la cristallisation de la sève en la fleur fraîchement éclose. Manquait l'origine de sa vocation, la cause inhérente à son acharnement réflexif, à sa passion dévorante pour les lettres.
Seule, en effet, importe une seule seconde au vécu ; celle de la décision heurtante d'une intériorité à s'embringuer courageusement sur l'itinéraire de sa plénitude, de ce pour quoi elle était faite au fond, dans une forme d'ellipse grammaticale.
Et cette cause initiale, originelle était inconnue de ses semblables, du moins à ce moment de l'écriture. Elle remontait, non pas à ses années de collège, comme soutenue avec fatuité par un autre conseiller honoraire ; mais à sa seconde expérience de l'Université et la rencontre d'un maître, dont continûment on taira le nom. Ce maître, enflammé et passionné quand il s'agissait de discourir de littérature Élisabéthaine – Shakespeare et les autres, pour résumer – n'en était pas moins froid et distant dans le flot magistral d'enseignements, donnés au tout-venant. Il donna à notre narrateur, comme premier conseil, de quitter le sérieux d'une retraite, d'une étude, pour embrasser la passion d'un effluve, d'une pensée bien vivante : le choc du ressenti, avant – ou serait-ce toujours à la place – de la redite et de l'apprentissage. Alors seulement doit venir la plénitude, comme une conséquence inféodée à l'enthousiasme : le terme « bouillonnant » revient, je crois, plusieurs fois pour décrire le sang tapant les veines, les lèvres, piquant, et le teint empourprant… comme s'il n'aurait pu en aller autrement d'une vie dédiée à l'abord des textes via, dans ce cas d'espèce, le sommital recours à une poignée d'artistes qui s'étaient donnés pour seul but de créer et de produire au mépris d'autrui et d'un fat respect de leurs pairs. C'était eux le climax et l'énergie de l'égérie d'une production littéraire, qui retombera bien vite. Ils ne se donnaient pas en exemple oiseux comme des littérateurs, mais comme des être volant au concret ses lambeaux de beau, ses tirades de superbe, s'aguichant de ses exploits du verbe ; un verbe triomphant bien sûr.
Commencez par Elisabeth, donc. Et y revenir toujours, l'extase accomplie.
Qui du ‘maître' ou du ‘texte' pénétra le plus violemment la conscience du narrateur ? les deux le firent, probablement… Sans le substrat, sans le catalyseur, il n'y aurait peut-être pas eu narrateur révisant sur la fin de sa vie sa carrière, rien qu'un atone et frustre anonyme occupé à trousser ses camarades féminines en arrière-cour d'une sorte de tripot berlinois, à l'image de sa première vie du genre après l'obtention de son Baccalauréat. de ce fait, et dans la continuité, c'est l'intervention subreptice d'un père, mal à-propos certes, mais Ô combien salvatrice, dans le temps ! qui fit grand bien au personnage de roman de S. Zweig quand d'étudiant arrogant, il se découvrit patachon un peu surcoté dans son estime, et surtout nouveau fomenteur d'une honte toute naturelle à entretenir un tel fils.
Alors pourquoi ce titre de la Confusion des sentiments ? il y a comme l'idée que l'on erre et piétine toujours irrémédiablement à deux pas de son réel, qui reste un supposé, et qu'il est bien difficile d'entrer en contact avec le vrai d'une situation de faits ou de pensées, car au fond, les attendus, éléments de contexte et contraintes extérieures sont multiples pour un même objet de pensée ! Il y a aussi l'idée que la haine affleure l'amour, que l'une et l'autre conjoignent en des couples soudés, que le sentiment et son contraire sourdent et sont appelés à la même grâce en un sens, pour peu que leur antinomie soit convoquée dans le ressort d'un être. La pluralité, le pluriel des particules, explique en partie cela, tout comme il aide, pousse à la roue de cet insatiable labeur de temps, de cette imprécision bercée de croyance du juste. Mais il est bien question de confusion des sentiments ici. Et un trouble jeu va s'instaurer entre le narrateur, son maître et … sa femme, dans une maison qui prit des airs de huis clos et dont les vantaux et escaliers en bois grinçaient à s'y méprendre. Et puis, il y avait les excursions, les absences incessantes de ce maître qui partait sans un mot, revenait quand bon lui chantait… l'aigreur de sa femme, sa froide distance mêlée de défi, quand, elle feignait que tout ceci fût normal et qu'il fallait « cesser de faire l'enfant ». Les rapports se distendirent, se tissèrent, s'intriquèrent de nouveau entre ces personnages jusqu'à la scène finale de l'aveu, un aveu sentimental et inconvenant, perpétré dans l'obscurité la plus totale. Tous ces êtres se sont aimés, mais dans des postures sociales et des rôles qui bien évidemment ne le leur permettaient pas. Les conventions étaient là, les convenances plus ordinaires aussi dans l'antre de la demeure du maître. Et comme il fut déchirant ce rejet de l'amitié du maître par son élève ayant découvert l'espionnage de la femme du logis à leur endroit ! Chacun en ressortit détruit, le lecteur peut-être aussi… car comment rester insensible à ce déballage de violences, certes, mais aussi de touchante et confondante sincérité ? La confusion des sentiments résulte du fait que l'on veuille aimer, par inclination de corps et de chairs, mais qu'un obstacle, moral ou social vient très vite à contrecarrer ses vues, voire les dresse à ses yeux propres comme abjectes. Où est le vouloir et que devient-il en pareil cas ? un sujet tout Freudien, à n'en pas douter.
Alors, revenons à Elisabeth et à ses pulsions (!)
Levons le voile : au premier quart du roman, on pouvait croire qu'il était question de S. Zweig se racontant (c'était mon doute, mon souhait aussi) mais chacun le savait confusément mort sous le fascisme – et mort jeune, disons-le ; en aucun cas, pour les méconnaissants, professeur honoraire d'une école de pensée allemande en dépit de ses écrits. Il faut alors se souvenir qu'il s'agit là d'un roman et que ces personnages, si vivants soient-ils, n'en sont pas moins que les créatures d'une pensée vibrionnante et particulièrement allègre. Il n'est nulle question d'autobiographie, et c'est là le tour de force. Il a « simplement » déniché et amené le prétexte à l'introspection et à la rétrospection… Stefan Zweig est l'homme de la seconde guerre et son roman fut reconnu et célébré par S. Freud. Ce texte à la langue châtiée, mais virevoltante, au langage aussi précis que sobre se veut d'un rendu enfiévré, mais il a de l'apprentissage, de l'austérité aussi. Son vocabulaire intuitif est pur et s'écrit en toutes libéralité en accord au magma des affects qui nous anime … Somme toute, il ne laisse de dépeindre non pas des rapports sociaux – ce n'est pas le souci premier de S. Zweig, non pas des situations politiques, mais l'éternité d'une relation d'un maître à son élève et réciproquement. Ingénieusement, des tableaux de maîtres viennent se glisser dans la discussion : c'est l'Ecole d'Athènes, de Raphaël. Et c'est incidemment que Socrate passe le bout de son nez, ou plutôt l'aplat de son front, à travers l'embrasure du visuel se répétant avec le crâne de ce maître décidément bien mystérieux. On y verra aussi des êtres inquiets d'eux-mêmes...