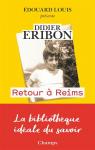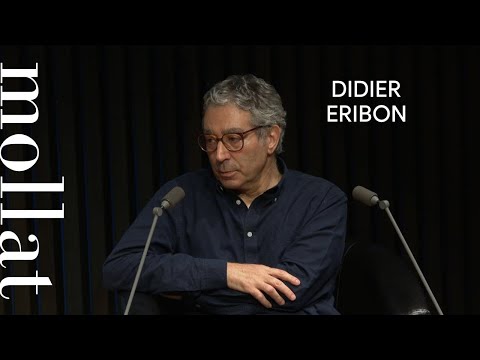Nationalité : France
Né(e) à : Reims , le 10/07/1953
Ajouter des informations
Né(e) à : Reims , le 10/07/1953
Biographie :
Didier Eribon est un sociologue et philosophe français, issu d'une famille ouvrière de Reims.
Il commence sa carrière, après des études de philosophie, comme critique littéraire à "Libération" de 1979 à 1983, puis, à partir de 1984, et jusqu'au milieu des années 1990, au "Nouvel Observateur".
Titulaire d'une habilitation à diriger des recherches soutenue à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, il est, de 2009 à 2017, professeur à la faculté de sciences humaines et sociales et philosophie de l'Université d'Amiens. Il est depuis octobre 2017 Montgomery Fellow de Dartmouth College, aux États-Unis.
Il est également pendant plusieurs années Visiting Professor of Philosophy and Theory à l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis, y donnant un séminaire de recherche pour étudiants doctorants, puis Visiting Scholar à l'Institute for Advanced Study de l'Université de Princeton.
Didier Eribon est l'auteur de plusieurs ouvrages, dans les domaines de la philosophie, de la sociologie et de l'histoire des idées, parmi lesquels une biographie qui fit date de Michel Foucault en 1989 (vingt traductions) suivie en 1994 de "Michel Foucault et ses contemporains", et en 1999 de "Réflexions sur la question gay" (Insult and the Making of the Gay Self, dans sa version anglaise), vite devenu une référence majeure des études de genre.
site officiel : http://didiereribon.blogspot.com/
Twitter : https://twitter.com/didiereribon
+ Voir plusDidier Eribon est un sociologue et philosophe français, issu d'une famille ouvrière de Reims.
Il commence sa carrière, après des études de philosophie, comme critique littéraire à "Libération" de 1979 à 1983, puis, à partir de 1984, et jusqu'au milieu des années 1990, au "Nouvel Observateur".
Titulaire d'une habilitation à diriger des recherches soutenue à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, il est, de 2009 à 2017, professeur à la faculté de sciences humaines et sociales et philosophie de l'Université d'Amiens. Il est depuis octobre 2017 Montgomery Fellow de Dartmouth College, aux États-Unis.
Il est également pendant plusieurs années Visiting Professor of Philosophy and Theory à l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis, y donnant un séminaire de recherche pour étudiants doctorants, puis Visiting Scholar à l'Institute for Advanced Study de l'Université de Princeton.
Didier Eribon est l'auteur de plusieurs ouvrages, dans les domaines de la philosophie, de la sociologie et de l'histoire des idées, parmi lesquels une biographie qui fit date de Michel Foucault en 1989 (vingt traductions) suivie en 1994 de "Michel Foucault et ses contemporains", et en 1999 de "Réflexions sur la question gay" (Insult and the Making of the Gay Self, dans sa version anglaise), vite devenu une référence majeure des études de genre.
site officiel : http://didiereribon.blogspot.com/
Twitter : https://twitter.com/didiereribon
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (20)
Voir plusAjouter une vidéo
Didier Eribon vous présente son ouvrage "Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple" aux éditions Flammarion. Entretien avec Sylvie Hazebroucq.
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2754464/didier-eribon-vie-vieillesse-et-mort-d-une-femme-du-peuple
Note de musique : © mollat
Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/
Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/
Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts
Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/
Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat
Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/
Vimeo : https://vimeo.com/mollat
+ Lire la suite
Podcasts (3)
Voir tous
Citations et extraits (301)
Voir plus
Ajouter une citation
L'augmentation de l'espérance de vie et donc le « vieillissement de la population », comme on dit dans les discours politiques et les rapports administratifs, impliquent que le nombre de personnes très âgées et devenant dépendantes ne cesse et ne cessera de croître considérablement : la vie, ce n'est pas seulement la vie en bonne santé, c'est aussi la vie en mauvaise santé ; et la vie diminuée.
Ma mère n'a pas supporté cette vie diminuée qui était la sienne. À quoi bon continuer ? Se maintenir en vie? Si c'est pour être prisonnière dans une chambre, seule, rivée à son lit, sans pouvoir désormais se lever, marcher, se déplacer? "L'espoir fait vivre", dit le dicton. L'absence d'espoir, qui conduit au désespoir, peut faire mourir. Le peu de forces qu'il lui restait l'avaient abandonnée, ou, plutôt, elle abandonna volontairement le peu de forces qu'il lui restait. Elle a choisi de se laisser mourir.
Ma mère n'a pas supporté cette vie diminuée qui était la sienne. À quoi bon continuer ? Se maintenir en vie? Si c'est pour être prisonnière dans une chambre, seule, rivée à son lit, sans pouvoir désormais se lever, marcher, se déplacer? "L'espoir fait vivre", dit le dicton. L'absence d'espoir, qui conduit au désespoir, peut faire mourir. Le peu de forces qu'il lui restait l'avaient abandonnée, ou, plutôt, elle abandonna volontairement le peu de forces qu'il lui restait. Elle a choisi de se laisser mourir.
" Maman n'aurait pas dû lui laisser ses clés. On ne sait pas si on peut avoir confiance. "
Et moi : " Ce sont ses clés à elle ! Et elle, elle a confiance... "
- On ne sait pas qui est ce monsieur. Et s'il vole des choses dans la maison !
- Qu'est-ce que vous voulez qu'il vole ? Il n'y a rien à voler...
- Mais les outils de papa dans le garage ? "
Il est vrai que mon père était très bricoleur, et qu'il avait beaucoup d'outils... Mais il était mort depuis plusieurs années et tout son matériel, tout son équipement qui occupait de nombreux placards, rayons et tiroirs dans le garage de la maison restaient inutilisés et inutiles. Pourquoi mes frères s'en préoccupaient-ils ?
"Personne ne s'en est servi depuis qu'il est mort ", objectais-je.
Et moi : " Ce sont ses clés à elle ! Et elle, elle a confiance... "
- On ne sait pas qui est ce monsieur. Et s'il vole des choses dans la maison !
- Qu'est-ce que vous voulez qu'il vole ? Il n'y a rien à voler...
- Mais les outils de papa dans le garage ? "
Il est vrai que mon père était très bricoleur, et qu'il avait beaucoup d'outils... Mais il était mort depuis plusieurs années et tout son matériel, tout son équipement qui occupait de nombreux placards, rayons et tiroirs dans le garage de la maison restaient inutilisés et inutiles. Pourquoi mes frères s'en préoccupaient-ils ?
"Personne ne s'en est servi depuis qu'il est mort ", objectais-je.
Le retour dans le milieu d'où l'on vient- et dont on est sorti, dans tous les sens du terme- est toujours un retour sur soi et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi même autant conservé que nié
Il est donc vain de vouloir opposer le changement ou la "capacité d'action" aux déterminismes et à la force autoreproductrice de l'ordre social et des normes sexuelles, ou une pensée de la "liberté" à une pensée de la "reproduction"... puisque ces dimensions sont inextricablement liées et relationnellement imbriquées. Tenir compte des déterminismes ne revient pas à affirmer que rien ne peut changer. Mais que les effets de l'activité hérétique qui met en question l'orthodoxie et la répétition de celle-ci ne peuvent être que limités et relatifs : la "subversion" absolue n'existe pas, pas plus que l'"émancipation" ; on subvertit quelque chose à un moment donné, on se déplace quelque peu, on accomplit un geste d'écart, un pas de côté. Pour le dire en termes foucaldiens : il ne faut pas rêver d'un impossible "affranchissement", tout au plus peut-on franchir quelques frontières instituées par l'histoire et qui enserrent nos existences.
Capitale fut donc pour moi la phrase de Sartre dans son livre sur Genet : " L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. " Elle constitua vite le principe de mon existence. Le principe d'une ascèse : d'un travail de soi sur soi.
Capitale fut donc pour moi la phrase de Sartre dans son livre sur Genet : " L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. " Elle constitua vite le principe de mon existence. Le principe d'une ascèse : d'un travail de soi sur soi.
Au fond, c'est simple, quelque chose a changé dans ma vie, dans mon identité personnelle, dans la définition de moi-même : j'étais un fils, et je ne le suis plus. Elle vivante, si espacées, si intermittentes qu'aient pu être nos relations, et, au fond, si peu fils que j'aie pu m'efforcer de l'être tout au long de ma vie (disons-le : je ne voulais plus être un fils, cela me pesait), je l'étais toujours, je l'étais malgré tout.
[...]
Désormais, je ne le suis plus. Dans le livre qu'Albert Cohen a consacré à sa mère, pleurant la disparition de celle-ci, on peut lire cette phrase coupante : "Jamais plus je ne serai un fils." C'est comme une fissure qui s'introduit dans l’identité personnelle : avoir été un fils et ne plus l’être.
[...]
Désormais, je ne le suis plus. Dans le livre qu'Albert Cohen a consacré à sa mère, pleurant la disparition de celle-ci, on peut lire cette phrase coupante : "Jamais plus je ne serai un fils." C'est comme une fissure qui s'introduit dans l’identité personnelle : avoir été un fils et ne plus l’être.
"Si on excepte le cas des vieux couples mariés, l'admission dans une maison de retraite signifie en général non seulement la rupture définitive des liens affectifs anciens, mais aussi la cohabitation avec des êtres qui ne sont liés à l'individu par aucune relation affective positive. Quand bien même les soins physiques prodigués par les médecins et le personnel soignant seraient excellents, ils ne peuvent empêcher le fait que couper des personnes âgées de la vie normale et les rassembler avec des inconnus signifie les condamner à la solitude. Je ne pense pas ici seulement aux besoins sexuels, qui peuvent être très actifs jusqu'à un âge très avancé, en particulier chez les hommes, mais aussi aux intensités émotionnelles qui existent entre des gens qui ont du plaisir à être ensemble et ont un certain attachement l'un pour l'autre. Les relations de ce type, elles aussi, diminuent en général avec le transfert dans une maison de retraite, et elles y sont rarement remplacées."
Sa conclusion est terrible, mais m'a frappé par sa justesse quand j'ai relu ce livre : "Aussi nombre de maisons de retraite sont-elles des déserts de solitude."
Sa conclusion est terrible, mais m'a frappé par sa justesse quand j'ai relu ce livre : "Aussi nombre de maisons de retraite sont-elles des déserts de solitude."
Capitale fut donc pour moi la phrase de Sartre dans son livre sur Genet : "L'important n'est pas ce que l'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-même de ce qu'on a fait de nous." Elle constitua vite le principe de mon existence. Le principe d'une ascèse : d'un travail de soi sur soi.
Quand je la vois aujourd'hui, le corps perclus de douleurs liées à la dureté des tâches qu'elle avait dû accomplir pendant près de quinze ans, debout devant une chaîne de montage où il lui fallait accrocher des couvercles à des bocaux de verre, avec le droit de se faire remplacer dix minutes le matin et dix minutes l'après-midi pour aller aux toilettes, je suis frappé par ce que signifie concrètement, physiquement, l'inégalité sociale. Et même ce mot d"'inégalité" m'apparaît comme un euphémisme qui déréalise ce dont il s'agit : la violence nue de l'exploitation. Un corps d'ouvrière, quand il vieillit, montre à tous les regards ce qu'est la vérité de l'existence des classes. Le rythme de travail était à peine imaginable dans cette usine, comme dans toute usine d'ailleurs : un contrôleur avait un jour chronométré une ouvrière pendant quelques minutes, et cela avait déterminé le nombre minimum de bocaux à "faire" par heure. C'était déjà extravagant, quasi inhumain. Mais comme une bonne partie de leur salaire se composait de primes dont l'obtention était liée au total quotidien, ma mère m'a indiqué qu'elle-même et ses collègues parvenaient à doubler ce qui était requis. Le soir, elle rentrait chez elle fourbue, "lessivée", comme elle disait, mais contente d'avoir gagné dans sa journée ce qui nous permettrait de vivre décemment.
Le goût pour l'art s'apprend. Je l'appris. Cela fit partie de la rééducation quasi complète de moi-même qu'il me fallut accomplir pour entrer dans un autre monde, une autre classe sociale- et pour mettre à distance celui, celle d'où je venais.(...) Combien de fois, au cours de ma vie ultérieure de personne "cultivée", ai-je constaté en visitant une exposition ou en assistant à un concert ou à une représentation à l'opéra à quel point les gens qui s'adonnent aux pratiques culturelles les plus "hautes" semblent tirer de ces activités une sorte de contentement de soi et un sentiment de supériorité en lisant le discret sourire ont ils ne se départent jamais, dans le maintien de leur corps, dans leur manière de parler en connaisseurs, d'afficher leur aisance...tout cela exprimant la joie sociale de correspondre à ce qu'il convient d'être, d'appartenir au monde privilégié de ceux qui peuvent se flatter de goûter les arts "raffinés". Cela m'intimida toujours, mais j'essayai néanmoins de leur ressembler, d'agir comme si j'étais né comme eux, de manifester la même décontraction qu'eux dans la situation esthétique. (p.107-108)
Il est mort à 54 ans, quand j'étais encore enfant, d'un cancer de la gorge (ce fléau par lequel étaient emportés à l'époque les ouvriers, qui consommaient un nombre à peine imaginable de cigarettes chaque jour. Trois frères de mon père succomberont par la suite, très jeunes, à la même maladie, un autre ayant été victime avant eux de l'alcoolisme). Quand je fus adolescent, ma grand-mère s'étonna que je ne fume pas : "Un homme qui fume, c'est plus sain", me dira-t-elle, inconsciente des ravages que de telles croyances n'avaient cessé de répandre autour d'elle.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Didier Eribon
Quiz
Voir plus
Fleurs, fruits, livres, chansons 🌸🍓📘🎶
Quelle chaleur!😓 Heureusement, j'ai gardé une ... pour la soif.
pomme
poire
10 questions
336 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur336 lecteurs ont répondu