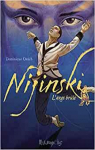Citation de Presence
Budapest, le 6 mars 1912. Ma mamoussia chérie, je crois que je suis dans une période de confidences. J’ai besoin de te raconter aujourd’hui cette épouvantable journée du 8 janvier 1905, lorsque nous avons enfreint les ordres des maîtres de l’École Impériale parce que nous voulions voir les cosaques avec leurs fouets et leurs chevaux qui devaient défiler dans la ville. Nous sommes tombés sur une énorme manifestation d’ouvriers. Nous étions tous les trois : Babitch, Tola et moi, à ne pas avoir obéi, et à n’être pas rentrés chez le dimanche après la messe. Nous avons été happés par la foule qui se dirigeait comme un énorme fleuve vers le Palais d’Hiver du Tsar. Impossible d’aller contre le courant ! Nous nous sommes tenus très fort les mains pour ne pas être éloignés les uns des autres. Nous avons eu peur de la foule avec ses poings levés, ses visages en colère. Un jeune homme en voyant nos uniformes aux emblèmes de l’Opéra impérial nous a donné un drapeau rouge en rigolant. Nous avons été amusés et fiers de le brandir parmi tous les autres. Tout à coup, c’était comme si nous faisions partie de la manifestation envers le tsar ! Mais les gens étaient pacifiques, ils avançaient sans armes, seulement avec les poings nus et criaient qu’ils voulaient manger, qu’ils voulaient pouvoir nourrir leur famille, suppliant le Père des peuples. Devant la Palais d’Hiver, quand nous sommes arrivés, des soldats étaient postés tenant en joue leurs fusils à baïonnette qui luisaient dans le jour pâle de l’hiver. Les cosaques étaient bien là. Ils se tenaient immobiles en ligne, bien droits sur leurs chevaux. Un jeune officier a crié quelque chose en traçant un cercle avec son épée. Personne n’a compris ce qu’il voulait dire quand tout à coup une salve de balles a explosé dans l’air glacé et immédiatement de nombreuses personnes sont tombées au sol parmi la foule. Alors ce fut la cohue. Les gens couraient dans tous les sens en hurlant. Les balles sifflaient. Les corps tombaient. La neige rougissait. Nous avons fui tous les trois comme du gibier aux abois en nous tenant très fort pour ne pas nous perdre. Nous avons couru à travers la perspective Nevski jusqu’à tourner dans la rue du Théâtre. À ce moment, a surgi de nulle part une horde de cosaques sauvages, le sabre et la nagaïka dégoulinants de sang. Ils frappaient sur les gens au hasard en tous sens, femmes enfants vieillards succombant sans avoir le temps de s’enfuir. Nous glissions sur les pavés trempés de sang gluant. J’ai reçu coup avec l’extrémité du fouet qu’un cosaque brandissait. J’ai senti le goût du sang qui coulait sur ma bouche. Nous nous sommes perdus les uns les autres dans la panique. Il y avait du sang partout sur les murs aussi. Ils tranchaient tout ce qui dépassait fendant les corps tremblants jusqu’à la colonne vertébrale. On voyait les squelettes mis à nu. Je ne sais pas comment nous avons fini par retrouver chacun la porte d’entrée de l’école par laquelle le portier nous a tirés tour à tour promptement à l’intérieur. Nous avions vécu la pire journée de notre vie, tremblants plusieurs jours après. Aujourd’hui je ne peux encore pas sans convulsions évoquer ces événements. Le lendemain de notre escapade, Babiteh nous a annoncé que sa sœur n’était pas rentrée à la maison. Les parents affolés nous ont demandé de la chercher partout car il y avait trop de morgues, de commissariats et d’hôpitaux pleins de cadavre pour qu’ils aient tous les deux le temps d’en faire le tour avant que les corps ne soient enterrés. Nous avons cherché partout, dû regarder chaque pauvre fille morte, mutilée pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas de la sœur chérie de Babiteh. Cette sœur que tout le monde aimait et qui était si belle et si douce. Nous avions tous été amoureux d’elle ! Nous ne l’avons pas retrouvée. Elle n’est jamais reparue. Elle a sûrement été jetée dans une fosse commune comme des centaines d’autres. J’ai gardé depuis un sentiment diffus de l’horreur du monde et d’une souffrance incommensurable. Un sentiment de mort. Pardon ma petite Maman pour toutes ces horreurs. Je n’aurais pas dû te livrer des souvenirs terrifiants. Je ne t’enverrai jamais cette lettre. Mais cela m’a fait du bien de te l’écrire car seule toi tu peux comprendre mon désarroi et ma grande souffrance. Ton fils adoré et aimant.