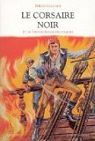Critiques de Emilio Salgari (14)
Le Corsaire noir (et les autres récits qui constituent le recueil de cette édition) est un chef d’œuvre de la littérature italienne du XIXe siècle qui a, selon moi, un peu mal vieilli. Malgré tout, c’est avec plaisir que l’on plonge dans le monde de la piraterie, sur la mer des Caraïbes ou celles d’Asie ainsi qu’en plein milieu de la jungle indienne. Salgari raconte les aventures rocambolesques de personnages hors du commun, plus grands que nature. Personnellement, en tant qu’adulte, je les juge exagérées, peu réalistes. Même James Bond n’y survivrait pas. Mais je suppose que beaucoup d’enfants les ont lues avidement et se sont imaginé les vivre par la même occasion. Simple mais efficace. Les amateurs de romans de capes et d’épées y trouvent leur compte. S’ajoutent à cela voyages, exotisme et romance. Malheureusement, le vocabulaire dépréciatif, sans doute considéré acceptable à l’époque, est difficilement défendable à la nôtre. Par exemple, le corsaire surnomme son camarade noir « compère Sac de charbon ».
Résumé : L'Histoire se passe au début du XXème siècle et met en scène deux russes, condamnés à mort à Pékin pour un méfait qu'ils n'ont pas commis, et qui sont sauvés par un mystérieux appareil volant, commandé par un capitaine tout aussi mystérieux. A bord de "l'Epervier", ce grand oiseau volant, merveille de technologie, ils survolent la Chine, le désert de Gobi, le Tibet, pour rejoindre les confins de l'Inde. A chaque descente au sol, ils rencontrent les populations locales et vivent mille aventures.
Mon avis : Emilio Salgari est une sorte de Jules Verne à l'italienne. L'aventure vécue par ses personnages est drôle et pleine de rebondissements. Le récit est bien rythmé et haut en couleurs ! L'auteur ne connaissait pas réellement les lieux décrits, et sa rigueur était suffisamment légère pour que les lieux, les peuples, la faune et la flore soient teintés du plus grand flou. Ce qui, pour ma part, n'enlève rien à la qualité des descriptions de paysage.
Il est juste à regretter que certains passages soient un peu longs et redondants, et que l'auteur laisse planer des mystères autour de ses personnages sans réellement chercher à les résoudre.
J'ai apprécié cette petite aventure légère, sorte de vacances aériennes entre deux lectures, qui, derrière quelques insuffisances, reste à découvrir.
Mon avis : Emilio Salgari est une sorte de Jules Verne à l'italienne. L'aventure vécue par ses personnages est drôle et pleine de rebondissements. Le récit est bien rythmé et haut en couleurs ! L'auteur ne connaissait pas réellement les lieux décrits, et sa rigueur était suffisamment légère pour que les lieux, les peuples, la faune et la flore soient teintés du plus grand flou. Ce qui, pour ma part, n'enlève rien à la qualité des descriptions de paysage.
Il est juste à regretter que certains passages soient un peu longs et redondants, et que l'auteur laisse planer des mystères autour de ses personnages sans réellement chercher à les résoudre.
J'ai apprécié cette petite aventure légère, sorte de vacances aériennes entre deux lectures, qui, derrière quelques insuffisances, reste à découvrir.
Ce serait faire preuve d’une grande présomption d’affirmer que la littérature populaire est une spécificité française. Certes, beaucoup d’auteurs-phares de ce type de littérature ont vu le jour dans notre pays, mais nous avons vu qu’en Angleterre et aux Etats-Unis, une littérature d’aventure, de fantastique, de science-fiction s’est installée durablement. On en parle moins, mais en Allemagne, un auteur comme Karl May (le créateur de Winetou) est un héros national. En Italie, c’est Emilio Salgari qui tient la vedette.
Emilio Salgari (1862-1911), était en 1952 l’italien le plus lu dans le monde, après Dante et sa « Divine Comédie ». Successeur d’Alexandre Dumas, Jules Verne, Fenimore Cooper ou Eugène Sue, contemporain de Karl May, tous auteurs qu’il a adulés (et parfois copiés), Emilio Salgari est le plus productif et le plus populaire des romanciers italiens. Il est assez peu connu en France, et c’est bien dommage, car son œuvre, immense et échevelée, mérite qu’on s’y arrête.
Sa spécialité, c’est l’exotisme : Salgari est un grand voyageur. Un peu avec ses pieds et avec les moyens de locomotion de son époque ; mais surtout avec son imagination, qu’il a grande et fertile. Il est l’auteur de trois grands cycles : « Les pirates de Malaisie » (où l’on trouve deux de ses héros Tremal-Naïk, le chasseur de tigres, et Sandokan, le pirate ; « Les Pirates des Antilles » (dont le héros n’est autre que « Le Corsaire noir ») ; et enfin « Les Pirates des Bermudes ».
« Les mystères de la jungle noire » est le premier volume du cycle des « Pirates de Malaisie ». On y retrouve tous les éléments qui ont fait le charme des œuvres de Kipling : l’Inde éternelle des maharadjahs et des réprouvés et l’impérialisme britannique. Ici pas de réalisme, pas de descriptions documentées à la Jules Verne, si Salgari s’est inspiré des comptes rendus de voyageurs, ou d’aventuriers, il les a transcendés par une imagination complètement échevelée, qui n’est pas pour rien dans l’imaginaire collectif, lié à cette période particulière de l’Inde sous domination anglaise.
Nous sommes en 1865, dans les contrées sauvages du Bengale, à l’embouchure du Gange. C’est le pays des serpents, des tigres et des Thugs (la secte redoutable des hindous étrangleurs, les mêmes que chez Rocambole). Tremal-Naïk, un jeune chasseur de tigres est obsédé par la vision d’une jeune fille nommée Ada (en fait Ada est la fille du capitaine MacPherson, farouche opposant aux Thugs). Ada est enlevée par les Thugs qui en font leur déesse, prêtresse de Kâli. Tremal-Naïk, accompagné de son tigre Dharma, et de son ami Kammamuri aura fort à faire pour soustraire sa bien-aimée à l’influence malfaisante des Etrangleurs menés par leur chef, l’impitoyable Suyodhana.
« Salgari reste avant tout le grand maître de l’exotisme et du suspens, celui qui ne cesse de captiver l’enfant qui sommeille en chacun de nous » (Robert Kopp)
Après tout, c’est-ce pas le meilleur titre de gloire de cette littérature dite « populaire » : s’adresser à ce qui reste en nous de plus innocent, de plus pur, de moins perverti par toutes les tentations externes, bref s’adresser à notre esprit d’enfance ?
Emilio Salgari (1862-1911), était en 1952 l’italien le plus lu dans le monde, après Dante et sa « Divine Comédie ». Successeur d’Alexandre Dumas, Jules Verne, Fenimore Cooper ou Eugène Sue, contemporain de Karl May, tous auteurs qu’il a adulés (et parfois copiés), Emilio Salgari est le plus productif et le plus populaire des romanciers italiens. Il est assez peu connu en France, et c’est bien dommage, car son œuvre, immense et échevelée, mérite qu’on s’y arrête.
Sa spécialité, c’est l’exotisme : Salgari est un grand voyageur. Un peu avec ses pieds et avec les moyens de locomotion de son époque ; mais surtout avec son imagination, qu’il a grande et fertile. Il est l’auteur de trois grands cycles : « Les pirates de Malaisie » (où l’on trouve deux de ses héros Tremal-Naïk, le chasseur de tigres, et Sandokan, le pirate ; « Les Pirates des Antilles » (dont le héros n’est autre que « Le Corsaire noir ») ; et enfin « Les Pirates des Bermudes ».
« Les mystères de la jungle noire » est le premier volume du cycle des « Pirates de Malaisie ». On y retrouve tous les éléments qui ont fait le charme des œuvres de Kipling : l’Inde éternelle des maharadjahs et des réprouvés et l’impérialisme britannique. Ici pas de réalisme, pas de descriptions documentées à la Jules Verne, si Salgari s’est inspiré des comptes rendus de voyageurs, ou d’aventuriers, il les a transcendés par une imagination complètement échevelée, qui n’est pas pour rien dans l’imaginaire collectif, lié à cette période particulière de l’Inde sous domination anglaise.
Nous sommes en 1865, dans les contrées sauvages du Bengale, à l’embouchure du Gange. C’est le pays des serpents, des tigres et des Thugs (la secte redoutable des hindous étrangleurs, les mêmes que chez Rocambole). Tremal-Naïk, un jeune chasseur de tigres est obsédé par la vision d’une jeune fille nommée Ada (en fait Ada est la fille du capitaine MacPherson, farouche opposant aux Thugs). Ada est enlevée par les Thugs qui en font leur déesse, prêtresse de Kâli. Tremal-Naïk, accompagné de son tigre Dharma, et de son ami Kammamuri aura fort à faire pour soustraire sa bien-aimée à l’influence malfaisante des Etrangleurs menés par leur chef, l’impitoyable Suyodhana.
« Salgari reste avant tout le grand maître de l’exotisme et du suspens, celui qui ne cesse de captiver l’enfant qui sommeille en chacun de nous » (Robert Kopp)
Après tout, c’est-ce pas le meilleur titre de gloire de cette littérature dite « populaire » : s’adresser à ce qui reste en nous de plus innocent, de plus pur, de moins perverti par toutes les tentations externes, bref s’adresser à notre esprit d’enfance ?
Véritable institution du roman d’aventures dans son Italie natale, Emilio Salgari a néanmoins souffert chez nous de l’écrasante et dévalorisante comparaison avec notre Jules Verne, plus pédagogue et scientifique que le fut ce pauvre Salgari, forçat de l’écriture, officier de marine raté, menteur compulsif, mais romancier énergique, vivace, attendrissant et assez ouvertement anarchiste et anticolonial.
Emilio Salgari ressentit d’abord une vocation profonde pour la vie maritime. Pour des raisons de santé physique, et peut-être aussi pour cause de fragilité psychologique, la marine italienne ne jugea pas utile de s’encombrer d’un tel personnage. Ce rejet fut une profonde blessure pour Emilio Salgari, qui commença à écrire dès 1883, à seulement 21 ans.
Ce fut cette frustration d’un homme rêvant de voyages lointains, - mais qui, pour des raisons qui demeurent en partie inexpliquées, ne pouvait pas voyager, ni par mer, ni sur la terre ferme -, qui scella le destin littéraire d’Emilio Salgari. Il ne quitta jamais l’Italie, vécût longtemps à Gênes, avant de se fixer définitivement à Turin. Ses voyages furent d'abord intérieurs, puis littéraires.
Emilio Salgari avait transformé son appartement en un entrepôt d’encyclopédies, d’atlas, de dictionnaires spécialisés, et de récits et de magazines de voyages, d’où il tirait la matière première de tous ses romans. Hélas pour lui, contrairement à Jules Verne, Salgari ne pouvait compter sur un éditeur aussi dévoué que le fut Jules Hetzel. Bien au contraire, il tomba assez rapidement sous les griffes d’un dénommé Speirani qui s’enrichit aux dépens de l’écrivain, et l’épuisa en le faisant cravacher du matin au soir.
Cette activité démentielle empêcha sans doute Emilo Salgari d’évoluer sur le plan de la qualité littéraire. Ses livres se vendaient très bien, mais ils étaient courts, le style y était sacrifié à une narration factuelle, et les pages gonflées par des illustrateurs de qualité inégale.
Néanmoins, les 80 romans d’Emilio Salgari connurent en Italie un énorme succès, au point que lorsque l’écrivain, pris d’une crise de démence, se suicida dans un parc public en avril 1911, son éditeur profita du fait que cette tragédie et les funérailles de l’écrivain furent médiocrement couvertes par la presse nationale (L’Italie était à ce moment-là surtout préoccupée des préparatifs de son Exposition Universelle) pour embaucher des nègres littéraires qu’il chargea de continuer à écrire et à publier des romans sous le nom d’Emilio Salgari, quand bien même ces romans apocryphes posthumes étaient assez souvent racistes et pro-coloniaux, trahissant sans vergogne les idéaux de Salgari.
L’imposture ne fut révélée qu’à la toute fin des années 40, soit plus de trente ans après la mort de l’auteur, et il reste difficile aujourd’hui de savoir qui a écrit ces romans posthumes, les descendants de Speirani (mort entre temps) ayant argué que beaucoup de ces livres apocryphes n’avaient été que finalisés par les auteurs-maisons, d'après une cinquantaine de manuscrits inachevés retrouvés dans les archives de l'écrivain. C'est en effet possible, vu la suractivité de Salgari et la nécessité pour l'éditeur de continuer à faire vivre sa veuve et ses enfants, mais cela reste invérifiable.
La traduction des œuvres d’Emilio Salgari en français débuta dès 1899 sous d’heureux auspices, et se poursuivit jusqu’en 1912. Puis, il y eut à nouveau une flopée de traductions entre 1926 et 1933, dans des collections plus populaires mais aussi plus confidentielles, où se mêlaient, sans manière de les distinguer, romans authentiques et romans apocryphes. Puis ce fut tout, jusqu’à la récente traduction en 2019 des « Aventuriers du Ciel » par les éditions Michel Lafon, passée totalement inaperçue.
« Un Défi au Pôle Nord » est l’un des derniers ouvrages d’Emilio Salgari, écrit en 1909, et traduit en 1912 par les éditions Charles Delagrave dans une très belle édition de luxe au lettrage doré, pesant pas moins de 2 kilos (idéal pour les mains d’un enfant), et reprenant la couverture et les illustrations originales italiennes de Gennaro d’Amato (assez incompréhensiblement crédité ici comme L. Amato).
« Una Sfida Al Polo » s’inspire à la base d’une histoire vraie, qui s’est déroulée en deux temps, en 1908 et 1909 : il s’agit de la rivalité qui opposa deux explorateurs américains Frederick Cook (1865-1940) et Robert Peary (1856-1920), lesquels, à un an d’écart et non sans s’abreuver mutuellement d’injures dans la presse, montèrent chacun une expédition pour le Pôle Nord et prétendirent ensuite chacun être le premier homme à y avoir planté le drapeau américain. En réalité, mais on ne le sut que bien plus tard, tous deux furent de fieffés menteurs, et vaincus par le froid et les éléments, ils firent demi-tour bien avant d’arriver au Pôle Nord, tout en prétendant l’avoir découvert. Les falsifications de leurs livres de bord ont depuis été largement prouvées.
C’est sans aucun doute de ce fait divers que partit Emilio Salgari pour ce « Défi au Pôle Nord », bien que l’auteur ait changé de nombreux détails : d’abord, les deux expéditions rivales ont ici lieu simultanément, chacun des explorateurs prenant une route différente pour se rendre à un même point de rendez-vous au Pôle Nord. Ensuite, on ne s’affronte pas dans ce roman pour la gloire ou pour entrer dans l’Histoire, mais pour conquérir le cœur d’une belle, qui a promis d’accorder sa main au vainqueur. Et enfin, les expéditions ne se font pas, comme pour Cook et Peary, en traîneaux à chiens, mais… en automobile !
Car oui, nous sommes en 1909, et l’automobile, incarnée par la très populaire Ford-T, c’est l’avenir ! Et même si l'automobile peine encore à dépasser les 45 km/h, on se dit qu’elle va forcément évoluer et qu’il n’y a pas de raison qu’elle ne puisse pas rouler un jour sur les glaces du Pôle…
D’ailleurs, nos trois explorateurs ne le deviennent que par accident, ce sont avant tout des férus d’automobiles : Miss Ellen Perkins, pour laquelle les cœurs ardents de deux rivaux se consument, est l’une des premières femmes pilotes de courses. Gaston de Montcalm (« Gastone di Montcalm » en V.O.), le prétendant "gentil", riche dilettante québécois, est lui aussi pilote, mais en amateur. Le prétendant "méchant", Torpon (« Master Torpon » en V.O.) est un riche américain, blond, gras, arrogant, fils d’un fabricant d’automobiles de Buffalo. Tous deux sont décrits, non sans un peu de mépris, comme des "crabments", du nom d’un authentique cocktail alcoolisé à base de crabe qui était apparemment la boisson chère et chic d’une certaine élite désœuvrée.
Montcalm et Torpon se sont déjà affrontés de bien des manières (biture, course d'équitation, match de boxe, et même affrontement au couteau dans une pièce plongée dans l’obscurité) sans parvenir à ce que la supériorité d’un des prétendants apparaisse aux yeux de Miss Perkins. La conquête du Pôle Nord en automobile est donc décidée, depuis la ville canadienne de Montréal.
Salgari va donc nous embarquer, durant cette compétition glaciale de 300 pages, dans l’expédition de Gaston de Montcalm, qui décide – comme le fit Frederick Cook – de partir avec une équipe réduite à trois personnes, qu’il recrute par petites annonces.
Montcalm engage d’abord un jeune pilote anglais, Walter Graham, que sa passion pour l’automobile a définitivement éloigné de ses études d’ingénieur, puis un mécanicien du nom de Dick Mac Leod, dont le travail sera de régler tout problème mécanique qui pourrait se présenter durant le trajet. Mais ce Dick Mac Leod est en réalité un traître payé par Torpon pour saboter la voiture de Montcalm et l’empêcher d’atteindre le Pôle Nord. Évidemment, suite à tout un tas d’impondérables, il n’y parviendra jamais…
C’est donc le début d’un long voyage qui va se révéler au fil des pages essentiellement sanguinaire. Montcalm a accroché derrière son automobile une petite roulotte – désignée incorrectement comme un "wagon" - qui contient armes, bagages et victuailles. Malgré cette précaution, même s’il est vrai que la dose journalière de nourriture pour trois hommes dans la force de l’âge n’est pas négligeable, nos trois héros sont embarqués avant tout dans une gigantesque partie de chasse, qui les amène à se nourrir principalement de toutes les bêtes qu’ils croisent. C’est d’abord une meute de loups, lancés à leur poursuite, que nos trois explorateurs, de peur d’être à court de balles, massacrent à la dynamite, non sans récupérer quelques lambeaux de loups pour les déguster au feu de bois. Puis ce sont des ours blancs, des élans, des bœufs musqués – lesquels creusent un terrier sous la roulotte arrêtée, puisque, comme chacun le sait, les bœufs musqués passent leur temps à creuser des terriers et des souterrains comme les castors – qui sont ainsi impitoyablement abattus, découpés en pièces de boucheries, et savourés sur place.
Une baleine morte, échouée sur les rives d’un lac, donne à Montcalm et à ses amis l’occasion d’en dévorer quelques filets, et ce doit être parce qu’ils ont, à ce moment-là, le ventre bien plein que, lorsque le hasard leur fait rencontrer une tribu Inuit, ils s’abstiennent de les boulotter eux aussi.
Et pourtant, ces Inuits seront source de grands désagréments, car c’est la première fois qu’ils voient une automobile, et ils la prennent pour un animal démoniaque ! Alors que franchement, si cette automobile était un animal, ça ferait un bon moment que Gaston, Walter et Dick l’auraient mangée !
Il n’empêche, ces Inuits, aux mœurs belliqueuses bien connues, sont quand même décidés à faire un mauvais sort à la voiture de nos héros, alors ces derniers sont bien obligés de tirer dans le tas ! Qu’est-ce que vous voulez, on ne fait pas toujours ce qu’on veut...
Jusqu’à ce point du roman, si l’introspection psychologique n’est pas vraiment de circonstance, Emilio Salgari reste quand même dans les limites d’un certain réalisme. Mais une fois qu’en dépit des malheureuses tentatives de sabotage de Dick Mac Leod, nos héros parviennent au Pôle Nord, alors ce brave Emilio se lâche complètement ! Pensez donc qu’on ne savait toujours pas vraiment à quoi ressemblait le Pôle Nord à l’époque !
Emilio Salgari, lui, y voit des morses, des grandes plaines glacées recouvertes de 400 morses qui prennent le soleil – et Dieu sait que ce ne sont pas les occasions de bronzer qui manquent au Pôle Nord ! Mais voilà, comment rouler au milieu de tous ces morses ? Et bien, c’est simple, on fonce dessus à toute vitesse, et on écrase ! Mais là, tout de même, on se dit qu’une Ford T avec une roulotte écrasant des morses de 3 mètres de long et qui pèsent une tonne, c’est tout de même un peu difficile à croire. Heureusement, par le biais de l’astucieux Walter Graham, Emilio Salgari nous explique comment c’est tout de même possible : les morses n’étant que des tas de graisse, leurs peaux n’ont aucune résistance, et elles éclatent sous les roues comme des vessies de porc. Par contre, toute la graisse s’échappant avec le sang, la glace devient glissante (car elle ne l’était pas avant), et il faut faire très attention en roulant.
On croit atteindre le fond, mais on n’y est pas encore, car au bout de quelques kilomètres sur la banquise, Gaston, Walter et Dick tombent sur… un mammouth. Ben oui ! Pourquoi n’y aurait-il pas de mammouths au Pôle Nord ? Ce sont des pachydermes de l’ère glaciaire, non ?
Ce mammouth, furieux d’être dérangé, se saisit avec sa trompe de Dick Mac Leod, le secoue bien fort, et le projette violemment à terre. S'emparant de leurs fusils, Gaston et Walter parviennent à tuer le mammouth, et sauvent le mécanicien, lequel, reconnaissant, leur avoue qu’il a été payé par Torpon pour saboter le voyage. Nos héros en sont tellement affectés qu’ils en oublient de se découper un steak de mammouth. En tout cas, Dick promet qu’il ne tentera plus rien contre ceux auxquels il doit la vie.
Enfin, les trois hommes parviennent au point de rendez-vous en même temps que Torpon. Celui-ci, enragé que tant de chemin ne parvienne pas plus à le départager de Montcalm, exige de se battre en duel sur un "glacier" voisin. Par "glacier", Emilio Salgari entend en fait un petit iceberg au bord de la banquise. Mais à peine les deux hommes sont-ils montés sur ce "glacier" que, déséquilibré comme le serait un glaçon sur lequel on poserait une olive, le "glacier" bascule, « se retourne » et les deux hommes tombent à l’eau. Walter et Dick plongent pour les sauver. Walter parvient à ramener Gaston, mais hélas, Dick Mac Leod se noie avec Torpon.
Faute d'adversaire, Gaston de Montcalm plante sur un piton de glace le drapeau français (et on se demande bien pourquoi, puisqu'il est canadien), actant sa victoire au défi, et sa conquête du Pôle Nord.
Victoire et conquête un peu amères, certes, mais il ne sert à rien de se lamenter, et quoiqu’un peu frigorifiés, car « l’eau n’est pas chaude » (sic), Gaston et Walter remontent en voiture et rentrent à Montréal. Un trajet retour expédié en deux pages, et qui n’est marqué par aucune aventure. Il faut dire qu’ayant tué et mangé tous les êtres vivants à l’aller, ils ne risquaient pas de croiser quoi que ce soit au retour.
La victoire de Montcalm étant attestée, Miss Ellen Perkins l’accueille avec émotion comme son futur mari, mais refroidi par le peu d’empathie dont elle fait preuve en apprenant la mort de Torpon et de Dick Mac Leod, Gaston de Montcalm rejette l’offre de mariage d’Ellen et lui débite cette tirade sublime : « Les femmes qui exigent des victimes et qui poussent les hommes à se tuer n’ont jamais fait fortune au Canada. Cherchez un mari parmi vos compatriotes. »
On l’aura compris, « Un Défi au Pôle Nord » est un très réjouissant nanar littéraire, où Emilio Salgari donne le meilleur de son art et de son savoir-faire, avec un rythme enlevé et frétillant. Si l’intrigue est assez prévisible et les personnages très stéréotypés, l’imagination baroque de Salgari, comme ce Pôle Nord naïf et hautement farfelu où il nous entraîne, donnent à ce roman une dimension onirique, que le temps a recouvert depuis d’une fine couche de dérision qui en rehausse la beauté désuète et la douce folie.
On frissonne peu à la lecture de ces aventures polaires, mais on sourit souvent, et on rit franchement à plusieurs reprises. À cela s’ajoutent une critique étonnamment précoce du "self-made-man" à l’américaine, toujours d'actualité, et le surprenant refus de l’auteur à céder à une happy-end romantique.
Dérisoire, pathétique mais engagé et rebelle : c’est bien ainsi que l’on aime Emilio Salgari, dont ce roman polaire méconnu est à classer parmi ses plus grandes réussites.
Emilio Salgari ressentit d’abord une vocation profonde pour la vie maritime. Pour des raisons de santé physique, et peut-être aussi pour cause de fragilité psychologique, la marine italienne ne jugea pas utile de s’encombrer d’un tel personnage. Ce rejet fut une profonde blessure pour Emilio Salgari, qui commença à écrire dès 1883, à seulement 21 ans.
Ce fut cette frustration d’un homme rêvant de voyages lointains, - mais qui, pour des raisons qui demeurent en partie inexpliquées, ne pouvait pas voyager, ni par mer, ni sur la terre ferme -, qui scella le destin littéraire d’Emilio Salgari. Il ne quitta jamais l’Italie, vécût longtemps à Gênes, avant de se fixer définitivement à Turin. Ses voyages furent d'abord intérieurs, puis littéraires.
Emilio Salgari avait transformé son appartement en un entrepôt d’encyclopédies, d’atlas, de dictionnaires spécialisés, et de récits et de magazines de voyages, d’où il tirait la matière première de tous ses romans. Hélas pour lui, contrairement à Jules Verne, Salgari ne pouvait compter sur un éditeur aussi dévoué que le fut Jules Hetzel. Bien au contraire, il tomba assez rapidement sous les griffes d’un dénommé Speirani qui s’enrichit aux dépens de l’écrivain, et l’épuisa en le faisant cravacher du matin au soir.
Cette activité démentielle empêcha sans doute Emilo Salgari d’évoluer sur le plan de la qualité littéraire. Ses livres se vendaient très bien, mais ils étaient courts, le style y était sacrifié à une narration factuelle, et les pages gonflées par des illustrateurs de qualité inégale.
Néanmoins, les 80 romans d’Emilio Salgari connurent en Italie un énorme succès, au point que lorsque l’écrivain, pris d’une crise de démence, se suicida dans un parc public en avril 1911, son éditeur profita du fait que cette tragédie et les funérailles de l’écrivain furent médiocrement couvertes par la presse nationale (L’Italie était à ce moment-là surtout préoccupée des préparatifs de son Exposition Universelle) pour embaucher des nègres littéraires qu’il chargea de continuer à écrire et à publier des romans sous le nom d’Emilio Salgari, quand bien même ces romans apocryphes posthumes étaient assez souvent racistes et pro-coloniaux, trahissant sans vergogne les idéaux de Salgari.
L’imposture ne fut révélée qu’à la toute fin des années 40, soit plus de trente ans après la mort de l’auteur, et il reste difficile aujourd’hui de savoir qui a écrit ces romans posthumes, les descendants de Speirani (mort entre temps) ayant argué que beaucoup de ces livres apocryphes n’avaient été que finalisés par les auteurs-maisons, d'après une cinquantaine de manuscrits inachevés retrouvés dans les archives de l'écrivain. C'est en effet possible, vu la suractivité de Salgari et la nécessité pour l'éditeur de continuer à faire vivre sa veuve et ses enfants, mais cela reste invérifiable.
La traduction des œuvres d’Emilio Salgari en français débuta dès 1899 sous d’heureux auspices, et se poursuivit jusqu’en 1912. Puis, il y eut à nouveau une flopée de traductions entre 1926 et 1933, dans des collections plus populaires mais aussi plus confidentielles, où se mêlaient, sans manière de les distinguer, romans authentiques et romans apocryphes. Puis ce fut tout, jusqu’à la récente traduction en 2019 des « Aventuriers du Ciel » par les éditions Michel Lafon, passée totalement inaperçue.
« Un Défi au Pôle Nord » est l’un des derniers ouvrages d’Emilio Salgari, écrit en 1909, et traduit en 1912 par les éditions Charles Delagrave dans une très belle édition de luxe au lettrage doré, pesant pas moins de 2 kilos (idéal pour les mains d’un enfant), et reprenant la couverture et les illustrations originales italiennes de Gennaro d’Amato (assez incompréhensiblement crédité ici comme L. Amato).
« Una Sfida Al Polo » s’inspire à la base d’une histoire vraie, qui s’est déroulée en deux temps, en 1908 et 1909 : il s’agit de la rivalité qui opposa deux explorateurs américains Frederick Cook (1865-1940) et Robert Peary (1856-1920), lesquels, à un an d’écart et non sans s’abreuver mutuellement d’injures dans la presse, montèrent chacun une expédition pour le Pôle Nord et prétendirent ensuite chacun être le premier homme à y avoir planté le drapeau américain. En réalité, mais on ne le sut que bien plus tard, tous deux furent de fieffés menteurs, et vaincus par le froid et les éléments, ils firent demi-tour bien avant d’arriver au Pôle Nord, tout en prétendant l’avoir découvert. Les falsifications de leurs livres de bord ont depuis été largement prouvées.
C’est sans aucun doute de ce fait divers que partit Emilio Salgari pour ce « Défi au Pôle Nord », bien que l’auteur ait changé de nombreux détails : d’abord, les deux expéditions rivales ont ici lieu simultanément, chacun des explorateurs prenant une route différente pour se rendre à un même point de rendez-vous au Pôle Nord. Ensuite, on ne s’affronte pas dans ce roman pour la gloire ou pour entrer dans l’Histoire, mais pour conquérir le cœur d’une belle, qui a promis d’accorder sa main au vainqueur. Et enfin, les expéditions ne se font pas, comme pour Cook et Peary, en traîneaux à chiens, mais… en automobile !
Car oui, nous sommes en 1909, et l’automobile, incarnée par la très populaire Ford-T, c’est l’avenir ! Et même si l'automobile peine encore à dépasser les 45 km/h, on se dit qu’elle va forcément évoluer et qu’il n’y a pas de raison qu’elle ne puisse pas rouler un jour sur les glaces du Pôle…
D’ailleurs, nos trois explorateurs ne le deviennent que par accident, ce sont avant tout des férus d’automobiles : Miss Ellen Perkins, pour laquelle les cœurs ardents de deux rivaux se consument, est l’une des premières femmes pilotes de courses. Gaston de Montcalm (« Gastone di Montcalm » en V.O.), le prétendant "gentil", riche dilettante québécois, est lui aussi pilote, mais en amateur. Le prétendant "méchant", Torpon (« Master Torpon » en V.O.) est un riche américain, blond, gras, arrogant, fils d’un fabricant d’automobiles de Buffalo. Tous deux sont décrits, non sans un peu de mépris, comme des "crabments", du nom d’un authentique cocktail alcoolisé à base de crabe qui était apparemment la boisson chère et chic d’une certaine élite désœuvrée.
Montcalm et Torpon se sont déjà affrontés de bien des manières (biture, course d'équitation, match de boxe, et même affrontement au couteau dans une pièce plongée dans l’obscurité) sans parvenir à ce que la supériorité d’un des prétendants apparaisse aux yeux de Miss Perkins. La conquête du Pôle Nord en automobile est donc décidée, depuis la ville canadienne de Montréal.
Salgari va donc nous embarquer, durant cette compétition glaciale de 300 pages, dans l’expédition de Gaston de Montcalm, qui décide – comme le fit Frederick Cook – de partir avec une équipe réduite à trois personnes, qu’il recrute par petites annonces.
Montcalm engage d’abord un jeune pilote anglais, Walter Graham, que sa passion pour l’automobile a définitivement éloigné de ses études d’ingénieur, puis un mécanicien du nom de Dick Mac Leod, dont le travail sera de régler tout problème mécanique qui pourrait se présenter durant le trajet. Mais ce Dick Mac Leod est en réalité un traître payé par Torpon pour saboter la voiture de Montcalm et l’empêcher d’atteindre le Pôle Nord. Évidemment, suite à tout un tas d’impondérables, il n’y parviendra jamais…
C’est donc le début d’un long voyage qui va se révéler au fil des pages essentiellement sanguinaire. Montcalm a accroché derrière son automobile une petite roulotte – désignée incorrectement comme un "wagon" - qui contient armes, bagages et victuailles. Malgré cette précaution, même s’il est vrai que la dose journalière de nourriture pour trois hommes dans la force de l’âge n’est pas négligeable, nos trois héros sont embarqués avant tout dans une gigantesque partie de chasse, qui les amène à se nourrir principalement de toutes les bêtes qu’ils croisent. C’est d’abord une meute de loups, lancés à leur poursuite, que nos trois explorateurs, de peur d’être à court de balles, massacrent à la dynamite, non sans récupérer quelques lambeaux de loups pour les déguster au feu de bois. Puis ce sont des ours blancs, des élans, des bœufs musqués – lesquels creusent un terrier sous la roulotte arrêtée, puisque, comme chacun le sait, les bœufs musqués passent leur temps à creuser des terriers et des souterrains comme les castors – qui sont ainsi impitoyablement abattus, découpés en pièces de boucheries, et savourés sur place.
Une baleine morte, échouée sur les rives d’un lac, donne à Montcalm et à ses amis l’occasion d’en dévorer quelques filets, et ce doit être parce qu’ils ont, à ce moment-là, le ventre bien plein que, lorsque le hasard leur fait rencontrer une tribu Inuit, ils s’abstiennent de les boulotter eux aussi.
Et pourtant, ces Inuits seront source de grands désagréments, car c’est la première fois qu’ils voient une automobile, et ils la prennent pour un animal démoniaque ! Alors que franchement, si cette automobile était un animal, ça ferait un bon moment que Gaston, Walter et Dick l’auraient mangée !
Il n’empêche, ces Inuits, aux mœurs belliqueuses bien connues, sont quand même décidés à faire un mauvais sort à la voiture de nos héros, alors ces derniers sont bien obligés de tirer dans le tas ! Qu’est-ce que vous voulez, on ne fait pas toujours ce qu’on veut...
Jusqu’à ce point du roman, si l’introspection psychologique n’est pas vraiment de circonstance, Emilio Salgari reste quand même dans les limites d’un certain réalisme. Mais une fois qu’en dépit des malheureuses tentatives de sabotage de Dick Mac Leod, nos héros parviennent au Pôle Nord, alors ce brave Emilio se lâche complètement ! Pensez donc qu’on ne savait toujours pas vraiment à quoi ressemblait le Pôle Nord à l’époque !
Emilio Salgari, lui, y voit des morses, des grandes plaines glacées recouvertes de 400 morses qui prennent le soleil – et Dieu sait que ce ne sont pas les occasions de bronzer qui manquent au Pôle Nord ! Mais voilà, comment rouler au milieu de tous ces morses ? Et bien, c’est simple, on fonce dessus à toute vitesse, et on écrase ! Mais là, tout de même, on se dit qu’une Ford T avec une roulotte écrasant des morses de 3 mètres de long et qui pèsent une tonne, c’est tout de même un peu difficile à croire. Heureusement, par le biais de l’astucieux Walter Graham, Emilio Salgari nous explique comment c’est tout de même possible : les morses n’étant que des tas de graisse, leurs peaux n’ont aucune résistance, et elles éclatent sous les roues comme des vessies de porc. Par contre, toute la graisse s’échappant avec le sang, la glace devient glissante (car elle ne l’était pas avant), et il faut faire très attention en roulant.
On croit atteindre le fond, mais on n’y est pas encore, car au bout de quelques kilomètres sur la banquise, Gaston, Walter et Dick tombent sur… un mammouth. Ben oui ! Pourquoi n’y aurait-il pas de mammouths au Pôle Nord ? Ce sont des pachydermes de l’ère glaciaire, non ?
Ce mammouth, furieux d’être dérangé, se saisit avec sa trompe de Dick Mac Leod, le secoue bien fort, et le projette violemment à terre. S'emparant de leurs fusils, Gaston et Walter parviennent à tuer le mammouth, et sauvent le mécanicien, lequel, reconnaissant, leur avoue qu’il a été payé par Torpon pour saboter le voyage. Nos héros en sont tellement affectés qu’ils en oublient de se découper un steak de mammouth. En tout cas, Dick promet qu’il ne tentera plus rien contre ceux auxquels il doit la vie.
Enfin, les trois hommes parviennent au point de rendez-vous en même temps que Torpon. Celui-ci, enragé que tant de chemin ne parvienne pas plus à le départager de Montcalm, exige de se battre en duel sur un "glacier" voisin. Par "glacier", Emilio Salgari entend en fait un petit iceberg au bord de la banquise. Mais à peine les deux hommes sont-ils montés sur ce "glacier" que, déséquilibré comme le serait un glaçon sur lequel on poserait une olive, le "glacier" bascule, « se retourne » et les deux hommes tombent à l’eau. Walter et Dick plongent pour les sauver. Walter parvient à ramener Gaston, mais hélas, Dick Mac Leod se noie avec Torpon.
Faute d'adversaire, Gaston de Montcalm plante sur un piton de glace le drapeau français (et on se demande bien pourquoi, puisqu'il est canadien), actant sa victoire au défi, et sa conquête du Pôle Nord.
Victoire et conquête un peu amères, certes, mais il ne sert à rien de se lamenter, et quoiqu’un peu frigorifiés, car « l’eau n’est pas chaude » (sic), Gaston et Walter remontent en voiture et rentrent à Montréal. Un trajet retour expédié en deux pages, et qui n’est marqué par aucune aventure. Il faut dire qu’ayant tué et mangé tous les êtres vivants à l’aller, ils ne risquaient pas de croiser quoi que ce soit au retour.
La victoire de Montcalm étant attestée, Miss Ellen Perkins l’accueille avec émotion comme son futur mari, mais refroidi par le peu d’empathie dont elle fait preuve en apprenant la mort de Torpon et de Dick Mac Leod, Gaston de Montcalm rejette l’offre de mariage d’Ellen et lui débite cette tirade sublime : « Les femmes qui exigent des victimes et qui poussent les hommes à se tuer n’ont jamais fait fortune au Canada. Cherchez un mari parmi vos compatriotes. »
On l’aura compris, « Un Défi au Pôle Nord » est un très réjouissant nanar littéraire, où Emilio Salgari donne le meilleur de son art et de son savoir-faire, avec un rythme enlevé et frétillant. Si l’intrigue est assez prévisible et les personnages très stéréotypés, l’imagination baroque de Salgari, comme ce Pôle Nord naïf et hautement farfelu où il nous entraîne, donnent à ce roman une dimension onirique, que le temps a recouvert depuis d’une fine couche de dérision qui en rehausse la beauté désuète et la douce folie.
On frissonne peu à la lecture de ces aventures polaires, mais on sourit souvent, et on rit franchement à plusieurs reprises. À cela s’ajoutent une critique étonnamment précoce du "self-made-man" à l’américaine, toujours d'actualité, et le surprenant refus de l’auteur à céder à une happy-end romantique.
Dérisoire, pathétique mais engagé et rebelle : c’est bien ainsi que l’on aime Emilio Salgari, dont ce roman polaire méconnu est à classer parmi ses plus grandes réussites.
Référence absolue du roman d’aventures exotiques en Italie, Emilio Salgari fut l’un des auteurs les plus productifs de la Belle-Époque, et même l’un des rares à continuer à publier des romans près de vingt ans après sa mort, étant sous contrat avec un éditeur peu scrupuleux qui continua à sortir sous le nom de Salgari des romans « à la manière de » écrits par des nègres littéraires.
Aisément comparable à notre Jules Verne national, quoique plus proche du côté "nanardesque" de seconds couteaux comme Paul d’Ivoi ou Louis Boussenard, Emilio Salgari différenciait de ses éminents prédécesseurs français par un point crucial, fort original pour son temps : il était vigoureusement anticolonial.
Il eût été compliqué pour lui de s’attaquer à la colonisation italienne sans risquer la censure, aussi la plupart de ses romans sont-ils situés dans les colonies britanniques, c’est-à-dire principalement dans l’Hindoustan (la région englobant l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et une partie du défunt empire mongol), ainsi que toute l’Asie du Sud-Est sous domination anglaise (Indonésie, Philippines, Malaisie, etc…).
Il fut l’un des premiers à donner les rôles principaux de ses romans à des indigènes et non à des colons occidentaux, qui ont d’ailleurs souvent le mauvais rôle dans ses récits. Très souvent, même, il chante la résistance héroïque de natifs indépendantistes contre l’occupant colonial, comme ce fut le cas dans son cycle romanesque le plus célèbre, celui du pirate malais « Sandokan », qui fut adapté de très nombreuses fois au cinéma, à la télévision, et même encore il y a quelques années, en dessin animé. « Sandokan » fut relativement populaire en France grâce au feuilleton italo-franco-allemand éponyme, produit en 1976 et diffusé en France sur TF1 jusqu’au début des années 80, mais qui n’est en réalité que l’adaptation du premier des 12 volumes du cycle de « Sandokan », dont uniquement 5 tomes furent publiés en français.
Beaucoup d’éditeurs français tentèrent de traduire les romans de Salgari, mais tous échouèrent à populariser ici cet auteur italien dont, il faut avouer, l’humanisme vibrant ne fait pas oublier un style souvent morne et bâclé. Face à nos propres écrivains dans le genre, souvent plus soignés et plus imaginatifs, Emilio Salgari a toujours fait pâle figure. Ses positions anticoloniales n’ont sans doute pas dû séduire beaucoup les jeunes français, très fiers de leur empire colonial. Mais cet élément est peut-être sans doute plus mineur qu’on ne le pense, puisqu’à partir des années 20, on publia- sans davantage de succès - les "faux" romans posthumes attribués à Emilio Salgari, qui généralement, étaient très favorables au colonialisme, et ne respectaient pas les véritables opinions de l'auteur.
De nature casanière et travaillant exclusivement à partir d’encyclopédies qui n’étaient pas toujours très sérieuses ou vraiment à jour, Emilio Salgari souffrait aussi, par rapport à Jules Verne, Paul d’Ivoi ou Louis Boussenard, d’un contenu pédagogique souvent limité à la simple géographie ou à quelques considérations ethnologiques peu fiables. Aussi, Salgari devient facilement risible quand il s’égare de manière délirante en descriptions botaniques ou en comportements animaliers, mais loin de lui nuire, cet à-peu-près, souvent nourri de naïveté positive, lui a longtemps accordé l'attention d’un public enfantin qui se laissait volontiers prendre à ses candeurs narratives.
C’est aussi pour cela qu’en France, Emilio Salgari fut principalement publié dans des collections pour la jeunesse, bien que ses romans ne s’adressaient à la base à aucun public en particulier. Ce fut le cas pour « Les Naufragés de la Djumna » (1897), qui fut traduit en français en 1902 chez l’éditeur Charles Delagrave, spécialiste de manuels scolaires et de publications diverses destinées à l’enseignement, et toujours en activité de nos jours.
On s’étonnera de cette initiative qui, sans nul doute, coûta fort cher à l’éditeur et ne lui rapporta guère, car « Les Naufragés de la Djumna » fut publié dans une édition "géante" de la taille d’un atlas, avec une couverture renforcée par une plaque rigide (peut-être même métallique) et un luxueux papier singulièrement épais, l’ensemble pesant pas loin de 3 kilos ! C'est quand même très lourd pour les mains d’un enfant, et encore plus lourd pour le brochage, lequel avec le temps, a lourdement souffert du poids de tout ce qu’il était censé retenir. Il est hélas devenu presque impossible de trouver ce volume dans un excellent état, tant, dans sa conception même, sa fabrication luxueuse n’avait pas la solidité requise pour traverser les années.
Mieux encore, on se demande encore ce qui a motivé une édition si luxueuse, avec une maquette de couverture très Art Nouveau et des illustrations crayonnées par le peintre Eugène Trigoulet, car assurément, « Les Naufragés de la Djumna » n’est ni un chef d’œuvre, ni l’un des meilleurs romans de son auteur.
L’action se situe tout d’abord au Bengale, à Calcutta, alors que deux colons anglais Oliver et Harry, chassent les oies en pleine migration sur la rivière Bhagirati. Oliver parvient à abattre deux de ces volatiles, quand en récupérant l’un d’eux, il trouve sous son aile un petit rouleau de bois contenant un manuscrit, et qui était noué à l’aile de l’oiseau par un fil mince. Le manuscrit contient l’appel au secours d’un dénommé Ali Middel, capitaine d’un petit navire de commerce nommé « La Djumna », et qui, si l’on en croit, est victime d’une mutinerie visant à piller le bateau, menée par deux fripouilles, Hungre et Garrovi, qui se sont faits embaucher comme marins à la seule fin de s’emparer du navire. Enfermé dans sa cabine, le capitaine consigne les évènements dans son journal de bord, dont ces pages ont été arrachées.
Tout laisse à croire que « Le Djumna » a fait naufrage dans les environs des Îles Adamanes (aujourd’hui appelées Andaman & Nicobar), un petit archipel à l’est de l’Inde qui s’étire du nord au sud, depuis la pointe sud de la péninsule birmane de Rangoun jusqu’à la pointe nord de l’île de Sumatra. Aujourd’hui, la majeure partie de ces îles et îlots sont habités, reliés entre eux par des ponts et traversés par une grande route du nord au sud durant plus de 1000 kilomètres. Depuis le tsunami de 2004, qui les a durement touchées mais a fait parler d’elles, les îles Andaman & Nicobar se sont développées sur le plan touristique, pour faire face à une demande croissante.
Cependant, à la fin du XIXème siècle, cet archipel était encore à l’état sauvage, et habité seulement par des tribus primitives hostiles aux étrangers (du moins au nord, car le sud et la capitale de Port-Blair étaient occupés par les colons britanniques, qui y avaient construit une vaste prison où étaient exilés et enfermés tous les opposants politiques, mais Emilio Salgari semble ne pas avoir eu connaissance de cela, car il situe le naufrage à l’extrême sud, près de l’île dite « Petite Andamane »).
La perspective donc d’un naufrage dans les parages de l’île laisse l’espoir de possibles survivants qui ont pu gagner les îles, mais ont forcément besoin de secours. Oliver et Harry se rendent à « L’Inde Nouvelle », la Compagnie Maritime qui employait le capitaine. Celle-ci avertit la police qui, après une enquête diligente, constate que le fameux Garrovi, l’un des deux mutinés, est revenu à Calcutta, apparemment fort riche, et y vit en pacha.
La police arraisonne le bandit, et le traîne en prison. Là, Garrovi raconte son histoire : il avait corrompu tout l’équipage de Malabares pour pouvoir s’emparer du navire. Seuls le capitaine et Sciapal, son assistant, n’étaient pas du complot. Enfermés dans la cabine, ils ne gênaient pas les mutinés, qui projetaient de détourner « La Djumna » jusqu'à Chandernagor, quand le navire s’est soudainement échoué sur un banc de sable.
« La Djumna » était dotée d’une pinasse, sorte de petit navire à moteur servant de canot de sauvetage amélioré. Il ne pouvait contenir tout l’équipage, mais Garrovi avait son idée. Préparant le soir le repas pour ses complices, il glissa dans leurs assiettes un poison violent, et se retrouva ainsi le seul survivant. Transportant le maximum de marchandises dans la pinasse, il partit à son bord, et après deux semaines, parvint à rejoindre Chandernagor, où il vendit à prix d’or ses marchandises volées, puis il rentra à Calcutta pour y mener la belle vie.
Une telle série de crimes mérite amplement la mort en Inde, mais Oliver et Harry, appuyés par le directeur de « L’Inde Nouvelle », proposent au condamné une alternative : monter une expédition de sauvetage, guidée par Garrovi, pour secourir Ali Riddel. En échange de sa participation, Garrovi aura droit à la vie sauve. Pour autant, il ne sera pas en croisière de plaisance, et voyagera à fonds de cale, surveillé par des policiers. Le fourbe accepte sa proposition mais encore une fois, il a son idée.
Le bateau affrété par « l’Inde Nouvelle » part donc un matin en direction de la Petite Adamane. Comme prévu, Garrovi reste enfermé dans la cale jusqu’à ce qu’on ait besoin de lui. On lui a juste mis à disposition sa malle de vêtements qu’il avait réclamée. Mais cette malle ne contient pas que des vêtements : il y a aussi dedans une petite fille, une petite orpheline bengalaise que Garrovi avait recueilli dans la misère, et dont il a fait son âme damnée. Narsinga est petite et très menue. Elle parvient à se glisser par les tuyaux d’aération, et à s’évader nuitamment de la cale afin de saboter le navire. Elle finit par créer un incendie, qui dévore une grande partie du bateau. Par charité, on délivre Garrovi de la cale. Alors, prenant Narsinga sous son bras, il court vers le pont, et se jette par-dessus bord. Il sait mieux que personne que le navire va couler, grâce aux bons soins, pas encore découverts, de Narsinga, et tient à gagner l’île avant eux, afin de leur tendre des pièges, et de tous les éliminer.
Hélas pour lui, au cours de son plongeon, Garrovi se blesse grièvement la jambe. Il parvient à gagner l’île, mais marche difficilement, et doit rester immobile en permanence. Narsinga est envoyée quotidiennement à la cueillette des fruits et des baies, afin de que le père et la fille puissent se nourrir.
C’est à ce moment-là que le récit quitte, temporairement, le naufrage de l’expédition de secours, pour revenir, quelques mois plus tôt, au premier naufrage, celui de « La Djumna », navire échoué et abandonné, avec tous ses cadavres, dont le capitaine Ali Riddel, son chien fidèle, et Sciapal, qui s’était dissimulé dans la cale, sont désormais les seuls naufragés en vie. Ils gagnent l’île toute proche, et dès lors, leur quête pour survivre, contre les animaux sauvages, les pièges de la nature et les tribus hostiles, devient l’unique sujet du livre, presque jusqu'à ses dernières pages. Puis les deux hommes rencontrent la petite Narsinga, sympathisent avec elle, et grâce à eux, elle comprend que son père adoptif est un méchant homme auquel elle a eu tort d’obéir. Le lien finira par se faire, après moults aventures, avec la nouvelle équipe de naufragés, et tous ensemble, au fil des jours, ils dégageront « La Djumna » de son banc de sable, et repartiront tous ensemble dessus. Quant à Garrovi, dont Salgari ne sait finalement plus quoi faire après l’avoir rendu impotent et donc inutile, il est retrouvé par le chien d’Ali Riddel, et tout bonnement égorgé par l’animal. Et voilà !
Bien qu’assez ouvertement inspiré des « Enfants du Capitaine Grant » de Jules Verne, et quoi qu’il soit en majeure partie une robinsonnade un peu éculée, « Les Naufragés de la Djumna » aurait pu être un excellent livre si Emilio Salgari avait su trouver le rythme parfait pour son récit. Mais tout cela nous est raconté très platement, pour ne pas dire distraitement, et quelque peu alourdi par une traduction française un peu trop méridionale, où sont placés dans la bouche de Bengalais quelques expressions ou formules plus typiques de Perpignan que de Calcutta. Néanmoins, il y a quelques passages très réussis, dont la scène mythique où Ali Riddel et son assistant Sciapal se retrouvent cernés dans une clairière par une meute de serpents (car vous n’êtes pas sans ignorer, j’en suis certain, que les serpents chassent en troupeaux) et n’ont que le temps de se réfugier dans un arbre, tandis que les reptiles en font le siège avec un assez admirable sens de l’organisation. Bien que totalement farfelue, cette scène, qui s’étale quand même sur plus d’une dizaine de pages, est rédigée avec un certain sens du suspense, et une grande énergie narrative, laquelle réveille à temps le lecteur en train de s’assoupir.
Toutefois, si le roman ne tient pas toutes ses promesses, il se laisse agréablement lire, et se révèle très moral et très pédagogique, dans le sens où le jeune lecteur ou la jeune lectrice profite de la leçon de vie donnée à la petite Narsinga, qui apprend que ce n’est pas parce qu’on aime les gens de sa famille qu’ils ne sont pas des êtres méprisables, et qu’il faut juger les autres sur leurs actes et non pas sur la place qu’ils ont dans notre vie (Ce n’était pas dans la Bibliothèque Rose qu’on pouvait lire quelque chose comme ça).
À noter enfin que les Éditions de Londres ont réédité ce roman en 2013 en format numérique, avec la plupart des illustrations d’Eugène Trigoulet, agrémenté d’une préface instruite, quoique tissant des liens plus que discutables avec les œuvres d’Hugo Pratt ou de Sergio Leone, mais qui a le mérite de rendre ce texte disponible pour quelques euros, ce qui est toujours appréciable vu la rareté et la cotation de l’ouvrage d’origine.
Aisément comparable à notre Jules Verne national, quoique plus proche du côté "nanardesque" de seconds couteaux comme Paul d’Ivoi ou Louis Boussenard, Emilio Salgari différenciait de ses éminents prédécesseurs français par un point crucial, fort original pour son temps : il était vigoureusement anticolonial.
Il eût été compliqué pour lui de s’attaquer à la colonisation italienne sans risquer la censure, aussi la plupart de ses romans sont-ils situés dans les colonies britanniques, c’est-à-dire principalement dans l’Hindoustan (la région englobant l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et une partie du défunt empire mongol), ainsi que toute l’Asie du Sud-Est sous domination anglaise (Indonésie, Philippines, Malaisie, etc…).
Il fut l’un des premiers à donner les rôles principaux de ses romans à des indigènes et non à des colons occidentaux, qui ont d’ailleurs souvent le mauvais rôle dans ses récits. Très souvent, même, il chante la résistance héroïque de natifs indépendantistes contre l’occupant colonial, comme ce fut le cas dans son cycle romanesque le plus célèbre, celui du pirate malais « Sandokan », qui fut adapté de très nombreuses fois au cinéma, à la télévision, et même encore il y a quelques années, en dessin animé. « Sandokan » fut relativement populaire en France grâce au feuilleton italo-franco-allemand éponyme, produit en 1976 et diffusé en France sur TF1 jusqu’au début des années 80, mais qui n’est en réalité que l’adaptation du premier des 12 volumes du cycle de « Sandokan », dont uniquement 5 tomes furent publiés en français.
Beaucoup d’éditeurs français tentèrent de traduire les romans de Salgari, mais tous échouèrent à populariser ici cet auteur italien dont, il faut avouer, l’humanisme vibrant ne fait pas oublier un style souvent morne et bâclé. Face à nos propres écrivains dans le genre, souvent plus soignés et plus imaginatifs, Emilio Salgari a toujours fait pâle figure. Ses positions anticoloniales n’ont sans doute pas dû séduire beaucoup les jeunes français, très fiers de leur empire colonial. Mais cet élément est peut-être sans doute plus mineur qu’on ne le pense, puisqu’à partir des années 20, on publia- sans davantage de succès - les "faux" romans posthumes attribués à Emilio Salgari, qui généralement, étaient très favorables au colonialisme, et ne respectaient pas les véritables opinions de l'auteur.
De nature casanière et travaillant exclusivement à partir d’encyclopédies qui n’étaient pas toujours très sérieuses ou vraiment à jour, Emilio Salgari souffrait aussi, par rapport à Jules Verne, Paul d’Ivoi ou Louis Boussenard, d’un contenu pédagogique souvent limité à la simple géographie ou à quelques considérations ethnologiques peu fiables. Aussi, Salgari devient facilement risible quand il s’égare de manière délirante en descriptions botaniques ou en comportements animaliers, mais loin de lui nuire, cet à-peu-près, souvent nourri de naïveté positive, lui a longtemps accordé l'attention d’un public enfantin qui se laissait volontiers prendre à ses candeurs narratives.
C’est aussi pour cela qu’en France, Emilio Salgari fut principalement publié dans des collections pour la jeunesse, bien que ses romans ne s’adressaient à la base à aucun public en particulier. Ce fut le cas pour « Les Naufragés de la Djumna » (1897), qui fut traduit en français en 1902 chez l’éditeur Charles Delagrave, spécialiste de manuels scolaires et de publications diverses destinées à l’enseignement, et toujours en activité de nos jours.
On s’étonnera de cette initiative qui, sans nul doute, coûta fort cher à l’éditeur et ne lui rapporta guère, car « Les Naufragés de la Djumna » fut publié dans une édition "géante" de la taille d’un atlas, avec une couverture renforcée par une plaque rigide (peut-être même métallique) et un luxueux papier singulièrement épais, l’ensemble pesant pas loin de 3 kilos ! C'est quand même très lourd pour les mains d’un enfant, et encore plus lourd pour le brochage, lequel avec le temps, a lourdement souffert du poids de tout ce qu’il était censé retenir. Il est hélas devenu presque impossible de trouver ce volume dans un excellent état, tant, dans sa conception même, sa fabrication luxueuse n’avait pas la solidité requise pour traverser les années.
Mieux encore, on se demande encore ce qui a motivé une édition si luxueuse, avec une maquette de couverture très Art Nouveau et des illustrations crayonnées par le peintre Eugène Trigoulet, car assurément, « Les Naufragés de la Djumna » n’est ni un chef d’œuvre, ni l’un des meilleurs romans de son auteur.
L’action se situe tout d’abord au Bengale, à Calcutta, alors que deux colons anglais Oliver et Harry, chassent les oies en pleine migration sur la rivière Bhagirati. Oliver parvient à abattre deux de ces volatiles, quand en récupérant l’un d’eux, il trouve sous son aile un petit rouleau de bois contenant un manuscrit, et qui était noué à l’aile de l’oiseau par un fil mince. Le manuscrit contient l’appel au secours d’un dénommé Ali Middel, capitaine d’un petit navire de commerce nommé « La Djumna », et qui, si l’on en croit, est victime d’une mutinerie visant à piller le bateau, menée par deux fripouilles, Hungre et Garrovi, qui se sont faits embaucher comme marins à la seule fin de s’emparer du navire. Enfermé dans sa cabine, le capitaine consigne les évènements dans son journal de bord, dont ces pages ont été arrachées.
Tout laisse à croire que « Le Djumna » a fait naufrage dans les environs des Îles Adamanes (aujourd’hui appelées Andaman & Nicobar), un petit archipel à l’est de l’Inde qui s’étire du nord au sud, depuis la pointe sud de la péninsule birmane de Rangoun jusqu’à la pointe nord de l’île de Sumatra. Aujourd’hui, la majeure partie de ces îles et îlots sont habités, reliés entre eux par des ponts et traversés par une grande route du nord au sud durant plus de 1000 kilomètres. Depuis le tsunami de 2004, qui les a durement touchées mais a fait parler d’elles, les îles Andaman & Nicobar se sont développées sur le plan touristique, pour faire face à une demande croissante.
Cependant, à la fin du XIXème siècle, cet archipel était encore à l’état sauvage, et habité seulement par des tribus primitives hostiles aux étrangers (du moins au nord, car le sud et la capitale de Port-Blair étaient occupés par les colons britanniques, qui y avaient construit une vaste prison où étaient exilés et enfermés tous les opposants politiques, mais Emilio Salgari semble ne pas avoir eu connaissance de cela, car il situe le naufrage à l’extrême sud, près de l’île dite « Petite Andamane »).
La perspective donc d’un naufrage dans les parages de l’île laisse l’espoir de possibles survivants qui ont pu gagner les îles, mais ont forcément besoin de secours. Oliver et Harry se rendent à « L’Inde Nouvelle », la Compagnie Maritime qui employait le capitaine. Celle-ci avertit la police qui, après une enquête diligente, constate que le fameux Garrovi, l’un des deux mutinés, est revenu à Calcutta, apparemment fort riche, et y vit en pacha.
La police arraisonne le bandit, et le traîne en prison. Là, Garrovi raconte son histoire : il avait corrompu tout l’équipage de Malabares pour pouvoir s’emparer du navire. Seuls le capitaine et Sciapal, son assistant, n’étaient pas du complot. Enfermés dans la cabine, ils ne gênaient pas les mutinés, qui projetaient de détourner « La Djumna » jusqu'à Chandernagor, quand le navire s’est soudainement échoué sur un banc de sable.
« La Djumna » était dotée d’une pinasse, sorte de petit navire à moteur servant de canot de sauvetage amélioré. Il ne pouvait contenir tout l’équipage, mais Garrovi avait son idée. Préparant le soir le repas pour ses complices, il glissa dans leurs assiettes un poison violent, et se retrouva ainsi le seul survivant. Transportant le maximum de marchandises dans la pinasse, il partit à son bord, et après deux semaines, parvint à rejoindre Chandernagor, où il vendit à prix d’or ses marchandises volées, puis il rentra à Calcutta pour y mener la belle vie.
Une telle série de crimes mérite amplement la mort en Inde, mais Oliver et Harry, appuyés par le directeur de « L’Inde Nouvelle », proposent au condamné une alternative : monter une expédition de sauvetage, guidée par Garrovi, pour secourir Ali Riddel. En échange de sa participation, Garrovi aura droit à la vie sauve. Pour autant, il ne sera pas en croisière de plaisance, et voyagera à fonds de cale, surveillé par des policiers. Le fourbe accepte sa proposition mais encore une fois, il a son idée.
Le bateau affrété par « l’Inde Nouvelle » part donc un matin en direction de la Petite Adamane. Comme prévu, Garrovi reste enfermé dans la cale jusqu’à ce qu’on ait besoin de lui. On lui a juste mis à disposition sa malle de vêtements qu’il avait réclamée. Mais cette malle ne contient pas que des vêtements : il y a aussi dedans une petite fille, une petite orpheline bengalaise que Garrovi avait recueilli dans la misère, et dont il a fait son âme damnée. Narsinga est petite et très menue. Elle parvient à se glisser par les tuyaux d’aération, et à s’évader nuitamment de la cale afin de saboter le navire. Elle finit par créer un incendie, qui dévore une grande partie du bateau. Par charité, on délivre Garrovi de la cale. Alors, prenant Narsinga sous son bras, il court vers le pont, et se jette par-dessus bord. Il sait mieux que personne que le navire va couler, grâce aux bons soins, pas encore découverts, de Narsinga, et tient à gagner l’île avant eux, afin de leur tendre des pièges, et de tous les éliminer.
Hélas pour lui, au cours de son plongeon, Garrovi se blesse grièvement la jambe. Il parvient à gagner l’île, mais marche difficilement, et doit rester immobile en permanence. Narsinga est envoyée quotidiennement à la cueillette des fruits et des baies, afin de que le père et la fille puissent se nourrir.
C’est à ce moment-là que le récit quitte, temporairement, le naufrage de l’expédition de secours, pour revenir, quelques mois plus tôt, au premier naufrage, celui de « La Djumna », navire échoué et abandonné, avec tous ses cadavres, dont le capitaine Ali Riddel, son chien fidèle, et Sciapal, qui s’était dissimulé dans la cale, sont désormais les seuls naufragés en vie. Ils gagnent l’île toute proche, et dès lors, leur quête pour survivre, contre les animaux sauvages, les pièges de la nature et les tribus hostiles, devient l’unique sujet du livre, presque jusqu'à ses dernières pages. Puis les deux hommes rencontrent la petite Narsinga, sympathisent avec elle, et grâce à eux, elle comprend que son père adoptif est un méchant homme auquel elle a eu tort d’obéir. Le lien finira par se faire, après moults aventures, avec la nouvelle équipe de naufragés, et tous ensemble, au fil des jours, ils dégageront « La Djumna » de son banc de sable, et repartiront tous ensemble dessus. Quant à Garrovi, dont Salgari ne sait finalement plus quoi faire après l’avoir rendu impotent et donc inutile, il est retrouvé par le chien d’Ali Riddel, et tout bonnement égorgé par l’animal. Et voilà !
Bien qu’assez ouvertement inspiré des « Enfants du Capitaine Grant » de Jules Verne, et quoi qu’il soit en majeure partie une robinsonnade un peu éculée, « Les Naufragés de la Djumna » aurait pu être un excellent livre si Emilio Salgari avait su trouver le rythme parfait pour son récit. Mais tout cela nous est raconté très platement, pour ne pas dire distraitement, et quelque peu alourdi par une traduction française un peu trop méridionale, où sont placés dans la bouche de Bengalais quelques expressions ou formules plus typiques de Perpignan que de Calcutta. Néanmoins, il y a quelques passages très réussis, dont la scène mythique où Ali Riddel et son assistant Sciapal se retrouvent cernés dans une clairière par une meute de serpents (car vous n’êtes pas sans ignorer, j’en suis certain, que les serpents chassent en troupeaux) et n’ont que le temps de se réfugier dans un arbre, tandis que les reptiles en font le siège avec un assez admirable sens de l’organisation. Bien que totalement farfelue, cette scène, qui s’étale quand même sur plus d’une dizaine de pages, est rédigée avec un certain sens du suspense, et une grande énergie narrative, laquelle réveille à temps le lecteur en train de s’assoupir.
Toutefois, si le roman ne tient pas toutes ses promesses, il se laisse agréablement lire, et se révèle très moral et très pédagogique, dans le sens où le jeune lecteur ou la jeune lectrice profite de la leçon de vie donnée à la petite Narsinga, qui apprend que ce n’est pas parce qu’on aime les gens de sa famille qu’ils ne sont pas des êtres méprisables, et qu’il faut juger les autres sur leurs actes et non pas sur la place qu’ils ont dans notre vie (Ce n’était pas dans la Bibliothèque Rose qu’on pouvait lire quelque chose comme ça).
À noter enfin que les Éditions de Londres ont réédité ce roman en 2013 en format numérique, avec la plupart des illustrations d’Eugène Trigoulet, agrémenté d’une préface instruite, quoique tissant des liens plus que discutables avec les œuvres d’Hugo Pratt ou de Sergio Leone, mais qui a le mérite de rendre ce texte disponible pour quelques euros, ce qui est toujours appréciable vu la rareté et la cotation de l’ouvrage d’origine.
Si le monde de l'édition du XXIème siècle ne nous offre majoritairement que des oeuvres d'une grande médiocrité, il faut soutenir néanmoins les quelques éditeurs contemporains qui prennent le risque commercial et idéologique d'exhumer des oeuvres rares et oubliées, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la pertinence de certains choix.
Ainsi, saluons l'éditeur Michel Lafon, peu habitué aux rééditions de classiques, pour avoir exhumé ce roman de 1904 signé par l'écrivain de romans d'aventure Emilio Salgari, très excessivement présenté comme le Jules Verne italien. En réalité, Emilio Salgari était plutôt un auteur de romans d'aventure farfelus et nanardesques, comparable aux auteurs français Paul d'Ivoi ou Louis Boussenard. Néanmoins, il est vrai que c'est une figure majeure du roman populaire en Italie, en partie par son abondante bibliographie, difficile à attribuer, puisque son éditeur ayant été un homme peu scrupuleux, les deux tiers des romans publiés sous le nom d'Emilio Salgari sont sortis après la mort de l'écrivain, rédigés par des nègres littéraires plus ou moins inventifs, poussant souvent encore plus loin la dimension nanardesque de Salgari.
En France, Emilio Salgari a été peu traduit. On retrouve néanmoins un certain nombre de romans publiés en France dans les années 1910 à 1930, mais ce sont majoritairement des ouvrages posthumes probablement écrits par d'autres mains.
Salgari reste néanmoins renommé dans toute l'Europe pour une série de romans autour du personnage de Sandokan, le pirate malaisien, dont le premier volume fut l'objet en 1976 d'une série télévisée italo-franco-allemande qui fit les beaux jours de Récré A2, ainsi que d'une séquelle dans les années 90 plus confidentiellement diffusée sur des chaines câblées. Néanmoins, aussi curieux que cela puisse paraître, le succès de cette série n'entraîna pas une nouvelle traduction française des romans d'Emilio Salgari.
C'est dire si la publication française du roman « I Figli dell'Aria », en 2019 aux éditions Michel Lafon, passa relativement inaperçue, mais n'en fut pas moins un évènement qui faisait redécouvrir l'oeuvre de Salgari au public français, et ce pour la première fois depuis pas loin de 80 ans.
Il faut souligner le travail magistral des deux traductrices, Ismène Cotensin-Gourrier et Cécile Terreaux-Scotto, qui non seulement ont su retrouver le style énergique et lapidaire propre à Salgari, mais se sont échinées, à l'aide de plusieurs consultants ethnologues, spécialiste de l'histoire chinoise ou du monde asiatique, à resituer et à redonner en bas de pages les exactitudes de noms de tous les toponymes du continent asiatique abordés dans ce roman. Un travail colossal, et peut-être hélas un peu vain dans le sens où Emilio Salgari ne travaillait qu'à partir de cartes d'encyclopédie, de récits de voyages, et n'a voulu témoigner ni de la réalité absolue d'une région du monde où il n'a jamais mis le pied, ni d'une érudition personnelle longuement acquise. La preuve en est qu'au final, près de la moitié dès lieux et coutumes prêtés aux pays dont parle Salgari ne sont que pure invention de sa part. L'auteur va même jusqu'à inventer une chaîne de montagnes là où il n'y en a pas.
L'intrigue de ces « Aventuriers du Ciel » est assez simple : A Pékin, deux négociants russes en thé chinois se retrouvent accusés injustement du meurtre de leurs fournisseurs, chez lequel ils passaient la nuit. Tout cela étant un piège destiné à les faire accuser, Fiodor et Rokoff, sortes de prototypes Belle-Époque de Terence Hill et Bud Spencer, finissent très logiquement sur l'échafaud, mais à l'instant où ils vont être exécutés, un mystérieux engin volant apparait au-dessus d'eux et des aéronautes en jaillissent pour les délivrer, tandis que les chinois, persuadés que l'aéroplane est une sorte de dragon, s'enfuient apeurés.
Dès ce moment, « Les Aventuriers du Ciel » suit plus ou moins l'intrigue de « Vingt Mille Lieues sous les Mers » de Jules Verne, à la différence qu'il ne s'agit pas d'un sous-marin mais d'un aéroplane pouvant voler à la vitesse quasi supersonique de 20 km/h. Invités forcés de ce prodige de technologie, Fiodor et Rokoff vont partager durant quelques mois les aventures de cet équipage mystérieux.
"L'Épervier" est assez bien reproduit sur la couverture d'après la description qu'en fait Salgari : un avion mécanique que surplombent de gigantesques ailes de chauve-souris qui battent l'air, pour une raison assez étrange, étant donné qu'à partir du moment où il y a un moteur, n'est-ce pas ?...
Mais une chose est sûre, lorsque ces ailes sont endommagées, l'appareil ne peut plus voler et doit atterrir d'urgence. L'avion est alimenté par l'électricité qu'il génère lui-même, ce qui fait qu'il peut voler des semaines entières sans nécessiter le moindre ravitaillement. Pour les vivres et l'équipage, il y a la chasse, et un système révolutionnaire de congélation des aliments qui, pour le coup, est assez prophétique.
Tout le reste au sujet de cet aéroplane est assez flou, à commencer par ses dimensions. À la base, "L'Épervier" n'est pas censé être plus grand qu'un aéroplane basique de 1904, mais il s'y trouve quand même quatre ou cinq chambres à coucher, un coin cuisine, une ample terrasse où l'on peut déjeuner à plusieurs en admirant le panorama, et des réserves pratiquement inépuisables de vivres, d'armes et de munitions.
Ces quelques imprécisions mises à part, le roman est une suite d'aventures qui naissent de la nécessité d'atterrir pour l'équipage de "L'Épervier", soit par des envies de chasse, soit par suite d'une avarie. Dès lors, à terre, l'aéroplane et son équipage sont fragilisés, à la merci des troupes tartares, des troupeaux de yacks furieux ou des moines tibétains sanguinaires. Oui, sanguinaires, car avant que la Chine n'occupent le territoire des pacifistes tibétains, il était assez répandu dans la littérature populaire de décrire ces derniers comme une secte de fanatiques religieux capables des pires exactions.
Toutes ces mini-aventures, vraisemblablement improvisées, s'enchaînent à un rythme frénétique sans avoir de liens entre elles, et sans véritablement mener nulle part. Il est bien question que le Commandant de "L'Épervier" ramène les deux hommes chez eux, mais il se plait en leur compagnie, et réciproquement, jusqu'à la dernière page où, finalement, il les dépose avant de continuer sa route, sans voir répondu à aucune de leurs questions sur la fonction première de cet aéroplane, ni sur le pays dont est originaire le Commandant.
Salgari a bien compris que le charme du Capitaine Nemo venait précisément du flou qu'il laisse peser sur ses intentions. Hélas, son très aimable Commandant est loin d'égaler en charisme l'antihéros de Jules Verne. La psychologie n'a d'ailleurs jamais été le fort d'Emilio Salgari, dont les personnages se résument le plus souvent à des héros très héroïques, des méchants très méchants, et des fourbes très fourbes. Déjà fort rares dans ses autres romans, les femmes sont ici totalement absentes. Aucune romance à l'horizon : juste de la fraternité entre vrais mâles, entrecoupée de massacres d'animaux et de populations sauvages. Sur ce point-là d'ailleurs, il est amusant de voir qu'en 2019, on censure allègrement toutes les oeuvres littéraires jugées racistes envers les populations africaines, mais en ce qui concerne les populations asiatiques, pas de problèmes, on peut y aller à fond ! Entre la fourberie des chinois et le primitivisme souvent mystique des populations de l'Empire Mongol, Emilio Salgari, qu'on a pourtant connu pourtant plus respectueux des autochtones, se lâche volontiers sur ces populations lointaines, avec lesquelles il faut, selon lui, effrayer le lecteur incrédule.
Pourtant, bien que ce soit assez peu dans ces habitudes, il est vrai qu'Emilio Salgari, peut-être conscient d'être parmi les premiers à aborder littérairement le continent asiatique dans toute son étendue, se montre étonnamment pédagogue et prolixe. C'est en partie pour cela que son livre flirte avec les 500 pages, lui qui affectionne plutôt les romans courts. Mais outre que, comme le démontrent fort bien les traductrices, ses cours de géographie sont assez peu fiables et en partie imaginaires, « Les Aventuriers du Ciel » souffre de longueurs et de nombreux piétinements, qui accentuent le vide scénaristique. Car oui, il n'y a pas grand-chose dans ce roman, des gens qui volent et qui atterrissent, d'autres qui les capturent et dont ils se libèrent. Les aventures mêmes sont assez prévisibles. C'est surtout le talent d'Emilio Salgari qui lui pêrmet de créer un suspense, une tension narrative, un rythme soutenu qui accroche le lecteur. Mais les trouvailles de ce roman – mis à part "L'Épervier" lui-même - restent assez pauvres, et peut-être eût-il mieux valu traduire les « Sandokan » dans leur intégralité, chose qui n'a jamais été faite en France, d'autant plus qu'ils pourraient rencontrer un écho favorable, puisque cette série de romans sont parmi les plus féroces envers la colonisation occidentale, ce qui était très inhabituel à l'époque.
À côté de bien des oeuvres essentielles d'Emilio Salgari, le choix de ce roman relativement anecdotique était tout de même discutable. Pas sûr d'ailleurs qu'il ait beaucoup attiré l'attention. Mais l'initiative, en tout cas, est à soutenir et à encourager, tant pour les romans d'Emilio Salgari que pour d'autres auteurs de romans populaires européens de la Belle-Époque dont les oeuvres parfois remarquables sont en passe de tomber dans l'oubli.
Ainsi, saluons l'éditeur Michel Lafon, peu habitué aux rééditions de classiques, pour avoir exhumé ce roman de 1904 signé par l'écrivain de romans d'aventure Emilio Salgari, très excessivement présenté comme le Jules Verne italien. En réalité, Emilio Salgari était plutôt un auteur de romans d'aventure farfelus et nanardesques, comparable aux auteurs français Paul d'Ivoi ou Louis Boussenard. Néanmoins, il est vrai que c'est une figure majeure du roman populaire en Italie, en partie par son abondante bibliographie, difficile à attribuer, puisque son éditeur ayant été un homme peu scrupuleux, les deux tiers des romans publiés sous le nom d'Emilio Salgari sont sortis après la mort de l'écrivain, rédigés par des nègres littéraires plus ou moins inventifs, poussant souvent encore plus loin la dimension nanardesque de Salgari.
En France, Emilio Salgari a été peu traduit. On retrouve néanmoins un certain nombre de romans publiés en France dans les années 1910 à 1930, mais ce sont majoritairement des ouvrages posthumes probablement écrits par d'autres mains.
Salgari reste néanmoins renommé dans toute l'Europe pour une série de romans autour du personnage de Sandokan, le pirate malaisien, dont le premier volume fut l'objet en 1976 d'une série télévisée italo-franco-allemande qui fit les beaux jours de Récré A2, ainsi que d'une séquelle dans les années 90 plus confidentiellement diffusée sur des chaines câblées. Néanmoins, aussi curieux que cela puisse paraître, le succès de cette série n'entraîna pas une nouvelle traduction française des romans d'Emilio Salgari.
C'est dire si la publication française du roman « I Figli dell'Aria », en 2019 aux éditions Michel Lafon, passa relativement inaperçue, mais n'en fut pas moins un évènement qui faisait redécouvrir l'oeuvre de Salgari au public français, et ce pour la première fois depuis pas loin de 80 ans.
Il faut souligner le travail magistral des deux traductrices, Ismène Cotensin-Gourrier et Cécile Terreaux-Scotto, qui non seulement ont su retrouver le style énergique et lapidaire propre à Salgari, mais se sont échinées, à l'aide de plusieurs consultants ethnologues, spécialiste de l'histoire chinoise ou du monde asiatique, à resituer et à redonner en bas de pages les exactitudes de noms de tous les toponymes du continent asiatique abordés dans ce roman. Un travail colossal, et peut-être hélas un peu vain dans le sens où Emilio Salgari ne travaillait qu'à partir de cartes d'encyclopédie, de récits de voyages, et n'a voulu témoigner ni de la réalité absolue d'une région du monde où il n'a jamais mis le pied, ni d'une érudition personnelle longuement acquise. La preuve en est qu'au final, près de la moitié dès lieux et coutumes prêtés aux pays dont parle Salgari ne sont que pure invention de sa part. L'auteur va même jusqu'à inventer une chaîne de montagnes là où il n'y en a pas.
L'intrigue de ces « Aventuriers du Ciel » est assez simple : A Pékin, deux négociants russes en thé chinois se retrouvent accusés injustement du meurtre de leurs fournisseurs, chez lequel ils passaient la nuit. Tout cela étant un piège destiné à les faire accuser, Fiodor et Rokoff, sortes de prototypes Belle-Époque de Terence Hill et Bud Spencer, finissent très logiquement sur l'échafaud, mais à l'instant où ils vont être exécutés, un mystérieux engin volant apparait au-dessus d'eux et des aéronautes en jaillissent pour les délivrer, tandis que les chinois, persuadés que l'aéroplane est une sorte de dragon, s'enfuient apeurés.
Dès ce moment, « Les Aventuriers du Ciel » suit plus ou moins l'intrigue de « Vingt Mille Lieues sous les Mers » de Jules Verne, à la différence qu'il ne s'agit pas d'un sous-marin mais d'un aéroplane pouvant voler à la vitesse quasi supersonique de 20 km/h. Invités forcés de ce prodige de technologie, Fiodor et Rokoff vont partager durant quelques mois les aventures de cet équipage mystérieux.
"L'Épervier" est assez bien reproduit sur la couverture d'après la description qu'en fait Salgari : un avion mécanique que surplombent de gigantesques ailes de chauve-souris qui battent l'air, pour une raison assez étrange, étant donné qu'à partir du moment où il y a un moteur, n'est-ce pas ?...
Mais une chose est sûre, lorsque ces ailes sont endommagées, l'appareil ne peut plus voler et doit atterrir d'urgence. L'avion est alimenté par l'électricité qu'il génère lui-même, ce qui fait qu'il peut voler des semaines entières sans nécessiter le moindre ravitaillement. Pour les vivres et l'équipage, il y a la chasse, et un système révolutionnaire de congélation des aliments qui, pour le coup, est assez prophétique.
Tout le reste au sujet de cet aéroplane est assez flou, à commencer par ses dimensions. À la base, "L'Épervier" n'est pas censé être plus grand qu'un aéroplane basique de 1904, mais il s'y trouve quand même quatre ou cinq chambres à coucher, un coin cuisine, une ample terrasse où l'on peut déjeuner à plusieurs en admirant le panorama, et des réserves pratiquement inépuisables de vivres, d'armes et de munitions.
Ces quelques imprécisions mises à part, le roman est une suite d'aventures qui naissent de la nécessité d'atterrir pour l'équipage de "L'Épervier", soit par des envies de chasse, soit par suite d'une avarie. Dès lors, à terre, l'aéroplane et son équipage sont fragilisés, à la merci des troupes tartares, des troupeaux de yacks furieux ou des moines tibétains sanguinaires. Oui, sanguinaires, car avant que la Chine n'occupent le territoire des pacifistes tibétains, il était assez répandu dans la littérature populaire de décrire ces derniers comme une secte de fanatiques religieux capables des pires exactions.
Toutes ces mini-aventures, vraisemblablement improvisées, s'enchaînent à un rythme frénétique sans avoir de liens entre elles, et sans véritablement mener nulle part. Il est bien question que le Commandant de "L'Épervier" ramène les deux hommes chez eux, mais il se plait en leur compagnie, et réciproquement, jusqu'à la dernière page où, finalement, il les dépose avant de continuer sa route, sans voir répondu à aucune de leurs questions sur la fonction première de cet aéroplane, ni sur le pays dont est originaire le Commandant.
Salgari a bien compris que le charme du Capitaine Nemo venait précisément du flou qu'il laisse peser sur ses intentions. Hélas, son très aimable Commandant est loin d'égaler en charisme l'antihéros de Jules Verne. La psychologie n'a d'ailleurs jamais été le fort d'Emilio Salgari, dont les personnages se résument le plus souvent à des héros très héroïques, des méchants très méchants, et des fourbes très fourbes. Déjà fort rares dans ses autres romans, les femmes sont ici totalement absentes. Aucune romance à l'horizon : juste de la fraternité entre vrais mâles, entrecoupée de massacres d'animaux et de populations sauvages. Sur ce point-là d'ailleurs, il est amusant de voir qu'en 2019, on censure allègrement toutes les oeuvres littéraires jugées racistes envers les populations africaines, mais en ce qui concerne les populations asiatiques, pas de problèmes, on peut y aller à fond ! Entre la fourberie des chinois et le primitivisme souvent mystique des populations de l'Empire Mongol, Emilio Salgari, qu'on a pourtant connu pourtant plus respectueux des autochtones, se lâche volontiers sur ces populations lointaines, avec lesquelles il faut, selon lui, effrayer le lecteur incrédule.
Pourtant, bien que ce soit assez peu dans ces habitudes, il est vrai qu'Emilio Salgari, peut-être conscient d'être parmi les premiers à aborder littérairement le continent asiatique dans toute son étendue, se montre étonnamment pédagogue et prolixe. C'est en partie pour cela que son livre flirte avec les 500 pages, lui qui affectionne plutôt les romans courts. Mais outre que, comme le démontrent fort bien les traductrices, ses cours de géographie sont assez peu fiables et en partie imaginaires, « Les Aventuriers du Ciel » souffre de longueurs et de nombreux piétinements, qui accentuent le vide scénaristique. Car oui, il n'y a pas grand-chose dans ce roman, des gens qui volent et qui atterrissent, d'autres qui les capturent et dont ils se libèrent. Les aventures mêmes sont assez prévisibles. C'est surtout le talent d'Emilio Salgari qui lui pêrmet de créer un suspense, une tension narrative, un rythme soutenu qui accroche le lecteur. Mais les trouvailles de ce roman – mis à part "L'Épervier" lui-même - restent assez pauvres, et peut-être eût-il mieux valu traduire les « Sandokan » dans leur intégralité, chose qui n'a jamais été faite en France, d'autant plus qu'ils pourraient rencontrer un écho favorable, puisque cette série de romans sont parmi les plus féroces envers la colonisation occidentale, ce qui était très inhabituel à l'époque.
À côté de bien des oeuvres essentielles d'Emilio Salgari, le choix de ce roman relativement anecdotique était tout de même discutable. Pas sûr d'ailleurs qu'il ait beaucoup attiré l'attention. Mais l'initiative, en tout cas, est à soutenir et à encourager, tant pour les romans d'Emilio Salgari que pour d'autres auteurs de romans populaires européens de la Belle-Époque dont les oeuvres parfois remarquables sont en passe de tomber dans l'oubli.
« L'Émeraude de Ceylan » fait partie des quelques ouvrages traduits et publiés dans les années 30 par la Comtesse de Gencé pour la collection « Les Belles Aventures » des éditions Albin Michel.
Comme souvent avec Salgari, il est difficile de dire s'il s'agit bien d'un ouvrage écrit de son vivant, ou d'un roman apocryphe rédigé par des nègres littéraires sur la demande de son éditeur après la mort de l'écrivain.
Toujours est-il que ce livre-ci est une plongée extrêmement envoûtante dans un Orient de pacotille et de carton pâte, où malgré un souci ponctuel de faire connaître cette région du monde, tout y est décrit de manière assez farfelue.
L'action se déroule, au début du roman, au royaume de Siam (l'actuelle Thaïlande), en un temps inconnu mais qui ressemble fort à l'Inde du XIXème siècle. le héros de cette aventure, Somoa-Krab, est le fils du dresseur d'éléphants Yang-Thar, fournisseur officiel du Mandarin (?) Cham-Chee-Wee. Somoa-Krab est fiancé à la très belle Dhavinia, que convoite l'ignoble grand chambellan du Mandarin, le sinistre Sampon-Laya. Pour discréditer son rival, Sampon-Laya fait prendre une drogue à l'éléphant Moa-Bir, que Yang-Thar et son fils sont venus présenter au Mandarin. Sous l'effet de cette drogue, Moa-Bir est pris d'une crise de folie, alors que le Prince, fils du Mandarin, le chevauche pour l'étrenner. L'éléphant finit par s'effondrer au sol, écrasant le Prince (Royal ? Mandarinal ?) sous son poids. Fou de douleur, son père, le Mandarin Cham-Chee-Wee, fait emprisonner Yang-Thar et le condamne à être exécuté par son propre éléphant, qui lui broiera la tête de sa patte.
La honte de cette mort absurde retombe sur Somoa-Krab, qui ne peut plus épouser Dhavinia en étant devenu bien malgré lui le fils d'un assassin d'un membre de l'aristocratie mandarino-siamoise. (Vous suivez ?)
Somoa-Krab propose alors un pacte au Mandarin : s'il lui accorde six mois, il promet d'aller à Ceylan (l'actuel Sri-Lanka) et de ramener l'Émeraude Sacrée, dite "Tête D'Éléphant", cachée dans le Temple de Bouddha du Pic d'Adam. L'endroit est inaccessible et fort bien gardé. le pari semble impossible, aussi le Mandarin l'accepte-t-il avec ironie, bien que le lecteur soit en droit se demander en quoi la possession de cette émeraude pourrait consoler le Mandarin de la mort de son fils unique, mais bon, ne compliquons pas les choses avec de dérisoires considérations psychologiques !
Somoa-Krab part donc pour un Sri-Lanka qui ressemble surtout au Tibet, où il aboutira après une longue quête chargée d'embûches, en compagnie de son serviteur fidèle Kalon et d'un marin cambodgien appelé Nankon, qui lui est venu en aide lors d'une tentative de piraterie. Hélas, en réalité, Nankon est l'âme damnée du cruel Sampon-Laya, et sa mission est d'assister Somoa-Krab jusqu'à ce qu'il s'empare de l'émeraude, puis de la lui voler pour la remettre personnellement au grand chambellan, qui la remplacera par une copie grossière en verre, faisant croire au Mandarin que Somoa-Krab a voulu se moquer de lui...
L'intrigue, on le voit, est à la fois rocambolesque, emberlificotée et pas crédible un seul instant. D'où effectivement le rythme trépidant de ce petit roman, qui enchaîne les aventures toutes plus improbables les unes que les autres avec une frénésie qui a comme premier souci de parvenir à ce que chaque nouvelle aventure empêche le lecteur de réfléchir au réalisme de celle qui précède. La méthode était sans doute plus efficace en 1934 qu'elle ne l'est aujourd'hui : il faut vraiment avoir gardé une âme incroyablement candide pour apprécier ce roman au premier degré. Néanmoins, au second degré, il se laisse lire comme une aventure de Tintin (l'humour en moins, mais l'exubérance italienne en plus), même si Emilio Salgari - ou son héritier - a fait mieux par le passé.
En effet, malgré ce condensé d'action et d'aventures très rythmé et sans temps mort, il manque peut-être à cette « Émeraude de Ceylan » une petite touche de folie burlesque qu'on a pu déjà croiser dans d'autres livres du même auteur. Là, on sent que, soucieux de rendre crédible aux yeux de ses lecteurs une civilisation peu connue, y compris de lui-même, Emilio Salgari se sent moins à l'aise que lorsqu'il évolue dans des contrées exotiques déjà bien exploitées en littérature ou dans l'imaginaire collectif.
Ceci dit, « L'Émeraude de Ceylan » ne manque pas de certains passages truculents, mais le rythme effréné de cette quête de l'émeraude empêche qu'on se sente vraiment installé dans ce récit bien trop houleux. Payé à la ligne et assez misérablement, Emilio Salgari n'a eu que très peu l'occasion de prendre son temps pour écrire, ne se relisait pas, et beaucoup de ses romans témoignent encore de l'urgence et du stress de leur auteur. À ce titre, « L'Émeraude de Ceylan » est clairement un de ses romans les plus stressés, et donc indirectement, les plus stressants. Mais le débit imaginatif de Salgari, son art d'installer pièges et rebondissements au risque de s'y perdre lui-même, fait que même s'il semble un peu bâclé, son roman témoigne de cette impressionnante force narrative et de l'engagement total de l'auteur dans son récit, deux des qualités essentielles du génie à la fois douteux et fascinant d'Emilio Salgari.
On ne peut que regretter qu'il n'y ait que si peu d'oeuvres d'Emilio Salgari qui aient été traduites en français, tant ses romans, même s'ils ne sont pas toujours très bons, portent encore en eux cette richesse frénétique de la narration que l'on cherchera en vain dans d'autres auteurs du genre, et qui confère à sa littérature, aussi bon marché soit-elle, un caractère vraiment unique.
Comme souvent avec Salgari, il est difficile de dire s'il s'agit bien d'un ouvrage écrit de son vivant, ou d'un roman apocryphe rédigé par des nègres littéraires sur la demande de son éditeur après la mort de l'écrivain.
Toujours est-il que ce livre-ci est une plongée extrêmement envoûtante dans un Orient de pacotille et de carton pâte, où malgré un souci ponctuel de faire connaître cette région du monde, tout y est décrit de manière assez farfelue.
L'action se déroule, au début du roman, au royaume de Siam (l'actuelle Thaïlande), en un temps inconnu mais qui ressemble fort à l'Inde du XIXème siècle. le héros de cette aventure, Somoa-Krab, est le fils du dresseur d'éléphants Yang-Thar, fournisseur officiel du Mandarin (?) Cham-Chee-Wee. Somoa-Krab est fiancé à la très belle Dhavinia, que convoite l'ignoble grand chambellan du Mandarin, le sinistre Sampon-Laya. Pour discréditer son rival, Sampon-Laya fait prendre une drogue à l'éléphant Moa-Bir, que Yang-Thar et son fils sont venus présenter au Mandarin. Sous l'effet de cette drogue, Moa-Bir est pris d'une crise de folie, alors que le Prince, fils du Mandarin, le chevauche pour l'étrenner. L'éléphant finit par s'effondrer au sol, écrasant le Prince (Royal ? Mandarinal ?) sous son poids. Fou de douleur, son père, le Mandarin Cham-Chee-Wee, fait emprisonner Yang-Thar et le condamne à être exécuté par son propre éléphant, qui lui broiera la tête de sa patte.
La honte de cette mort absurde retombe sur Somoa-Krab, qui ne peut plus épouser Dhavinia en étant devenu bien malgré lui le fils d'un assassin d'un membre de l'aristocratie mandarino-siamoise. (Vous suivez ?)
Somoa-Krab propose alors un pacte au Mandarin : s'il lui accorde six mois, il promet d'aller à Ceylan (l'actuel Sri-Lanka) et de ramener l'Émeraude Sacrée, dite "Tête D'Éléphant", cachée dans le Temple de Bouddha du Pic d'Adam. L'endroit est inaccessible et fort bien gardé. le pari semble impossible, aussi le Mandarin l'accepte-t-il avec ironie, bien que le lecteur soit en droit se demander en quoi la possession de cette émeraude pourrait consoler le Mandarin de la mort de son fils unique, mais bon, ne compliquons pas les choses avec de dérisoires considérations psychologiques !
Somoa-Krab part donc pour un Sri-Lanka qui ressemble surtout au Tibet, où il aboutira après une longue quête chargée d'embûches, en compagnie de son serviteur fidèle Kalon et d'un marin cambodgien appelé Nankon, qui lui est venu en aide lors d'une tentative de piraterie. Hélas, en réalité, Nankon est l'âme damnée du cruel Sampon-Laya, et sa mission est d'assister Somoa-Krab jusqu'à ce qu'il s'empare de l'émeraude, puis de la lui voler pour la remettre personnellement au grand chambellan, qui la remplacera par une copie grossière en verre, faisant croire au Mandarin que Somoa-Krab a voulu se moquer de lui...
L'intrigue, on le voit, est à la fois rocambolesque, emberlificotée et pas crédible un seul instant. D'où effectivement le rythme trépidant de ce petit roman, qui enchaîne les aventures toutes plus improbables les unes que les autres avec une frénésie qui a comme premier souci de parvenir à ce que chaque nouvelle aventure empêche le lecteur de réfléchir au réalisme de celle qui précède. La méthode était sans doute plus efficace en 1934 qu'elle ne l'est aujourd'hui : il faut vraiment avoir gardé une âme incroyablement candide pour apprécier ce roman au premier degré. Néanmoins, au second degré, il se laisse lire comme une aventure de Tintin (l'humour en moins, mais l'exubérance italienne en plus), même si Emilio Salgari - ou son héritier - a fait mieux par le passé.
En effet, malgré ce condensé d'action et d'aventures très rythmé et sans temps mort, il manque peut-être à cette « Émeraude de Ceylan » une petite touche de folie burlesque qu'on a pu déjà croiser dans d'autres livres du même auteur. Là, on sent que, soucieux de rendre crédible aux yeux de ses lecteurs une civilisation peu connue, y compris de lui-même, Emilio Salgari se sent moins à l'aise que lorsqu'il évolue dans des contrées exotiques déjà bien exploitées en littérature ou dans l'imaginaire collectif.
Ceci dit, « L'Émeraude de Ceylan » ne manque pas de certains passages truculents, mais le rythme effréné de cette quête de l'émeraude empêche qu'on se sente vraiment installé dans ce récit bien trop houleux. Payé à la ligne et assez misérablement, Emilio Salgari n'a eu que très peu l'occasion de prendre son temps pour écrire, ne se relisait pas, et beaucoup de ses romans témoignent encore de l'urgence et du stress de leur auteur. À ce titre, « L'Émeraude de Ceylan » est clairement un de ses romans les plus stressés, et donc indirectement, les plus stressants. Mais le débit imaginatif de Salgari, son art d'installer pièges et rebondissements au risque de s'y perdre lui-même, fait que même s'il semble un peu bâclé, son roman témoigne de cette impressionnante force narrative et de l'engagement total de l'auteur dans son récit, deux des qualités essentielles du génie à la fois douteux et fascinant d'Emilio Salgari.
On ne peut que regretter qu'il n'y ait que si peu d'oeuvres d'Emilio Salgari qui aient été traduites en français, tant ses romans, même s'ils ne sont pas toujours très bons, portent encore en eux cette richesse frénétique de la narration que l'on cherchera en vain dans d'autres auteurs du genre, et qui confère à sa littérature, aussi bon marché soit-elle, un caractère vraiment unique.
Roman d'aventures idéal pour les aficionados de Jules Verne....Deux russes condamnés à mort en Chine pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis sont sauvés par un mystérieux capitaine aux commandes d'une formidable machine volante... s'ensuivent des péripéties hautes en couleurs à travers la Chine et le Tibet....un bon moment de détente et au final une heureuse découverte !!
Fellini , Eco, Ugo Pratt , chez tous et bien d’autres j’ai retrouvé des allusions à Salgari et à son héros Sandokan. Et bien maintenant j’ai fait la connaissance du redoutable prince des pirates . C’est de la littérature populaire , et cela n’a rien de péjoratif : exotisme , passions déchainées et aventures épiques . Beau ténébreux vengeur et belle dame énamourée … C’est du Dumas avec des gestes encore plus larges , des passions encore plus excessives (Italie oblige ) et c’est bien divertissant
"L'Esclave de Madagascar" fait partie des quelques ouvrages traduits et publiés dans les années 30 par la Comtesse de Gencé pour la collection "Les Belles Aventures" des éditions Albin Michel.
Si la plupart de ces romans, publiés bien après le suicide d'Emilio Salgari, sont dus à la plume de nègres littéraires assez peu fidèles à l'esprit anti-colonial de Salgari, il est probable que "L'Esclave de Madagascar" soit, sinon directement rédigé par Salgari, du moins scénarisé par lui peu de temps avant sa mort. On retrouve en effet dans ce roman le goût pour la liberté et pour la rebellion propre au véritable Emilio Salgari, l'auteur toujours révéré en Italie de la saga de Sandokan.
"L'Esclave de Madagascar" est l'un des rares romans coloniaux d'Emilio Salgari, où l'homme blanc n'apparaît quasiment pas. le roman narre les aventures mouvementées et funestes de deux malgaches, Mayunga et sa fiancée Suli, seuls survivants d'une tribu massacrée et réduite en esclavage par le cruel négrier arabe Kaphir. Au terme d'un long voyage jusqu'au Zambèze et de cruelles épreuves, les deux amants échappent à leur statut d'esclaves et entament un long retour à pied vers Madagascar, durant lequel ils devront affronter quantité d'obstacles presque insurmontables : d'autres esclavagistes, des fauves, des pirates, des tribus hostiles, des traîtres, des arbres empoisonnés, jusqu'à leur île natale où, en compagnie d'un ancien esclave évadé qui leur a sauvé la vie et est devenu leur ami, ils pourront y fonder une nouvelle tribu.
Bien que rédigé (et/ou traduit) dans un style médiocre, et ne craignant ni les rebondissements téléphonés, ni les dénouements miraculeux, "L'Esclave de Madagascar" est un roman tout à fait prenant, tant par la frénésie de son rythme, que par la richesse et l'énergie de son imagination. Les personnages sont volontiers stéréotypés - les gentils très gentils, les méchants très méchants et les fourbes très fourbes -, mais Emilio Salgari porte sur les deux héros malgaches de ces tragiques mésaventures un regard d'une infinie tendresse qui parvient à nous les rendre attachants malgré leur inconsistance.
Si l'on dépasse tout ce que ce genre de roman exotique peut avoir de convenu, y compris l'utilisation constante du mot "nègre" qui en ce temps-là n'était pas péjoratif, on se laisse volontiers porter par ce petit joyau insolite de littérature populaire et adolescente, qui témoigne d'une grande maîtrise narrative mise au service d'une morale à la fois romantique et combative, qui démontre à ses jeunes lecteurs l'importance de rester humain, droit et intègre dans un monde hostile, haineux et corrompu, hanté par la domination des faibles par les brutes esclavagistes.
Ni d'une grande profondeur, ni d'une totale superficialité, "L'Esclave de Madagascar" préfigure les bandes dessinées américaines, façon Tarzan, Conan ou Mandrake, qui prendront le relai de cette littérature européenne déjà un peu désuète dans les années 30. De nos jours, ce roman, comme tous ceux d'Emilio Salgari, fait figure d'antiquité d'un autre âge, mais il n'empêche qu'il n'est pas si compliqué que ça - et même tout à fait délicieux - de laisser au vestiaire sa philosophie d'homme urbain du XXIème siècle pour céder avec complaisance à cette histoire pleine d'amour et de fureur qui fit sans doute rêver nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, alors que l'adolescence leur donnait le goût des grands espaces et des aventures lointaines.
Si la plupart de ces romans, publiés bien après le suicide d'Emilio Salgari, sont dus à la plume de nègres littéraires assez peu fidèles à l'esprit anti-colonial de Salgari, il est probable que "L'Esclave de Madagascar" soit, sinon directement rédigé par Salgari, du moins scénarisé par lui peu de temps avant sa mort. On retrouve en effet dans ce roman le goût pour la liberté et pour la rebellion propre au véritable Emilio Salgari, l'auteur toujours révéré en Italie de la saga de Sandokan.
"L'Esclave de Madagascar" est l'un des rares romans coloniaux d'Emilio Salgari, où l'homme blanc n'apparaît quasiment pas. le roman narre les aventures mouvementées et funestes de deux malgaches, Mayunga et sa fiancée Suli, seuls survivants d'une tribu massacrée et réduite en esclavage par le cruel négrier arabe Kaphir. Au terme d'un long voyage jusqu'au Zambèze et de cruelles épreuves, les deux amants échappent à leur statut d'esclaves et entament un long retour à pied vers Madagascar, durant lequel ils devront affronter quantité d'obstacles presque insurmontables : d'autres esclavagistes, des fauves, des pirates, des tribus hostiles, des traîtres, des arbres empoisonnés, jusqu'à leur île natale où, en compagnie d'un ancien esclave évadé qui leur a sauvé la vie et est devenu leur ami, ils pourront y fonder une nouvelle tribu.
Bien que rédigé (et/ou traduit) dans un style médiocre, et ne craignant ni les rebondissements téléphonés, ni les dénouements miraculeux, "L'Esclave de Madagascar" est un roman tout à fait prenant, tant par la frénésie de son rythme, que par la richesse et l'énergie de son imagination. Les personnages sont volontiers stéréotypés - les gentils très gentils, les méchants très méchants et les fourbes très fourbes -, mais Emilio Salgari porte sur les deux héros malgaches de ces tragiques mésaventures un regard d'une infinie tendresse qui parvient à nous les rendre attachants malgré leur inconsistance.
Si l'on dépasse tout ce que ce genre de roman exotique peut avoir de convenu, y compris l'utilisation constante du mot "nègre" qui en ce temps-là n'était pas péjoratif, on se laisse volontiers porter par ce petit joyau insolite de littérature populaire et adolescente, qui témoigne d'une grande maîtrise narrative mise au service d'une morale à la fois romantique et combative, qui démontre à ses jeunes lecteurs l'importance de rester humain, droit et intègre dans un monde hostile, haineux et corrompu, hanté par la domination des faibles par les brutes esclavagistes.
Ni d'une grande profondeur, ni d'une totale superficialité, "L'Esclave de Madagascar" préfigure les bandes dessinées américaines, façon Tarzan, Conan ou Mandrake, qui prendront le relai de cette littérature européenne déjà un peu désuète dans les années 30. De nos jours, ce roman, comme tous ceux d'Emilio Salgari, fait figure d'antiquité d'un autre âge, mais il n'empêche qu'il n'est pas si compliqué que ça - et même tout à fait délicieux - de laisser au vestiaire sa philosophie d'homme urbain du XXIème siècle pour céder avec complaisance à cette histoire pleine d'amour et de fureur qui fit sans doute rêver nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, alors que l'adolescence leur donnait le goût des grands espaces et des aventures lointaines.
« José le Péruvien » fait partie d'une sélection d'oeuvres traduites par la Comtesse de Gencé et publiées par les éditions Albin Michel au début des années 30, et qui, bien qu'attribuées à Emilio Salgari, ont été rédigées longtemps après sa mort par ses anciens collaborateurs et nègres littéraires, et dans un esprit relativement différent de leur modèle. C'est l'éditeur italien qui a entretenu, durant de longues années, le mystère sur la mort de Salgari en transformant son nom en un "house-name" dont les vrais auteurs sont peu faciles à identifier.
« José le Péruvien » est un roman qui se déroule en Australie, ou plus exactement dans une Australie hautement fantaisiste. Suite à un pari entre deux riches colons, José le Péruvien, son ami et futur beau-frère Fernandez et un chasseur mercenaire nommé Lindsay entreprennent la traversée de l'Australie, du nord au sud. Leur périple sera traversé par bien des difficultés, dont l'acharnement d'un indigène anthropophage, Mulga, et d'un rival amoureux, Merual, que José pensait avoir tué avant son départ.
Cette aventure très classique, fortement inspirée de Jules Verne et de Paul d'Ivoi, serait plaisante, si elle n'était aussi complaisamment raciste et peu au fait de son sujet. L'auteur (ou les auteurs) placent ainsi en Australie une multitude de tribus anthropophages hautement farfelues, composées d'hommes noirs de type africain, avec une mâchoire proéminente et des dents extrêmement pointues. Il semble que les colons britanniques au XIXème siècle ont alimenté (c'est le cas de le dire) cette propagande à des fins touristiques, certains villages étant bâtis de toutes pièces pour le frisson des touristes et des explorateurs.
N'ayant jamais mis un pied en Australie, l'écrivain rapporte comme vrais ces racontars d'encyclopédie, et, ce qui est plus grave, en fait le coeur de son aventure et y puise nombre d'informations inexactes ou légendaires, dont il parsème un récit qu'il a tout de même le souci de rendre un minimum pédagogique.
Notons qu'il est principalement question, dans cette aventure, de gloutonnerie, et pas seulement anthropophage. Les trois héros ne pensent qu'à manger, et ils mangent absolument tous les animaux qu'ils rencontrent, du kangourou au perroquet, en passant par les koalas. Les kangourous sont même directement cuits "sous la cendre", intégralement enfouis sous un feu de camp, ce qui est d'ailleurs considéré par l'auteur comme la manière australienne, puisque les anthropophages procèdent de même avec les êtres humains dans les quelques scènes cannibales de ce récit.
Enfin, si le héros de ce roman s'appelle José le Péruvien, c'est simplement parce qu'il est péruvien, ainsi que sa fiancée Marinka et le frère de celle-ci, Fernandez. Que font ces trois Péruviens à Port-Augusta, au sud de l'Australie ? Cela ne sera pas dit...
On l'aura compris : « José le Péruvien » est un navet, mais un navet de compétition ! On le déguste sans déplaisir au second degré. D'ailleurs, l'auteur lui-même est-il si sérieux que ça ? Les blagues récurrentes sur les cannibales laissent penser que ce roman a été écrit par quelqu'un qui s'amusait beaucoup à le rédiger de manière aussi fantaisiste. Néanmoins, la narration reste sérieuse, et l'auteur se donne du mal pour entretenir un suspense qui abonde en rebondissements totalement rocambolesques : enlèvements, plantes suceuses de sang, volcan démoniaque, bagarres avec les kangourous, mine d'or exploitée par des esclaves, cariole tirée par des émeus dressés (?), chariot et bateau piégés, bandits qu'on croyait morts, qui s'en sortis et qui reviennent se venger... Sur bien des plans, on flirte avec la parodie pure d'un genre qui, pourtant, dans les années 1920-1930, commençait à être singulièrement dépassé.
Reste que toute cette abondance d'action narrative ne dissimule guère le caractère plus que minimal de l'intrigue, ni l'absence de profondeur des personnages ou leur manichéisme simpliste, ni surtout le racisme omniprésent, vindicatif, accompagné d'interminables moqueries sur les coutumes ou les croyances des autochtones, ou plus précisément des "singes", comme les appellent le plus souvent nos trois héros, tout en les envoyant dormir avec les boeufs quand ils en accueillent un dans leur petit groupe.
Il faut donc faire abstraction de cette autosatisfaction coloniale et raciste pour apprécier ce roman nanardesque, qui n'est pourtant pas sans charme, de par cette balourdise désuète si fondamentalement italienne, et ce culot affabulateur si sincèrement potache.
« José le Péruvien » est un roman qui se déroule en Australie, ou plus exactement dans une Australie hautement fantaisiste. Suite à un pari entre deux riches colons, José le Péruvien, son ami et futur beau-frère Fernandez et un chasseur mercenaire nommé Lindsay entreprennent la traversée de l'Australie, du nord au sud. Leur périple sera traversé par bien des difficultés, dont l'acharnement d'un indigène anthropophage, Mulga, et d'un rival amoureux, Merual, que José pensait avoir tué avant son départ.
Cette aventure très classique, fortement inspirée de Jules Verne et de Paul d'Ivoi, serait plaisante, si elle n'était aussi complaisamment raciste et peu au fait de son sujet. L'auteur (ou les auteurs) placent ainsi en Australie une multitude de tribus anthropophages hautement farfelues, composées d'hommes noirs de type africain, avec une mâchoire proéminente et des dents extrêmement pointues. Il semble que les colons britanniques au XIXème siècle ont alimenté (c'est le cas de le dire) cette propagande à des fins touristiques, certains villages étant bâtis de toutes pièces pour le frisson des touristes et des explorateurs.
N'ayant jamais mis un pied en Australie, l'écrivain rapporte comme vrais ces racontars d'encyclopédie, et, ce qui est plus grave, en fait le coeur de son aventure et y puise nombre d'informations inexactes ou légendaires, dont il parsème un récit qu'il a tout de même le souci de rendre un minimum pédagogique.
Notons qu'il est principalement question, dans cette aventure, de gloutonnerie, et pas seulement anthropophage. Les trois héros ne pensent qu'à manger, et ils mangent absolument tous les animaux qu'ils rencontrent, du kangourou au perroquet, en passant par les koalas. Les kangourous sont même directement cuits "sous la cendre", intégralement enfouis sous un feu de camp, ce qui est d'ailleurs considéré par l'auteur comme la manière australienne, puisque les anthropophages procèdent de même avec les êtres humains dans les quelques scènes cannibales de ce récit.
Enfin, si le héros de ce roman s'appelle José le Péruvien, c'est simplement parce qu'il est péruvien, ainsi que sa fiancée Marinka et le frère de celle-ci, Fernandez. Que font ces trois Péruviens à Port-Augusta, au sud de l'Australie ? Cela ne sera pas dit...
On l'aura compris : « José le Péruvien » est un navet, mais un navet de compétition ! On le déguste sans déplaisir au second degré. D'ailleurs, l'auteur lui-même est-il si sérieux que ça ? Les blagues récurrentes sur les cannibales laissent penser que ce roman a été écrit par quelqu'un qui s'amusait beaucoup à le rédiger de manière aussi fantaisiste. Néanmoins, la narration reste sérieuse, et l'auteur se donne du mal pour entretenir un suspense qui abonde en rebondissements totalement rocambolesques : enlèvements, plantes suceuses de sang, volcan démoniaque, bagarres avec les kangourous, mine d'or exploitée par des esclaves, cariole tirée par des émeus dressés (?), chariot et bateau piégés, bandits qu'on croyait morts, qui s'en sortis et qui reviennent se venger... Sur bien des plans, on flirte avec la parodie pure d'un genre qui, pourtant, dans les années 1920-1930, commençait à être singulièrement dépassé.
Reste que toute cette abondance d'action narrative ne dissimule guère le caractère plus que minimal de l'intrigue, ni l'absence de profondeur des personnages ou leur manichéisme simpliste, ni surtout le racisme omniprésent, vindicatif, accompagné d'interminables moqueries sur les coutumes ou les croyances des autochtones, ou plus précisément des "singes", comme les appellent le plus souvent nos trois héros, tout en les envoyant dormir avec les boeufs quand ils en accueillent un dans leur petit groupe.
Il faut donc faire abstraction de cette autosatisfaction coloniale et raciste pour apprécier ce roman nanardesque, qui n'est pourtant pas sans charme, de par cette balourdise désuète si fondamentalement italienne, et ce culot affabulateur si sincèrement potache.
Un bon divertissement !
Un roman que nous devons replacer dans son contexte, puisqu'il a été écrit au début des années 1900 !
Nous partons donc sur une fabuleuse machine volante, à la découverte de peuples et de paysages "autochtones" et "sauvages".
C'est frais, enchanteur et badin. Un voyage à la Jules Verne ou à la Marco Polo comme on n'en fait plus, puisqu'il s'agissait de découvrir à proprement parlé le monde : les personnages sont des caricatures avec des yeux d'Européens, autrement dit de "gens civilisés".
Et malgré tout, on y passe un bon moment, dans ce roman d'aventures, on voyage sur cet Epervier fait d'acier avec délice, on redevient enfant, insouciant et exempt de préjugé.
Un roman que nous devons replacer dans son contexte, puisqu'il a été écrit au début des années 1900 !
Nous partons donc sur une fabuleuse machine volante, à la découverte de peuples et de paysages "autochtones" et "sauvages".
C'est frais, enchanteur et badin. Un voyage à la Jules Verne ou à la Marco Polo comme on n'en fait plus, puisqu'il s'agissait de découvrir à proprement parlé le monde : les personnages sont des caricatures avec des yeux d'Européens, autrement dit de "gens civilisés".
Et malgré tout, on y passe un bon moment, dans ce roman d'aventures, on voyage sur cet Epervier fait d'acier avec délice, on redevient enfant, insouciant et exempt de préjugé.
Première lecture des vacances avec "Les aventuriers du ciel", et l'objectif de dépaysement est atteint !
Nous suivons les aventures de deux amis à travers la Chine et le Tibet à bord d'une mystérieuse machine volante dirigée par son non moins mystérieux capitaine.
Tout cela fleure bon le Jules Verne, et on a l'impression de retomber un peu en enfance ! 😄
Alors oui, c'est un roman qui reflète un autre temps (Salgari écrit entre la fin du 19ème et le début du 20ème), notamment dans sa vision des populations "autochtones" (avec des grosses guillemets, entendons nous bien !) ou de la chasse comme art de vivre. Mais en prenant un peu de distance avec tout ça, on arrive à pleinement profiter des péripéties nombreuses et des descriptions des lieux traversés, dont une partie est issue de l'imagination de Salgari, qui n'est jamais sorti d'Italie !
On regrettera un peu la fin du roman, qui nous laisse un peu en plan. Mais quelques recherches m'ont appris qu'il existait une suite, le roi du ciel. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle soit traduite !
En bref, un roman d'aventures dans la lignée de Jules Verne, reflet des préjugés de son époque mais très prenant et dépaysant malgré tout !
Lien : https://instagram.com/Mangeu..
Nous suivons les aventures de deux amis à travers la Chine et le Tibet à bord d'une mystérieuse machine volante dirigée par son non moins mystérieux capitaine.
Tout cela fleure bon le Jules Verne, et on a l'impression de retomber un peu en enfance ! 😄
Alors oui, c'est un roman qui reflète un autre temps (Salgari écrit entre la fin du 19ème et le début du 20ème), notamment dans sa vision des populations "autochtones" (avec des grosses guillemets, entendons nous bien !) ou de la chasse comme art de vivre. Mais en prenant un peu de distance avec tout ça, on arrive à pleinement profiter des péripéties nombreuses et des descriptions des lieux traversés, dont une partie est issue de l'imagination de Salgari, qui n'est jamais sorti d'Italie !
On regrettera un peu la fin du roman, qui nous laisse un peu en plan. Mais quelques recherches m'ont appris qu'il existait une suite, le roi du ciel. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle soit traduite !
En bref, un roman d'aventures dans la lignée de Jules Verne, reflet des préjugés de son époque mais très prenant et dépaysant malgré tout !
Lien : https://instagram.com/Mangeu..
Face à un marché du livre en plein tourment, plusieurs maisons d’éditions font le pari d’exhumer des oeuvres rares et oubliées… C’est notamment le cas des éditions Michel Lafon qui ont fait le choix de publier ce roman de 1904 signé par Emilio Salgari, un écrivain de romans d’aventure, présenté par l’éditeur comme « le Jules Verne italien ». Cette figure majeure du roman populaire en Italie, n’avait jusque là que très peu été traduit en France.
Fiodor et Rokoff, deux négociants des thé russes sont condamnés à mort en Chine pour un meurtre qu’ils n’ont pas commis. Il sont alors sauvés in extremis par un mystérieux capitaine aux commandes d’une formidable machine volante appelée « L’Épervier ». S’ensuivent des péripéties hautes en couleurs à travers la Chine et le Tibet...
« Les Aventuriers du Ciel » s’inscrit dans la même veine que « Vingt Mille Lieues sous les Mers » de Jules Verne, à la différence qu’il ne s’agit ici pas d’un sous-marin mais bien d’un aéroplane pouvant voler à la vitesse de 20 km/h.
Il est bon de replacer ce texte dans son contexte, puisqu’il a été écrit au début des années 1900 ! Le lecteur est embarqué sur cette fabuleuse machine volante pour un voyage à la Jules Verne ou à la Marco Polo comme on n’en fait plus… D’un autre temps au sens propre du terme car les différents personnages rencontrés sont dans le texte de véritables caricatures, vus avec des yeux d’Européens de l’époque, autrement dit de « gens civilisés ». En cela, on peut regretter des descriptions qui ont mal vieilli - quitte parfois même à choquer le lecteur contemporain - notamment dans sa vision des populations « autochtones ».
Si le lecteur arrive à prendre un peu de distance avec tout cela, il pourra pleinement profiter des nombreuses péripéties et descriptions des lieux traversés, dont une partie est issue de l’imagination de Salgari, qui n’est jamais sorti d’Italie !
Soulignons d’ailleurs le travail colossal des deux traductrices, Ismene Cotensin-Gourrier et Cécile Terreaux-Scotto, qui non seulement ont su recréer le style énergique propre à Emilio Salgari, mais surtout se sont échinées, à l'aide de plusieurs spécialistes de l'histoire chinoise et du monde asiatique, à resituer et à corriger en bas de pages les références et toponymes utilisés dans ce roman. Un travail hélas un peu vain dans le sens où Emilio Salgari ne travaillait qu'à partir de cartes d'encyclopédie, de récits de voyages, et n'a jamais voulu témoigner ni de la réalité absolue d'une région du monde où il n'a jamais mis le pied (l’auteur va même jusqu'à inventer une chaîne de montagnes là où il n'y en a pas), ni d'une érudition personnelle longuement acquise.
Ces quelques imprécisions mises à part, on peut surtout regretter un récit qui se contente d’être une suite de mésaventures de l’équipage à la merci des troupes tartares, des troupeaux de yacks furieux ou des moines tibétains sanguinaires. Le seul échappatoire étant à chaque fois : s’échapper dans les airs à l’aide de « L’Épervier ». Toutes ces mini-aventures, souvent invraisemblables, s'enchaînent à un rythme frénétique sans avoir de liens entre elles, et sans véritablement mener nulle part.
Un véritable livre d’aventures, dans le sens le plus classique du terme, qui souffrira pour certains d’une géographie approximative alors que d’autres loueront au contraire une imagination impressionnante. Toujours est-il que « Les Aventuriers du Ciel » souffre de longueurs et de nombreux piétinements, qui accentuent le vide de la trame narrative.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Fiodor et Rokoff, deux négociants des thé russes sont condamnés à mort en Chine pour un meurtre qu’ils n’ont pas commis. Il sont alors sauvés in extremis par un mystérieux capitaine aux commandes d’une formidable machine volante appelée « L’Épervier ». S’ensuivent des péripéties hautes en couleurs à travers la Chine et le Tibet...
« Les Aventuriers du Ciel » s’inscrit dans la même veine que « Vingt Mille Lieues sous les Mers » de Jules Verne, à la différence qu’il ne s’agit ici pas d’un sous-marin mais bien d’un aéroplane pouvant voler à la vitesse de 20 km/h.
Il est bon de replacer ce texte dans son contexte, puisqu’il a été écrit au début des années 1900 ! Le lecteur est embarqué sur cette fabuleuse machine volante pour un voyage à la Jules Verne ou à la Marco Polo comme on n’en fait plus… D’un autre temps au sens propre du terme car les différents personnages rencontrés sont dans le texte de véritables caricatures, vus avec des yeux d’Européens de l’époque, autrement dit de « gens civilisés ». En cela, on peut regretter des descriptions qui ont mal vieilli - quitte parfois même à choquer le lecteur contemporain - notamment dans sa vision des populations « autochtones ».
Si le lecteur arrive à prendre un peu de distance avec tout cela, il pourra pleinement profiter des nombreuses péripéties et descriptions des lieux traversés, dont une partie est issue de l’imagination de Salgari, qui n’est jamais sorti d’Italie !
Soulignons d’ailleurs le travail colossal des deux traductrices, Ismene Cotensin-Gourrier et Cécile Terreaux-Scotto, qui non seulement ont su recréer le style énergique propre à Emilio Salgari, mais surtout se sont échinées, à l'aide de plusieurs spécialistes de l'histoire chinoise et du monde asiatique, à resituer et à corriger en bas de pages les références et toponymes utilisés dans ce roman. Un travail hélas un peu vain dans le sens où Emilio Salgari ne travaillait qu'à partir de cartes d'encyclopédie, de récits de voyages, et n'a jamais voulu témoigner ni de la réalité absolue d'une région du monde où il n'a jamais mis le pied (l’auteur va même jusqu'à inventer une chaîne de montagnes là où il n'y en a pas), ni d'une érudition personnelle longuement acquise.
Ces quelques imprécisions mises à part, on peut surtout regretter un récit qui se contente d’être une suite de mésaventures de l’équipage à la merci des troupes tartares, des troupeaux de yacks furieux ou des moines tibétains sanguinaires. Le seul échappatoire étant à chaque fois : s’échapper dans les airs à l’aide de « L’Épervier ». Toutes ces mini-aventures, souvent invraisemblables, s'enchaînent à un rythme frénétique sans avoir de liens entre elles, et sans véritablement mener nulle part.
Un véritable livre d’aventures, dans le sens le plus classique du terme, qui souffrira pour certains d’une géographie approximative alors que d’autres loueront au contraire une imagination impressionnante. Toujours est-il que « Les Aventuriers du Ciel » souffre de longueurs et de nombreux piétinements, qui accentuent le vide de la trame narrative.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Emilio Salgari
Lecteurs de Emilio Salgari (51)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz sur l´Etranger par Albert Camus
L´Etranger s´ouvre sur cet incipit célèbre : "Aujourd´hui maman est morte...
Et je n´ai pas versé de larmes
Un testament sans héritage
Tant pis
Ou peut-être hier je ne sais pas
9 questions
4758 lecteurs ont répondu
Thème : L'étranger de
Albert CamusCréer un quiz sur cet auteur4758 lecteurs ont répondu