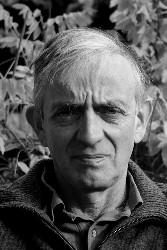Nationalité : France
Né(e) à : Marcq-en-Baroeul
Né(e) à : Marcq-en-Baroeul
Biographie :
Né à Marcq-en-Baroeul, Georges Flipo y vit et y fait toutes ses études jusqu’à 20 ans. Il part ensuite à Paris pour achever ses études à l’Essec, et faire carrière dans la publicité. Ce qui ne l’empêche pas de garder de très solides attaches avec son Nord natal, où il revient chaque mois.
En 2002, à la suite d’un pari, il commence à écrire quelques nouvelles, puis à participer à quelques concours littéraires. Les résultats étant plus que stimulants (plus de 50 concours gagnés), il se lance dans une activité de nouvelliste pour la radio (Radio-France, France Bleu). Près de 70 nouvelles seront ainsi produites et mises en ondes.
Parallèlement, il tente sa chance dans l’édition, avec succès. En 2006, son recueil L’Étage de Dieu est couronné par le prix « Découverte d’un écrivain du Nord – Pas-de-Calais », attribué par Le Furet du Nord. Ce sera pour lui l’étape décisive vers une carrière d’écrivain : il publie désormais un livre par an, travaillant avec deux éditeurs parisiens (Anne Carrière et Le Castor Astral) chez lesquels il alterne recueils de nouvelles et romans.
Début 2007, le premier roman de Georges Flipo, Le Vertige des auteurs sort au Castor Astral, il est finaliste du grand prix de l’Humour noir.
Chacun de ses livres reçoit un excellent accueil de la critique (Le Monde, Le Nouvel Obs, Le Magazine Littéraire, etc.), qui salue la diversité de son inspiration, la fluidité de son style, l’acuité de son regard, et, dans plusieurs de ses livres, la férocité de son humour.
+ Voir plusNé à Marcq-en-Baroeul, Georges Flipo y vit et y fait toutes ses études jusqu’à 20 ans. Il part ensuite à Paris pour achever ses études à l’Essec, et faire carrière dans la publicité. Ce qui ne l’empêche pas de garder de très solides attaches avec son Nord natal, où il revient chaque mois.
En 2002, à la suite d’un pari, il commence à écrire quelques nouvelles, puis à participer à quelques concours littéraires. Les résultats étant plus que stimulants (plus de 50 concours gagnés), il se lance dans une activité de nouvelliste pour la radio (Radio-France, France Bleu). Près de 70 nouvelles seront ainsi produites et mises en ondes.
Parallèlement, il tente sa chance dans l’édition, avec succès. En 2006, son recueil L’Étage de Dieu est couronné par le prix « Découverte d’un écrivain du Nord – Pas-de-Calais », attribué par Le Furet du Nord. Ce sera pour lui l’étape décisive vers une carrière d’écrivain : il publie désormais un livre par an, travaillant avec deux éditeurs parisiens (Anne Carrière et Le Castor Astral) chez lesquels il alterne recueils de nouvelles et romans.
Début 2007, le premier roman de Georges Flipo, Le Vertige des auteurs sort au Castor Astral, il est finaliste du grand prix de l’Humour noir.
Chacun de ses livres reçoit un excellent accueil de la critique (Le Monde, Le Nouvel Obs, Le Magazine Littéraire, etc.), qui salue la diversité de son inspiration, la fluidité de son style, l’acuité de son regard, et, dans plusieurs de ses livres, la férocité de son humour.
Source : www.eulalie.fr
Ajouter des informations
étiquettes
Video et interviews (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Citations et extraits (22)
Voir plus
Ajouter une citation
- C’est fini, c’est fini.
- Comment avez-vous deviné ?
- Je n’ai rien deviné : j’ai simplement constaté que vous aviez gardé mon portable, et je suis venu le reprendre. Là, je vous ai vue partir avec Tolosa. Je ne suis pas assez bon tireur, je n’ai pas osé intervenir tout de suite. C’est quand vous êtes entrée dans le coffre que j’ai pu l’ajuster sans risquer de vous blesser.
Elle se pencha sur Tolosa. Plus exactement sur son cadavre. La balle avait traversé le dos, pile à hauteur du cœur. Monot se sous-estimait, c’était un excellent tireur. Il lui sourit.
Avec tout ça, j’ai raté au moins l’introït de la messe.
Viviane téléphona à la PJ presque à regret. Elle regrettait le moment où il disait « C’est fini ». Elle aurait aimé repartir avec lui, mais elle ne pouvait laisser ce cadavre sur le trottoir, ce n’était pas le jour des encombrants. (p.224)
- Comment avez-vous deviné ?
- Je n’ai rien deviné : j’ai simplement constaté que vous aviez gardé mon portable, et je suis venu le reprendre. Là, je vous ai vue partir avec Tolosa. Je ne suis pas assez bon tireur, je n’ai pas osé intervenir tout de suite. C’est quand vous êtes entrée dans le coffre que j’ai pu l’ajuster sans risquer de vous blesser.
Elle se pencha sur Tolosa. Plus exactement sur son cadavre. La balle avait traversé le dos, pile à hauteur du cœur. Monot se sous-estimait, c’était un excellent tireur. Il lui sourit.
Avec tout ça, j’ai raté au moins l’introït de la messe.
Viviane téléphona à la PJ presque à regret. Elle regrettait le moment où il disait « C’est fini ». Elle aurait aimé repartir avec lui, mais elle ne pouvait laisser ce cadavre sur le trottoir, ce n’était pas le jour des encombrants. (p.224)
Guillermo R. était natif de Séville, vicaire à Séville, aficionado à Séville. Il avait reçu du Seigneur ces trois grâces et les vivait en une confusion fervente : quand approchait la fête de Pâques, en son for intime, il s’apprêtait aussi à fêter la résurrection de la saison des corridas.
D’un pas allègre mais recueilli, il traversait alors le Guadalquivir au pont de San Telmo, empruntait le long paseo Cristóbal Colón et, tremblant d’effusion, s’engouffrait dans la Plaza de Toros de la Maestranza comme on pénètre dans une cathédrale : il venait communier à la joyeuse messe de la mort, l’office noir et chamarré.
(Et à l’heure de notre mort)
C’est le jour du blog de voyage. Joseph l’écrit chez lui, confortablement installé devant son PC. Il s’est servi un café allongé, il a choisi la musique qu’il écoutera ; aujourd’hui ce sera l’intégrale des sonates de Liszt, c’est si agréable de voyager en compagnie de Franz Liszt. Sur sa table traînent des atlas, un dictionnaire français-anglais. Son étagère est pleine de Guides du routard, de Lonely Planet.
Joseph hésite : où partira-t-il cette fois-ci ? Il ouvre l’atlas, surfe sur internet, consulte les blogs de voyage des autres. Tiens, la route de la soie, ce ne serait pas mal. Un peu long, peut-être. Il la prendra à la sortie de la Turquie, ça raccourcira le voyage.
(La route de la soie)
D’un pas allègre mais recueilli, il traversait alors le Guadalquivir au pont de San Telmo, empruntait le long paseo Cristóbal Colón et, tremblant d’effusion, s’engouffrait dans la Plaza de Toros de la Maestranza comme on pénètre dans une cathédrale : il venait communier à la joyeuse messe de la mort, l’office noir et chamarré.
(Et à l’heure de notre mort)
C’est le jour du blog de voyage. Joseph l’écrit chez lui, confortablement installé devant son PC. Il s’est servi un café allongé, il a choisi la musique qu’il écoutera ; aujourd’hui ce sera l’intégrale des sonates de Liszt, c’est si agréable de voyager en compagnie de Franz Liszt. Sur sa table traînent des atlas, un dictionnaire français-anglais. Son étagère est pleine de Guides du routard, de Lonely Planet.
Joseph hésite : où partira-t-il cette fois-ci ? Il ouvre l’atlas, surfe sur internet, consulte les blogs de voyage des autres. Tiens, la route de la soie, ce ne serait pas mal. Un peu long, peut-être. Il la prendra à la sortie de la Turquie, ça raccourcira le voyage.
(La route de la soie)
“Des femmes ? Au nom de la très sainte mixité, on avait tenté d’en nommé quelques unes sous ses ordres. Des gentilles, des teigneuses, des bosseuses, aucune n’avait tenu le coup : dans son équipe la mixité c’était Viviane. Viviane et ses hommes. La gentille, la teigneuse, la bosseuse, c’était elle.”
“Des femmes ? Au nom de la très sainte mixité, on avait tenté d’en nommé quelques unes sous ses ordres. Des gentilles, des teigneuses, des bosseuses, aucune n’avait tenu le coup : dans son équipe la mixité c’était Viviane. Viviane et ses hommes. La gentille, la teigneuse, la bosseuse, c’était elle.”
- Prends-le en photo, Jean-René, m'a dit Mimi, ce sera chouette à montrer au retour.
Elle ne comprenait pas mon personnage, elle ne vivait ce voyage que pour en parler au retour. J'ai remarqué qu'il avait souri, brièvement, en entendant Mimi. La marquise parlait donc français.
Alors, j'ai armé mon appareil, j'ai cadré, puis je me suis arrêté, en lâchant : "Et puis non, finalement, il serait bien trop content." Je l'ai vu tressaillir et je me suis écarté, léger, heureux. Méchant.
in "L'indifférent"
Elle ne comprenait pas mon personnage, elle ne vivait ce voyage que pour en parler au retour. J'ai remarqué qu'il avait souri, brièvement, en entendant Mimi. La marquise parlait donc français.
Alors, j'ai armé mon appareil, j'ai cadré, puis je me suis arrêté, en lâchant : "Et puis non, finalement, il serait bien trop content." Je l'ai vu tressaillir et je me suis écarté, léger, heureux. Méchant.
in "L'indifférent"
Ah Raoul, un prénom démodé qui enchantait Adrien. Il sentait bon le label héréditaire que l’on se passait avec amour, de père en fils aîné, comme une montre de gousset. Célibataire, heureusement, puisqu’il serait appelé à voyager continuellement en France la première année. Une fille dans chaque port, ce serait de son âge. Ou plutôt dans chaque parfumerie, les occasions ne lui manqueraient pas, au garnement, avec les petites vendeuses.
Né à Versailles, le 25 décembre 1988, parfait. Bientôt vingt-quatre ans, Raoul n’avait donc jamais redoublé de classe, il ne s’était permis aucun zigzag dans sa jeune trajectoire. Pas d’erreur d’orientation en début de parcours, pas d’année sabbatique à la sortie, ni de lavage de cerveau dans une quelconque O.N.G – cette abréviation-là, il l’acceptait, il aimait même parler d’« ongue » avant de décoder pour l’interlocuteur perplexe. Pas non plus de fourvoiement dans une éphémère start-up avec des potes. Non, un beau projet de carrière rectiligne. Amusante, cette naissance le 25 décembre. Madame avait dû ressentir les contractions au retour de la messe de minuit. À Saint-Louis ou à Saint-Symphorien, il en aurait juré. Études probables à Notre-Dame du Grandchamp ou au Sacré-Cœur. Pourquoi ne le mentionnait-il pas ? Ah, bien sûr, pour éviter les foudres d’un directeur des relations humaines franc-maçon – il était finaud, le jeune Raoul, il avait déjà compris que ces types-là étaient partout.
Licence de sciences économiques à la faculté de Nanterre. Un autre bon point, et même un double. Il devait être légèrement rebelle, juste assez pour avoir refusé de faire une grande école comme papa. Mieux encore, il était allé se frotter au peuple, à Nanterre, dans une faculté notoirement rouge. Courageux, le petit gars.
Master 2 de marketing à Paris-Dauphine. Rassurant. Après cette descente aux soutes, il était remonté en cabine des officiers, hé, la mixité sociale avait ses limites...
Né à Versailles, le 25 décembre 1988, parfait. Bientôt vingt-quatre ans, Raoul n’avait donc jamais redoublé de classe, il ne s’était permis aucun zigzag dans sa jeune trajectoire. Pas d’erreur d’orientation en début de parcours, pas d’année sabbatique à la sortie, ni de lavage de cerveau dans une quelconque O.N.G – cette abréviation-là, il l’acceptait, il aimait même parler d’« ongue » avant de décoder pour l’interlocuteur perplexe. Pas non plus de fourvoiement dans une éphémère start-up avec des potes. Non, un beau projet de carrière rectiligne. Amusante, cette naissance le 25 décembre. Madame avait dû ressentir les contractions au retour de la messe de minuit. À Saint-Louis ou à Saint-Symphorien, il en aurait juré. Études probables à Notre-Dame du Grandchamp ou au Sacré-Cœur. Pourquoi ne le mentionnait-il pas ? Ah, bien sûr, pour éviter les foudres d’un directeur des relations humaines franc-maçon – il était finaud, le jeune Raoul, il avait déjà compris que ces types-là étaient partout.
Licence de sciences économiques à la faculté de Nanterre. Un autre bon point, et même un double. Il devait être légèrement rebelle, juste assez pour avoir refusé de faire une grande école comme papa. Mieux encore, il était allé se frotter au peuple, à Nanterre, dans une faculté notoirement rouge. Courageux, le petit gars.
Master 2 de marketing à Paris-Dauphine. Rassurant. Après cette descente aux soutes, il était remonté en cabine des officiers, hé, la mixité sociale avait ses limites...
Philippe sentit monter une colère muette et impuissante. Il ne pouvait évidemment plus faire un scandale et réclamer sa chambre pour lui seul, ce serait très désobligeant envers ce Kristofer avec tous ses k qui lui souhaitait la bienvenue. Il ne tenait pas à passer pour xénophobe, d’autant que le chirurgien qui devait l’opérer portait un nom imprononçable, genre tchèque ou slovaque, « mais il est français comme vous et moi », l’avait rassuré son médecin traitant. Kristofer Kask, lui, n’était certainement pas français, en tout cas pas comme vous et moi, il avait un affreux accent venu de nulle part, avec des consonnes finales qui claquaient et d’autres qu’il mouillait.
- C’est très joli, votre accent, vous venez de quel pays ?
- Je suis estonien, mais il y a longtemps que je vis en France.
- Ah, parfait.
Philippe avait hésité à ajouter « J’aime beaucoup l’Estonie », mais il s’en était abstenu, craignant que Kristofer lui demandât ce qu’il aimait en Estonie. Que diable y avait-il à aimer en Estonie ?
- C’est très joli, votre accent, vous venez de quel pays ?
- Je suis estonien, mais il y a longtemps que je vis en France.
- Ah, parfait.
Philippe avait hésité à ajouter « J’aime beaucoup l’Estonie », mais il s’en était abstenu, craignant que Kristofer lui demandât ce qu’il aimait en Estonie. Que diable y avait-il à aimer en Estonie ?
– À quoi pensiez-vous, lieutenant, quand vous avez dit que la police commençait à se faire une idée plus précise de l'auteur des crimes ? C'est quoi, ces révélations ?
– Oh, c'est un truc d'Hercule Poirot, dans Agatha Christie : il lance ça pour paniquer l'assassin, pour le pousser à l'erreur. Et ne dites rien, commissaire, je devine ce que vous pensez.
La commissaire allait quand même déverser le fond de sa pensée sur Hercule Poirot, la littérature policière et ses lecteurs, quand le téléphone de Monot sonna. (page 152)
– Oh, c'est un truc d'Hercule Poirot, dans Agatha Christie : il lance ça pour paniquer l'assassin, pour le pousser à l'erreur. Et ne dites rien, commissaire, je devine ce que vous pensez.
La commissaire allait quand même déverser le fond de sa pensée sur Hercule Poirot, la littérature policière et ses lecteurs, quand le téléphone de Monot sonna. (page 152)
Viviane soupira, heureuse. On ne lui avait pas proposé de siège, ses escarpins lui faisaient mal aux pieds, les miettes de macaron grattaient sa gorge, le champagne lui donnait un léger hoquet, le foie gras remontait avec un goût aigre, mais c'était vraiment une belle soirée (p.22)
Accablée, Viviane rendit le dossier à Monot. Elle avait cru que les médias s'intéressaient aux individus intéressants. Elle avait mal compris : c'était les individus qui se trouvaient intéressants dés qu'ils étaient dans les médias. Le pire, c'était qu'ils le devenaient.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Drôles de Clubs
Pecosa
44 livres
Auteurs proches de Georges Flipo
Quiz
Voir plus
QUESTIONNAIRE LE CID
Qui aime secrètement Rodrigue?(Acte 1)
Chimène
L'infante
Elvire
Leonor
16 questions
521 lecteurs ont répondu
Thème : Le Cid de
Pierre CorneilleCréer un quiz sur cet auteur521 lecteurs ont répondu