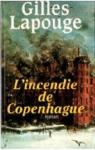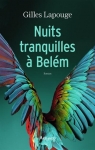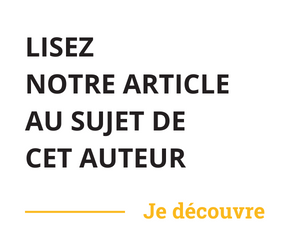Né(e) à : Digne-les-Bains , le 07/11/1923
Mort(e) à : Paris , le 31/07/2020
Gilles Lapouge est un écrivain et journaliste français.
Il passe son enfance en Algérie où son père est militaire. Après des études d'histoire et de géographie, il devient journaliste.
En 1950, il part pour le Brésil. Pendant trois ans, il travaille pour le quotidien brésilien "O Estado de São Paulo", dont il restera le correspondant en France pendant plus de quarante ans. De retour en France, il collabore au Monde, au Figaro Littéraire et à Combat.
Il participe à l'émission de Bernard Pivot "Entre guillemets" qui deviendra "Apostrophes". À France Culture il produit l'émission "Agora" puis "En étrange pays". Il fait partie du comité de rédaction de La Quinzaine littéraire.
Il a reçu de nombreux prix dont le prix des Deux Magots en 1987 ou encore le Grand Prix de la Société des Gens De Lettres en 2007 et le prix Pierre Ier de Monaco pour l'ensemble de son œuvre.
Entretien avec Gilles Lapouge, à propos de son Atlas des paradis perdus
Il y a, dans votre atlas, quatre types de paradis perdus : les jardins, les utopies, la mer et les paradis artificiels. Comment définiriez-vous la notion de "paradis perdu" ? A quel moment l`association des deux termes est-elle apparue ?
L`expression "paradis perdu" est utilisée, popularisée et sans doute forgée par le poète anglais puritain John Milton, au XVIIe siècle, dans un poème maintes fois traduit par les plus grands esprits du temps. En France, Jean Racine et plus tard François-René de Chateaubriand. Mais le thème est bien plus ancien et pour moi, je le repère d`abord dans la Bible et le récit des déboires d`Adam et Eve, ou dans l`histoire du pays de Nod, que presque personne en France ne connaît... On retrouve ce paradis perdu tout au long de la littérature européenne. Et dans nombre de peintures.
Comment est-ce qu`on conçoit un atlas de lieux parfois imaginaires ? On imagine une pléthore de lieux, réels ou imaginaires, qui auraient pu postuler pour une place dans cet atlas. Comment s`est effectuée votre sélection ? Sont-ce des paradis qui vous auraient tenté ou qui vous font, encore aujourd`hui, rêver ?
Je ne me suis pas contenté de réexaminer le récit de la Chute. J`ai jeté un œil sur d`autres images de paradis puisées dans la plupart des religions ou des mythologies (Atlantide) dans l`histoire ou dans nos vies quotidiennes. J`ai interrogé les tentatives incessantes et toujours ratées des hommes pour bâtir des paradis à la mesure des hommes ou des sociétés, ce qu`on appelle les « utopies », ces utopies étant souvent demeurées dans le champ du discours ( Thomas More ) et parfois incarnées dans des sociétés réelles (Godin, La Cecilia, etc.) Conclusion : que les utopies soient inscrites sur du papier ou dans le réel, leur destin est toujours désastreux. Echec généralisé (Phalanstères, La Cecilia, etc.). Je retiens aussi quelques paradis imaginés par le désir ou le songe des hommes, Tahiti vue par Bougainville, etc. Egalement ces paradis que la mer engendre volontiers, soit dans les yeux des pirates ou des marins, soit dans l`émerveillement que les explorateurs éprouvent devant des paysages inconnus et exotiques, avec ananas, poissons inconnus et femmes nues. Il est clair que les songes des marins sont souvent peuplés de femmes, ce qui explique ce thème récurrent dans la cartographie ou le récit : l`île des femmes. J`imagine que dans la littérature de science-fiction, que je ne connais pas, les paradis doivent pulluler, et souvent défaillir.
Les premières cartes et les premières "légendes" de votre atlas sont donc consacrées aux jardins. Le paradis, à l`origine, était-il forcément vu comme un jardin?
De fait, c`est le même mot qui dans la langue persane primitive désigne le jardin et le paradis. Depuis tous les jardins du monde sont hantés par le désir avoué ou dérobé, de créer sur la terre des petits paradis. Pour moi, c`est là un des rares paradis qui ne se sont pas perdus en route et qui perdurent, sous une forme miniaturisée et amputée. J`ajoute dans cette liste de paradis pas tout à fait perdus, des formations chéries des enfants, tel le cirque, j`aurais pu ajouter le corps de leur mère, le corps de la femme etc. mais je ne voulais pas que la psychanalyse me grignote. D`autres paradis brillent par moments dans quelques institutions des hommes, le bordel, le couvent, etc…
Lors d`un entretien pour son livre Jardins de papiers, Evelyne Bloch-Dano nous disait que le jardin reflétait "la nature profonde de celui qui le crée ou le possède et, au-delà de sa personnalité, de la civilisation qui le produit". Les paradis imaginaires, artificiels, rêvés ou recherchés sont-ils eux aussi le reflet des différentes civilisations qui traversent l`Histoire, en même temps que le portrait fidèle des aventuriers ou des rêveurs ayant voulu les arpenter ?
Oui, l`observation d`Evelyne Bloch Dano est exacte. Un seul exemple : je parle d`un jardin exotique, magnifique, créé dans le nord de l`Ecosse, bâti il y a cent ans, comme si ce jardin, regroupant sur les terres brumeuses et inhospitalière de l`Ecosse toutes les variétés de plantes existant sur les cinq continents, était une sorte d`annonciation de la fin du Commonwealth et du rapatriement en Grande Bretagne de cet Empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais.
La mer occupe naturellement une partie importante de l`atlas. Cet espace a-t-il pour vous toujours été synonyme d`aventure, de recherche inépuisable de bonheur ?
Oui, mais surtout au bénéfice de ces mauvais garçons que j`aime bien, les pirates et même les corsaires.
Qu`est-ce qui vous plaît particulièrement, vous, dans cette histoire finalement assez cruelle, de paradis qui inéluctablement s`effondrent, tels le jardin d`Eden ou l`Atlantide ?
Je ne déteste pas les désastres, quand ils ont de la grandeur, du talent, des générosités. Or, si l`histoire des paradis est celle d`un interminable échec, elle ne manque pas du panache qui couronne les entreprises situées au-delà du Bien et du Mal. Ici, ces deux strates incompatibles que sont le Bien et le Mal, avouent leur connivence, qu`elles se nourrissent l`une de l`autre, et qu`elles entrecroisent leurs dessins et leurs couleurs sur le même métier (cf. Fiodor Dostoievski ou Georges Bernanos, ou tous les grands écrivains du Mal, Georges Bataille, Pier Paolo Pasolini ).
C`est l`horloge, cet instrument de mesure décrit par Charles Baudelaire comme un "dieu sinistre, effrayant, impassible" qui conclut l`atlas. Pourquoi ce choix surprenant comme ultime paradis perdu ?
Oui. L`horloge me paraît une des rares utopies réussies. Par exemple, elle est si habile à nous dire le temps qui passe et à le remplacer par un temps hors du temps, un temps morne et immobile à jamais, mortifère. L`homme, par la grâce de cet instrument chargé de dire le temps, expulse le temps et ses beaux déséquilibres. Pas de déséquilibre dans l`horloge, en utopie, au Paradis… Là, tout n`est qu`ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Pauvre Baudelaire, comme ses rêves sont petits ! Le « désordre », cette merveille de la nature et du « vivant » est absent de la rêverie baudelairienne. Or, aujourd`hui, il me paraît que le « désordre » est en danger, soit par l`invasion de l`horloge, soit par les innombrables sous-produits de l`horloge, par exemple l`abominable GPS qui nous prive de la plus grande volupté qui soit, la perte, l`égarement, la preuve que nous sommes des « vivants », c`est à dire des « désordres » et plongé dans le désordre qui est « l`être » de la terre, en dépit des efforts que les géographes poursuivent depuis leur apparition pour faire rentrer dans l`ordre mortifère de leurs mappemondes le chaos de la géographie et de la géologie. L`horloge et ses doubles nous tendent un miroir dans lequel s`annonce le destin que vivra l`humanité le jour où les techniciens, les géomètres, les techniciens, les planificateurs nous auront asservis à leurs lois, (là encore voir Dostoievski).
Gilles Lapouge et ses lectures
Quel est le livre qui vous a donné envie d`écrire ?
Une saison en enfer de Arthur Rimbaud.
Quel est le livre que vous avez honte de ne pas avoir lu ?
Je n`ai pas lu Belle du seigneur d`Albert Cohen, mais je n`en ai pas honte. Je m`en félicite. Ma vraie honte, c`est de n`avoir jamais lu Alexandre Dumas.
Quelle est la perle méconnue que vous souhaiteriez faire découvrir à nos lecteurs?
Toute l`oeuvre du Norvégien Knut Hamsum
Quel est le classique de la littérature dont vous trouvez la réputation surfaite ?
Les Lusiades de Luis de Camoes. Paul Bourget.
Avez-vous une citation fétiche issue de la littérature ?
Un exemple, entre dix mille : « Les plaisirs de la jeunesse, reproduits par la mémoire, sont des ruines vues au flambeau. » Chateaubriand.
Et en ce moment que lisez-vous ?
Je relis certaines oeuvres que je connais, mais jamais dans leur continuité, de manière à voiler l`histoire que ces pages racontent. Par exemple Marcel Proust en miettes, ou William Faulkner en haillons. J`ouvre une page au hasard, et je la savoure, toute seule, loin de son sens. Je lis une page réduite à son vocabulaire, à sa grammaire et à sa syntaxe, amputée de son sens. Pas n`importe quelle grammaire, bien entendu, car celle-ci n‘est jamais qu`un « fauteur d`ordre ». Pour moi, un grand écrivain est celui qui écrit toujours à la limite de l`incorrection, à la limite du « désordre », comme un somnambule au bord d`un toit et qui ne chute jamais.
Découvrez Atlas des paradis perdus de Gilles Lapouge aux éditions Arthaud :

Entretien réalisé par Pierre Krause
Dani Legras, journaliste franco-brésilienne, nous fait le plaisir de nous parler du livre d'Adriana Brandão, "Les Brésiliens à Paris, au fil des siècles et des arrondissements"... Elle évoque pour nous le spirite Allan Kardec, la grande artiste Tarsila do Amaral, la lutte des brésiliens et des brésiliennes contre la dictature militaire ... On a envie de lire et relire ce texte en l'écoutant ! Et de l'utiliser comme la "lanterne magique" évoquée par Gilles Lapouge. Pour plus d'informations sur le livre, veuillez cliquer sur ce lien : https://editionschandeigne.fr/livre/bresiliens-a-paris/https://editionschandeigne.fr/livre/bresiliens-a-paris/
.
J'aime l'âne
.
J’aime l’âne si doux
marchant le long des houx.
Il prend garde aux abeilles
et bouge ses oreilles ;
et il porte les pauvres
et des sacs remplis d’orge.
Il va, près des fossés,
d’un petit pas cassé.
Mon amie le croit bête
parce qu’il est poète.
Il réfléchit toujours.
Ses yeux sont en velours.
Jeune fille au doux cœur,
tu n’as pas sa douceur [...]
Francis Jammes
Un autre député demande la parole. Il est probablement versé dans les sciences de la nature à moins qu’il ne soit producteur de miel. Il objecte. L’abeille risquerait de répandre de mauvais exemples. Dans la société des abeilles, explique le député, le pouvoir est absolu. Pour comble, il est exercé par une reine. Or une reine, la France en possède déjà une et elle s’apprête au surplus à lui couper le cou. L’abeille fut recalée. (p.101)
Enfin, les musiciens, s'ils reconnaissent à la suite de Pythagore que la mélodie du braiment n'est pas une réussite, n'oublient pas que la Grèce primitive façonna ses premières flûtes avec des tibias d'âne. Cela ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs. Ésope ronchonne. Il ne comprend pas qu'on façonne des flûtes avec les ossements d'un animal aussi bouché en musique. (p.78)
le Roi Arthur de Michael Morpurgo
Pourquoi le jeune garçon se retrouve-t-il piégé au milieu de l'océan?
3794 lecteurs ont répondu