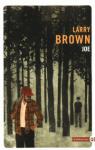Nationalité : États-Unis
Né(e) à : Oxford, Mississipi , le 09/07/1951
Mort(e) à : Oxford, Mississipi , le 24/11/2004
Né(e) à : Oxford, Mississipi , le 09/07/1951
Mort(e) à : Oxford, Mississipi , le 24/11/2004
Biographie :
Larry Brown est un écrivain, auteur de romans noirs.
Après avoir servi dans le Corps des Marines de 1970 à 1972 et exercé de multiples petits boulots (bûcheron, charpentier, peintre, nettoyeur de moquette, tailleur de haies), il fut pompier pendant seize ans jusqu'en 1990.
Il commence à écrire des nouvelles à partir de 1980. Un éditeur remarque un jour une de ses nouvelles dans un magazine et, enthousiasmé par son écriture forte, décide de prendre contact avec lui
Son premier roman est publié en 1989. A partir de 1990, il se consacre à l'écriture. Il enseigne l'écriture dans plusieurs universités.
En quelques années, Larry Brown est reconnu comme un grand romancier, par la critique qui lui décerne de nombreux prix tel le Southern Book Critics Circle Award for Fiction (qu'il est le seul auteur à l'avoir reçu deux fois), comme par les lecteurs.
Il décède d'une crise cardiaque en 2004 à l'age de cinquante trois ans, laissant une œuvre forte et inachevée de six romans, deux recueils de nouvelles, une autobiographie et un essai.
Deux nouvelles et le roman Joe (réalisé par David Gordon Green avec Nicolas Cage) ont été adaptés au cinéma. Il fait un caméo dans le film Big Bad Love d'Arliss Howard en 2001.
+ Voir plusLarry Brown est un écrivain, auteur de romans noirs.
Après avoir servi dans le Corps des Marines de 1970 à 1972 et exercé de multiples petits boulots (bûcheron, charpentier, peintre, nettoyeur de moquette, tailleur de haies), il fut pompier pendant seize ans jusqu'en 1990.
Il commence à écrire des nouvelles à partir de 1980. Un éditeur remarque un jour une de ses nouvelles dans un magazine et, enthousiasmé par son écriture forte, décide de prendre contact avec lui
Son premier roman est publié en 1989. A partir de 1990, il se consacre à l'écriture. Il enseigne l'écriture dans plusieurs universités.
En quelques années, Larry Brown est reconnu comme un grand romancier, par la critique qui lui décerne de nombreux prix tel le Southern Book Critics Circle Award for Fiction (qu'il est le seul auteur à l'avoir reçu deux fois), comme par les lecteurs.
Il décède d'une crise cardiaque en 2004 à l'age de cinquante trois ans, laissant une œuvre forte et inachevée de six romans, deux recueils de nouvelles, une autobiographie et un essai.
Deux nouvelles et le roman Joe (réalisé par David Gordon Green avec Nicolas Cage) ont été adaptés au cinéma. Il fait un caméo dans le film Big Bad Love d'Arliss Howard en 2001.
Source : http://www.polars.org/
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (6)
Voir plusAjouter une vidéo
Michael Farris Smith réussit un polar âpre et brûlant sur les terres du sud des Etats-Unis, à la manière d'un Larry Brown ou d'un William Gay. Mario Condé, le héros désormais fameux de Leonardo Padura, traîne sa nonchalance sous le soleil noir de la mélancolie cubaine. Et Julien Capron nous embarque dans un futur d'autant plus glaçant qu'il est proche de nous. Belle manière, à travers ces trois romans noirs, de prendre la température du monde.
+ Lire la suite
Citations et extraits (105)
Voir plus
Ajouter une citation
Domino savait que la vie se mesure parfois en intervalles qui, bien que minuscules, sont cruciaux. Ainsi, quand on baisse les yeux pendant juste une seconde pour allumer une cigarette alors qu'un véhicule arrive en sens inverse. Ou si on se torche le cul avec le billet de loterie gagnant parce qu'on a pas d'autre papier dans son portefeuille à part des billets de banque. Ou si on est trop pressé de remonter sa braguette et qu'on coince un peu de peau tendre entre les petites dents de laiton et puis qu'on reste là tout seul devant l'urinoir sans pouvoir baisser ou monter la fermeture éclair, qu'on se débat silencieusement en essayant de ne pas hurler.
Une chaude soirée de fin de printemps ou de début d'été, où les branches commençaient à se fondre les unes dans les autres, où tout au loin devenait moins net, jusqu'à ce que la nuit finisse par arriver, que toutes les lumières s'allument et que le jour soit une affaire classée.
Ça fait quelque chose de tuer quelqu’un. Je parle pas d’un chien. Quelqu’un. Une personne, qui parle comme toi, qui mange comme toi, qui a une cervelle comme toi. Une âme comme toi. Et chacun a une façon différente de l’assumer. Parce que c’est pas facile à assumer. C’est un truc que t’oublies pas. Quand t’appuies sur la détente, t’appuies pour l’éternité. C’est pas comme larguer une bombe, quand t’es haut dans le ciel et que tu vois pas ce que ça fait en bas, même si tu sais que ça fait des dégâts.
Tu regardes quelqu’un dans les yeux, puis tu le tues, t’oublies pas ces yeux là. T’oublies pas que t’es la dernière chose qu’il a vue.
Tu regardes quelqu’un dans les yeux, puis tu le tues, t’oublies pas ces yeux là. T’oublies pas que t’es la dernière chose qu’il a vue.
Il se cala contre le siège et la regarda. Elle avait les cheveux lâchésl, complètement défaits, et sa chemise de nuit était ouverte en haut, de sorte qu'il voyait ses seins lourds avec leurs grandes aréoles. Toutes ces nuits où il avait rêvé d'elle, où il s'était endormi en pensant à elle, tous ces jours dans les champs de coton où seule la perspective de cette nuit lui avait permis de tenir jusqu'au soir, tout cela lui ordonnait de descendre de voiture, de prendre sa main, de se recoucher dans son lit, de s'endormir avec elle, dans l'odeur de ses cheveux et de sa peau.
Il tendit la main, fit démarrer la voiture, puis alluma les phares.
Il tendit la main, fit démarrer la voiture, puis alluma les phares.
Le monde est trop grand. Les gens ne savent pas ce que font les autres. Comment tu veux te tenir au courant de tout ce qui se passe ? Y a trop de choses, et trop de gens. Tout ce que tu peux connaitre du monde, c’est la petite place riquiqui que tu occupes.
Mais ça ne lui ferait certainement pas de mal de passer chez Jewel un petit moment. Il n'était pas obligé d'entrer. Il suffisait qu'il fasse venir Jewel dans la voiture quelques minutes. Elle accepterait, probablement. Ca faisait si longtemps. Il ne voulait tout simplement pas être obligé de lui parler du gamin pour l'instant. Il ne voulait pas qu'elle recommence à lui saper le moral avec ça. D'ailleurs, tout n'était pas de sa faute à lui. Il faut être deux pour danser le tango.
Car on se laisse facilement aller, quand on sort avec une femme depuis quelques temps. Et puis il n'avait jamais aimé les capotes. Ca enlève du plaisir. Elle avait toujours insisté pour qu'il les mette, ces putains de machins. Elle en avait, même, et qui sait où elle se les était procurés. Une femme célibataire, dans cette petite ville, n'allait tout simplement pas entrer à la pharmacie pour acheter une boîte de préservatifs. Peut-être son médecin les lui avait-il fournis. Peut-être y avait-il des distributeurs de capotes dans les toilettes pour femmes des stations-service et des bars. Il n'en savait rien. Peut-être était-elle allée jusqu'à Memphis et en avait-elle acheté là où personne ne la connaissait. Il se souvenait qu'ils s'étaient disputés à ce sujet, qu'elle avait pleuré entre des déclarations d'amour. Et puis elle s'excitait et laissait tomber parce qu'il promettait de ne pas finir en elle. Et puis c'était si bon… une erreur, c'est tout. La vie, quoi. Il ne pouvait rien y changer à présent.
Car on se laisse facilement aller, quand on sort avec une femme depuis quelques temps. Et puis il n'avait jamais aimé les capotes. Ca enlève du plaisir. Elle avait toujours insisté pour qu'il les mette, ces putains de machins. Elle en avait, même, et qui sait où elle se les était procurés. Une femme célibataire, dans cette petite ville, n'allait tout simplement pas entrer à la pharmacie pour acheter une boîte de préservatifs. Peut-être son médecin les lui avait-il fournis. Peut-être y avait-il des distributeurs de capotes dans les toilettes pour femmes des stations-service et des bars. Il n'en savait rien. Peut-être était-elle allée jusqu'à Memphis et en avait-elle acheté là où personne ne la connaissait. Il se souvenait qu'ils s'étaient disputés à ce sujet, qu'elle avait pleuré entre des déclarations d'amour. Et puis elle s'excitait et laissait tomber parce qu'il promettait de ne pas finir en elle. Et puis c'était si bon… une erreur, c'est tout. La vie, quoi. Il ne pouvait rien y changer à présent.
Il mit ses chaussettes, remonta son caleçon jusqu'aux hanches, se souvenant d'un grand bébé dans un berceau qui l'avait regardé avec ses grands yeux sombres sous un mobile bon marché qui tournait lentement, des chevaux bleu féeriques aux cornes en tortillon, des soleils orangés, des étoiles jaunes et des petits lapins roses. Un enfant silencieux qui lui ressemblait.
Les gens se battent depuis que Dieu les a faits et ils continueront toujours. Y a que les raisons qui changent, mec.
- Je peux vous acheter une de ces bières ? demanda-t-il.
Joe se retourna et le regarda.
- Quoi ?
- J’ai un peu soif. […] Je peux vous en acheter une ? […]
- Je vais te dire, petit. Tu peux boire une bière si tu veux. Je crois pas que ton père* trouverait à y redire, hein ?
- Je crois pas.
- Mais tu ne peux pas m’en acheter une. Les amis n’achètent pas les choses entre eux.
- Oui, m’sieur.
- Et arrête de m’appeler m’sieur.
- Oui, m’sieur.
Le père de Gary est un véritable alcoolo !
Joe se retourna et le regarda.
- Quoi ?
- J’ai un peu soif. […] Je peux vous en acheter une ? […]
- Je vais te dire, petit. Tu peux boire une bière si tu veux. Je crois pas que ton père* trouverait à y redire, hein ?
- Je crois pas.
- Mais tu ne peux pas m’en acheter une. Les amis n’achètent pas les choses entre eux.
- Oui, m’sieur.
- Et arrête de m’appeler m’sieur.
- Oui, m’sieur.
Le père de Gary est un véritable alcoolo !
J'ai eu envie de sortir et de regarder les poissons rouges.
- Ah bon ? Et qu'est-ce qu'ils font ?
- Rien. Ils nagent en rond.
- Ah bon ? Et qu'est-ce qu'ils font ?
- Rien. Ils nagent en rond.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

50 Polars / 50 Etats
Pecosa
50 livres

Un tour chez les bouseux
encoredunoir
59 livres

50 états avec Gallmeister
Jeneen
46 livres
Auteurs proches de Larry Brown
Quiz
Voir plus
Créatures mythiques
A quelle mythologie appartiennent les Valkyries ?
nordique
maghrébine
slave
12 questions
237 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur237 lecteurs ont répondu