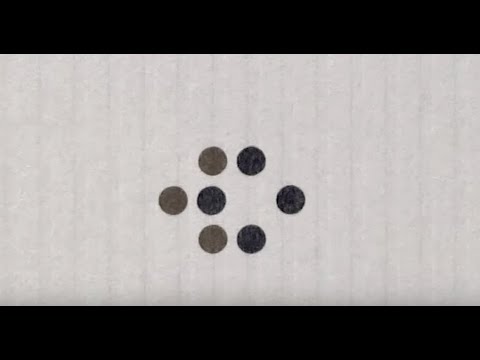Louise Chennevière est une écrivaine française.
"Comme la chienne" (2019) est son premier roman.
Ajouter des informations
"Bienvenue aux éditions P.O.L", un film de Valérie Mréjen. Pour les 40 ans des éditions P.O.L, quelques un(e)s des auteurs et des autrices publié(e)s aux éditions P.O.L écrivent une carte postale et laissent un message aux éditions P.O.L. Avec par ordre d'apparition de la carte postale: Violaine Schwartz, Jean-Paul Hirsch, Lucie Rico, Emmanuel Lascoux, Jacques jouet, Philippe Michard, François Matton, Frédéric Boyer, Catherine Henri, Suzanne Doppelt, Lamia Zadié, Marianne Alphant, Suzanne Duval, Laure Gouraige, Emmanuel Carrère, Jean Rolin, Elisabeth Filhol, Célia Houdart, Nicolas Fargues, Nicolas Bouyssi, Louise Chennevière, Frédérique Berthet, Marie Darrieussecq, Jocelyne Desverchère, Jean Frémon, Kiko Herrero, Julie Wolkenstein, Emmanuelle Bayamack-Tam, Liliane Giraudon, Frédéric Forte, Pierric Bailly, Valère Novarina, Hélène Zimmer, Nicolas Combet, Christian Prigent, Patrice Robin,, Emmanuelle Salasc, Alice Roland, Shane Haddad, Mathieu Bermann, Arthur Dreyfus, legor Gran, Charles Pennequin, Atiq Rahimi, Anne Portugal, Patrick Lapeyre, Caroline Dubois, Ryad Girod, Valérie Mréjen / Dominique Fourcade, Marielle Hubert, Robert Bober, Pierre Patrolin, Olivier Bouillère, Martin Winckler, Jean-Luc Bayard, Anne Parian, Nathalie Azoulai, Julie Douard, Théo Casciani, Paul Fournel, Raymond Bellour, Christine Montalbetti, Francis Tabouret, Ryoko Sekiguchi,
Ce corps si froid, presque glacé, qui voudrait seulement : glisser dans l’invisible. Mais ce corps que tout le monde regarde, juge, quand, lentement, elle marche dans la rue, ce corps que l’on observe, mesure, examine, et elle-même qui se guette, s’épie, comme on surveille un ennemi, son propre corps pourtant et qui la surprend au coin d’une rue, au détour d’un reflet, envahissant un instant l’univers tout entier. Oui, depuis longtemps l’univers n’est plus que cela, son corps. Et la mort y rôde, comme chez elle. Le monde n’est plus qu’un squelette.
Elle se demande encore comment font les autres pour vivre avec ça, un corps, parfois, en regardant simplement les gens marcher dans la rue, comme si c’était si simple, marcher, et comme si ça ne coûtait rien, se lever, et courir, s’étirer, et danser, et pourquoi elle n’y arrivera jamais. Et elle a questionné les psys, les médecins, et sa mère, toujours on lui a répondu que ce n’était pas de sa faute à elle, que c’était normal de ne pas parvenir à exister après ça. Oui, c’est normal, c’était juste la pénétration dans son corps de son père, une nuit, enfant. Et son corps qui n’existe pas sans cette nuit-là.
Jamais je n’ai été enfant. Ma mère ne l’aurait pas permis, elle était comme moi ma mère : les gosses elle détestait ça. Moi, je l’ai vite compris et j’ai essayé de me faire toute petite, de me faire pas enfant, de me faire adulte, sérieuse, et silencieuse, dans un coin. Ce n’était jamais assez. Je ne lui en ai jamais voulu. Longtemps pourtant je me suis demandé comment j’étais arrivée à ma mère, à elle qui voulait tellement pas de ça, à elle qui voulait tout sauf ça, cette chose étrange, chronophage et coûteuse, elle bossait déjà tellement. Je lui étais arrivée de nulle part, un jour comme les autres, alors que rien dans son corps n’avait trahi le secret, dévoilé les mystères, que son ventre ne s’était pas arrondi, que ses seins n’avaient pas gonflé, que ses jambes ne s’étaient pas alourdies, qu’elle détestait toujours autant les fraises et bouffer. Ma mère était très maigre. Oui, j’étais arrivée comme ça, d’on ne sait où, sur simple malentendu, d’un oubli, sortie de la nuit profonde de tous ses tapins, du sexe des centaines d’hommes qui étaient passés par elle, comme un affreux complot.
Et il y a comme quelque chose qui vient échouer en toi, un peu d’écume des siècles, quelques restes du monde. Soit alors, à la hauteur de ce que ces restes exigent, de ce que demandent ceux qui, ont par le monde, été réduits au silence. Celles. Assume-le, assume-les. Celles qui ont été réduites au silence. Ce silence c’est ton histoire, ma vieille, ma petite, ma chérie. Dans le vacarme de l’histoire, ne reste de vous, que ce mutisme, ce trou, et dans la nuit de la peinture, le silence comme un écho sur vos lèvres entrouvertes, déjà prêtes à se clore à nouveau, comme si vous aviez toujours su que vos voix ne seraient jamais entendues. J’écoute résonner ce silence, rebondir cet écho. Des fantômes peuplent ma solitude. Invoquer les esprits, les mânes des morts. Tu as envie, mais tu as peur : fouiller les invisibles.
Mais tu demeures allongée dans ton lit, les mots comme les sanglots ruissellent dans tes entrailles, ta gorge. Tu entrouvres légèrement les lèvres mais rien de toi ne s’échappe, tu plisses le coin de tes yeux pour frayer un chemin aux larmes, mais tes yeux, ta bouche sont secs, arides comme les champs après les campagnes de terre brûlée. Un arrière-goût de cendre. Tout autour est étonnamment calme, presque serein et tu n’y peux rien. Tu ne sais ce qui t’empêche d’agir, de parler, et de vivre, l’on t’a dit que c’était toi seule et d’abord tu l’as cru. Il te semble pourtant comme un bâillon posé sur ta bouche, et ton corps lié, ligoté par mille et une cordes invisibles, nouées savamment et de main de maître.
Où es-tu donc passée ? Et qu’est-ce qui t’a engloutie ? C’est peut-être ce silence.
Cette histoire doit remonter loin, aussi loin qu’aiment à remonter les psychanalystes, à la plus tendre enfance, aux mains épaisses et larges de ma mère saisissant mes cheveux, empoignant mon petit cou, plus loin encore, aux coups de mon père sur ma mère enceinte, et sur ma mère si jeune, si frêle, son amante. Ça doit remonter plus loin, bien plus loin que moi, bien plus loin que ma mère. Cette haine vient d’ailleurs, n’est pas la nôtre. Pourtant, c’est moi qu’elle brûle.
ans je vivais, cet être sans substance, sans passé, désincarné, sans nom, par toi ridiculisé – Lui. Lui que je n’avais pas nommé pourtant, car quel autre nom que le tien aurais-je pu lui donner ? Et ça je ne pouvais pas, inscrire ton nom noir sur blanc, au cœur du livre à venir. Est-ce par pudeur,fierté, perversité, par jalousie, peut-être ?
Ton nom que je n’avais plus jamais prononcé, plus nulle part entendu, ni lu, ce nom que j’avais pris garde hier encore de ne
pas prononcer, comme si je savais qu’unevfois qu’il aurait été dit, il serait trop tard, que je ne pourrais plus l’oublier, ne pas
vouloir le dire encore et encore – qui était venu échouer sur le bord de mes lèvres,au fond de la nuit, dans le creux de tes bras, comme s’il s’était tout ce temps tenu quelque part en moi attendant de pouvoir
un jour encore, te nommer.
Livres et Films
Quel livre a inspiré le film "La piel que habito" de Pedro Almodovar ?
7077 lecteurs ont répondu