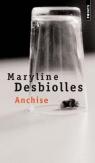Né(e) à : Ugine , le 21/05/1959
Originaire de Savoie, Maryline Desbiolles vit loin de la scène littéraire parisienne, dans l'arrière pays niçois.
Dès l’enfance, elle écrit des poèmes, des nouvelles, et crée, après ses études à Nice et à Cannes, deux revues de poésie et de littérature, Offset en 1980 et La Métis en 1990, qui réunissent des auteurs méditerranéens.
En 1998, la publication de La Seiche la révèle au public : ce roman singulier construit une réflexion digressive sur la vie humaine à partir d’une recette de cuisine.
Son écriture à la fois tendue et lyrique est récompensée par le prix Femina pour Anchise, en 1999, qui évoque un deuil impossible.
Le Goinfre, en 2004, récit d’un périple désespéré en Italie, témoigne lui aussi de l’intensité et de la maîtrise de son écriture.
Depuis, elle a écrit de nombreux romans et récits, notamment : Manger avec Piero (Mercure de France, 2004), Primo (Seuil, 2005), C'est pourtant pas la guerre (Seuil, 2007), Les draps du peintre (Seuil, 2008), Croisée de voix (Cherche-midi, 2008), La scène (Seuil, 2010), Je vais faire un tour (Facim, 2010), Une femme drôle (l'Olivier, 2010), Dans la route (Seuil, 2012), Lampedusa (L'École des loisirs, 2012), Vallotton est inadmissible (Seuil, 2013), Ceux qui reviennent (Seuil, 2014), Le beau temps (Seuil, 2015), Écrits pour voir (François-Marie Deyrolle éditeur, 2016), Le bleu du ciel n'est pas toujours rose (éd. des Cendres, 2016).
Elle a aussi écrit plusieurs fictions pour France Culture : Vous, Les petites filles, Frictions, Les Corbeaux, et produit plusieurs émissions : L'arrière-pays niçois : l'épreuve du rêve, Nice, ville perdue ? et Zéphirin des montagnes.
Entretien avec Maryline Desbiolles à propos de son roman Rupture
S`il est question de plusieurs « ruptures » dans votre roman, celui-ci s’ouvre par celle du barrage de Malpasset en 1959 qui a provoqué de nombreux dégâts et plusieurs centaines de morts. Que saviez-vous de cet accident avant de vous plonger dans l’écriture de ce roman ? Avez-vous toujours été fascinée ou tout du moins intéressée par cet événement ?
La rupture du barrage de Fréjus, la plus grande catastrophe civile en France, a eu lieu le 2 décembre, en 1959, l’année de ma naissance. J’en ai entendu parler dans mon enfance. Je me sentais proche de cette catastrophe, historiquement et géographiquement comme j’habitais déjà dans l’arrière-pays niçois, non loin de Fréjus. Nous avions partagé les pluies méditerranéennes, diluviennes, qui ont conduit à la rupture du barrage. Le site des ruines du barrage est extraordinaire, effrayant et magnifique. Je l’ai découvert il y a quelques années seulement. Il nous parle de la lumière tragique de ce pays, il la porte à incandescence, cette « lumière noire » évoquée par Picasso. Et puis le nom de Malpasset a grandement résonné en moi. Malpasset, le « mauvais pas », littéralement. Les mots en savent plus que nous, portent des histoires perdues, l’histoire tout court. Mais sans doute est-ce l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice qui a réactivé le drame que porte ce mot en lui et m’a incitée à écrire ce roman, d’autant plus que j’assistais aux feux d’artifice de ce jour funèbre.
La tragédie est-elle encore très présente dans la vallée du Reyran et la région de Fréjus ? Vous êtes-vous rendue sur place pour l’écriture du récit ?
Cette tragédie est inscrite dans les ruines du barrage mais elle est dans la mémoire de quantité d’habitants, dans leur chair même. Il y a encore de nombreux rescapés, toujours vivants. Certains étaient enfants. Ils ont perdu leurs parents, parfois toute leur famille. Je les ai rencontrés lors de la signature de Rupture à la librairie de Fréjus. Ce fut un moment extraordinaire. Beaucoup m’ont dit qu’ils étaient heureux que ce soit un roman qui porte au jour leur histoire. Mais ils m’étaient aussi reconnaissants d’avoir été précise, de m’être énormément documentée. Car non seulement j’ai sillonné Fréjus, mais j’ai consulté les archives départementales du barrage, notamment celles qui concernent le chantier de cet ouvrage d’art et n’avaient jamais été consultées jusque-là.
La rupture dans le roman, ce n’est pas seulement celle du barrage, c’est également celle que vit François, votre personnage principal, qui quitte aussi bien sa ville natale d’Ugine que sa mère pour rejoindre un ami qui travaille sur le barrage près de Fréjus. Est-ce le passage de l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte que vous souhaitiez explorer dans ce roman ?
François quitte Ugine, la ville sidérurgique de Savoie où je suis née moi aussi, pour aller travailler sur le chantier du barrage de Fréjus, près de la mer. Il est ébloui. Comme je le suis toujours par ce pays. Mais avec le « petit « François, je connais cet éblouissement à nouveau, pour la première fois. Et j’aime les premières fois, les commencements, l’allant des commencements. Ce que découvre François, il le découvre en étranger. Tout comme lui, je me sens étrangère, je me sens du côté des étrangers. Je trouve que c’est une bonne position pour écrire des livres.
Qui est François, d’ailleurs ? Il semble souvent en retrait de ce monde et se pose lui-même de nombreuses questions sur sa santé mentale… Lui « manque-t-il une case » comme il se le demande parfois ?
François est étranger au pays qu’il découvre, mais plus encore étranger au monde, étranger à lui-même. Étranger, étrange peut-être. Il porte une faille, la rupture en lui. Je serais tentée de dire que François, c’est moi. Mais je crois surtout que François, c’est nous, nous qui ne comprenons pas toujours ce qui arrive, qui n’avons pas de réponse, nous qui sommes quelquefois interdits.
François aime la photographie et économise son argent pour s’acheter des appareils photo. L’art sous toutes ses formes a toujours été très important dans votre oeuvre. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à la photographie dans ce roman ? Qu’est-ce que cela représente pour François ?
Pour le coup, l’art est ici un lien et non une rupture. L’art n’est pas réservé à une élite. Les personnages de Rupture sont des gens « simples » mais ils lisent, vont au cinéma, font des photos. François fait de la photo, le medium ne lui fait pas peur, il est à sa portée. Nous sommes avec ce roman dans les utopies des années 1950 -la culture comme manière de sortir de sa condition-, mais aussi dans mon utopie, toujours active. Je ne pourrais pas écrire si j’imaginais n’écrire que pour une élite.
Un mot sur les dialogues : on n’en retrouve aucun dans les pages de votre roman. Est-ce un choix délibéré ?
Les dialogues sont pris dans la pâte de la phrase, ils ne la coupent pas. La phrase les comprend. Il me semble qu’elle est ainsi plus fluide, plus ample, comme un paysage. Ce que je crois aussi, c’est que l’écriture n’est pas la parole, elle ne peut pas la restituer, mais s’en nourrir et la prendre à son compte.
Maryline Desbiolles et ses lectures
Quel est le livre qui vous a donné envie d’écrire ?
Dès que j’ai su lire un livre, j’ai eu envie d’écrire. N’importe quel livre. La vie des Saints, le Club des Cinq, une biographie de Claude Debussy. Il n’y avait pas chez moi de bibliothèque avec les livres qu’il faut avoir lus. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main et je « pastichais ».
Quel est le livre que vous auriez rêvé d’écrire ?
Je ne rêve que d’écrire un livre qui n’existe pas encore…
Quelle est votre première grande découverte littéraire ?
J’ai lu L’Idiot de Fiodor Dostoïevski à treize ou quatorze ans. Je me souviens du gros volume à la couverture violette. Je ne comprenais pas grand chose mais j’ai adoré m’embarquer dans cet univers qui m’ouvrait à bien plus grand que moi.
Quel est le livre que vous avez relu le plus souvent ?
J’ai lu À la Recherche temps perdu de Marcel Proust deux fois in extenso puis des volumes de la Recherche et plus tard encore des passages au hasard dans ces volumes…
Quel est le livre que vous avez honte de ne pas avoir lu ?
Je n’ai pas honte. Il y a des livres qui attendent leur heure. Il faut se sentir libre de les lire ou pas. La liberté fait partie de la lecture, du bonheur de la lecture.
Quelle est la perle méconnue que vous souhaiteriez faire découvrir à nos lecteurs ?
Il y en a beaucoup mais je choisirais Marie-Claire de Marguerite Audoux. Il est paru en 1910, écrit par une couturière et inspiré par son histoire personnelle. Mais il est tout sauf misérabiliste. C’est un livre rayonnant.
Quel est le classique de la littérature dont vous trouvez la réputation surfaite ?
Paul Morand. Je ne sais pas si c’est un classique mais on le cite bien trop souvent.
Avez-vous une citation fétiche issue de la littérature ?
Je suis très mauvaise en citations… Mais j’aime beaucoup l’incipit de Moby Dick de Herman Melville, si différent selon les traductions. « Je m’appelle Ismaël. Mettons » selon Giono, ou « Appelons-moi Ismahel » selon Armel Guerne…
Et en ce moment que lisez-vous ?
Plusieurs romans en même temps, Jean-Luc persécuté de Charles Ferdinand Ramuz (que j’adore), Henri Matisse, roman d’Aragon, et un livre récent, Fraternelle mélancolie, de Stéphane Lambert, où il est question de l’amitié de Herman Melville et d’Hawthorne.
Découvrez Rupture de Maryline Desbiolles aux éditions Flammarion :
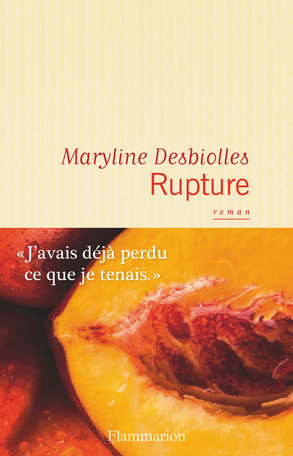
Entretien réalisé par Pierre Krause
comme la mer bat et que c'est beau on vient vérifier
qu'on a toujours de l'appétit et du goût pour les choses
et qu'on n'a pas fini de vivre
Sète, novembre
In le Monde 16 juillet 2016
J’ai nettoyé la trompette, je l’ai frottée, elle a pris des coups, elle est rayée par endroits, mais elle a retrouvé un peu de son lustre. C’est une vieille trompette, je ne sais pas si elle a servi. Une trompette de la marque Besson. Je ne sais pas si c’est une bonne trompette. Je ne sais pas ce qu’est une bonne trompette. Je sais que la trompette est un instrument réputé difficile, populaire, manouche, fête au village, sonnerie, fanfare, la trompette est en laiton, jouer avec le vent, jouer dans le vent, oiseau-trompette, un instrument réputé militaire, royal, trompettes de la renommée, de-la-mort. Mais elle a beau être dotée, capable d’un son brillant, elle n’est pas prétentieuse, je peux la prendre avec moi, l’escamoter, je l’ai bien en main sinon en bouche. C’est déjà quelque chose.
(p.84)
Musique d'écran, Musique des grands !
Quel réalisateur, icône de de la nouvelle vague, a choisi une musique de Maurice Jaubert pour accompagner un film (avec Nathalie Baye et Antoine Vitez) réalisé en 1978, d'après trois nouvelles de Henry James ? La femme de Gérard Mazet vient de décéder. Julien Davenne est arrivé dans l'est de la France pour le réconforter, mais lui-même vit un véritable drame : il est veuf, vit avec une gouvernante et Georges, un enfant sourd et muet à qui il apprend à parler. Dans cette même maison, où il abrite sa solitude, il a aménagé une chambre entièrement consacrée au souvenir de sa femme Julie.
9 lecteurs ont répondu