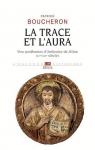Nationalité : France
Né(e) à : Paris , le 28/10/1965
Né(e) à : Paris , le 28/10/1965
Biographie :
Patrick Boucheron est un historien et un universitaire français.
Il est reçu premier au concours de l'École normale supérieure de Saint-Cloud en 1985, puis premier à l'agrégation d'histoire en 1988. Il soutient son doctorat en 1994 à la Sorbonne, consacré à l'urbanisme et la politique édilitaire à Milan.
En 1994, il devient maître de conférences à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud avant de rejoindre l’université Panthéon-Sorbonne en 1999. Il est membre de l’Institut universitaire de France de 2004 à 2009 et il soutient une habilitation à diriger des recherches en 2009.
En 2012, il est élu professeur d'histoire du Moyen Âge à l'université Panthéon-Sorbonne. En 2015, il est nommé professeur au Collège de France sur une chaire intitulée "Histoire des pouvoirs en Europe occidentale (XIIIe – XVIe siècles)".
Spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance, particulièrement en Italie, son domaine de recherche est l’histoire urbaine et monumentale de l'Italie médiévale et renaissante, dans ses aspects matériels aussi bien qu'abstraits et symboliques. Parallèlement, il s'intéresse à l'écriture et à l'épistémologie de l'histoire.
Il est président du Conseil scientifique de l’École française de Rome de 2015 à 2020. En 2017, il dirige un ouvrage intitulé "Histoire mondiale de la France" dans lequel 122 chercheurs reviennent sur l’histoire de la France en quelques 140 dates-clé.
Depuis 2017, Patrick Boucheron est chercheur associé au Théâtre national de Bretagne où il propose un cycle intitulé "Rencontrer l'histoire". Depuis septembre 2021, il est producteur et animateur de l'émission "Histoire de" sur France Inter.
Il est marié à l'historienne Mélanie Traversier (1975).
+ Voir plusPatrick Boucheron est un historien et un universitaire français.
Il est reçu premier au concours de l'École normale supérieure de Saint-Cloud en 1985, puis premier à l'agrégation d'histoire en 1988. Il soutient son doctorat en 1994 à la Sorbonne, consacré à l'urbanisme et la politique édilitaire à Milan.
En 1994, il devient maître de conférences à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud avant de rejoindre l’université Panthéon-Sorbonne en 1999. Il est membre de l’Institut universitaire de France de 2004 à 2009 et il soutient une habilitation à diriger des recherches en 2009.
En 2012, il est élu professeur d'histoire du Moyen Âge à l'université Panthéon-Sorbonne. En 2015, il est nommé professeur au Collège de France sur une chaire intitulée "Histoire des pouvoirs en Europe occidentale (XIIIe – XVIe siècles)".
Spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance, particulièrement en Italie, son domaine de recherche est l’histoire urbaine et monumentale de l'Italie médiévale et renaissante, dans ses aspects matériels aussi bien qu'abstraits et symboliques. Parallèlement, il s'intéresse à l'écriture et à l'épistémologie de l'histoire.
Il est président du Conseil scientifique de l’École française de Rome de 2015 à 2020. En 2017, il dirige un ouvrage intitulé "Histoire mondiale de la France" dans lequel 122 chercheurs reviennent sur l’histoire de la France en quelques 140 dates-clé.
Depuis 2017, Patrick Boucheron est chercheur associé au Théâtre national de Bretagne où il propose un cycle intitulé "Rencontrer l'histoire". Depuis septembre 2021, il est producteur et animateur de l'émission "Histoire de" sur France Inter.
Il est marié à l'historienne Mélanie Traversier (1975).
Source : Wikipedia
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (84)
Voir plusAjouter une vidéo
La Bibliothèque universitaire de Paris 8 vous a proposé en avant-première la projection de l’épisode "L’Autochrome - La vie en couleur " issue de la série Faire l’Histoire d’Arte, suivie par une Rencontre-Débat avec Patrick Boucheron et Adrien Genoudet. Retrouvez cette ressource et sa documentation sur Octaviana (la bibliothèque numérique de l'université Paris 8) : https://octaviana.fr/document/VUN0035_13 .
Podcasts (2)
Voir tous
Citations et extraits (152)
Voir plus
Ajouter une citation
Lorsque l'on parle de la peur du tyran, qui a peur de qui ? Ne finit-il pas toujours par tomber dans le piège de la peur qu'il inspire ? Et inversement, le gouvernement injuste n'est-il pas celui qui se targue de n'avoir peur de rien, celui dont les dirigeants sont sans vergogne - c'est-à-dire, disait Machiavel, privé de la honte que laisse craindre la colère des autres ? L'histoire redevient alors comme Walter Benjamin l'avait rêvée : un avertisseur -d'incendie.
Lire, c’est s’exercer à la gratitude.
(...) certains jours je commence à trouver que ça pèse, je me dis qu'il se pourrait bien que ce soit ça, finalement, ce que les manuels d'histoire nommaient « la montée des périls » pour désigner, avec leur confortable recul, les années trente en Europe. Il y a beau temps que je me demandais ce que ça pouvait bien faire au corps, au cœur et à l'esprit de vivre une période où d'une année à l'autre tous les signaux passent au rouge: est-ce qu'on s'en aperçoit, est-ce qu'on en prend la mesure, est-ce qu'on y pense, est-ce qu'on en rêve, est-ce qu'on en est malade, est-ce qu'on se laisse prendre par surprise, est-ce qu'on se sent condamné à l'impuissance, est-ce qu'on décide d'agir, mais alors pour faire quoi, est-ce qu'on pense à partir, si on peut, et quand?
Dans le champ de l’économie politique, le management est le laboratoire d’une politique de la peur : la crainte qu’inspire le chômage aux salariés est le principal levier de domination, alors que les employeurs, pour leur part, n’ont rien à craindre de personne.
L’unité de la peur n’est donc pas un artéfact de la psychologie de masse ; c’est un projet politique qui s’élabore par le biais des autorités, de l’idéologie et de l’action collective.
- Manque-t-il à l’homme du XXIe siècle une dimension spirituelle qui l’aiderait à penser la réparation ?
- Elle nous manque car nous ne savons pas la reconnaître. Le "Yes We Can" de Barack Obama proposait le salut. C’est ce qu’on appelle le "Tikkoun Olam" : une conception de la mystique juive de la réparation du monde qui date du XVIe siècle. Son fondateur, Isaac Louria, soutient que le monde se recrée sans cesse. Le moment clef de sa recréation, c’est lors-que nous, humains, le réparons. Ce monde est organisé en sphères de lumière, les "sefirot", dix vases qui représentent des valeurs telles que la générosité, l’éternité, etc. Vient un moment où ces vases se brisent. Leurs lumières se dispersent et les hommes doivent les rassembler pour réparer le monde. Le "Tikkoun Olam" est le moment où les hommes, parce que les vases se sont brisés, parcourent le monde pour récupérer les étincelles.
- S’il devait y avoir une ordonnance délivrant un remède pour la réparation, ne devrait-elle pas prescrire plus d’art et de culture ?
- C’est exactement ce que répondait le philosophe Michel Foucault (1926-1984) à la fin de sa vie, dans un entretien au Nouvel Observateur, lorsqu’il affirmait que le problème de notre époque est qu’on ne propose pas assez d’art et de culture et qu’il en faudrait plus pour qu’advienne « un âge nouveau de la curiosité ». Par réparation, il ne faut pas entendre un retour racorni sur les plaies du réel.
(dans Télérama 3702-3703 du 23 décembre 2020)
- Elle nous manque car nous ne savons pas la reconnaître. Le "Yes We Can" de Barack Obama proposait le salut. C’est ce qu’on appelle le "Tikkoun Olam" : une conception de la mystique juive de la réparation du monde qui date du XVIe siècle. Son fondateur, Isaac Louria, soutient que le monde se recrée sans cesse. Le moment clef de sa recréation, c’est lors-que nous, humains, le réparons. Ce monde est organisé en sphères de lumière, les "sefirot", dix vases qui représentent des valeurs telles que la générosité, l’éternité, etc. Vient un moment où ces vases se brisent. Leurs lumières se dispersent et les hommes doivent les rassembler pour réparer le monde. Le "Tikkoun Olam" est le moment où les hommes, parce que les vases se sont brisés, parcourent le monde pour récupérer les étincelles.
- S’il devait y avoir une ordonnance délivrant un remède pour la réparation, ne devrait-elle pas prescrire plus d’art et de culture ?
- C’est exactement ce que répondait le philosophe Michel Foucault (1926-1984) à la fin de sa vie, dans un entretien au Nouvel Observateur, lorsqu’il affirmait que le problème de notre époque est qu’on ne propose pas assez d’art et de culture et qu’il en faudrait plus pour qu’advienne « un âge nouveau de la curiosité ». Par réparation, il ne faut pas entendre un retour racorni sur les plaies du réel.
(dans Télérama 3702-3703 du 23 décembre 2020)
Dans le champ de l’économie politique, le management est le laboratoire d’une politique de la peur : la crainte qu’inspire le chômage aux salariés est le principal levier de domination, alors que les employeurs, pour leur part, n’ont rien à craindre de personne.
Une brèche peut être minuscule, elle ne se referme jamais tout à fait, dès lors qu'elle lézarde et rend friable ce que l'on croyait si intangible et solidement établi. Car ce que l'on a aperçu au travers de cette brèche, aucun pouvoir ne pourra faire en sorte qu'on l'ait pas vu. Dès lors s'y engouffre une autre histoire, qui a toujours à voir avec l'effraction des discours, et qui rend impossible tout retour au cours normal des choses.
Le De natura rerum de Lucrèce était-il un livre dangereux ? Moins qu’on a pu le dire. Certains historiens se plaisent à imaginer que sa redécouverte en 1417 par l’humaniste Poggio Bracciolini, dit le Pogge, a pu faire dévier le cours du monde, le précipitant soudainement dans la modernité. On comprend pourquoi cette idée les tente : elle élargit aux sociétés humaines cette expérience littéraire qu’ils chérissent en tant que lettrés. Mais elles prêtent trop au pouvoir de lire. Jamais les livres ne produisent de révolutions. Ils ne deviennent nos alliés que si nous sommes préparés à les lire. Ils sont des maîtres de liberté, oui, mais seulement pour ceux qui sont suffisamment libres.
Nous sommes au coeur de la tourmente, car qui ne voit aujourd'hui qu'elle prend deux formes également assourdissantes : celle des bavardages incessants et celle du grand silence apeuré ? Nous ne pourrons les affronter que par une conjuration de patience, de travail, d'amitié, d'invention, de courage - bref une conjuration d'intelligences qui trouve sa forme dans l'ordre des livres dont je veux défendre la cause. Lire, c'est s'exercer à la gratitude. (p. 28)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Patrick Boucheron
Quiz
Voir plus
Quelle poésie est la plus ancienne ?
Lequel de ces deux recueils a été publié EN PREMIER: "Capitale de la douleur" (P. Eluard) ou "Les trophées" (J.-M. de Heredia) ?
Capitale de la douleur
Les trophées
12 questions
6 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur6 lecteurs ont répondu