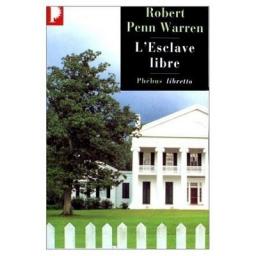Critiques de Robert Penn Warren (118)
Il s'agit là du premier roman de Robert Penn Warren (triple Prix Pulitzer ), paru en 1939 aux Etats-Unis puis en France en 1951. Heureuse réédition qui permet de mieux comprendre cet auteur majeur mais finalement à la notoriété assez confidentielle en France. Si Le Cavalier de la nuit n'atteint pas encore les sommets de son chef-d'oeuvre Tous les hommes du roi ( quel livre !!!! ), on sent toute la puissance et la maestria de l'écrivain qui résonnent dans des passages éblouissants de beauté formelle et évocatrice.
Robert Penn Warren s'est emparé d'un fait social majeur qui s'est déroulé dans le Kentucky de 1905 à 1908 : la guerre du tabac entre les planteurs sudistes et les gros trusts type American Tobacco Company qui, après entente tarifaire monopolistique, leur achetaient leur production en leur imposant des prix dérisoires, au point que les premiers se sont constituées en association coopérative de résistance. Mais face à la pression économique des « gros », l'association adopte la violence en menant des opérations de guérilla rurale pour punir les producteurs acceptant les conditions des trusts : ravages des récoles, destructions des semis, incendies des séchoirs ou dynamitages des entrepôts. Plusieurs décennies après la guerre de Sécession, l'auteur saisit brillamment l'esprit de revanche des Sudistes, la victoire des Yankees ayant justement permis à leurs grandes entreprises de dicter leurs règles économiques et d'étouffer ainsi la production agricole des Etats du Sud comme le Kentucky.
Paru la même année que Les Raisins de la colère, Le Cavalier de la nuit est un roman social, politique, dénonçant les effets du capitalisme. Le libre-arbitre est-il encore possible à l'ère du libéralisme économique ? Pouvons-nous bousculer le déterminisme né du choc muet des forces économiques ? Il interroge très puissamment sur le hiatus quasi schizophrénique entre les rêves auréolés d'idéal et la réalité d'une action qui dérape vers la violence. Ou comment l'action dégrade les idéaux. Même avec les intentions initiales les plus pures, les mains sales peuvent se retrouver bien sales lorsque la violence dérape vers la jouissance à détruire, les vengeances déguisées et les règlements de compte sous-jacents. Comme si l'impulsion visant à changer l'ordre des choses, si noble soit-elle, portait en elle le ver corrupteur de sa propre destruction.
Pour incarner cette passionnante réflexion politique sur « la fin et les moyens », Robert Penn Warren choisit un personnage plutôt médiocre, finalement peu attachant, très intéressant pour autant. Percy Munn, avocat et planteur, idéaliste naïf surpris par son intransigeance lorsqu'il se retrouve à la tête d'un bataillon de justicier menant les actions punitives sur les plantations aux propriétaires récalcitrants à sa cause. En fait, tout le roman raconte l'éveil de sa conscience, lui qui au départ se laisse facilement manipuler par des pairs plus assurés comme le sénateur ou le docteur. Son épiphanie donne lieu à une scène superbe au début du roman. Lui, de tempérament plutôt froid et pondéré, peu porté à l'exaltation, se laisse griser par l'ivresse d'un discours qu'il fait en quasi transe, ivre de cet élan collectif qu'il découvre et qui commence à l'habiter.
Et c'est là que le roman prend toute son ampleur introspective et acquiert une dimension toute métaphysique en dévoilant le retentissement existentiel de l'action politique violente sur cet être. On voit son identité se construire au fil de ses péripéties en tant que cavalier de la nuit. C'est dans l'arène de la violence et de la radicalité que son identité se compose dans la complexité, ne laissant que très peu d'issue à Percy lorsque ses désirs se fracassent aux intentions des autres, puis lorsque la cause semble perdue.
Malgré des longueurs, on est là dans un grand roman à l'américain avec une mise en scène épatante qui multiplie les tableaux marquants ( le discours d'ouverture, le serment nocturne, le procès, le grand incendie de l'entrepôt ) en mode cinématographique, le tout porté par une langue dense et lyrique, entre intimisme sensible et mélancolie lucide. Jusqu'à cette dernière phrase absolument sublime :
« Couché sur le sol qui tanguait et se soulevait sous lui comme une longue houle, il entendait, assoupi, les voix qui appelaient, au pied de la colline, comme des voix d'enfants qui jouent dans la nuit. »
Robert Penn Warren s'est emparé d'un fait social majeur qui s'est déroulé dans le Kentucky de 1905 à 1908 : la guerre du tabac entre les planteurs sudistes et les gros trusts type American Tobacco Company qui, après entente tarifaire monopolistique, leur achetaient leur production en leur imposant des prix dérisoires, au point que les premiers se sont constituées en association coopérative de résistance. Mais face à la pression économique des « gros », l'association adopte la violence en menant des opérations de guérilla rurale pour punir les producteurs acceptant les conditions des trusts : ravages des récoles, destructions des semis, incendies des séchoirs ou dynamitages des entrepôts. Plusieurs décennies après la guerre de Sécession, l'auteur saisit brillamment l'esprit de revanche des Sudistes, la victoire des Yankees ayant justement permis à leurs grandes entreprises de dicter leurs règles économiques et d'étouffer ainsi la production agricole des Etats du Sud comme le Kentucky.
Paru la même année que Les Raisins de la colère, Le Cavalier de la nuit est un roman social, politique, dénonçant les effets du capitalisme. Le libre-arbitre est-il encore possible à l'ère du libéralisme économique ? Pouvons-nous bousculer le déterminisme né du choc muet des forces économiques ? Il interroge très puissamment sur le hiatus quasi schizophrénique entre les rêves auréolés d'idéal et la réalité d'une action qui dérape vers la violence. Ou comment l'action dégrade les idéaux. Même avec les intentions initiales les plus pures, les mains sales peuvent se retrouver bien sales lorsque la violence dérape vers la jouissance à détruire, les vengeances déguisées et les règlements de compte sous-jacents. Comme si l'impulsion visant à changer l'ordre des choses, si noble soit-elle, portait en elle le ver corrupteur de sa propre destruction.
Pour incarner cette passionnante réflexion politique sur « la fin et les moyens », Robert Penn Warren choisit un personnage plutôt médiocre, finalement peu attachant, très intéressant pour autant. Percy Munn, avocat et planteur, idéaliste naïf surpris par son intransigeance lorsqu'il se retrouve à la tête d'un bataillon de justicier menant les actions punitives sur les plantations aux propriétaires récalcitrants à sa cause. En fait, tout le roman raconte l'éveil de sa conscience, lui qui au départ se laisse facilement manipuler par des pairs plus assurés comme le sénateur ou le docteur. Son épiphanie donne lieu à une scène superbe au début du roman. Lui, de tempérament plutôt froid et pondéré, peu porté à l'exaltation, se laisse griser par l'ivresse d'un discours qu'il fait en quasi transe, ivre de cet élan collectif qu'il découvre et qui commence à l'habiter.
Et c'est là que le roman prend toute son ampleur introspective et acquiert une dimension toute métaphysique en dévoilant le retentissement existentiel de l'action politique violente sur cet être. On voit son identité se construire au fil de ses péripéties en tant que cavalier de la nuit. C'est dans l'arène de la violence et de la radicalité que son identité se compose dans la complexité, ne laissant que très peu d'issue à Percy lorsque ses désirs se fracassent aux intentions des autres, puis lorsque la cause semble perdue.
Malgré des longueurs, on est là dans un grand roman à l'américain avec une mise en scène épatante qui multiplie les tableaux marquants ( le discours d'ouverture, le serment nocturne, le procès, le grand incendie de l'entrepôt ) en mode cinématographique, le tout porté par une langue dense et lyrique, entre intimisme sensible et mélancolie lucide. Jusqu'à cette dernière phrase absolument sublime :
« Couché sur le sol qui tanguait et se soulevait sous lui comme une longue houle, il entendait, assoupi, les voix qui appelaient, au pied de la colline, comme des voix d'enfants qui jouent dans la nuit. »
Au XXème siècle, la littérature américaine a connu son explosion, comme pour les autres disciplines artistiques, fournissant au monde un très grand nombre de romanciers aux talents protéiformes. En établir la liste exhaustive relève de la gageure ; preuve en est : une liste des 100 plus grands postée sur notre site ; très vite, elle s'avère incomplète, sans qu'il soit évident d'y remplacer l'un par l'autre…
À ce jeu, Robert Penn Warren fait souvent office d'oublié-idéal (comme Richard Brautigan…) ; toute comparaison avec son illustre aîné William Faulkner apparait vaine, bien que leur terroir commun la justifie.
D'un classicisme de grand conteur, sa plume est belle sans avoir recours à de grands effets ; elle sonne juste.
…
Dans ce roman, il assemble une histoire avec des éléments à priori difficile à réunir sans que cela semble tiré par les cheveux : un roman d'apprentissage, au déroulé picaresque, avec un héros qui tient lieu d'expérience symbolique, d'hypothèse farfelue et humaniste, celle de catapulter un juif-allemand handicapé d'un pied bot au milieu de la Guerre de Sécession afin de, prétend-il, « combattre pour la liberté » ;
prenez le parti un peu voyant de l'affubler du nom du tout premier homme ; ajoutez à cela quelques dilemmes entre tradition et modernité, universalisme et communautarisme, et vous obtiendrez un mélange sur le papier assez difficile à tenir, promettant entre de mauvaises mains une accumulation de poncifs, voire un relativisme de bon ton avec sa possible construction en thèse-antithèse-synthèse.
Pourtant, le miracle a lieu : malgré ce garçon que parfois l'on aimerait rouer de coup — qui ferait passer Candide pour un amiral-vétéran, ou le prince Idiot Mychkine pour le père Karamazov — l'histoire s'épanouit sans jamais tomber dans le ridicule ou dans l'impression de « forcée ».
…
Les descriptions de nature viennent considérablement enrichir le récit, allant même jusqu'à lui donner une âme romantique, résonnant avec celle de notre héros.
…
On ne peut que s'incliner devant la facture « classique » de ce roman, au sens de sa grande justesse, venant enrichir les éternelles réflexions du lecteur de Dostoïevski, ainsi qu'apportant une contribution limpide aux interrogations racialistes essentielles à la civilisation étasunienne.
À ce jeu, Robert Penn Warren fait souvent office d'oublié-idéal (comme Richard Brautigan…) ; toute comparaison avec son illustre aîné William Faulkner apparait vaine, bien que leur terroir commun la justifie.
D'un classicisme de grand conteur, sa plume est belle sans avoir recours à de grands effets ; elle sonne juste.
…
Dans ce roman, il assemble une histoire avec des éléments à priori difficile à réunir sans que cela semble tiré par les cheveux : un roman d'apprentissage, au déroulé picaresque, avec un héros qui tient lieu d'expérience symbolique, d'hypothèse farfelue et humaniste, celle de catapulter un juif-allemand handicapé d'un pied bot au milieu de la Guerre de Sécession afin de, prétend-il, « combattre pour la liberté » ;
prenez le parti un peu voyant de l'affubler du nom du tout premier homme ; ajoutez à cela quelques dilemmes entre tradition et modernité, universalisme et communautarisme, et vous obtiendrez un mélange sur le papier assez difficile à tenir, promettant entre de mauvaises mains une accumulation de poncifs, voire un relativisme de bon ton avec sa possible construction en thèse-antithèse-synthèse.
Pourtant, le miracle a lieu : malgré ce garçon que parfois l'on aimerait rouer de coup — qui ferait passer Candide pour un amiral-vétéran, ou le prince Idiot Mychkine pour le père Karamazov — l'histoire s'épanouit sans jamais tomber dans le ridicule ou dans l'impression de « forcée ».
…
Les descriptions de nature viennent considérablement enrichir le récit, allant même jusqu'à lui donner une âme romantique, résonnant avec celle de notre héros.
…
On ne peut que s'incliner devant la facture « classique » de ce roman, au sens de sa grande justesse, venant enrichir les éternelles réflexions du lecteur de Dostoïevski, ainsi qu'apportant une contribution limpide aux interrogations racialistes essentielles à la civilisation étasunienne.
Certains chefs-d’œuvre sont difficiles d’accès. Ce n’est pas le cas de Tous les hommes du roi, un roman sublime de bout en bout. J’ai été emporté d’emblée. Dès la première page, une route, toute droite, se déroule à l’infini au travers des paysages sauvages et incandescents du Sud des Etats-Unis, et sur cette route, une Cadillac noire fonce à tombeau ouvert. A bord, quelques-uns des personnages hauts en couleur du roman : le Boss, homme-clé autour duquel est bâtie l’intrigue ; Lucy Stark, sa femme ; l’obèse Tiny Duffy, souffre-douleur patenté ; le bègue et malingre Sugar Boy, chauffeur porte-flingue. Et Jack Burden, un fils de famille, journaliste éphémère reconverti dans un job d’homme de confiance. C’est lui le narrateur du roman.
L’action principale se développe à la fin des années trente. Willie Stark, dit le Boss, est un homme politique atypique. Petit agriculteur à la détermination farouche, il se présente aux élections dans l’intention de lutter contre la corruption et le chantage qui gangrènent l’Etat. Révélant un véritable talent de tribun, il est élu Gouverneur. Mais dans l’exercice du pouvoir, il se montre populiste et autoritaire, son cynisme l’amenant finalement à penser que corruption et chantage sont des moyens acceptables pour parvenir aux fins qu’il juge bonnes pour le peuple. Il est convaincu que le bien ne peut naître que du mal.
Jack Burden raconte par le menu l’histoire de Willie Stark qu’il accompagne jusqu’aux circonstances qui mettront fin tragiquement à son parcours. Les missions délicates, parfois indignes, dont il se charge pour le compte du Boss, ainsi que son observation lucide et ironique des personnages du roman, l’amènent à se pencher en même temps sur lui-même et sur sa propre histoire. Apte à juger, mais incapable de se résoudre à intervenir, il observe sans réagir les manipulations et les événements qui conduiront à trois drames tragiques. Il lui faudra du temps pour comprendre qu’il n’appartient qu’à lui de s’assumer et de donner un sens à sa vie.
Impossible de ne pas citer les autres personnages : Adam Stanton, le chirurgien pianiste, idéaliste, intransigeant et incontrôlable ; sa sœur Anne, amour de jeunesse de Jack, qui, comme ce dernier, peine à trouver sa voie ; Sadie Burke, une femme dévouée au Boss, dont l’activisme masque une frustration physique ; le juge Irwin, figure emblématique de la rigueur morale, sauf que… Sans oublier madame Burden mère, une ancienne beauté menant grand train.
La construction du roman est complexe et très finement conçue. Malgré leur diversité, les péripéties, parfois brutales et surprenantes, s’enchaînent presque logiquement tout au long des six cent quarante pages du livre. Comme si, justement, tout était écrit d’avance. L’auteur soulève de profondes réflexions philosophiques sur la fatalité, le secret, la trahison, le péché, la culpabilité. Une culpabilité propre à chacun, mais également collective dans un Sud hanté par ses démons du passé : l’esclavage, le racisme et la guerre perdue contre les Yankees.
La plume de Robert Penn Warren est éblouissante. Les journées brûlantes et les nuits étouffantes de la Louisiane donnent lieu à des images sans cesse renouvelées, toutes d’un lyrisme époustouflant. Dans son rôle de narrateur, Jack Burden use d’un ton décalé et fait mine de prendre à témoin un interlocuteur qu’il tutoie ; on ne sait pas s’il s’adresse au lecteur ou à lui-même, mais l’effet est percutant. Les nombreux personnages, dont les traits de caractère sont ciselés avec une certaine férocité, jouent des scènes captivantes dont les dialogues, alliant burlesque et gravité, sont dignes des meilleures séries noires. La traduction, revue à l’occasion d’une publication en 2017 par les éditions Monsieur Toussaint Louverture, mérite d’être saluée, car elle transpose à la perfection le langage populaire que l’on imagine dans le Sud profond.
Deux fois porté à l’écran, Tous les hommes du roi a été aussi à plusieurs reprises adapté pour le théâtre. Le roman, pour lequel je confirme et j’assume tous les superlatifs de ma chronique, avait valu en 1947 à son auteur, le poète et romancier Robert Penn Warren, le prix Pulitzer de la fiction.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
L’action principale se développe à la fin des années trente. Willie Stark, dit le Boss, est un homme politique atypique. Petit agriculteur à la détermination farouche, il se présente aux élections dans l’intention de lutter contre la corruption et le chantage qui gangrènent l’Etat. Révélant un véritable talent de tribun, il est élu Gouverneur. Mais dans l’exercice du pouvoir, il se montre populiste et autoritaire, son cynisme l’amenant finalement à penser que corruption et chantage sont des moyens acceptables pour parvenir aux fins qu’il juge bonnes pour le peuple. Il est convaincu que le bien ne peut naître que du mal.
Jack Burden raconte par le menu l’histoire de Willie Stark qu’il accompagne jusqu’aux circonstances qui mettront fin tragiquement à son parcours. Les missions délicates, parfois indignes, dont il se charge pour le compte du Boss, ainsi que son observation lucide et ironique des personnages du roman, l’amènent à se pencher en même temps sur lui-même et sur sa propre histoire. Apte à juger, mais incapable de se résoudre à intervenir, il observe sans réagir les manipulations et les événements qui conduiront à trois drames tragiques. Il lui faudra du temps pour comprendre qu’il n’appartient qu’à lui de s’assumer et de donner un sens à sa vie.
Impossible de ne pas citer les autres personnages : Adam Stanton, le chirurgien pianiste, idéaliste, intransigeant et incontrôlable ; sa sœur Anne, amour de jeunesse de Jack, qui, comme ce dernier, peine à trouver sa voie ; Sadie Burke, une femme dévouée au Boss, dont l’activisme masque une frustration physique ; le juge Irwin, figure emblématique de la rigueur morale, sauf que… Sans oublier madame Burden mère, une ancienne beauté menant grand train.
La construction du roman est complexe et très finement conçue. Malgré leur diversité, les péripéties, parfois brutales et surprenantes, s’enchaînent presque logiquement tout au long des six cent quarante pages du livre. Comme si, justement, tout était écrit d’avance. L’auteur soulève de profondes réflexions philosophiques sur la fatalité, le secret, la trahison, le péché, la culpabilité. Une culpabilité propre à chacun, mais également collective dans un Sud hanté par ses démons du passé : l’esclavage, le racisme et la guerre perdue contre les Yankees.
La plume de Robert Penn Warren est éblouissante. Les journées brûlantes et les nuits étouffantes de la Louisiane donnent lieu à des images sans cesse renouvelées, toutes d’un lyrisme époustouflant. Dans son rôle de narrateur, Jack Burden use d’un ton décalé et fait mine de prendre à témoin un interlocuteur qu’il tutoie ; on ne sait pas s’il s’adresse au lecteur ou à lui-même, mais l’effet est percutant. Les nombreux personnages, dont les traits de caractère sont ciselés avec une certaine férocité, jouent des scènes captivantes dont les dialogues, alliant burlesque et gravité, sont dignes des meilleures séries noires. La traduction, revue à l’occasion d’une publication en 2017 par les éditions Monsieur Toussaint Louverture, mérite d’être saluée, car elle transpose à la perfection le langage populaire que l’on imagine dans le Sud profond.
Deux fois porté à l’écran, Tous les hommes du roi a été aussi à plusieurs reprises adapté pour le théâtre. Le roman, pour lequel je confirme et j’assume tous les superlatifs de ma chronique, avait valu en 1947 à son auteur, le poète et romancier Robert Penn Warren, le prix Pulitzer de la fiction.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Naissance d’une conscience
Après le fabuleux Tous les homes du roi, inutile de vous dire que je me suis précipité sur Le Cavalier de la nuit de Robert Penn Warren, opportunément réédité par Séguier dans une traduction de Michel Mohrt.
À Bardsville dans le Kentucky au début du siècle dernier, la culture du tabac fait vivre la quasi-totalité de la population du comté et les plants de ce petit coin du Deep South alimentent ce qui ressemble déjà à une industrie mondialisée.
Dans ce contexte, le bras de fer sur les prix est grandissant entre acheteurs de plus en plus puissants et petits producteurs isolés. Jusqu’à ce que sous l’influence de décideurs locaux emmenés par le sénateur Tolliver, le capitaine Todd et M. Christian, naisse l’Association des planteurs de tabac pour peser davantage dans les négociations tarifaires.
Jeune avocat trentenaire, Percy Munn les rejoint, flatté par les invitations des dirigeants à devenir l’un des leurs, comme par l’effet de ses premières prises de paroles lors des réunions publiques d’adhérents où ses mots portent et convainquent.
Mais la lutte politique va vite montrer ses limites et ses effets malsains, sous les yeux d’un Munn naïf et novice : postures, pressions, délations, désertions, ambitions… Tout y passe. L’heure est alors au passage à l’action répressive et intimidante envers les fermiers ne jouant pas le jeu collectif, avec la création d’une milice secrète locale, Les cavaliers de la nuit, dont Munn va devenir chef de la bande 17.
Le cavalier de la nuit est un livre à deux facettes. D’une part, l’épopée quasi-cinématographique (on lit ce livre en technicolor !) de cette lutte des planteurs de tabacs pour leurs droits à vivre dignement de leur travail. La première réunion publique des 20 000 fermiers, le dîner chez le sénateur, le procès de Treyvelan ou le grand incendie des entrepôts sont autant de scènes épiques et réussies, aux accents hollywoodiens.
Mais l’essentiel du livre est ailleurs, dans ce personnage de Percy Munn dont la personnalité et la conscience vont s’éveiller au fur et à mesure de son entrée dans la lutte. Une entrée passive et subie au début, devenant de plus en plus active et consolidant une réflexion personnelle jusque-là un peu trop faiblarde.
Cette montée en conscience va révolutionner la vie de Munn, d’abord orgueilleusement flatté de son rôle grandissant, puis interrogatif sur le sens de ses actions, de sa lutte et de sa vie. Une remise en cause parfaitement illustrée dans son rapport avec les femmes : May, la sienne, le quittera, lasse de sa distance grandissante ; les suivantes, Sukie ou Lucille, ne le trouveront pas plus lisible ni plus rassurant.
À la fois porté par ce qui lui arrive et éternellement torturé sur son positionnement et le sens de ses actions, Munn va finir par se perdre : « À quel moment un homme pouvait-il se fier à ses sensations, à ses certitudes ? À quel point fixer le centre immobile et véritable de son être, le foyer de ses devoirs ? ». Avant de se reconstruire.
Alternant dans des chapitres longs les scènes d’action et le cheminement personnel de Munn dans une approche souvent naturaliste et parfois limite contemplative, Le cavalier de la nuit est un roman d’autant plus fort et réussi qu’il fut le premier de l’auteur, couronné ensuite de trois Pulitzer. À ne pas manquer donc.
Après le fabuleux Tous les homes du roi, inutile de vous dire que je me suis précipité sur Le Cavalier de la nuit de Robert Penn Warren, opportunément réédité par Séguier dans une traduction de Michel Mohrt.
À Bardsville dans le Kentucky au début du siècle dernier, la culture du tabac fait vivre la quasi-totalité de la population du comté et les plants de ce petit coin du Deep South alimentent ce qui ressemble déjà à une industrie mondialisée.
Dans ce contexte, le bras de fer sur les prix est grandissant entre acheteurs de plus en plus puissants et petits producteurs isolés. Jusqu’à ce que sous l’influence de décideurs locaux emmenés par le sénateur Tolliver, le capitaine Todd et M. Christian, naisse l’Association des planteurs de tabac pour peser davantage dans les négociations tarifaires.
Jeune avocat trentenaire, Percy Munn les rejoint, flatté par les invitations des dirigeants à devenir l’un des leurs, comme par l’effet de ses premières prises de paroles lors des réunions publiques d’adhérents où ses mots portent et convainquent.
Mais la lutte politique va vite montrer ses limites et ses effets malsains, sous les yeux d’un Munn naïf et novice : postures, pressions, délations, désertions, ambitions… Tout y passe. L’heure est alors au passage à l’action répressive et intimidante envers les fermiers ne jouant pas le jeu collectif, avec la création d’une milice secrète locale, Les cavaliers de la nuit, dont Munn va devenir chef de la bande 17.
Le cavalier de la nuit est un livre à deux facettes. D’une part, l’épopée quasi-cinématographique (on lit ce livre en technicolor !) de cette lutte des planteurs de tabacs pour leurs droits à vivre dignement de leur travail. La première réunion publique des 20 000 fermiers, le dîner chez le sénateur, le procès de Treyvelan ou le grand incendie des entrepôts sont autant de scènes épiques et réussies, aux accents hollywoodiens.
Mais l’essentiel du livre est ailleurs, dans ce personnage de Percy Munn dont la personnalité et la conscience vont s’éveiller au fur et à mesure de son entrée dans la lutte. Une entrée passive et subie au début, devenant de plus en plus active et consolidant une réflexion personnelle jusque-là un peu trop faiblarde.
Cette montée en conscience va révolutionner la vie de Munn, d’abord orgueilleusement flatté de son rôle grandissant, puis interrogatif sur le sens de ses actions, de sa lutte et de sa vie. Une remise en cause parfaitement illustrée dans son rapport avec les femmes : May, la sienne, le quittera, lasse de sa distance grandissante ; les suivantes, Sukie ou Lucille, ne le trouveront pas plus lisible ni plus rassurant.
À la fois porté par ce qui lui arrive et éternellement torturé sur son positionnement et le sens de ses actions, Munn va finir par se perdre : « À quel moment un homme pouvait-il se fier à ses sensations, à ses certitudes ? À quel point fixer le centre immobile et véritable de son être, le foyer de ses devoirs ? ». Avant de se reconstruire.
Alternant dans des chapitres longs les scènes d’action et le cheminement personnel de Munn dans une approche souvent naturaliste et parfois limite contemplative, Le cavalier de la nuit est un roman d’autant plus fort et réussi qu’il fut le premier de l’auteur, couronné ensuite de trois Pulitzer. À ne pas manquer donc.
Poursuite de mes rattrapages d’été en catégorie pavés, avec Tous les hommes du roi, de Robert Penn Warren - traduit par Pierre Singer - récompensé par le Pulitzer en 1947.
Tous les hommes du roi est le livre aux deux héros : Willie Starck d’abord, jeune juriste naïf et maladroit, appelé après avoir perdu ses illusions et gravi quelques marches à devenir le Boss politique de la Louisiane, caïd désabusé, pragmatique et philanthrope.
Face à des adversaires politiques de l’ancien monde (déjà à l’époque…), il prône le dégagisme des corrompus et des fainéants, ne demandant pas qu’on l’aime mais qu’on ne le juge qu’à son efficacité. Populiste avant l’heure, la fin justifie toujours les moyens, quels que soient ceux qu’il emploie.
Puis Jack Burden, journaliste et historien devenu indispensable au Boss. Ni bras droit, ni factotum, pas mêmeporte-flingues, Burden est à la fois son ambassadeur, sa conscience ou son sherpa. Une conscience qui a sa propre conscience et qui s’interroge sans cesse au fur et à mesure de l’irrésistible ascension du Boss sur ses propres places et rôles.
À travers ses relations avec les autres – Adam l’ami d’enfance idéaliste, Anne l’amoureuse platonique, mais aussi sa mère au relationnel complexe ou le juge Irwin voisin et protecteur - Burden se confronte au renvoi de sa propre image, changeante au fil des étapes, et à l’acceptabilité personnelle de cette évolution.
Tragédie moderne de haut vol mêlant saga politique au long cours, intrigue à rebonds, contexte historique documenté et réflexions philosophiques sur la responsabilité individuelle et collective ou la destinée, Tous les hommes du roi est un grand livre. Un très grand livre. De ceux dont tu ne peux te décoller et que tu termines à la fois heureux de la découverte et frustré de ses 640 pages finalement bien trop brèves.
Warren écrit avec une délicieuse élégance, mélangeant les longs paragraphes léchés et descriptifs destinés à fixer le cadre, avec les digressions politiques ou sociétales éveillant l’intérêt autant que la conscience historique du lecteur, avant de raviver son attention avec quelques dialogues secs et directs venant casser l’effet pavé du tout. C’est un chef d’œuvre d’équilibre littéraire, qui explique sans aucun doute le succès de ce livre depuis tant d’année, sans aucun ravage du temps. Alors si ça n’est déjà fait, on se précipite !
Tous les hommes du roi est le livre aux deux héros : Willie Starck d’abord, jeune juriste naïf et maladroit, appelé après avoir perdu ses illusions et gravi quelques marches à devenir le Boss politique de la Louisiane, caïd désabusé, pragmatique et philanthrope.
Face à des adversaires politiques de l’ancien monde (déjà à l’époque…), il prône le dégagisme des corrompus et des fainéants, ne demandant pas qu’on l’aime mais qu’on ne le juge qu’à son efficacité. Populiste avant l’heure, la fin justifie toujours les moyens, quels que soient ceux qu’il emploie.
Puis Jack Burden, journaliste et historien devenu indispensable au Boss. Ni bras droit, ni factotum, pas mêmeporte-flingues, Burden est à la fois son ambassadeur, sa conscience ou son sherpa. Une conscience qui a sa propre conscience et qui s’interroge sans cesse au fur et à mesure de l’irrésistible ascension du Boss sur ses propres places et rôles.
À travers ses relations avec les autres – Adam l’ami d’enfance idéaliste, Anne l’amoureuse platonique, mais aussi sa mère au relationnel complexe ou le juge Irwin voisin et protecteur - Burden se confronte au renvoi de sa propre image, changeante au fil des étapes, et à l’acceptabilité personnelle de cette évolution.
Tragédie moderne de haut vol mêlant saga politique au long cours, intrigue à rebonds, contexte historique documenté et réflexions philosophiques sur la responsabilité individuelle et collective ou la destinée, Tous les hommes du roi est un grand livre. Un très grand livre. De ceux dont tu ne peux te décoller et que tu termines à la fois heureux de la découverte et frustré de ses 640 pages finalement bien trop brèves.
Warren écrit avec une délicieuse élégance, mélangeant les longs paragraphes léchés et descriptifs destinés à fixer le cadre, avec les digressions politiques ou sociétales éveillant l’intérêt autant que la conscience historique du lecteur, avant de raviver son attention avec quelques dialogues secs et directs venant casser l’effet pavé du tout. C’est un chef d’œuvre d’équilibre littéraire, qui explique sans aucun doute le succès de ce livre depuis tant d’année, sans aucun ravage du temps. Alors si ça n’est déjà fait, on se précipite !
Au nom des Noirs : États-Unis, 1964, au coeur du mouvement pour les droits civiques
Robert Penn Warren
Robert Penn Warren
« D’abord on fait tomber les murs, puis on construit les ponts ».
Je connaissais Robert Penn Warren en virtuose du roman – Tous les hommes du roi, Le cavalier de la nuit… -, je ne savais pas qu’il avait aussi trempé dans le récit sociétal. C’est chose faite avec la lecture de Au nom des noirs, traduit par Valérie Le Plouhinec.
La lutte pour les droits civiques aux États-Unis aura connu plusieurs tournants décisifs, et l’année 1964 en est un avec l’accès des Noirs aux inscriptions sur les listes électorales, véritable tremblement de terre symboliquement égalitaire dans les états du Deep South comme le Mississippi.
Passionné par « le problème noir » comme tous les grands écrivains du Sud et conscient du point de bascule en cours, Penn Warren entreprend un vaste tour d’horizon à 360° des points de vue de l’époque, questionnant leaders engagés, universitaires, politiques, religieux ou simples protagonistes sur la question de la déségrégation.
Mélangeant les interviews, les écrits de l’époque, ses notes et propres réflexions sur la question, il aborde les volets législatifs (plus faciles à voter qu’à mettre en œuvre), historiques, idéologiques ou stratégiques de la cause.
Mais il met surtout en lumière la grande hétérogénéité du mouvement Noir de l’époque, divisé sur le fond comme sur les formes de la lutte, à l’image d’un Martin Luther King et d’un Malcom X que tout ou presque semble opposer, notamment sur la légitimité de la violence.
« Un Noir qui est victime du système peut-il échapper à la marque d’infamie collective placée sur tous les Noirs de ce pays ? La réponse est non. Eh bien, il en va de même pour la race blanche en Amérique. Individuellement, il est impossible d’échapper au crime collectif ».
Il remonte aux sources, celles de Sambo, la représentation rassurante du « fidèle serviteur noir, courbé, reconnaissant, humble, irresponsable, efféminé, joueur de banjo, servile, souriant, bayant aux corneilles, docile, dépendant, lent, rieur, ami des enfants, puéril, voleur de pastèques, chanteur de gospel, fornicateur impénitent, insouciant, hédoniste (…) le stéréotype rassurant du Nègre pour l’homme blanc du Sud ».
Il évoque le fantasme des liens avec l’Afrique, « aussi loin qu’un rêve » et la nécéssité d’intégrer que ce n’est pas le bon référentiel puisque « l’Américain noir est avant tout Américain ». Une assertion loin d’être partagée par les « Chevaliers blancs du Ku Klux Klan du Royaume souverain du Mississippi ».
Il décrypte la difficulté d’intégrer les Blancs à la lutte des Noirs et d’y trouver leur juste place, qu’ils soient « Dixiecrates », libéraux ou Blancs engagés, victimes de « l’idée jalousement gardée que les Noirs doivent conserver le contrôle, doivent être indépendants, peuvent “accepter“ mais pas “demander“. Ne rien demander du tout ».
Il rappelle l’impact accélérateur de la guerre sur « la déségrégation des forces armées, peut-être un des événements les plus importants qui soient survenus dans ce pays. On dormait avec les gars, on passait le temps avec eux, on mangeait ensemble, et il y en avait qui reconnaissaient franchement et librement qu’ils s’étaient fait des idées fausses ».
Et il est aussi question de rééquilibrage scolaire dans les écoles ségréguées, d’indemnisation des esclavages d’antan, de redistribution des terres ou d’un antisémitisme supposé d’une partie des Noirs américains. Et on y croise aussi Camus ou Montesquieu…
Vous l’aurez compris, ce pavé de 600 pages est extrêmement dense et riche, alternant les passages instructifs et passionnants avec d’autres moins digestes pour qui n’est pas un spécialiste du sujet. Un livre pour lequel il faut prendre son temps et savoir passer quelques pages quand la longueur s’installe.
Reste surtout un livre qui, hors contexte et 60 ans plus tard, fait réfléchir et remet en perspective un combat pas toujours bien appréhendé vu d’ailleurs. Avec une dernière citation qui sonne comme évidente et glaçante :
« Je pense que mon frère blanc m’est grandement redevable quand je lui permets de m’accorder mes droits petit à petit. Mes droits m’appartiennent désormais. Il a de la chance que je ne les prenne pas tout d’un coup ».
Je connaissais Robert Penn Warren en virtuose du roman – Tous les hommes du roi, Le cavalier de la nuit… -, je ne savais pas qu’il avait aussi trempé dans le récit sociétal. C’est chose faite avec la lecture de Au nom des noirs, traduit par Valérie Le Plouhinec.
La lutte pour les droits civiques aux États-Unis aura connu plusieurs tournants décisifs, et l’année 1964 en est un avec l’accès des Noirs aux inscriptions sur les listes électorales, véritable tremblement de terre symboliquement égalitaire dans les états du Deep South comme le Mississippi.
Passionné par « le problème noir » comme tous les grands écrivains du Sud et conscient du point de bascule en cours, Penn Warren entreprend un vaste tour d’horizon à 360° des points de vue de l’époque, questionnant leaders engagés, universitaires, politiques, religieux ou simples protagonistes sur la question de la déségrégation.
Mélangeant les interviews, les écrits de l’époque, ses notes et propres réflexions sur la question, il aborde les volets législatifs (plus faciles à voter qu’à mettre en œuvre), historiques, idéologiques ou stratégiques de la cause.
Mais il met surtout en lumière la grande hétérogénéité du mouvement Noir de l’époque, divisé sur le fond comme sur les formes de la lutte, à l’image d’un Martin Luther King et d’un Malcom X que tout ou presque semble opposer, notamment sur la légitimité de la violence.
« Un Noir qui est victime du système peut-il échapper à la marque d’infamie collective placée sur tous les Noirs de ce pays ? La réponse est non. Eh bien, il en va de même pour la race blanche en Amérique. Individuellement, il est impossible d’échapper au crime collectif ».
Il remonte aux sources, celles de Sambo, la représentation rassurante du « fidèle serviteur noir, courbé, reconnaissant, humble, irresponsable, efféminé, joueur de banjo, servile, souriant, bayant aux corneilles, docile, dépendant, lent, rieur, ami des enfants, puéril, voleur de pastèques, chanteur de gospel, fornicateur impénitent, insouciant, hédoniste (…) le stéréotype rassurant du Nègre pour l’homme blanc du Sud ».
Il évoque le fantasme des liens avec l’Afrique, « aussi loin qu’un rêve » et la nécéssité d’intégrer que ce n’est pas le bon référentiel puisque « l’Américain noir est avant tout Américain ». Une assertion loin d’être partagée par les « Chevaliers blancs du Ku Klux Klan du Royaume souverain du Mississippi ».
Il décrypte la difficulté d’intégrer les Blancs à la lutte des Noirs et d’y trouver leur juste place, qu’ils soient « Dixiecrates », libéraux ou Blancs engagés, victimes de « l’idée jalousement gardée que les Noirs doivent conserver le contrôle, doivent être indépendants, peuvent “accepter“ mais pas “demander“. Ne rien demander du tout ».
Il rappelle l’impact accélérateur de la guerre sur « la déségrégation des forces armées, peut-être un des événements les plus importants qui soient survenus dans ce pays. On dormait avec les gars, on passait le temps avec eux, on mangeait ensemble, et il y en avait qui reconnaissaient franchement et librement qu’ils s’étaient fait des idées fausses ».
Et il est aussi question de rééquilibrage scolaire dans les écoles ségréguées, d’indemnisation des esclavages d’antan, de redistribution des terres ou d’un antisémitisme supposé d’une partie des Noirs américains. Et on y croise aussi Camus ou Montesquieu…
Vous l’aurez compris, ce pavé de 600 pages est extrêmement dense et riche, alternant les passages instructifs et passionnants avec d’autres moins digestes pour qui n’est pas un spécialiste du sujet. Un livre pour lequel il faut prendre son temps et savoir passer quelques pages quand la longueur s’installe.
Reste surtout un livre qui, hors contexte et 60 ans plus tard, fait réfléchir et remet en perspective un combat pas toujours bien appréhendé vu d’ailleurs. Avec une dernière citation qui sonne comme évidente et glaçante :
« Je pense que mon frère blanc m’est grandement redevable quand je lui permets de m’accorder mes droits petit à petit. Mes droits m’appartiennent désormais. Il a de la chance que je ne les prenne pas tout d’un coup ».
Quel bouquin mais quel bouquin !
J'ai fini Les rendez-vous de la clairière hier soir et j'en suis encore toute retournée. J'ai adoré ce livre, il n'y a pas assez d'étoiles pour exprimer mon ressenti.
Robert Penn Warren signe un drame magnifique. Car c'est un drame, un drame antique, où le sort s'emploie à faire plier les protagonistes. Rien ne peut arrêter la roue qui les entraîne tous vers leur destinée fatale.
C'est d'une violence inouie.
La puissance du récit tient autant à ses personnages qu'au style de l'auteur et à sa trame.
Les longues phrases, les mots percutants, les points de vue qui s'imbriquent, tout cela donne une sensation d'inconfort à une histoire qui reste logique et compréhensible.
Je ne connaissais pas du tout Robert Penn Warren et je vous assure que je ne vais pas en rester là avec cet écrivain. D'autant que Les Fous du Roi a été publié dans cette édition.
Ce fut une superbe découverte que je dois à Babelio et aux éditions Les Belles Lettres qui m'ont fait parvenir ce titre dans le cadre de l'opération Masse Critique de janvier.
Merci, merci, merci !
CHALLENGE MULTI-DÉFIS 2018
J'ai fini Les rendez-vous de la clairière hier soir et j'en suis encore toute retournée. J'ai adoré ce livre, il n'y a pas assez d'étoiles pour exprimer mon ressenti.
Robert Penn Warren signe un drame magnifique. Car c'est un drame, un drame antique, où le sort s'emploie à faire plier les protagonistes. Rien ne peut arrêter la roue qui les entraîne tous vers leur destinée fatale.
C'est d'une violence inouie.
La puissance du récit tient autant à ses personnages qu'au style de l'auteur et à sa trame.
Les longues phrases, les mots percutants, les points de vue qui s'imbriquent, tout cela donne une sensation d'inconfort à une histoire qui reste logique et compréhensible.
Je ne connaissais pas du tout Robert Penn Warren et je vous assure que je ne vais pas en rester là avec cet écrivain. D'autant que Les Fous du Roi a été publié dans cette édition.
Ce fut une superbe découverte que je dois à Babelio et aux éditions Les Belles Lettres qui m'ont fait parvenir ce titre dans le cadre de l'opération Masse Critique de janvier.
Merci, merci, merci !
CHALLENGE MULTI-DÉFIS 2018
La tranche abimée, il a bien vécu. Au point d’ailleurs que j’ai presque hésité à le prendre. Mais la tendresse particulière que j’éprouve pour la collection « libretto » des éditions Phébus et le fait qu’il s’offre ainsi à moi, petit trésor parmi d’autres ouvrages plus communs dans une boîte à livres, ont eu raison de mes préventions.
L’Esclave libre est paru pour la première fois aux Etats Unis en 1955, soit cinq ans après Autant en emporte le vent. La quatrième de couverture indique que ces circonstances lui auront fait de l’ombre et que Robert Penn Warren a longtemps été considéré comme le principal rival de Faulkner (Doriane, descends de cette armoire, lâche ce couteau et respire ! tu vas voir, ça va aller). Avec ces éléments en tête, je m’attendais à de la crinoline, du bal et des larmes. A un traitement… sévère de la narration peut-être aussi.
La prose de Warren est tout à fait classique, c’est en tout cas ce qu’il m’en a semblé à lire la traduction de J.G. Chauffeteau et G. Vivier, et de froufrous il est très peu question malgré le fait que le personnage principal du roman soit une femme.
Dans les années 1860, Amantha Starr, originaire du Kentucky, suit sa scolarité dans une austère pension qui prône l’abolition de l’esclavage au nom de principes religieux. Elle se vautre dans des exercices de mortification, songe à son âme et au torturé et immaculé Seth qui l’honore de son attention. Orpheline de mère depuis son plus jeune âge, Amantha a toujours vécu entourée de l’affection distraite de son père et des nègres familiers qui habitent avec elle la riche plantation paternelle.
Quand son père meurt, ruiné, dans les bras de sa maitresse, la jeune fille va découvrir que sa mère était une esclave et qu’à ce titre, elle ne peut prétendre à aucun héritage pas plus qu’à aucune liberté. Commence alors pour elle une vie à la merci des hommes qui l’achèteront pour user d’elle à leur convenance.
Durant la première moitié du roman, j’ai été un peu déçue du traitement que recevait cette histoire si rocambolesque. Puisque le filigrane d’Autant en emporte le vent s’imposait, où étaient donc les regards embrasés, les frissons et les soupirs ? A la première personne, avec le recul de quelques années, le récit est conduit par une Amantha presque désincarnée, subissant les aléas de l’existence sans que le lecteur accède pleinement aux émotions que cela suscite en elle. C’est parce que, ainsi qu’elle le dit sans cesse, elle ne sait qui elle est, elle ne sait ce qui gouverne ses impulsions, pas plus qu’elle ne comprend la raison de ce qui lui arrive. Ainsi dès l’incipit : « Oh, qui suis-je ? … Tel a été le cri de mon cœur pendant si longtemps ! Il y avait des fois où je me répétais mon nom – je m’appelle Amantha Starr – inlassablement, essayant par là, en quelque sorte, de me donner une existence réelle. Mais alors mon nom lui-même se dissolvait dans l’air, dans l’immensité de l’univers. »
Le roman déploie ensuite la folle et parfois macabre farandole des événements qui entraineront la « pauvre Manty » d’une existence innocente et comblée aux bras d’un riche et vieil armateur sudiste puis vers les ravages de la guerre de Sécession, les affres d’une identité sans cesse chahutée par ceux qui la trouvent trop blanche pour être nègre, trop désirable pour être honnête, trop noire pour être fiable. Elle se mariera, elle trahira, elle connaitra richesses et déchéances.
Dans le chaos des événements incessants, des batailles et des prises de guerre, difficile de comprendre les enjeux des uns et des autres. A fortiori quand, comme moi, on n’a qu’une connaissance très lacunaire de cette période. Le roman a été intitulé en anglais Band of angels et ce titre dépeint avec suffisamment d’ironie distancée tout ce que contient le livre de faux-semblants et de postures. Bien mieux que le fade L'esclave libre qui a le défaut supplémentaire de mettre le seul accent sur Amantha.
Le roman fait la part belle aux enjeux de la guerre de Sécession. Les confédérés (sudistes) qui se battent pour garder leurs privilèges esclavagistes contre les unionistes fervents défenseurs… fervents défenseurs… c’est là que ça coince… D’un idéal abolitionniste ? D’un libéralisme à tout crin que le paternalisme des sudistes empêche ? D’une réelle conception égalitaire des hommes quelle que soit leur couleur de peau ? Cette proposition n’est jamais pleinement assumée par aucun des personnages. Pas plus que le parti confédéré ne s’incarne dans une unanime défense du bon vieux uncle Ben’s. C’est toujours beaucoup plus torturé que cela, soit que les personnages les meilleurs puisent leurs motivations dans un sombre passé, soit que leurs élans cachent d’orgueilleuses et vénales motivations, soit enfin que le fondement même de leur abnégation ne soit encore qu’un orgueil démesuré. Au même titre que tous les autres personnages, les nègres, soi-disant enjeux de cette guerre, sont en proie aux mêmes circonvolutions, aux mêmes marchés de dupes : personne n’échappe à cette confrontation à l’Histoire en train de se faire.
Encore une fois, le traitement qui est fait de cette histoire n’est ni celui de la bluette sentimentale ni celui de l’introspection. Encore moins celui d’une revendication identitaire. Au fil des pages, Amantha Starr est le siège de désirs et de discours portés sur elle. Elle est elle-même saisie d’impulsions, se voit proférer des propos qu’elle ne savait même pas pouvoir abriter. Et ainsi se déroule le fil de son existence presque malgré elle tandis qu’elle attend que l’Histoire lui révèle le sens de sa vie.
Je tourne depuis quelques années autour des questions du féminisme, de l’intersectionnalité, de l’assignation et, - sans qu’il soit jamais possible de le définir en parfaite opposition avec ces derniers termes - de l’universalisme. De manière aussi caricaturale que fausse, certains pourraient croire que tout texte antérieur à cette lecture du réel selon ce prisme serait bon à oublier. Que seul notre temps est à même de proposer un propos pertinent sur ces questions qu’il a cœur de problématiser. Ce qui m’a fasciné dans L’Esclave noire, c’est justement cette distance temporelle. Ce que nous propose Warren en 1955, c’est le portrait de personnages qui cherchent toute leur existence durant ce que les autres font d’eux. En tant que Noirs, même si cela ne se voit pas, en tant que Blanc sauveurs et puritains, en tant qu’homme, en tant que femme. Et la conclusion de cette quête, que je ne révèlerai pas pour ne pas en gâcher la découverte, est d’une admirable portée, en remonte sobrement à bien de nos discours contemporains.
L’Esclave libre est paru pour la première fois aux Etats Unis en 1955, soit cinq ans après Autant en emporte le vent. La quatrième de couverture indique que ces circonstances lui auront fait de l’ombre et que Robert Penn Warren a longtemps été considéré comme le principal rival de Faulkner (Doriane, descends de cette armoire, lâche ce couteau et respire ! tu vas voir, ça va aller). Avec ces éléments en tête, je m’attendais à de la crinoline, du bal et des larmes. A un traitement… sévère de la narration peut-être aussi.
La prose de Warren est tout à fait classique, c’est en tout cas ce qu’il m’en a semblé à lire la traduction de J.G. Chauffeteau et G. Vivier, et de froufrous il est très peu question malgré le fait que le personnage principal du roman soit une femme.
Dans les années 1860, Amantha Starr, originaire du Kentucky, suit sa scolarité dans une austère pension qui prône l’abolition de l’esclavage au nom de principes religieux. Elle se vautre dans des exercices de mortification, songe à son âme et au torturé et immaculé Seth qui l’honore de son attention. Orpheline de mère depuis son plus jeune âge, Amantha a toujours vécu entourée de l’affection distraite de son père et des nègres familiers qui habitent avec elle la riche plantation paternelle.
Quand son père meurt, ruiné, dans les bras de sa maitresse, la jeune fille va découvrir que sa mère était une esclave et qu’à ce titre, elle ne peut prétendre à aucun héritage pas plus qu’à aucune liberté. Commence alors pour elle une vie à la merci des hommes qui l’achèteront pour user d’elle à leur convenance.
Durant la première moitié du roman, j’ai été un peu déçue du traitement que recevait cette histoire si rocambolesque. Puisque le filigrane d’Autant en emporte le vent s’imposait, où étaient donc les regards embrasés, les frissons et les soupirs ? A la première personne, avec le recul de quelques années, le récit est conduit par une Amantha presque désincarnée, subissant les aléas de l’existence sans que le lecteur accède pleinement aux émotions que cela suscite en elle. C’est parce que, ainsi qu’elle le dit sans cesse, elle ne sait qui elle est, elle ne sait ce qui gouverne ses impulsions, pas plus qu’elle ne comprend la raison de ce qui lui arrive. Ainsi dès l’incipit : « Oh, qui suis-je ? … Tel a été le cri de mon cœur pendant si longtemps ! Il y avait des fois où je me répétais mon nom – je m’appelle Amantha Starr – inlassablement, essayant par là, en quelque sorte, de me donner une existence réelle. Mais alors mon nom lui-même se dissolvait dans l’air, dans l’immensité de l’univers. »
Le roman déploie ensuite la folle et parfois macabre farandole des événements qui entraineront la « pauvre Manty » d’une existence innocente et comblée aux bras d’un riche et vieil armateur sudiste puis vers les ravages de la guerre de Sécession, les affres d’une identité sans cesse chahutée par ceux qui la trouvent trop blanche pour être nègre, trop désirable pour être honnête, trop noire pour être fiable. Elle se mariera, elle trahira, elle connaitra richesses et déchéances.
Dans le chaos des événements incessants, des batailles et des prises de guerre, difficile de comprendre les enjeux des uns et des autres. A fortiori quand, comme moi, on n’a qu’une connaissance très lacunaire de cette période. Le roman a été intitulé en anglais Band of angels et ce titre dépeint avec suffisamment d’ironie distancée tout ce que contient le livre de faux-semblants et de postures. Bien mieux que le fade L'esclave libre qui a le défaut supplémentaire de mettre le seul accent sur Amantha.
Le roman fait la part belle aux enjeux de la guerre de Sécession. Les confédérés (sudistes) qui se battent pour garder leurs privilèges esclavagistes contre les unionistes fervents défenseurs… fervents défenseurs… c’est là que ça coince… D’un idéal abolitionniste ? D’un libéralisme à tout crin que le paternalisme des sudistes empêche ? D’une réelle conception égalitaire des hommes quelle que soit leur couleur de peau ? Cette proposition n’est jamais pleinement assumée par aucun des personnages. Pas plus que le parti confédéré ne s’incarne dans une unanime défense du bon vieux uncle Ben’s. C’est toujours beaucoup plus torturé que cela, soit que les personnages les meilleurs puisent leurs motivations dans un sombre passé, soit que leurs élans cachent d’orgueilleuses et vénales motivations, soit enfin que le fondement même de leur abnégation ne soit encore qu’un orgueil démesuré. Au même titre que tous les autres personnages, les nègres, soi-disant enjeux de cette guerre, sont en proie aux mêmes circonvolutions, aux mêmes marchés de dupes : personne n’échappe à cette confrontation à l’Histoire en train de se faire.
Encore une fois, le traitement qui est fait de cette histoire n’est ni celui de la bluette sentimentale ni celui de l’introspection. Encore moins celui d’une revendication identitaire. Au fil des pages, Amantha Starr est le siège de désirs et de discours portés sur elle. Elle est elle-même saisie d’impulsions, se voit proférer des propos qu’elle ne savait même pas pouvoir abriter. Et ainsi se déroule le fil de son existence presque malgré elle tandis qu’elle attend que l’Histoire lui révèle le sens de sa vie.
Je tourne depuis quelques années autour des questions du féminisme, de l’intersectionnalité, de l’assignation et, - sans qu’il soit jamais possible de le définir en parfaite opposition avec ces derniers termes - de l’universalisme. De manière aussi caricaturale que fausse, certains pourraient croire que tout texte antérieur à cette lecture du réel selon ce prisme serait bon à oublier. Que seul notre temps est à même de proposer un propos pertinent sur ces questions qu’il a cœur de problématiser. Ce qui m’a fasciné dans L’Esclave noire, c’est justement cette distance temporelle. Ce que nous propose Warren en 1955, c’est le portrait de personnages qui cherchent toute leur existence durant ce que les autres font d’eux. En tant que Noirs, même si cela ne se voit pas, en tant que Blanc sauveurs et puritains, en tant qu’homme, en tant que femme. Et la conclusion de cette quête, que je ne révèlerai pas pour ne pas en gâcher la découverte, est d’une admirable portée, en remonte sobrement à bien de nos discours contemporains.
Un pavé de 523 pages ! Je me suis accrochée jusqu'à la page 250, mais je n'en pouvais plus, je l'ai fermé. Je me suis vraiment, mais vraiment ennuyé. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon bouquin, sans doute est-ce moi -même qui me suis égarée dans un univers qui n'est pas le mien et qui ne m'intéresse pas, la sphère politique et ses frasques.
Grosse déception avec ce roman, présenté comme un grand roman sur la guerre de Sécession et l'idéalisme du jeune Adam Rosenzweig, jeune allemand avec un pied-bot parti pour se battre pour les droits des Noirs ; entre les nombreuses coquilles et les lourdeurs de la traduction (et pourtant ils étaient deux !), la lecture de ce roman a été pénible. La seule chose que je retiens est la construction assez originale par petites saynètes qui reconstituent au final l'image complète.
Mais je suis loin de recommander cette lecture, très dispensable...
Coquilles :
p70 : Les gens qui ont maltraité les Noirs avaient immobile... au lieu de "un mobile"
p 162 : S'il l'avait craint, il aurait décroché des mûries deux pistolets de cavalerie... au lieu "des murs"
p 181 : Même à cette heure - l'heure du repos - il y avait moins départies de cartes... au lieu "de parties de cartes".
p 256 : Puis, sans transition, sapeur disparut... au lieu de "sa peur".
p 280 : Une savait pas ce qu'il lui faudrait faire... au lieu de "Il ne savait pas ce qu'il lui"...
Lourdeurs de traductions :
Il fit un temps au lieu de : il fit une pause...(faire un temps au marathon je comprendrais...)
p 203 : Sur cette pensée, Adam Rosenzweig se sentit rasséréné . Il se sentit rendu à un commencement d'espoir.
p 214 : Et pendant qu'Adam remuait ces réflexions, une nouvelle pensée commença de croître sous son crâne.
p 229 : Une étrange exaltation le visita. Il se sentit trembler au bord d'une révélation.
Mais je suis loin de recommander cette lecture, très dispensable...
Coquilles :
p70 : Les gens qui ont maltraité les Noirs avaient immobile... au lieu de "un mobile"
p 162 : S'il l'avait craint, il aurait décroché des mûries deux pistolets de cavalerie... au lieu "des murs"
p 181 : Même à cette heure - l'heure du repos - il y avait moins départies de cartes... au lieu "de parties de cartes".
p 256 : Puis, sans transition, sapeur disparut... au lieu de "sa peur".
p 280 : Une savait pas ce qu'il lui faudrait faire... au lieu de "Il ne savait pas ce qu'il lui"...
Lourdeurs de traductions :
Il fit un temps au lieu de : il fit une pause...(faire un temps au marathon je comprendrais...)
p 203 : Sur cette pensée, Adam Rosenzweig se sentit rasséréné . Il se sentit rendu à un commencement d'espoir.
p 214 : Et pendant qu'Adam remuait ces réflexions, une nouvelle pensée commença de croître sous son crâne.
p 229 : Une étrange exaltation le visita. Il se sentit trembler au bord d'une révélation.
Une drôle d'histoire écrite au début du siècle dernier.
Un homme étrange ,qui toute sa vie a part construire un cirque ( jouet) n'a rien fait d'autre d'inventif.Un récit qui se passe au fin fond du Tennessee.
Je ne sais pas quoi en penser???
Un homme étrange ,qui toute sa vie a part construire un cirque ( jouet) n'a rien fait d'autre d'inventif.Un récit qui se passe au fin fond du Tennessee.
Je ne sais pas quoi en penser???
UN ENDROIT OÙ ALLER de ROBERT PENN WARREN
Dugton, Alabama, Jed Tewksbury a neuf ans, son père Bucky vient de mourir, il pissait debout à l’avant de son chariot, il est tombé sur la tête, raide mort, la queue à la main. Jed se souvient de l’enterrement , sa mère sans pleurs, le déménagement, le sabre du grand père qu’elle balance dans la rivière, la stupéfaction de Jed et sa mère lui expliquant qu’à son avis le grand père s’était plutôt servi d’une bouteille que d’un sabre quand il se battait avec les confédérés. A l’école Jed accroche rapidement, emprunte le bouquin de latin d’un grand et étudie. Encouragé par une prof il va lire César, Catulle, Horace, Ciceron et Tacite. Et déjà la beauté, l’étoile de l’école, Rozelle, est omniprésente et promise à un bel avenir, il était sûrement amoureux d’elle mais n’avait pas mis de nom sur son sentiment. La première fois qu’ils se parlèrent il avait 28 ans et c’est elle qui l’invita au bal de fin d’année. La mère de Jed, elle, n’a qu’une ambition, qu’il quitte le Sud, le plus loin possible, elle le formulait très simplement, »si tu restes, j’te tue »!! Dès lors, Jed étudiera le latin et le grec, s’installera à Chicago, suivra les cours du professeur Stahlmann, juif allemand, miné par la mort de sa femme, ils avaient cru au socialisme, puis avaient compris et migré. Jed va s’engager dans l’infanterie, fera des publications appréciées qui lui vaudront une belle notoriété mais il est suivi de loin ou de près par la belle Rozelle qui au fil des années ne l’a pas oublié.
Un roman magnifique qui nous entraîne au cœur des grandes questions, l’amour, qu’est ce qu’aimer, comment le sait on? Comment savoir si l’on a trouvé sa place dans le monde, y en a t il seulement une ? Et bien sûr pour un écrivain comme Warren ( à l’instar de Faulkner) le Sud, que l’on veut quitter pour fuir ce qu’il a fait et représenté mais qui attire comme un aimant ceux qui y sont nés.
Lisez le c’est une merveille.
Dugton, Alabama, Jed Tewksbury a neuf ans, son père Bucky vient de mourir, il pissait debout à l’avant de son chariot, il est tombé sur la tête, raide mort, la queue à la main. Jed se souvient de l’enterrement , sa mère sans pleurs, le déménagement, le sabre du grand père qu’elle balance dans la rivière, la stupéfaction de Jed et sa mère lui expliquant qu’à son avis le grand père s’était plutôt servi d’une bouteille que d’un sabre quand il se battait avec les confédérés. A l’école Jed accroche rapidement, emprunte le bouquin de latin d’un grand et étudie. Encouragé par une prof il va lire César, Catulle, Horace, Ciceron et Tacite. Et déjà la beauté, l’étoile de l’école, Rozelle, est omniprésente et promise à un bel avenir, il était sûrement amoureux d’elle mais n’avait pas mis de nom sur son sentiment. La première fois qu’ils se parlèrent il avait 28 ans et c’est elle qui l’invita au bal de fin d’année. La mère de Jed, elle, n’a qu’une ambition, qu’il quitte le Sud, le plus loin possible, elle le formulait très simplement, »si tu restes, j’te tue »!! Dès lors, Jed étudiera le latin et le grec, s’installera à Chicago, suivra les cours du professeur Stahlmann, juif allemand, miné par la mort de sa femme, ils avaient cru au socialisme, puis avaient compris et migré. Jed va s’engager dans l’infanterie, fera des publications appréciées qui lui vaudront une belle notoriété mais il est suivi de loin ou de près par la belle Rozelle qui au fil des années ne l’a pas oublié.
Un roman magnifique qui nous entraîne au cœur des grandes questions, l’amour, qu’est ce qu’aimer, comment le sait on? Comment savoir si l’on a trouvé sa place dans le monde, y en a t il seulement une ? Et bien sûr pour un écrivain comme Warren ( à l’instar de Faulkner) le Sud, que l’on veut quitter pour fuir ce qu’il a fait et représenté mais qui attire comme un aimant ceux qui y sont nés.
Lisez le c’est une merveille.
Quel roman !
Si l’une des œuvres de fiction suivantes vous a déjà conquis, alors « Tous les hommes du roi » (Prix Pulitzer 1947) est pour vous : Gatsby le magnifique, Citizen Kane, Il était une fois en Amérique, L’homme qui voulut être roi… Il y a même à parier que les créateurs du machiavélique « House of Cards » se sont inspirés de Robert Penn Warren.
Le sujet principal du livre est l’ambition, cette prétention bien ordonnée qui naît dans le cerveau d’un homme, aussi bouseux soit-il – c’est le cas de notre homme, Willie Stark. Son bras droit, Jack Burden, raconte son histoire, celle d’un homme venu de nulle part qui - thématique bien américaine – arrive au sommet. Par la voix de Burden, l’auteur montre qu’avec la meilleure volonté du monde, il est impossible d’accéder au pouvoir sans se salir les mains. Le vice et la vertu sont des frères jumeaux issus d’un même spasme. Tôt ou tard, ils se rejoignent et bien téméraire celui qui les distinguera, au risque de subordonner la morale et de la voir se retourner contre lui. Personne n’en réchappe. « L’homme est conçu dans le péché et élevé dans la corruption, il ne fait que passer de la puanteur des couches à la pestilence du linceul. Il y a toujours quelque chose ». À tout moment, on peut trébucher : « Pour quelles raisons, en dehors du péché originel, un homme peut-il s’écarter du droit chemin ? Je répondis : l’ambition, l’amour, la peur, l’argent ».
Je n’ai pas trouvé ce roman cynique parce que l’idéalisme, pour autant volatile, est omniprésent, que l’abject est tenu à distance respectable du lecteur et que l’ambition n’est pas intrinsèquement destructrice.
La précision des portraits et des paysages est à tomber par terre (ex : p11, p350). La profondeur des réflexions (ex : p20, p340), la justesse et la drôlerie des images (ex : « Elle se figea comme si son porte-jarretelles avait lâché en plein milieu de la messe ») m’ont conquise.
Encore un roman bestial et magistral réédité par Monsieur Toussaint Louverture, qui m’avait déjà régalée avec « Karoo » dans la même collection « Les grands animaux ».
Bilan : 🌹🌹🌹
Si l’une des œuvres de fiction suivantes vous a déjà conquis, alors « Tous les hommes du roi » (Prix Pulitzer 1947) est pour vous : Gatsby le magnifique, Citizen Kane, Il était une fois en Amérique, L’homme qui voulut être roi… Il y a même à parier que les créateurs du machiavélique « House of Cards » se sont inspirés de Robert Penn Warren.
Le sujet principal du livre est l’ambition, cette prétention bien ordonnée qui naît dans le cerveau d’un homme, aussi bouseux soit-il – c’est le cas de notre homme, Willie Stark. Son bras droit, Jack Burden, raconte son histoire, celle d’un homme venu de nulle part qui - thématique bien américaine – arrive au sommet. Par la voix de Burden, l’auteur montre qu’avec la meilleure volonté du monde, il est impossible d’accéder au pouvoir sans se salir les mains. Le vice et la vertu sont des frères jumeaux issus d’un même spasme. Tôt ou tard, ils se rejoignent et bien téméraire celui qui les distinguera, au risque de subordonner la morale et de la voir se retourner contre lui. Personne n’en réchappe. « L’homme est conçu dans le péché et élevé dans la corruption, il ne fait que passer de la puanteur des couches à la pestilence du linceul. Il y a toujours quelque chose ». À tout moment, on peut trébucher : « Pour quelles raisons, en dehors du péché originel, un homme peut-il s’écarter du droit chemin ? Je répondis : l’ambition, l’amour, la peur, l’argent ».
Je n’ai pas trouvé ce roman cynique parce que l’idéalisme, pour autant volatile, est omniprésent, que l’abject est tenu à distance respectable du lecteur et que l’ambition n’est pas intrinsèquement destructrice.
La précision des portraits et des paysages est à tomber par terre (ex : p11, p350). La profondeur des réflexions (ex : p20, p340), la justesse et la drôlerie des images (ex : « Elle se figea comme si son porte-jarretelles avait lâché en plein milieu de la messe ») m’ont conquise.
Encore un roman bestial et magistral réédité par Monsieur Toussaint Louverture, qui m’avait déjà régalée avec « Karoo » dans la même collection « Les grands animaux ».
Bilan : 🌹🌹🌹
C’est pour des livres comme ça que Babelio devrait créer la 6eme étoile.
•
Hors de question que je m’essaye à la critique de ce livre. Ce roman est bien trop grand, bien trop monumental pour que j’essaye en quelques mots d’en retranscrire toute la complexité, toute la puissance dramatique et toute la richesse narrative.
•
Je pourrais vous le présenter comme un roman sur la politique - voire même comme le roman par excellence sur la politique - ou bien comme une saga épique, biblique, humaine. Mais aucun des deux pitchs ne rendrait compte de la force du propos, de la profondeur d’analyse et de l’immense qualité littéraire de ce texte fascinant.
•
C’est le genre de livre dans lequel on s’enfonce, mais dans lequel on ne se perd jamais. Le genre de livre qui t’accompagne longtemps après l’avoir refermé. C’est un roman métaphysique !
•
Je suis au delà du coup de cœur, je suis terrassée.
On lit quoi après ça ? Tout risque de sembler bien fade, bien insipide.
•
Traduit par Pierre Singer
•
Hors de question que je m’essaye à la critique de ce livre. Ce roman est bien trop grand, bien trop monumental pour que j’essaye en quelques mots d’en retranscrire toute la complexité, toute la puissance dramatique et toute la richesse narrative.
•
Je pourrais vous le présenter comme un roman sur la politique - voire même comme le roman par excellence sur la politique - ou bien comme une saga épique, biblique, humaine. Mais aucun des deux pitchs ne rendrait compte de la force du propos, de la profondeur d’analyse et de l’immense qualité littéraire de ce texte fascinant.
•
C’est le genre de livre dans lequel on s’enfonce, mais dans lequel on ne se perd jamais. Le genre de livre qui t’accompagne longtemps après l’avoir refermé. C’est un roman métaphysique !
•
Je suis au delà du coup de cœur, je suis terrassée.
On lit quoi après ça ? Tout risque de sembler bien fade, bien insipide.
•
Traduit par Pierre Singer
"Bientôt, dans un moment, nous sortirons de la maison pour nous jeter dans la fournaise du monde ; sortis de l'histoire, nous rentrerons dans l'histoire et nous affronterons le verdict inexorable du temps. ". C'est par cette phrase énigmatique que se closent les sept cents pages du roman de Robert Penn Warren.
"Les fous du roi" est un livre ...métaphysique. Un roman exigeant dans lequel le lecteur aura quelquefois peine à entrer. Il ne faut pas s'attendre a une intrigue ponctuée de multiples rebondissement comme chez Ellroy par exemple, qui dépeint lui aussi dans ses livres les turpitudes de la vie politique américaine. Comme le dit justement Kajaku dans une critique précédente : "Il ne se passe pas grand chose" dans ce livre. Il existe quand même une trame narrative que Robert Penn Warren a emprunté à la vie du sénateur de Louisiane, Huey- Long, un homme politique démagogue et cynique, qui mourût assassiné . le personnage central du roman n'est pas le sénateur Willie Stark , l'avatar de Huey-Long , mais un de ces hommes qui gravitent autour des chefs de partis, un conseiller tout autant qu'un homme de main : Jack Burden.
L'intrigue , sans être compliquée, n'est pas facile à raconter. Si l'on veut qualifier le tout d'un raccourci trivial , on pourrait dire que c'est une histoire banale d'arroseur arrosé. le gouverneur du Comté de Mason City , Willie Stark brigue le Sénat. Un de ses adversaires, le sénateur McMurfee , se trouvant sur son chemin , il charge son homme de main, Jack Burden, de trouver un moyen de faire pression sur le Juge Irwin, un ancien ami de sa mère, afin que lui même intercède auprès de McMurfee pour qu'il laisse la place libre à Willie Stark. Burden ,connaissant bien l'intégrité du juge à la retraite, doute que l'on puisse le faire chanter , "cherche et tu trouveras" lui dit l'inflexible gouverneur. Et il va trouver : une misérable petite affaire de malversations financières vieille de trente ans ; la tâche, le pêché , dans la carrière immaculée du Juge Irwin. Cette découverte sera à l'origine des évènements qui vont alors s'enchaîner inexorablement.
Jack Burden sera ,à son corps défendant , le messager autant que la main du destin. L'auteur a mis beaucoup de ses questionnements, de ses angoisses, de ses anxiétés, dans son personnage principal. Jack Burden est le rejeton d'une riche famille sudiste, étudiant moyen, mal dans sa peau, amoureux fou d'Anne Stanton son amie d'enfance. Il devient journaliste dans un journal local d'où Willie Stark le débauche pour en faire son conseiller. Jack Burden n'est pas un raté malgré les apparences. C'est au contraire un homme d'une lucidité extrême, absolument pas dupe des forfaitures et des perfidies nécessaires au "vivre ensemble" de tous les jours. C'est l'homme de la "chair" , opposé à l'homme de "l'idée" incarné par son ami d'enfance Adam Stanton , brillant chirurgien habité par l'obsession du Bien , qui refuse la direction de l'hôpital construit par Willie Stark , persuadé qu'une bonne dose de Mal s'est invité à sa construction...
Vous l'aurez compris, au fin des fins, "Les fous du roi" se résume à une grandiose dissertation sur le Bien et le Mal , thème éminemment sudiste s'il en est (Faulkner et ma chère Flannery O'Connor ).
S'il vous prend l'idée (bienvenue , malgré mon compte-rendu décousu :-) , d'entreprendre la lecture de ce livre (lu dans l'édition de poche "biblio" ) , il faut absolument lire la belle introduction de Michel Mohrt qui explique magnifiquement les enjeux du roman, son contexte, sa place dans l'oeuvre de Penn Warren.
Enfin, une mention particulière pour la langue de Robert Penn Warren ; certainement édulcorée par la traduction (traducteur Pierre Singer, qui a du être à la peine vu la difficulté à rendre le sel des dialogues...) . L'auteur est un virtuose de l'image et de la métaphore. Tout au long des sept cents pages et au moment des dialogues je n'ai pu m'empêcher de penser à des scènes réelles ou imaginées de cinéma américain . Pouvoir du MYTHE !
"Par ici les choses ne changent guère" , dit le patron. La phrase ne semblait pas exiger de réponse , donc je n'en fournis aucune.
"Je parie que j'ai bien entassé , l'un dans l'autre, des milliers de litres de pâtée pour les cochons dans cette auge" dit-il. Il cracha de nouveau. " Je parie que j'ai régalé au moins cinq cents cochons dans ce coin-là. Et d'ailleurs, nom de Dieu ! c'est toujours ce que je fais : verser de la pâtée !
- Eh bien, c'est de ça qu'on vit, n'est-ce-pas ?
Il ne répondit pas."
"Les fous du roi" est un livre ...métaphysique. Un roman exigeant dans lequel le lecteur aura quelquefois peine à entrer. Il ne faut pas s'attendre a une intrigue ponctuée de multiples rebondissement comme chez Ellroy par exemple, qui dépeint lui aussi dans ses livres les turpitudes de la vie politique américaine. Comme le dit justement Kajaku dans une critique précédente : "Il ne se passe pas grand chose" dans ce livre. Il existe quand même une trame narrative que Robert Penn Warren a emprunté à la vie du sénateur de Louisiane, Huey- Long, un homme politique démagogue et cynique, qui mourût assassiné . le personnage central du roman n'est pas le sénateur Willie Stark , l'avatar de Huey-Long , mais un de ces hommes qui gravitent autour des chefs de partis, un conseiller tout autant qu'un homme de main : Jack Burden.
L'intrigue , sans être compliquée, n'est pas facile à raconter. Si l'on veut qualifier le tout d'un raccourci trivial , on pourrait dire que c'est une histoire banale d'arroseur arrosé. le gouverneur du Comté de Mason City , Willie Stark brigue le Sénat. Un de ses adversaires, le sénateur McMurfee , se trouvant sur son chemin , il charge son homme de main, Jack Burden, de trouver un moyen de faire pression sur le Juge Irwin, un ancien ami de sa mère, afin que lui même intercède auprès de McMurfee pour qu'il laisse la place libre à Willie Stark. Burden ,connaissant bien l'intégrité du juge à la retraite, doute que l'on puisse le faire chanter , "cherche et tu trouveras" lui dit l'inflexible gouverneur. Et il va trouver : une misérable petite affaire de malversations financières vieille de trente ans ; la tâche, le pêché , dans la carrière immaculée du Juge Irwin. Cette découverte sera à l'origine des évènements qui vont alors s'enchaîner inexorablement.
Jack Burden sera ,à son corps défendant , le messager autant que la main du destin. L'auteur a mis beaucoup de ses questionnements, de ses angoisses, de ses anxiétés, dans son personnage principal. Jack Burden est le rejeton d'une riche famille sudiste, étudiant moyen, mal dans sa peau, amoureux fou d'Anne Stanton son amie d'enfance. Il devient journaliste dans un journal local d'où Willie Stark le débauche pour en faire son conseiller. Jack Burden n'est pas un raté malgré les apparences. C'est au contraire un homme d'une lucidité extrême, absolument pas dupe des forfaitures et des perfidies nécessaires au "vivre ensemble" de tous les jours. C'est l'homme de la "chair" , opposé à l'homme de "l'idée" incarné par son ami d'enfance Adam Stanton , brillant chirurgien habité par l'obsession du Bien , qui refuse la direction de l'hôpital construit par Willie Stark , persuadé qu'une bonne dose de Mal s'est invité à sa construction...
Vous l'aurez compris, au fin des fins, "Les fous du roi" se résume à une grandiose dissertation sur le Bien et le Mal , thème éminemment sudiste s'il en est (Faulkner et ma chère Flannery O'Connor ).
S'il vous prend l'idée (bienvenue , malgré mon compte-rendu décousu :-) , d'entreprendre la lecture de ce livre (lu dans l'édition de poche "biblio" ) , il faut absolument lire la belle introduction de Michel Mohrt qui explique magnifiquement les enjeux du roman, son contexte, sa place dans l'oeuvre de Penn Warren.
Enfin, une mention particulière pour la langue de Robert Penn Warren ; certainement édulcorée par la traduction (traducteur Pierre Singer, qui a du être à la peine vu la difficulté à rendre le sel des dialogues...) . L'auteur est un virtuose de l'image et de la métaphore. Tout au long des sept cents pages et au moment des dialogues je n'ai pu m'empêcher de penser à des scènes réelles ou imaginées de cinéma américain . Pouvoir du MYTHE !
"Par ici les choses ne changent guère" , dit le patron. La phrase ne semblait pas exiger de réponse , donc je n'en fournis aucune.
"Je parie que j'ai bien entassé , l'un dans l'autre, des milliers de litres de pâtée pour les cochons dans cette auge" dit-il. Il cracha de nouveau. " Je parie que j'ai régalé au moins cinq cents cochons dans ce coin-là. Et d'ailleurs, nom de Dieu ! c'est toujours ce que je fais : verser de la pâtée !
- Eh bien, c'est de ça qu'on vit, n'est-ce-pas ?
Il ne répondit pas."
Une écriture remarquable pour un roman sur le monde politique avec "ses "grandeurs et ses turpitudes". Des personnages décrits avec maestria et une ambiance magnifique. Epuisé mais à chercher d'occasion car il en vaut la peine.
LE CAVALIER DE LA NUIT de ROBERT PENN WARREN
Perse Munn, marié, avocat, vien assister à une réunion ayant pour but de créer une association de producteurs de tabac pour lutter contre les fabricants de cigarettes unis dans un cartel pour acheter le tabac à bas prix. Sans l’avoir cherché il va se retrouver après le discours du sénateur Tolliver, propulsé sur l’estrade à faire un discours qui enflamme les participants. On le dit promis à un grand avenir. Il va défendre un planteur accusé de meurtre et son importance grandit au sein du mouvement. Invité par le sénateur à Noël, il rencontre Christian et le Capitaine, mais sans le réaliser sur le moment, tout va changer, on entrevoit pour lui un poste au Congrès. Puis, très vite, le sénateur quitte l’association, Munn, Christian et le Capitaine créent l’Union libre des Fermiers organisée en bandes de 10 pour mener des actions militaires envers les planteurs qui continuent à vendre leur tabac aux cigarettiers en dehors de l’association. Munn s’implique directement dans la bande 17. Curieusement Munn perpétue ces attaques sans avoir l’impression de le faire, sa femme ne le reconnaît plus et le quitte, il s’enfonce dans son rôle de Cavalier de la nuit, le Capitaine ne le suit plus et un meurtre va précipiter les événements.
C’est sur un fond d’histoire réel que ce roman est construit, la lutte au tout début du 20 ème siècle au Kentucky et dans le Tennessee entre planteurs et fabricants autour du prix du tabac. Lutte violente qui générera de nombreux morts avant qu’une loi n’impose des règles de concurrence. Mais le propos de l’auteur va bien au delà de cette histoire presque anecdotique, c’est surtout l’aventure humaine de cet avocat plutôt timide qui va se trouver impliqué dans une affaire dont chaque étape va lui échapper, pris qu’il est dans des discours qui le dépassent totalement, aspiré par les foules qui vont le transformer en un exécutant tueur pour une société secrète. Un roman sombre, un homme seul, abandonné de tous, qui croira jusqu’à la fin que son combat est juste, qu’il sert le Bien contre le Mal mais qui finira par tout perdre. Ce n’est pas pour rien que Penn Warren a été comparé à Faulkner!
Perse Munn, marié, avocat, vien assister à une réunion ayant pour but de créer une association de producteurs de tabac pour lutter contre les fabricants de cigarettes unis dans un cartel pour acheter le tabac à bas prix. Sans l’avoir cherché il va se retrouver après le discours du sénateur Tolliver, propulsé sur l’estrade à faire un discours qui enflamme les participants. On le dit promis à un grand avenir. Il va défendre un planteur accusé de meurtre et son importance grandit au sein du mouvement. Invité par le sénateur à Noël, il rencontre Christian et le Capitaine, mais sans le réaliser sur le moment, tout va changer, on entrevoit pour lui un poste au Congrès. Puis, très vite, le sénateur quitte l’association, Munn, Christian et le Capitaine créent l’Union libre des Fermiers organisée en bandes de 10 pour mener des actions militaires envers les planteurs qui continuent à vendre leur tabac aux cigarettiers en dehors de l’association. Munn s’implique directement dans la bande 17. Curieusement Munn perpétue ces attaques sans avoir l’impression de le faire, sa femme ne le reconnaît plus et le quitte, il s’enfonce dans son rôle de Cavalier de la nuit, le Capitaine ne le suit plus et un meurtre va précipiter les événements.
C’est sur un fond d’histoire réel que ce roman est construit, la lutte au tout début du 20 ème siècle au Kentucky et dans le Tennessee entre planteurs et fabricants autour du prix du tabac. Lutte violente qui générera de nombreux morts avant qu’une loi n’impose des règles de concurrence. Mais le propos de l’auteur va bien au delà de cette histoire presque anecdotique, c’est surtout l’aventure humaine de cet avocat plutôt timide qui va se trouver impliqué dans une affaire dont chaque étape va lui échapper, pris qu’il est dans des discours qui le dépassent totalement, aspiré par les foules qui vont le transformer en un exécutant tueur pour une société secrète. Un roman sombre, un homme seul, abandonné de tous, qui croira jusqu’à la fin que son combat est juste, qu’il sert le Bien contre le Mal mais qui finira par tout perdre. Ce n’est pas pour rien que Penn Warren a été comparé à Faulkner!
Lire Robert Penn Warren n’est pas de tout repos. Si tu as l’impression que ton cerveau est en friche, donne lui à lire le triple lauréat du prix Pulitzer. Il va devoir réfléchir. Et quand tu arriveras au bout, il te restera le plus dur, essayer d’écrire une bafouille en tentant de rendre compte de l’étendue de ce que tu as eu entre les mains et en acceptant le fait que tu ne pourras forcément pas tout dire.
Ce premier roman de Robert Penn Warren, tout juste réédité, nous embarque au début du XXème dans le Kentucky. Afin de résister aux pratiques monopolistiques des grandes compagnies de tabac qui proposent des prix d’achat ridiculement bas, des producteurs décident de se réunir et appellent à refuser de vendre, à boycotter ces acheteurs qui prennent à la gorge les cultivateurs. De cette coalition va émerger une faction plus militante, plus radicale. Les cavaliers de la nuit vont avoir recours à l’intimidation physique et à l’incendie des récoltes de ceux qui ne veulent pas rejoindre le mouvement. Le jeune avocat Percy Munn se retrouve embringué dans cette histoire. Au début un peu contre son gré, flatté d’être désiré, enorgueillit de la place qu’on lui donne au sein de l’organisation, puis petit à petit, galvanisé, il va sombrer dans la violence.
Ces évènements ont réellement eu lieu. On pourrait donc penser que l’on entre dans un roman historique sauf que l’on est chez Robert Penn Warren et l’on se dit que le contexte n’est finalement que prétexte à sonder les conflits intérieurs d’un
Les dilemmes moraux de Percy Munn illustrent des questions plus vastes que l’auteur semble se poser (et nous poser) sur l’Homme, sur l’action et la dynamique politique. Qu'y a-t-il en nous ? De quoi les hommes sont-ils capables ? Savent-ils ce qu'ils font, ce qu'ils veulent ? Comment en tant que particule d’un grand tout, se laissent-on entraîner ? Comment nos idéaux peuvent être corrompus ? Pourquoi accepte ton de perdre son âme par vanité ? La liste des questionnements soulevés par le cheminement introspectif de Percy Mumm est longue, la réflexion est vaste.
Robert Penn Warren plonge son personnage dans le tumulte de l’Histoire et entraine le lecteur dans quelque chose de plus grand, dans une dimension quasi métaphysique.
Traduit par Michel Mohrt
Ce premier roman de Robert Penn Warren, tout juste réédité, nous embarque au début du XXème dans le Kentucky. Afin de résister aux pratiques monopolistiques des grandes compagnies de tabac qui proposent des prix d’achat ridiculement bas, des producteurs décident de se réunir et appellent à refuser de vendre, à boycotter ces acheteurs qui prennent à la gorge les cultivateurs. De cette coalition va émerger une faction plus militante, plus radicale. Les cavaliers de la nuit vont avoir recours à l’intimidation physique et à l’incendie des récoltes de ceux qui ne veulent pas rejoindre le mouvement. Le jeune avocat Percy Munn se retrouve embringué dans cette histoire. Au début un peu contre son gré, flatté d’être désiré, enorgueillit de la place qu’on lui donne au sein de l’organisation, puis petit à petit, galvanisé, il va sombrer dans la violence.
Ces évènements ont réellement eu lieu. On pourrait donc penser que l’on entre dans un roman historique sauf que l’on est chez Robert Penn Warren et l’on se dit que le contexte n’est finalement que prétexte à sonder les conflits intérieurs d’un
Les dilemmes moraux de Percy Munn illustrent des questions plus vastes que l’auteur semble se poser (et nous poser) sur l’Homme, sur l’action et la dynamique politique. Qu'y a-t-il en nous ? De quoi les hommes sont-ils capables ? Savent-ils ce qu'ils font, ce qu'ils veulent ? Comment en tant que particule d’un grand tout, se laissent-on entraîner ? Comment nos idéaux peuvent être corrompus ? Pourquoi accepte ton de perdre son âme par vanité ? La liste des questionnements soulevés par le cheminement introspectif de Percy Mumm est longue, la réflexion est vaste.
Robert Penn Warren plonge son personnage dans le tumulte de l’Histoire et entraine le lecteur dans quelque chose de plus grand, dans une dimension quasi métaphysique.
Traduit par Michel Mohrt
Alors, par où commencer ? J'ai lu ce roman en me disant que j'attaquais un monument, un chef d'œuvre… Si j'ai dévoré le début, j'ai laissé tomber au bout d'un moment et ne l'ai repris que bien plus tard. Sans doute ma lecture en a-t-elle souffert, mais c'est aussi le signe que cette lecture était ardue !
Corruption, magouilles politiques, allers et retours dans le temps pour comprendre comment le narrateur "s'est fait". Un roman noir fourmillant de détails, amples (on s'y perd un peu dans le temps et les personnages, mais ce n'est que mon avis). Malheureusement, la narration fait un peu datée, cette lecture a ressemblé à un exercice pour moi, dommage. Mais je reconnais la valeur littéraire de ce roman, et je comprends ce qui en a fait un classique !
Corruption, magouilles politiques, allers et retours dans le temps pour comprendre comment le narrateur "s'est fait". Un roman noir fourmillant de détails, amples (on s'y perd un peu dans le temps et les personnages, mais ce n'est que mon avis). Malheureusement, la narration fait un peu datée, cette lecture a ressemblé à un exercice pour moi, dommage. Mais je reconnais la valeur littéraire de ce roman, et je comprends ce qui en a fait un classique !
Amantha Starr, dite Manty, apprend à la mort de son père que, malgré sa peau blanche, elle a du sang noir dans les veines et que sa mère n'était autre qu'une des esclaves de la plantation de son père.
Vendue à un propriétaire terrien puis affranchie, témoin des heures sombres de la guerre de Sécession, Manty, déchirée entre deux mondes, le monde blanc de son enfance et le monde noir auquel elle appartient, passera son existence à essayer de trouver cette liberté à laquelle chacun de nous aspire.
Très beau roman sur l'esclavage et la Guerre de Sécession, analyse subtile de l'Amérique à la fin d'une époque, celle des planteurs du Sud, ce récit est également une réflexion sur la liberté, l'espérance et sur la difficulté pour chacun de nous d'y accéder.
Un texte riche et dense, très imagé, qui allie avec brio les sentiments romanesques, la brutalité du réel, le tourbillon de l'histoire, les intérêts et les idéaux politiques.
Souvent comparé à Faulkner, Pen Warren (1905-1989), universitaire et romancier, fut deux fois prix Pulitzer et reste malheureusement peu connu en France.
Vendue à un propriétaire terrien puis affranchie, témoin des heures sombres de la guerre de Sécession, Manty, déchirée entre deux mondes, le monde blanc de son enfance et le monde noir auquel elle appartient, passera son existence à essayer de trouver cette liberté à laquelle chacun de nous aspire.
Très beau roman sur l'esclavage et la Guerre de Sécession, analyse subtile de l'Amérique à la fin d'une époque, celle des planteurs du Sud, ce récit est également une réflexion sur la liberté, l'espérance et sur la difficulté pour chacun de nous d'y accéder.
Un texte riche et dense, très imagé, qui allie avec brio les sentiments romanesques, la brutalité du réel, le tourbillon de l'histoire, les intérêts et les idéaux politiques.
Souvent comparé à Faulkner, Pen Warren (1905-1989), universitaire et romancier, fut deux fois prix Pulitzer et reste malheureusement peu connu en France.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Robert Penn Warren
Quiz
Voir plus
Viviane Moore, Le seigneur sans visage
Quel est l'animal de compagnie de Michel ?
une hermine
un chat
une salamandre
un chien
15 questions
810 lecteurs ont répondu
Thème : Le Seigneur sans visage de
Viviane MooreCréer un quiz sur cet auteur810 lecteurs ont répondu