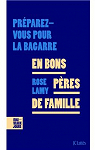Né(e) : 2019
Après avoir travaillé dans la musique et la communication, Rose Lamy a créé en 2019 le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, décidée à mettre au jour un discours sexiste et antiféministe à l’œuvre au quotidien dans les médias. Il est suivi aujourd’hui par plus de 190 000 personnes. Défaire le discours sexiste dans les médias est son premier livre.
Ajouter des informations
A l'occasion des 6 ans du mouvement #MeToo et pour la sortie du livre #MeToo l le combat continue aux éditions du Seuil, Mediapart a organisé une soirée spéciale le 19 octobre 2023 à la salle Olympe de Gouges dans le 11ème arrondissement de Paris. #MeToo : À quoi servent les médias ? - Rose Lamy, autrice de « Défaire le discours sexiste dans les médias » - Valence Borgia, avocate et membre de la force juridique de la Fondation des femmes - Alexis Levrier, historien des médias et maître de conférences à l'Université de Reims - Laure Heinich, avocate - Camille Aumont Carnel, autrice et animatrice de @Jemenbatsleclito 00:00:00 - 00:09:35 : Introduction par Lénaïg Bredoux co-directrice éditoriale de Mediapart, et présentation des invités par Marine Turchi journaliste au pôle Enquêtes de Mediapart. 00:09:35 - 00:17:53 : A quel moment la presse a-t-elle commencé à s'intéresser aux questions de violences sexuelles et sexistes ? avec Alexis Levrier. 00:17:53 - 00:27:31 : Comment percevez-vous le mouvement Metoo ? avec Rose Lamy. 00:27:31 - 00:37:15 : Quel est le rôle des médias et des réseaux sociaux dans ces affaires de violences sexuelles et sexistes ? avec Camille Aumont Carnel. 00:37:15 - 00:43:45 : Les médias accompagnent-ils le mouvement de libération de la parole et de l'écoute ? avec Valence Borgia. 00:43:45 - 00:50:15 : L'utilisation par les médias du langage judiciaire dans ces affaires, et la question de la présomption d'innocence, avec Valence Borgia. 00:50:15 - 01:00:25 : Comment voyez-vous le rôle des médias ? Quelle place pour que chacun et chacune puisse raconter son récit ? avec Laure Heinich. 01:00:25 - 01:08:15 : Présomption de culpabilité et tribunal médiatique, avec Laure Heinich. 01:08:15 - 01:15:50 : Quand est-ce qu'apparaît l'expression de "tribunal médiatique" ? Pourquoi cette expression est-elle un piège ? avec Alexis Lévrier 01:15:50 - 01:19:08 : Quid des "carrières brisées" ? Est-ce que les médias ne se trompent-ils pas d'analyse lorsque de nombreux mis en cause sont toujours invités sur les plateaux et les victimes mises au ban ? Mediapart n'a qu'une seule ressource financière: l'argent issu de ses abonnements. Pas d'actionnaire milliardaire, pas de publicités, pas de subventions de l'État, pas d'argent versé par Google, Amazon, Facebook… L'indépendance, totale, incontestable, est à ce prix. Pour nous aider à enrichir notre production vidéo, soutenez-nous en vous abonnant à partir de 1 euro (https://abo.mediapart.fr/abonnement/decouverte#at_medium=custom7&at_campaign=1050). Si vous êtes déjà abonné·e ou que vous souhaitez nous soutenir autrement, vous avez un autre moyen d'agir: le don https://donorbox.org/mediapart?default_interval=o#at_medium=custom7&at_campaign=1050
« [Les violences intrafamiliales] sont en train de devenir le premier motif d'intervention des policiers et gendarmes. » Et pour ces sta-tistiques, combien de femmes et d'enfants qui n'ont pas encore composé le numéro des secours ? Qui ne le feront jamais, comme moi, parce qu'on leur a confisqué leur histoire ?
Les patriarches tiennent le beau rôle, et les hommes violents, ce sont toujours les autres, les monstres, les fous, les étrangers, les margi-naux. Enfin, c'est ce qu'ils (se) racontent.
Blaguer, ironiser, rire des violences conjugales ne consiste pas seulement à déshumaniser les femmes et les enfants. Le processus permet également de rendre sympathiques des hommes violents, qu'on considère comme de lointains copains gaffeurs, à qui on met une tape dans le dos avec fraternité. On prend de la distance avec leur comportement sans jamais dénoncer leurs violences, jugées secon-daires, ou légitimes.
Dans les brèves de faits divers, tout tourne autour des motivations et de la psychologie des bons pères de famille.
Viviane Elisa-quoi?
Qui Viviane tue-t-elle au début du roman ?
24 lecteurs ont répondu