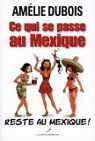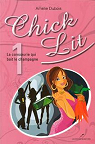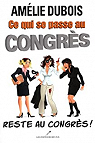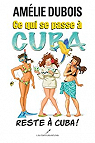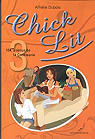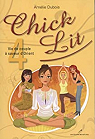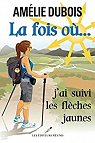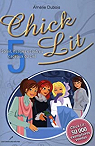Livres populaires du moment
voir plus
Dernières parutions
voir le calendrier des sorties
Dernières critiques
Le commentaire de Lynda : ♥ Coup de coeur ♥
Le premier tome a été un coup de cœur, et le deuxième tome le fut également. J’étais très contente de retrouver Madeleine, ainsi que plein d’autres personnages qui ont été au centre du premier tome, surtout Madeleine bien sûr, mais également Nadia. Ces deux-là font vraiment la paire.
On se souvient que le premier tome s’était terminé avec l’annonce du gagnant du concours. Cette annonce n’est pas au premier plan au début du 2e tome, mais un peu plus tard.
L’auteure met moins d’emphase sur la cuisine dans ce 2e tome, qui se consacre surtout sur Madeleine, ses amours, sa famille, ses buts, et j’ai beaucoup aimé approfondir ce personnage que l’on a appris à aimer dans le 1er tome.
Madeleine est maintenant rendue à Montréal, et ce contre l’avis de ses parents qui ne sont pas tellement d’accord de la voir poursuivre dans cette voie, mais Madeleine s’est fixé un but et un objectif et elle ne dérogera pas, c’est primordial pour elle de réussir.
Mais il y a aussi autre chose que la cuisine dans la vie et elle devra apprendre à vivre avec ça, la famille oui bien sûr, j’en ai déjà parlé, mais que dire de l’amour, et Romain, dans tout ça, réussira-t-elle à lui faire une petite place dans sa vie ?
Madeleine est comme tous les jeunes adultes qui avancent et qui foncent dans la vie. C’est une jeune femme à laquelle on s’attache, et ça pourrait être facile de s’y identifier, je suis certaine d’ailleurs, que beaucoup de jeunes vont se reconnaître dans ce personnage.
Bref, j’ai beaucoup aimé ce deuxième tome, qui se déguste page par page, comme un bon petit plat que l’on a réalisé en suivant une recette.
L'auteure sait garder notre attention et ce depuis le tout début, et quand on termine, on aurait eu envie de continuer. Une plume fluide, des situations qui nous vont directement au coeur, que demander de plus ?
Un coup de cœur pour la fraîcheur du personnage, pour l’histoire qui nous tient solidement du début à la fin, et je crois, que même si ce 2e tome est final, et bien, on aurait pris encore et encore sur Madeleine et son parcours de vie, qui fait chaud au coeur….Je vous recommande sans hésitation.
Lien : https://lesmilleetunlivreslm..
Le premier tome a été un coup de cœur, et le deuxième tome le fut également. J’étais très contente de retrouver Madeleine, ainsi que plein d’autres personnages qui ont été au centre du premier tome, surtout Madeleine bien sûr, mais également Nadia. Ces deux-là font vraiment la paire.
On se souvient que le premier tome s’était terminé avec l’annonce du gagnant du concours. Cette annonce n’est pas au premier plan au début du 2e tome, mais un peu plus tard.
L’auteure met moins d’emphase sur la cuisine dans ce 2e tome, qui se consacre surtout sur Madeleine, ses amours, sa famille, ses buts, et j’ai beaucoup aimé approfondir ce personnage que l’on a appris à aimer dans le 1er tome.
Madeleine est maintenant rendue à Montréal, et ce contre l’avis de ses parents qui ne sont pas tellement d’accord de la voir poursuivre dans cette voie, mais Madeleine s’est fixé un but et un objectif et elle ne dérogera pas, c’est primordial pour elle de réussir.
Mais il y a aussi autre chose que la cuisine dans la vie et elle devra apprendre à vivre avec ça, la famille oui bien sûr, j’en ai déjà parlé, mais que dire de l’amour, et Romain, dans tout ça, réussira-t-elle à lui faire une petite place dans sa vie ?
Madeleine est comme tous les jeunes adultes qui avancent et qui foncent dans la vie. C’est une jeune femme à laquelle on s’attache, et ça pourrait être facile de s’y identifier, je suis certaine d’ailleurs, que beaucoup de jeunes vont se reconnaître dans ce personnage.
Bref, j’ai beaucoup aimé ce deuxième tome, qui se déguste page par page, comme un bon petit plat que l’on a réalisé en suivant une recette.
L'auteure sait garder notre attention et ce depuis le tout début, et quand on termine, on aurait eu envie de continuer. Une plume fluide, des situations qui nous vont directement au coeur, que demander de plus ?
Un coup de cœur pour la fraîcheur du personnage, pour l’histoire qui nous tient solidement du début à la fin, et je crois, que même si ce 2e tome est final, et bien, on aurait pris encore et encore sur Madeleine et son parcours de vie, qui fait chaud au coeur….Je vous recommande sans hésitation.
Lien : https://lesmilleetunlivreslm..
J'ai beaucoup aimé ce roman. Il nous fait découvrir l'Italie pauvre de la fin du XIXème siècle, avec le récit de la narratrice qui a appris à coudre avec sa grand-mère, seule famille qui lui restait après une épidémie de choléra.
Il nous parle de différences entre les classes sociales, de la condition féminine, du statut de "bonne de maison" avec ses côtés obscurs.
Quelques éléments sont très romancés, mais cela reste malgré tout une belle découverte d'un milieu que je ne connaissais pas du tout.
Il nous parle de différences entre les classes sociales, de la condition féminine, du statut de "bonne de maison" avec ses côtés obscurs.
Quelques éléments sont très romancés, mais cela reste malgré tout une belle découverte d'un milieu que je ne connaissais pas du tout.
Amoureuse des animaux, ce livre m'a tout de suite attiré. J'ai eu des difficultés avec toutes les expressions québécoises, il y a bien des passages où j'aurais eu besoin d'une traduction et malheureusement cela a un peu gâché ma lecture. Cependant j'ai beaucoup apprécié le thème de ce roman et la sensibilisation à la cause animale et au métier de vétérinaire. Histoire d'amour entre Alex et Amelia est assez prévisible, j'ai tout de suite deviné la raison pour laquelle Alex a tellement de mal à s'engager mais cela reste une très belle histoire.
Etiquettes
voir plus