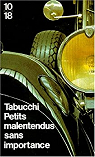| juliebabelio le 03 avril 2023
Nouveau mois, nouveau défi d’écriture ! Je vous propose de travailler sur le quiproquo pour ce mois d’avril. L’idée m’est venue à la suite d’une discussion avec ma grand-mère. Son père aimait peindre et le faisait très bien. Un jour, quand elle était petite, il lui a annoncé avoir fait une reproduction de Monet. Trop jeune pour savoir qui était Monet, elle a compris que son père avait fait une reproduction de monnaie. Vous pouvez imaginer la peur qu’elle a eue en croyant que son père fraudait. C’est une histoire qui nous a bien fait rire. Quels sont ces moments l’interprétation joue un rôle central ? Comment une situation pourrait créer un quiproquo entre des personnages ? Cette situation entraine-t-elle des retombées dramatiques ou humoristiques ?Nous croyons souvent que tout le monde pense comme nous, mais il existe autant d’interprétations qu’il existe de personnes ! J’espère que ce sujet vous inspira ! La taille et la forme de votre contribution sont libres et nous ne prenons en compte que le premier texte que vous posterez ici en répondant ci-dessous. Vous avez jusqu’au 30 avril pour participer et tenter de remporter un livre. À vos claviers ! Julie  |

 | Walex le 03 avril 2023
Bonjour juliebabelio, Merci pour ce nouveau défi du mois d'avril et la rapidité de sa venue. Jolie histoire. Lorsque vous parlez de Monnet, j'imagine que vous évoquez Claude (Monet, avec un seul -n), le peintre, et non pas Jean (Monnet, avec 2 -n), que ce soit le banquier ou le directeur de théâtre, tous deux plus coutumiers des pièces ^^ |
 | juliebabelio le 03 avril 2023
Oh excusez-moi ! Quelle erreur... Je corrige cela tout de suite. Merci pour votre oeil de lynx ! Comme quoi, une petite faute peut changer l'interprétation. Nous sommes toujours dans le thème !
|
 | Snoopythecat le 03 avril 2023
Chouette sujet. Reste à cogiter et à trouver l'inspiration. |
 | Cathye le 03 avril 2023
Bonjour juliebabelio Encore un sujet qui va nous remuer les méninges. |
 | JoiE2Lire le 04 avril 2023
Bonjour, Je n'ai jamais participé mais j'ai envie de me lancer... A très bientôt, enfin je l'espère si je trouve l'inspiration et la motivation. Bonne fin de journée à tous. |
 | Snoopythecat le 04 avril 2023 GaLim Courage, le terme est excellement adéquat |
 | Salameche65 le 04 avril 2023
Bonsoir, je n'avais jamais penser essayer ce genre de projet mais je trouve que c'est un bon défi à relever pour une passionnée d'écriture. J'espère apprendre beaucoup. Hâte de découvrir toutes les œuvres des participants. |
 | uryade le 05 avril 2023
Bonjour Je découvre ce genre de défi. Je n'ai jamais écrit mais pourquoi pas tenter l'expérience... On doit mettre son récit ici, dans les commentaires ? Merci et belle idée de thème. |
 | Snoopythecat le 05 avril 2023 uryade Oui, oui, c'est bien sur cette page qu'il faut poster votre texte. Hâte de vous lire.
|
 | liliper66 le 05 avril 2023
Bonjour à toutes et à tous. Voici mon texte qui raconte ce qui m'est arrivé lorsque j'avais huit ans. Nostalgie bucolique Après avoir quitté depuis peu les rives sud-américaines de l’Océan Atlantique, je découvris les plages de la Grande Bleue. Accueillis par mes grands-parents maternels, mes parents tentaient de construire un nouvel avenir et moi de m’adapter à ce pays bien différent de celui qui m’avait vu naître. Il fallait également que j’assimile vite sa langue afin de ne pas prendre trop de retard dans ma scolarité. Le cours de CE1 venait tout juste de commencer et l’institutrice nous avait appris ce jour-là une chanson du répertoire infantile. En fin d’après-midi, maman était venue me chercher à la sortie des classes et nous rejoignîmes mémé sur les dunes. Elles y ramassaient des pissenlits que la famille savourait en salade. Mon aïeule était une femme de terrain, au sens littéral du terme. Toujours dehors, pendant des années elle avait parcouru tous les chemins, vers les villages les plus reculés, afin de vendre le poisson que son mari pêchait. Maintenant elle passait l’hiver au milieu des vignes, affrontant les attaques d’un souffle glacial, à faire des fagots de sarments qu’elle vendait aux touristes pendant la saison estivale. Petite et toute ronde, elle donnait pourtant une impression de force extraordinaire. Un regard gris clair, des cheveux blancs coupés court mais aussi fins et doux que ceux d’un enfançon. Quand elle chantait, et cela lui arrivait souvent, elle avait une voix claire comme l’eau bondissante d’une cascade. Sa fille, qui avait hérité de ce don, l’accompagnait volontiers et cela nous ravissait toujours. C’est donc avec fierté que je leur annonçai que j’allais leur interpréter la ritournelle récemment mémorisée. Elles cessèrent leur activité et m’écoutèrent : - Coliques dans les prés fleurissent… Maman m’interrompit aussitôt, en essayant de ne pas s’esclaffer, pour rectifier mon erreur. - Je crois que c’est plutôt : colchiques. Ce sont des fleurs… - Non, j’en suis sûre ! Et de recommencer : -Coliques dans les prés fleurissent, fleurissent Coliques dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne emportée par le vent En ronde monotone tombe en tourbillonnant. Cette fois elles éclatèrent de rire et, devant mon visage renfrogné, leur hilarité redoubla. Mémé, essuyant des larmes avec le devant de son tablier, prit prétexte de relacer ses espadrilles et s’assit sur le sable, tentant de reprendre son souffle. Maman tenta de m’expliquer la signification du mot que j’employais mais le fou rire l’en empêcha. Terriblement vexée je n’en démordis pas, annonçai que je demanderais confirmation à la maîtresse et me mis à bouder. J’aurais tant voulu leur parler de ces châtaignes dont je n’arrivais pas à prononcer correctement les syllabes, mettant un t devant le ch, et qui m’étaient aussi inconnues que ces maudites col… je ne savais pas quoi ! Levant les yeux au ciel je vis les nuages qui n’avaient pas le temps de s’étirer car, telles les feuilles, ils étaient emportés par la Tramontane vers le continent africain. Et ce chant qui s’était voulu offrande de bonheur, me laissait le goût amer de la désillusion. Le lendemain je dus convenir que je m’étais trompée et présentai mes excuses. Cette erreur « comico-linguistique » resta un sujet de tendre plaisanterie. Bien plus tard, lorsque la quatrième génération se joignit à nos promenades, mémé, devenue mimine, ne put s’empêcher d’entonner la chanson et… d’amuser ses arrière-petites-filles. |
 | voloskine le 05 avril 2023
A propos de quiproquo Adéquat ? Ou a des couettes ? De pas savoir c'est tressant ! Volo |
 | Nastasia-B le 05 avril 2023
Bonjour à toutes et tous, voici une petite fantaisie, sans prétention. C'est la première fois que je participe, peut-être n'est-ce pas la forme idoine. Vous me direz. L'ÂNE Mon ex-mari est quelqu’un d’assez fantasque : il fait parfois des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, il y a plus d’une dizaine d’années de cela, il est revenu un jour en me disant : « Chérie ! Je t’ai acheté une maison de campagne. — Ah bon, fis-je, sans m’en parler ? comme ça ? — C’est une occasion unique, il faut sauter dessus, tu comprends : je me suis engagé tout de suite. Si j’avais attendu ne serait-ce que deux heures, elle nous passait sous le nez, c’est certain. — Et quand est-ce que tu l’as visitée ? — Je ne l’ai pas encore visitée. — Quoi !? Tu as acheté une maison sans la visiter !? — À ce prix-là, pas besoin de la visiter, c’est une affaire en or. » Je n’insistai pas, mais cela me paraissait hallucinant d’agir ainsi pour des projets qui nous engageaient sur le long cours. J’acceptai néanmoins de lui faire confiance et de ne pas voir la maison tout de suite. D’ailleurs, il tenait à me faire la surprise de sa découverte le jour où nous en serions les légitimes propriétaires. Les démarches se firent, donc, avec les incompressibles délais notariés, et enfin, après plus d’un mois ou deux, je ne sais plus exactement, vint le jour où il me dit : « T’es prête, Chérie ? Je t’emmène voir ta maison. » Après bientôt une centaine de kilomètres, nous quittâmes l’autoroute et commençâmes d’arpenter quelques départementales bien tortueuses des Vosges, puis, à un moment, il bifurqua vers un chemin encore plus pentu et contourné. Quand, à force de cahots, je sentais le mal de mer monter en moi, il arrêta la voiture ; nous descendîmes. J’avais la tête cotonneuse. Alors c’était donc ça, ma maison de campagne ! Ça n’avait pas grand-chose d’une maison, mais en revanche tout de la campagne. J’imagine que pour à peine plus cher on aurait pu avoir des portes et un plafond. Mais bon, c’était bucolique, il est vrai, excessivement dépaysant. Il y avait, attenant, un petit terrain au relief assez abrupt, dont pas un seul mètre carré ne devait être horizontal, mais qui semblait convenir parfaitement aux ronces qui ne demandaient qu’à y prospérer. Bref, je vous passe les détails mais pendant des années, nous n’avons passé nos vacances et nos week-end qu’à effectuer des travaux à l’intérieur de la maison et qu’à couper des mauvaises herbes à l’extérieur. Peu à peu, nos filles grandissant et nous y incitant lourdement, l’idée fit son chemin que nous aurions pu avoir un âne pour entretenir ce terrain à l’entour de notre maison de campagne. C’était une idée qu’on avait posée comme ça, sans nous être décidés tout à fait, ni y avoir placé d’échéancier. Un jour, après avoir fait des courses avec leur père, l’aînée de mes filles, celle qui a du mal à ne pas vendre les mèches, courut vers moi avec un sac plein de victuailles en disant : « Papa a acheté quelque chose, mais c’est une surprise. » Habituée à redouter le pire, j’attendais impatiemment qu’il m’en parle de lui-même, ce qu’il ne fit pas. N’y tenant plus, à un moment, je m’approchai de lui et dit : « Alors ? Les filles m’ont dit que tu avais fait quelque chose au magasin. — Ouais ! J’ai acheté l’âne au Mali. — Quelle idée ! Mais pourquoi ça ? — Parce que je pensais que ça t’aurais fait plaisir. — Mais pourquoi là-bas ? — Et pourquoi pas ? Ce que tu peux être snobinarde, parfois ! — C’est pas une question d’être snob, c’est une question de bon sens. En l’occurrence, c’est s’attirer des frais et des emmerdes là où on aurait pu les éviter, c’est tout. » Il y avait déjà de l’eau dans le gaz entre nous à l’époque, c’était peu de temps avant notre divorce. Il n’empêche qu’il me considéra avec un regard interdit que je ne lui connaissais pas, du genre : « Qu’est-ce qu’elle me dit, cette folle ? » Il resta interloqué pendant peut-être une minute puis finit par lâcher : « Écoute, si tu ne veux pas le lire, j’irai le rendre : j’ai gardé le ticket de caisse. Mais ce n’est pas la peine d’en faire une affaire d’état : je pensais que ça t’aurait plu. — Mais ?? De quoi parles-tu ? — Eh bien, du livre, pardi ! Tu croyais que c’était quoi ? — Tu m’as bien dit que tu avais acheté un âne, non ? — Pas du tout ! Où as-tu été chercher ça ? » Et il me sortit le roman d’Hervé Le Tellier, L’Anomalie. |
 | JeffKerdraon le 05 avril 2023
Intéressant ce sujet , alors je me lance voici ma participation. J'espère que cela n'est pas trop long. LES YEUX DE SYLVIA A la sortie de mon bureau, après ma journée de labeur au « Crédit Populaire », il m’arrive souvent de ne pas avoir envie de prendre le métro. J’adore, traîner, flâner, errer, musarder, baguenauder, ou plutôt vagabonder, déambuler, vadrouiller, parfois m’asseoir à une terrasse de café, ou sur un banc public. Il y a mille façons de traînasser quand on n’a pas envie de se retrouver solitaire dans son appartement plutôt exigu et en désordre. Souvent, je reviens chez moi à pied, en changeant de chemin à chaque fois. C’est ma façon à moi d’explorer Paris, cette ville qui se réinvente sans cesse, où toutes les rencontres sont possibles, où le paradis côtoie l’enfer, où la frénésie bouscule l’indolence, où la richesse toise la pauvreté et où la charité croise l’indifférence. Je suis célibataire, en dehors des heures que je passe à travailler comme une souris dans sa roue, le temps pour moi, n’est soumis à aucune obligation. Je travaille dans le quartier de la Bourse et j’habite prés du métro Brochant. Mon rythme de marche se prête au jeu de mon humeur : rapide, tête baissée, pour les jours noirs, lente, regard aux aguets, pour les jours sereins. Chaque voyage, vers mon appartement, diffère du précédent, les décors changent et avec eux les odeurs, les bruits, les gens. La ville, comme une forêt labyrinthique, me renvoie des images et des sensations d’homme des bois. Certaines rues, riches de leurs boutiques, de leur larges trottoirs plantés d’arbres me procurent du bien être, presque de la béatitude, grâce à cette profusion de lumières, cette pléthore de tentations, cette suavité des odeurs de pâtisseries ou de parfumeries. D’autres, par contre, peuvent m’angoisser, m’amener à me tenir aux abois tant ma méfiance y est grande, étroites et sombres, les bruits de pas s’y étouffent, les odeurs y sont souvent celles des poubelles des petits restaurant kebabs ou chinois qu’elles abritent ainsi que quelques bars louches d’où sortent des silhouettes titubantes et des couples tarifés. Et puis il y a celles, très ennuyeuses, dans lesquelles se suivent des immeubles alignés comme à la parade, tous en costume haussmannien avec des décorations prétentieuses, témoignage d’une vanité architecturale bourgeoise ; aucun commerce dans ces rues, aucun bruit, les pas y résonnent comme sur le dallage d’un hall de palais de justice. Je n’établis jamais à l’avance mon parcours, seules mes envies me guident ainsi que le hasard. Il m’arrive de me perdre, peut-être alors, mon sens de l’orientation, mon instinct, me pousse à prendre telle rue plutôt que telle autre, je débouche toujours sur quelque chose de connu et mon errance continue. Mes possibilités de rencontres devraient se compter par centaines, mais le milieu citadin, royaume de l’incognito, n’autorise que le croisement rapide, pas de : « bonsoir » ou de « comment allez-vous ?». La ville permet de rester un anonyme, ce qui peut être un avantage, mais elle vous contraint souvent à la solitude au milieu d’une énorme population indifférente à vos problèmes, à vos déficiences. Lorsque je cesse de marcher et que j’occupe un banc publique, je peux enfin observer les va et vient de ces molécules humaines que l’on appelle aussi : individus, gens, personnes, êtres humains, ou au mieux Monsieur, Madame. Ils viennent d’on ne sait où, et vont, de même, dans l’inconnu. Rares sont ceux qui ne se pressent pas. Pourtant, il existe une catégorie d’immobiles que nous définissons en trois lettres : les SDF, ceux qui, par malchance, vivent dehors. Avec ceux là, comme je suis chez eux dans la rue, je me dois d’être poli, je ne les ignore pas, je leur parle, pas de la dernière pièce qui sort au « Gymnase », mais de la pluie et du beau temps, je leur laisse régulièrement un peu d’argent comme si je payais une dette. Je les retrouve souvent aux mêmes endroits, car comme les animaux sauvages, il leur faut des repères, ils se maintiennent sur leur territoire pour capter les diverses offrandes des dames patronnesses du coin, ces dernières les connaissent bien. J’ai fini par retenir les prénoms de certains d’entre eux, du moins les sédentaires. J’aime aller les voir pour prendre de leurs nouvelles. Ce milieu de la rue, pourtant dur, sale, inconfortable, cruel parfois, peut attirer. Il y règne une certaine forme de liberté, les rapports sociaux se réduisent à presque rien, on ne doit rien, et on ne rend compte de rien à personne, et surtout pas à la société : « cette garce qui m’a rejeté, et dont je ne fais plus partie». On y est à l’abri de la plupart des responsabilités qui se réduisent qu’à soi, ce petit rien qui souffre et qu’il faut nourrir, protéger du froid, et lui procurer de quoi dormir. Pour poser son amour ou sa haine, on prend un chien, support du peu d’autorité qu’il nous reste. Dans la rue, l’ordre bourgeois se présente sous la forme de flics, la plupart du temps peu présents, sauf si vous dérangez. Ici, sur le macadam du trottoir il n’y a pas d’avenir et plus de passé, « trop douloureux », seul l’immédiateté compte dans le lieu et le moment. Le jeune, dans la précarité, avec sa santé encore neuve, peut vivre la rue comme une aventure libertaire excitante où, chaque jour, la vie se réinvente avec de nombreuses rencontres souvent dans l’alcool et la drogue. Mais, cela ne dure pas longtemps, bien entendu, un ou deux hivers suffisent à comprendre que la liberté se déguste qu’une fois les besoins primaires satisfaits, et pour cela il faut un minimum d’argent. Ce jeune devient alors un marginal et ne tarde pas à être un exclu, presque irrécupérable, se comportant comme un loup affamé à la recherche de la nourriture, d’un abri, et pour certains de quoi se payer sa drogue. Mais, le moment est venu que je vous raconte ma rencontre avec une jeune SDF qui, ce jour là, mendiait en jouant de la flûte douce. Elle se prénommait Sylvia. Nous étions à la mi juin, grâce à un anticyclone persistant, le soleil donnait à Paris une humeur méridionale. Les femmes se dénudaient, réveillaient leur séduction amoureuse. La vie s’exprimait avec force et tonicité. Les terrasses de café débordaient de monde. Tout ces gens volubiles et joyeux donnaient envie de danser, de chanter. Ce soir là, prétextant une obligation quelconque, je me trouvai sur le trottoir une heure plut tôt que d’habitude. Je me sentais des fourmis dans les jambes et une envie de nature. Comme je ne pouvais pas aller à pied dans les prairies et les bois de Normandie, j’optai pour le jardin des tuileries, en même temps je rendrais visite, sur les quais, à Michel, un clochard, un vrai de vrai, avec la chopine, la clope collé à la lèvre, une trogne de cirrhosé à la barbe hirsute. Ma traversée des Tuileries m’a fait l’effet d’un cocktail a la fois amère et sucré. J’adore les enfants, et ce jour là le parc en regorgeait avec des mamans gracieuses et charmantes. Toute cette vibration de la vie humaine me ramena à ma solitude, plus de femme et pas d’enfants. J’empruntais le quai des tuileries jusqu’au pont du Carrousel, Michel s’y trouvait souvent, mais pas aujourd’hui. Assis sur des cartons, en train de ranger leur barda, Manbata et Lucien, ses potes, m’informèrent que Michel avait eu un malaise, les flics l’avaient emmené et ils ne savaient pas où ? Manbata d’un ton fatigué, sans intonation me dit : - Faut qu’on se barre d’ici, c’est s’qu’ont dit les poulets ; on peut plus se poser nulle part maintenant, y faudrait marcher tout le temps. Comme à chaque fois, je les quittai tristement, pris de remords à cause de mon impuissance à les aider. Je m’attardai sur les quais jusqu’au pont Alexandre III, je me sentais bien, en ce sens que je jouissais de ce plein de vie en moi et du soleil qui rendait l’endroit presque paradisiaque. Dans ce monde urbain, le couloir de la Seine permet à l’air de circuler et sur les quais je respirais mieux. Je remontai sur le pont et décidai, pour rentrer chez moi, de prendre l’avenue Winston Churchill pour rejoindre l’avenue Marigny, et remonter la longue rue de Miromesnil, jusqu’au boulevard des Batignolles. Beaucoup de monde occupait l’esplanade devant le métro Champs Elysées Clémenceau, des touristes mais aussi des parisiens qui rentraient du travail, un vélo taxi, des vendeurs à la sauvette, des pigeons et des moineaux qui ramassaient les miettes. Mais, par le travers de mon oreille, quelque chose de particulier attira mon attention : le son d’une flûte douce, cette musique s’insinuait dans le brouhaha de la circulation et les harangues des vendeurs. Ces petites notes voletaient allégrement en harmonie avec cette soirée printanière, elles venaient d’une zone proche de la sortie du métro. Attiré et curieux je m’approchai. Le long des grilles du square, entre le métro et le kiosque à journaux, deux jeunes SDF quêtaient tandis qu’une jeune fille assise au milieu d’un fatras de sacs jouait de la flûte douce à bec. La scène ne présentait aucun caractère d’originalité et de nos jours on pouvait l’observer couramment, mais ce qui me surpris fut l’extraordinaire beauté de la jeune fille. Je restais, figé, à l’écouter jouer, elle ne semblait pas s’intéresser à son environnement, entièrement habitée par sa musique, le regard fixé sur le sol. La plupart des gens ne prêtaient guère attention à ces marginaux, ils s’engouffraient vite dans le métro, parfois, s’arrêtaient acheter un journal au kiosque. Les touristes, quand à eux, avaient la tête plongée dans leur guide et pivotaient sur eux même, les yeux en l’air vers le grand palais. Donc, comme j’étais un des rares spectateurs, quand la fille releva la tête, elle accrocha mon regard et me fixa avec insistance. D’habitude, je fuis ce que je perçois comme une intrusion, un trop d’intimité, je regarde ailleurs. Cette fois-ci je gardai mes yeux dans les siens et de sa part je compris le sens d |
 | JeffKerdraon le 05 avril 2023 |
 | JeffKerdraon le 05 avril 2023
Je ne comprends pas. J'ai lu que la taille était libre or après avoir cliqué sur PUBLIER je constate qu'il n'apparait ici qu'une partie de mon texte. Dois-je scinder mon histoire en plusieurs parties ? Jeff
|
 | JeffKerdraon le 05 avril 2023 Les yeux de Sylvia Partie 2 Cette fois-ci je gardai mes yeux dans les siens et de sa part je compris le sens de l’expression : « fusiller du regard ». Sa manière de me dévisager ne présentait aucune douceur, elle contenait de la colère, de la révolte que de grands yeux en amande marrons foncés presque noirs accentuaient par leur intensité. Elle tourna la tête vers un de ses camarades et se releva. Je l’imaginais plus petite alors qu’elle avait presque ma taille soit pas loin d’un mètre quatre vingt, son corps gardait encore des rondeurs d’adolescente, visible grâce à un jean particulièrement collant, déchiré par endroit et un tee-shirt blanc orné du symbole « peace and love » qui laissait voir le nombril. Un bandeau rouge maintenait ses grands cheveux noirs qui encadraient un visage non maquillé, en ovale, avec des joues légèrement creusées au teint naturellement bronzé. Une bouche aux lèvres charnues, d’un dessin parfait, occupait une bonne place au dessus d’un menton arrondi et moyennement saillant. L’un des garçons me tendit un petit chapeau de paille, dans lequel je mis modestement cinq euros qui me valurent un : « Merci ! Monseigneur ». La jeune fille me regarda à nouveau avec cette fois-ci un grand sourire. Avant que ma timidité ne me bloque, je me dépêchai de l’interpeller : - Pardon Mademoiselle, quelle était la musique que vous jouiez ? C’était particulièrement joli. Elle éclata de rire avant de me répondre. - Je ne peux pas vous dire, la plupart du temps j’improvise, ou je mélange des petites séquences de mélodie classique. Vous êtes musicien ? - Non, hélas, cela me plairait bien. Je ne savais pas trop comment continuer la conversation et l’envie de rester plus longtemps avec eux me souffla cette proposition presque saugrenue : - Peut-être avez-vous faim ? Cela vous direz que j’aille vous chercher des burgers au Mac Do. A vos âges vous devez en raffoler. Ils se regardèrent avec étonnement, mon invitation sortait du cadre de l’habituel. La fille, la première s’exprima sans consulter les garçons : - Oh ! Oui ! Ce serait sympa de votre part. Mais ce n’est pas tout près. Vous allez vous retarder. Ensuite, elle questionna les garçons sur leur choix de burger. La montée des Champs Elysées avec un des garçons m’appris que la fille s’appelait Sylvia, elle était de descendance italienne, des Pouilles. Il ne savait pas grand-chose sur elle. Ils ne se connaissaient pas beaucoup, ils se retrouvaient un peu par hasard. Son pote et lui ne se séparaient presque jamais, c’est elle qui apparaissait, mais jamais pour très longtemps. Ils ne savaient pas où elle dormait le soir. Son pote aurait bien aimé savoir car il voulait se la faire. On la voyait avec divers groupes, souvent avec celui de la vieille Irma et Banane, du côté de la République, le canal Saint Martin, ou alors vers St Lazare avec Rose et Bernard et le vieux Marcel. Il me fit remarquer : - Eh ! Mais, vous la kiffez bien c’te meuf ! Vrai, c’est de la balle ! Pour se brancher, c’est pas de la tarte, elle cause pas. J’la fissure aussi, mais c’est pas une timp, Avec son argot de banlieue, j’avais du mal a bien comprendre les nuances de ce qu’il me racontait. Lors de mon retour, alors que je tenais un sac aux effigies de Mac do, Sylvia me regarda intensément, avec une sensualité qui me déstabilisa, il me sembla ressentir cette sorte d’appel à partir duquel le désir prend naissance chez l’homme. A cause de cette intensité, cette fois-ci mon regard se détourna. Elle paraissait joyeuse, un large sourire donnait encore plus de force à sa beauté et à son pouvoir de séduction. Elle s’adressa à ses deux acolytes : - Chouette, on va se régaler ! Ramda, je connais ton amour pour les frites, mais là, tu te sers dans mon paquet ! Je fus, comme tout à l’heure, un peu étonné par sa voix, d’un alto velouté, elle parlait sans vulgarité, avec un français correct. La fréquentation des SDF ne m’avait pas habitué à cela et je n’arrivais pas à comprendre ce que Sylvia faisait ici avec ces types. Il est vrai que dans la rue on rencontre une grande variété de gens paumés qui ne le paraissent pas. Ils se battent tous les jours pour rester propre, et pour chercher gîte et pitance le soir. Bien qu’ayant envie de rester avec eux, ou plutôt avec Sylvia, je me sentis, d’un coup, gêné, j’occupais une place, celle du passant. Une vraie frontière invisible nous séparait, ils appartenaient au dehors et moi au-dedans de ce que l’on appelle, le système. Je n’allais pas tarder à être perçu comme un peu lourd et collant. Mais, quelque chose devint évident pour moi : je ne pouvais pas partir sans l’espoir de revoir Sylvia. De façon ridicule, comme on demande à un concertiste dans quelle salle il va jouer à nouveau, je m’adressai à elle presque en bafouillant : - Où est-ce que je peux vous revoir jouer ces prochains jours ? Je pris conscience que j’avais dit « revoir » et non « entendre ». Mais revoir était le mot juste, je désirais plus que tout la revoir, croiser encore son regard profond. Elle me répondit : - Dans la journée je suis un peu partout, mais le soir je suis plutôt dans le quartier de Saint Lazare. Parce que si je ne trouve pas un refuge je peux essayer de dormir dans la gare. Les recoins pour SDF devaient être nombreux autour de St Lazare, je m’imaginais la cherchant sans la trouver. Ses propos m’attristèrent par leur imprécision et je m’apprêtai à continuer ma route la mort dans l’âme. A ce moment, une émotion violente m’envahit, je ne pouvais pas partir sans certitude d’une possibilité de la revoir. Mon trouble me paralysait, je restais quelques minutes, figé, impuissant, fermé au mouvement permanent d’hommes et de femmes qui parcouraient cette petite esplanade. Je me décidai enfin à faire quelque chose qui me parut farfelu : je tendis à Sylvia une carte de visite personnelle avec ces mots que je prononçais sur le ton de la confidence : - Voilà, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez m’appeler sur mon portable, ou le soir chez moi, et même si vous avez des difficultés vous pouvez venir frapper à ma porte, je vous aiderais. Mon bras resta tendu un moment, le temps que Sylvia réalise ma proposition, qu’elle cesse de manger son hamburger et qu’elle s’empare d’une serviette en papier pour essuyer la mayonnaise de ses doigts. - Guillaume Dubuchain,…..Oui,… j’aime mieux les gens quand je peux leur donner un nom. Merci, j’vais essayer de pas la perdre. Peut être que je pourrais en avoir besoin, on sait jamais. Mais vous savez, j’me débrouille assez bien. J’ai moins de problèmes que ce que vous pouvez imaginer. Le regard et l’expression de Ramda et de son copain me sembla plein de désapprobation, ils devaient me considérer comme un bourgeois qui draguait leur copine, qui piétinait leur territoire. Chacun devrait rester à sa place dans ce monde, mais voilà on ne choisit pas les yeux qui vous pénètrent, vous bouleversent, vous bousculent, et apportent la révolution dans votre tête. Ces yeux qui juste avant que je m’en aille, avec toujours la même intensité, m’attrapèrent sans que, cette fois ci, je ne les lâche pendant quelques secondes proches d’une éternité. Avec le brouhaha de la circulation, mes pas reprirent leur rythme dans le flot humain. Je me sentais comme le marin qui s’éloigne d’un port et qui retrouve le vent et l’air du large, portant encore en lui la chaleur d’une rencontre éphémère. Le lendemain, je dérogeai à mes habitudes de marcheur. A la fin de ma journée de labeur, je décidai de prendre le métro pour me rendre au plus vite, devinez où ? A Saint Lazare ! Pendant toute la journée je fus assailli par le souvenir des yeux de Sylvia. Au début je résistai, pour essayer de faire cesser cette obsession, je me persuadai que cette rencontre ne pourrait jamais mener quelque part, il me fallait oublier. Vous avez tous connu ce langage de la raison, celui qui ne gagne jamais contre les élans du cœur. Ces yeux, et tout ce qu’ils contenaient, refusèrent de quitter mon esprit. Alors j’échafaudai un plan, celui de parcourir dans la soirée tout le quartier de Saint Lazare, ensuite, demain, j’irai vers le canal Saint Martin, puis à nouveau vers St Lazare jusqu'à ce que je la retrouve. Je ferais en sorte de l’inviter à dîner quelque part, même s’il fallait que je lui achète une robe pour qu’elle soit présentable. Et puis, je la mettrais en confiance et nous parlerons, elle me racontera son histoire, ses déboires et moi les miens, nous avons tous des moments de chute dans nos vies. Je l’aiderais à se reconstruire, à sortir de la rue. Mon cerveau jonglait avec tout cela, sur un air de pure romance, flottant sur le rêve éveillé d’un homme un peu trop solitaire. Je me replongeai dans mon travail, mais je savais que les yeux étaient toujours là. Je commençai par la cour du Havre, sous les arcades de l’immeuble de l’hôtel Hilton, je découvris un sans abri, un homme maigre en survêtement, encombré de sacs plastiques plein de vêtements et d’un grand cabas à roulettes gonflé par un sac de couchage. Il lisait un journal froissé. Je ne savais pas comment le questionner sans le mettre sur ses gardes, s’il m’associait à une quelconque autorité, sa peur, pourrait le conduire à un mutisme total. Je plaçai quelques euros dans une coupelle qu’il avait posé devant un carton sur lequel on pouvait lire « S’il vous plaît, donnez moi ce que vous pouvez, votre Dieu en tiendra compte ». Je trouvais cette annotation peu banale et très intelligente compte tenu des nombreuses personnes qui sont dans la croyance d’un au-delà. Il se plaçait ainsi dans la famille de ceux qui croient en un Dieu, peu importe la religion. Il leva la tête et me remercia, j’en profitais pour le questionner :< |
 | JeffKerdraon le 05 avril 2023 Les yeux de Sylvia Partie 3 Il se plaçait ainsi dans la famille de ceux qui croient en un Dieu, peu importe la religion. Il leva la tête et me remercia, j’en profitais pour le questionner : - Avez-vous besoin de quelques choses ? - Non, merci, ça va, y fait beau, ça aide. - Est-ce que des maraudes viennent vous voir pour vous aider ? - Oui, des fois, y a des gens moins cons que d’autres, y m’ont changé mon duvet, l’autre était pourri. - Est-ce qu’il y a d’autres sans abris comme vous par ici ? - Oui, mais ça bouge toujours un peu, on nous fait souvent déguerpir, c’est des enfoirés qui voudraient bien qu’on crève. De l’autre côté, cour de Rome, sous les arcades, y a souvent le vieux, Bernard, un vieux routier de la rue, va pas tarder à clamser, en plus, sa caboche est un peu dérangée. Y l’est pas souvent tout seul, mais les autres j’les connais pas. - Par hasard vous ne connaîtriez pas une sans abri qui se nomme Sylvia ? - Sylvia……….non …..je vois pas, c’est-y pas une jeune bien roulé ? On l’appelle la gitane, elle est des fois avec le vieux Bernard de l’aut’ côté. Elle se déplace souvent avec une vieille, Rose la pipelette. T’as pas une cigarette des fois ? Bien que je ne fume pas, j’avais toujours dans mes poches un ou deux paquets de cigarettes, justement pour en offrir lors de mes conversations avec ces locataires de la rue. Je lui remis un paquet au trois quart plein. - Merci ! T’es un bon mec toi, qu’est-ce tu lui veux à la gitane ? T’es pas un flic au moins ? - Non, rassure-toi, je suis un amoureux qui cherche la sorcière qui l’a envoûté. Allez salut, je te souhaite de t’en sortir. - Fait gaffe mec, y a des sorcières qui peuvent te transformer en rat d’égout, c’est mon cas. Je ne compris pas la signification de sa réponse. Avec du temps il m’aurait raconté sa vie, cette partie où une femme : sa sorcière, l’avait poussé dehors, vers la rue : pour lui, cet égout dans lequel s’écoule la misère humaine. Il m’avait donné des informations très utiles qui me conduisirent dans la cour de Rome. Sous les arcades, identiques à celles de la cour D’Amsterdam, assis par terre sur des couvertures sales, appuyé contre un pilier, un vieux monsieur, que l’on pouvait qualifier de « clochard », somnolait. Sous une casquette crasseuse de couleur incertaine à dominante grise, un visage ridé, bouffi, avec une barbe de sanglier, racontait ses souffrances, ses renoncements et ses abus. Je restai un moment à le regarder jusqu'à ce qu’il ouvre les yeux aux cernes sombres. J’étais dos à la lumière, pour mieux me voir il fut obligé de mettre sa main en visière sur son front. Je l’interpellai en lui tendant un billet qu’il attrapa d’une main tremblante : - Salut, ça va ? Avez-vous besoin de quelque chose ? - Hein ? Qu’est-ce vous dites ? Il retira sa casquette et y rangea le billet dans la doublure, un peu ouverte sur l’arrière. Manifestement il n’entendait plus très bien et je m’efforçais donc d’augmenter le son de ma voix. - Avez-vous besoin de quelque chose ? Un sandwich ou à boire ? - Non……….J’attends la Rose. J’suis bien là ; j’veux point m’en aller ; faut pas m’embêter monsieur. Pas les refuges, non, non, pas les refuges. On le ramasse pas Bernard ; y reste là. Rose ! Où elle est Rose ? Sa confusion me surprit, je ne voyais pas comment amorcer un dialogue avec ce vieux qui tremblait, pour lui je constituais une source de peur, un agresseur, un oppresseur du système. Il attendait Rose, effectivement, cela me revint en mémoire, Ramda m’avait parlé de Bernard et de Rose; Sylvia, selon ses dires accompagnait souvent cette dernière. Mon optimisme grandit mais je restais dans l’indécision : attendre ici la venue de cette Rose ou continuer le tour de la gare ? Je scrutais, pendant quelques minutes, le mouvement des gens. La bulle transparente au dessus du métro, comme une bouche, vomissait en continue une foule de personnes qui pour la plupart, à cette heure, se dirigeaient vers l’entrée de la gare. Avec cette affluence, impossible de repérer qui que ce soit, de plus, je ne connaissais pas l’allure de Rose, je décidai donc de continuer mes recherches. Mon obstination faiblit et je me posai, à nouveau, la question de ma présence ici, pourquoi ce travail de détective ? Il y a mille et autres façons de trouver une amie ! Oui, mais, comment résister à ces yeux qui me hantaient. D’instinct, je décidai de retourner vers la cour du Havre, par la rue intérieure, sur l’arrière du Hilton ; Après quelques pas, face à moi, je vis une femme sans âge qui marchait en conduisant une poussette chargé de sacs hétéroclites. Mal peignée, habillée, jusqu’au chevilles, d’une robe noire, ses épaules couvertes d’une veste jean bleu délavé, une tête qui pivotait sans cesse avec un visage émacié au teint gris où des yeux noirs vifs, écarquillés, donnaient de la vivacité au regard ; sans nul doute il s’agissait d’une sans abri. Était-ce Rose ? Pour en être sure, je la suivis, et comme je le pressentis, elle rejoignit le vieux Bernard. - Pardon Madame, êtes-vous Rose ? Elle me regarda longuement avant de me répondre, la politesse et la douceur de mon ton devaient l’intriguer. - Qu’est-ce que vous lui voulez à la Rose ? Elle veut rien la Rose ! Elle veut qu’on lui fiche la paix la Rose ! Elle veut bien qu’on lui donne une petite pièce la Rose ! C’est tout ! Sa voix forte, rauque, un peu grave me surprit de la part d’une femme qui avec cette maigreur me paraissait fragile. Je donnai encore cinq euros pour l’amadouer et obtenir ce que je voulais : des renseignements sur Sylvia. - La Rose, elle connaît la Sylvia. C’est l’ange de Rose ! Rose la voit arriver, partir, encore arriver, repartir. Rose ne sais pas où elle va. Rose trouve que vous devez être un gentil garçon. Tout à l’heure Rose était avec elle, à l’entrée, à l’escalier de l’autre côté, là-bas. La Rose vous dit : emmenez-la, la Sylvia, la laissez pas dans la rue. Personne est venu chercher la Rose, alors, elle est toujours dans la rue la Rose. J’attendis quelques secondes, mais elle ne dit plus rien. Sa façon très particulière de parler de soi comme s’il s’agissait d’une autre personne m’intrigua. Son « moi », disparu, laissait la place à une Rose inventée, ce n’était plus elle qui avait froid ou faim c’était « la Rose », elle transférait la douleur pour mieux la supporter, une sorte de suicide psychologique. Je la remerciai un peu froidement, car soudain je devins pressé, Sylvia se trouvait peut-être, encore, du côté de la cour d’Amsterdam. Je courus presque, me cognant à des gens sans m’excuser. Quelque chose me disait qu’elle était là, tous prés, il ne pouvait pas en être autrement. « Mais, poussez-vous bon sang ! » La sortie du métro déversait un torrent de gens dont une partie empruntait un imposant escalier de pierre et l’autre se ruait, presque en courant, sur les escalators. Hélas pas de Sylvia dans les parages. Je restai un moment pantois, déçu, immobile au milieu de la cohue de ces laborieux pressés de regagner leur logis de banlieue. Peut-être est-elle dans le hall d’entrée de la gare, juste un peu plus loin ? Je jouai encore des coudes sans aucune politesse, et soudain, par-dessus le brouhaha de la foule, par-dessus le vacarme de la rue d’Amsterdam, une petite musique vint habiter tout mon espace, une musique de bonheur qui effaçai tout ce qui m’environnait : la petite flûte de Sylvia. Je bousculai encore et encore, recevant un chapelet de : « ça va pas non ! ». Cette flûte devait être magique, comme celle du joueur de Hamelin, elle attirait, comme dans le conte, les enfants de la ville. Je la vis enfin, juste à l’entrée, à droite de la dernière porte du hall, dans un espace restreint, entre un pilier et un distributeur de barres sucrées. Un endroit idéal pour mendier, des centaines de personnes passaient devant elle. Je traversai, sans excuses, le flot de banlieusards. Elle se tenait assise en tailleur a même le carrelage, elle jouait la tête baissée, elle n’avait pas attaché ses cheveux et ils tombaient sur son visage cachant ainsi ses yeux : une barrière entre elle et les gens. Mon regard ne la quittait pas, les battements de mon cœur refusaient de se calmer ; j’attendais, fébrile, que ses grands yeux apparaissent. Pourquoi, alors, à ce moment là, je me posai la question de ce que je faisais là ? Qu’allai-je lui dire ? L’interpeller ? Du genre : hello, Sylvia !! Non, trop direct ! Faire du bruit, applaudir ? Il me vint l’idée de laisser tomber, de ma hauteur, des pièces dans sa boite de conserve qui lui servait de sébile, les sons métalliques d’une répétition inhabituelle, devraient l’interpeller. Au bout de la troisième pièce de deux euros, elle releva la tête, s’arrêta de jouer, ses yeux se plantèrent dans les miens et provoquèrent, chez moi, cette sorte d’émotion qui vous paralyse et vous transforme en un être piteux, ridicule et idiot. Heureusement elle parla la première avec un grand sourire : - Tiens voilà mon fan club, bonsoir monsieur Dubuchain, vous venez au concert ? - Vous vous souvenez de mon nom, c’est flatteur ! Mais, appelez-moi Guillaume, oui je viens vous écouter, mais pas seulement, je viens aussi vous voir et puis parler un peu. - Me draguer quoi !! Excusez-moi, je dois continuer à jouer c’est le meilleur moment de la journée pour se faire un peu de sous. Elle reprit sa flûte et de nouveau la musique transforma cet endroit, il me semblait que les gens marchaient moins vite, souriaient plus. Libéré de l’avoir trouvée, d’avoir pu lui parler, j’éprouvai un plaisir qui modifia la perception de mon environnement qui devenait moins agressif. Il me sembla reconnaître un morceau des nuits d’été de Be |
 | JeffKerdraon le 05 avril 2023 Les yeux de Sylvia Partie 4 Il me sembla reconnaître un morceau des nuits d’été de Berlioz, une de ces villanelles joyeuses qu’elle jouait avec plus d’entrain qu’à mon arrivée ; ma présence, en tant qu’auditeur plus attentionné que ce flux de personnes indifférentes, devait la motiver. De temps à autre, elle levait son regard sur moi, j’y puisais alors une sorte de chaleur qui me confortait dans ma patience de l’attendre aussi longtemps qu’elle le désirerait. Cette épreuve ne dura pas très longtemps, elle s’arrêta de jouer, non de son fait, mais à cause d’un policier qui lui intima l’ordre de déguerpir, la mendicité est interdite dans la gare. Je serais bien intervenu pour plaider, pour elle, le droit de rester un peu plus longtemps, de quoi gagner un peu plus d’argent, mais par expérience je sus que je ne ferais qu’aggraver les choses. Nous nous retrouvâmes dans la cour d’Amsterdam, avec son gros sac à dos. Elle m’expliqua : - Cela se produit souvent vous savez. Avant qu’un flic arrive, on peut rester des fois deux heures. Aujourd’hui c’est mauvais, j’ai tenu un peu plus d’une heure seulement. - Je ne voudrais pas être indiscret, mais, combien récoltez-vous en une heure ? - Cela dépend des jours, de vingt à quarante euros, en moyenne vingt cinq, trente ! Mais moi je joue de la musique, la manche simple c’est moins et la mendicité passive encore moins. - Je vois, quand je vous distrais vous perdez de l’argent. Est-ce qu’avec un dédommagement, vous accepteriez de venir boire quelque chose avec moi ? - Hé là ! Monsieur Guillaume, je ne suis pas une pute moi. Vous savez ce que je dis au paumé de la rue qui me cherche : « fais gaffe, je fais du karaté. Tu me touche je t’éclate ». - N’ayez pas peur !! D’abord je ne suis pas un « paumé » et je veux juste compenser le fait que je vous fais perdre de l’argent. Et puis juré, je ne vous toucherais pas, je n’ai pas envie d’être éclaté par une championne de karaté. - Je veux bien, mais pas longtemps, j’ai des trucs à faire. On n’a qu’a aller au Caravelle, c’est le plus prés, de l’autre côté de la rue, et j’aime bien le patron, il m’offre parfois un café quand il fait froid. En effet, Le Caravelle était un bar, PMU, loto, à deux pas de l’entrée de la gare sur la rue d’Amsterdam. Nous eûmes beaucoup de peine pour atteindre une table, encore libre, au fond de la salle, les gens devant le bar encombraient le passage. Il régnait ici, une chaleur moite, et il flottait des odeurs chaudes de café, de saucisses, de gruyère fondu. Sous un ciel de néons, des buveurs de tout genre : bière, pastis, petit blanc ou rouge, occupaient le comptoir et discutaient peu-être de courses de chevaux, de politique, de femmes, de problèmes de boulot ou de je ne sais quoi d’autres mais très bruyamment. A peine installés et servis, je me pressai de parler à Sylvia, quelque chose me disais que ce petit moment en tête à tête ne durerait pas longtemps : - Vous savez, depuis notre rencontre d’hier, j’ai beaucoup pensé à vous. J’aimerais vous connaître un peu mieux. Nous pourrions aller dîner un soir, puis voir un film ou aller au théâtre, faire ce qui vous ferez plaisir ; quelque chose que vous ne faites que rarement. - Vous foncez toujours comme ça avec les femmes ? Les hommes me font peur, vous savez, on ne sait jamais le niveau et la durée de leur sincérité. Ils n’utilisent pas les mots comme nous les femmes. Ils ne vous laissent pas libre, ils cherchent à vous acheter, à vous posséder. Il y a sûrement des hommes biens. Peut-être en êtes vous un. Je ne suis pas blasé, et je ne voudrais pas le devenir. Mais, à la rue on apprend que tout le monde veux niquer tout le monde comme dit mon copain Ramda, même moi je trompe, je triche, je ne suis jamais totalement vrai, sauf avec les beaucoup plus faibles que moi. Je ne m’attendis pas à cette réponse. Son langage ne correspondait pas à l’image d’une SDF, du moins, à l’idée que je m’en faisais, trop éduqué, trop poli, trop mure pour son âge, trop forte, trop comme certaines femmes de mon quotidien. Je m’imaginais quelqu’un de plus cabossée par la vie dans la rue. Quand elle parlait, son regard s’allumait et accrochait le mien. Toujours ces yeux qui me bouleversaient, me happaient, me projetaient hors de la réalité. Après un court silence je lui répondis : - Alors il faut que vous soyez vrai avec moi parce que vous m’avez rendu le plus faible des hommes. Moi ce sont les femmes qui me font peur. Leur séduction forcenée pour vous attirer me fait parfois l’effet d’un chant de sirène, d’une approche de vampire. Certaines d’entre elles me paralysent, comme la souris devant le serpent. Mais vous…… ? Je ne sais quoi dire, mon vocabulaire n’est pas suffisant. Simplement, de façon abrupte, je vous trouve très belle, vous me plaisez, vous m’attirez sans que vous l’ayez cherché, sans que je sache si je vous plais. Alors voilà, je suis là, avec vous, sans calcul, heureux d’être en face de vous. Peut-être allez-vous m’envoyez balader. Peut être sommes nous destinés à devenir que des amis qui se croisent de temps à autres. Mais si vous n’avez rien à faire de votre vie maintenant, et si voulez que nous cherchions si la nature n’a rien prévu pour nous deux ensemble, alors apprenons à nous connaître. - Ouah !! Je suis bluffée, personne ne m’a jamais draguée comme ça ! D’habitude c’est : « salut la Gitane ! Quand est-ce que j’te la met ». Bon, d’accord je ne suis pas gentille, vous voulez que je sois plus sérieuse. Qu’est-ce que vous voulez dans la rue on ne prend rien au sérieux ou on meurt. Je ne sais pas si vous me plaisez, vous êtes beau gosse, c’est sure, moi je vous vois comme un bourgeois, un nanti, vous êtes la foule qui va et vient sans nous regarder. Il faut que je m’habitue à vous, que vous deveniez vraiment Guillaume et non le mec de l’autre jour. Je voudrais qu’on aille doucement pour se connaître. C’est vrai qu’après aujourd’hui, je vous chercherai dans la foule, je vous attendrai. - Alors, je serais souvent là. Vous savez vous êtes l’Ange de Rose, elle m’a dit que je ne devais pas vous laisser à la rue. Mais il faut que vous le vouliez aussi. Vous êtes dorénavant dans mes pensées et j’ignore tout de vous, comment vous vivez, où vous dormez, je souffre de votre précarité, j’aurai tout le temps le bras tendu vers vous. Il vous suffit d’attraper ma main. - Ne vous faite pas de souci pour moi, j’ai l’habitude de me débrouiller. Pour ce qui est de se faire un resto, d’accord, mais je ne sais pas quand ! Je vous le dirais un jour, lorsque vous viendrez m’écouter. En fait je ne sais pas encore si je peux accepter, faut que je réfléchisse. Le resto c’est comme franchir une porte sans savoir où cela conduit. Après on se sent obligé d’être gentille, et moi, j’ai envie de rester rebelle. Je suis compliquée, vous savez. Et ma vie est moins simple qu’il n’y parait. Je ne suis peut-être pas celle que vous croyez. Souvent, tout n’est qu’apparence et faux semblant. Ce que vous m’avez dit m’a fait beaucoup plaisir. Je vais rester quelques temps dans le quartier pour aider un peu Rose, qui perd parfois la boule, alors passez le soir entre quatre et sept heure, je serai soit comme aujourd’hui, soit de l’autre côté cour de Rome. Je dois y aller, salut Guillaume. Votre resto, il me tente bien ! Mais peut-être qu’aujourd’hui je me sens fatiguée. Je ne sais pas si je vais vous laisser franchir certaines frontières. Elle attrapa prestement son barda et disparut. Je restai un long moment songeur, dépité, déçu et en même temps plein d’espoir. Les clients du bar, plus nombreux, n’arrangeaient pas l’atmosphère empuantie par leurs haleines alcoolisées. Le brouhaha devenait insupportable. Quelques minutes après Sylvia, je m’empressai de sortir. Tout près, au feu du bas de la rue, des voitures démarraient bruyamment, après l’air sale du bar, j’inhalais celui des échappements. Ma déception, telle une hache, avait décapité mon humeur plutôt enjouée. Cette première vrai rencontre ne m’apportait que des espoirs avec en bandoulière une exigence de patience, moi qui en avait si peu. Je jouerai le jeu qu’elle m’imposera, j’irai jusqu’au bout pour la conquérir, cette « Esméralda », cette orgueilleuse reine de la rue. Mes sentiments affluaient, portés par le désir de serrer Sylvia dans mes bras, mais d’autres s’imposaient négativement, telle la vexation du mâle, le conquérant, le chevalier sauveur de la pauvresse en détresse, éconduit comme un laquais. Je rentrais chez moi avec tous ces remous en tête, avec en plus, pour être honnête, quelques fantasmes dans lesquels de grands yeux noirs devenaient implorants sous mes caresses. Le lendemain, mélangé au flux des voyageurs, j’arpentais la gare Saint Lazare pendant plus d’une heure, d’un côté à l’autre et retour, plusieurs fois, le ventre crispé, dans un état d’excitation extrême. Pas de Sylvia, pas de petite musique, j’échafaudais tout un tas de raisons dont la plus pessimiste était qu’elle ne voulait plus me rencontrer. Je me précipitai pour questionner Rose qui se tenait toujours avec Bernard cour de Rome. La chaleur sévissait encore, la sueur me coulait sur le visage, la mauvaise qualité de l’air contribuait à mon essoufflement. Bernard dormait en chien de fusil sur un carton, Rose, assise par terre, le dos appuyé au mur, me reconnut de suite. Après les politesses d’usage, et avec un effort pour rester le plus calme possible, je la questionnai sur Sylvia, sans succès, elle me précisa que cette dernière venait parfois plusieurs jours de suite, puis disparaissait pendant deux ou trois jours. Elle me dit quelque chose qui m’intrigua : - Rose pense qu’elle est partout, un peu dans la rue et un peu ailleurs, tout autour. Sylvia apparaît quand elle veut, comme un ange. Des fois je pense à elle, et hop elle est devan |
 | JeffKerdraon le 05 avril 2023 Les yeux de Sylvia partie 5 - Rose pense qu’elle est partout, un peu dans la rue et un peu ailleurs, tout autour. Sylvia apparaît quand elle veut, comme un ange. Des fois je pense à elle, et hop elle est devant moi. Rose vous vois, monsieur, oui, comme un seigneur. Rose le sait. Mais, vous savez les seigneurs ont besoin des anges, mais les anges ont peur des seigneurs. C’est tout ce que Rose doit vous dire. Merci Milord ! Je la remerciai avec un petit billet et repartis vers la gare : côté Rome, personne, côté Havre, personne, fin de ma quête pour ce soir là. Tristesse ! Tristesse dans mon cœur, et pourtant, pas comme chez Verlaine, il ne pleuvait pas sur les toits, un grand beau temps aux suaves chaleurs inondait la capitale. Demain, oui demain je reviendrai, et après demain aussi. Autant de fois qu’il le faudrait. Les yeux de Sylvia m’obsédaient, ils allaient me rendre fou. Je traînai les pieds pour rentrer chez moi avec une frustration qui alimentait une sourde colère. Le lendemain, avec une conviction qui fléchissait et l’amorce d’une sensation de ridicule, je me tenais cour du Havre, à l’entrée de la gare. Mes oreilles tentaient de capter les petites notes vagabondes, mais il n’y avait rien d’autres que l’écho des haut-parleurs émettant des annonces. Toujours cette foule oppressante, programmée comme une horde de robots. Comme la veille, avec autant de précipitation, je courrais presque d’un bord à l’autre de la gare. J’empruntai pour cela le chemin à l’extérieur, le long de la desserte des taxis, puis pour revenir je décidai de parcourir le centre commercial. Bien mal m’en a pris, tant l’affluence me retardait : une foule très féminine, peu pressée, m’obligeait à des évitements en zigzag. J’ai failli passer à côté d’elle, sans la voir. Elle se tenait là. Devant une vitrine de vêtements féminins, très absorbée, contemplative. Je me suis déplacé pour mieux la voir. J’ai douté un bon moment, parce que la Sylvia ici, à quelques mètres de moi, n’avait plus grand-chose à voir avec la Sylvia de la rue, la SDF. Plus de tee-shirt et de jean usagés, elle portait une magnifique robe blanche à manche courte, avec de gros motifs géométriques bleus marine, des chaussures à talon mi-haut assorties aux dessins de la robe. Son visage, maquillé, avait perdu son côté un peu sauvage, deux perles pendaient à ses oreilles et un chignon sophistiqué ornait l’arrière de sa tête. Pour fignoler le tout, elle tenait à son bras un sac à main de taille moyenne, lui aussi du même bleu marine. Cette femme, d’une rare élégance, au look de jeune bourgeoise à l’entrée d’une réception mondaine, ce ne pouvait pas être Sylvia. Peut-être un sosie ? Pourtant je ne me trompais pas, je l’avais ces derniers temps, plusieurs fois dévorée des yeux, je connaissais les moindres contours de ce visage, la forme de ces lèvres, la façon dont le cou portait la tête. Et puis il y avait ces yeux, personne ne pouvait avoir de tels yeux, aucun doute possible c’était les yeux de Sylvia. Alors, comment expliquer un tel changement, qui était-elle ? Je ne savais plus quoi faire, j’étais l’homme amoureux de Sylvia, la jeune femme de la rue, j’étais le sauveur, celui qui allait la ramener dans la normalité de notre société. Mais maintenant, déboussolé, il me vint la pensée saugrenue : cette femme avait usurpé le corps de Sylvia. Mon cerveau n’arrivait plus à se décider sur la bonne attitude à adopter : se précipiter pour lui parler, la suivre, laisser tomber ? Cette Sylvia là, je ne la connaissais pas. Elle poursuivit son chemin lentement, avec la posture d’une femme qui fait du shopping, c'est-à-dire la tête tournée vers les boutiques, indifférente aux autres. Je la suivis, sans réfléchir, en terme plus policier : je la pistai avec zèle en me dissimulant derrière les gens. Pendant un petit quart d’heure, nous avons progressé de façon chaotique, au gré des intérêts de Sylvia pour telle ou telle vitrine, d’un bord à l’autre de la galerie. Plusieurs fois je pris peur, car il lui arrivait d’un coup, en tournant sur elle-même, de scruter la foule environnante, comme si une inquiétude subite lui venait. Je lui tournai alors rapidement le dos. Dés la sortie de la galerie, son pas s’accéléra pour se diriger vers la rue de Rome. Au fur et à mesure que la densité de la foule diminuait, il devenait, pour moi, plus difficile de la suivre. A aucun moment je me suis posé la question de la légitimité morale de ce pistage. Il fallait que je sache, que je découvre ce que je considérais comme une anomalie. Cette nouvelle Sylvia perturbait mon scénario et mes sentiments. Quelque chose m’échappait, et il me semblait quelque part, perdre pied. Ma fascination très concrète, pour elle, se transformait en une sorte de mirage inaccessible. Elle marchait vite, sans se retourner, je la filai avec facilité. Le soleil accompagnait sa démarche légère, fraîche, printanière. Après quelques minutes, nous abordâmes le square Marcel Pagnol, elle sembla se diriger vers l’église Saint Augustin dont on voyait le dôme au dessus des arbres. Rue Bergson, je la vis disparaître à gauche, comme si elle entrait dans le square. Je courus pour ne pas la perdre et constatai qu’elle venait de pénétrer dans un parking. Disparue, engloutie, terminée ma filature. La suivre, pour quel niveau ? Et puis pourquoi ? Pour la voir monter dans un véhicule et s’échapper ! Une voiture me klaxonna, immobile sans réaction, devant la rampe d’accès, je gênais. Je réalisai vite qu’il devait y avoir une sortie ailleurs. Effectivement, après une course, à la performance de mes moyens, j’atteignis la rampe de sortie, rue Laborde, de l’autre côté du square. Je pensai pouvoir la surprendre dans la montée de la rampe. Une Mercédès, puis une Volvo, se présentèrent, conduites par des hommes. Il n’était pas aisé de pouvoir observer les chauffeurs sans que ceux-ci ne me voient. A chaque grondement de moteur mon attention augmentait. Enfin, je la vis monter la rampe à faible allure. Elle conduisait une mini Rover cabriolet grise claire. Le sens interdit l’obligeait à tourner à gauche pour prendre la rue, elle tourna la tête pour s’assurer de l’absence de véhicule et j’eus juste le temps de me retourner pour ne pas qu’elle m’aperçoive. La voiture se dilua, au bout de la rue, dans la circulation dense de la ville. Voilà, solitude brutale, peur du vide devant le gouffre de l’inconnu, paralysie de l’incompréhension ! Comme avec une persistance rétinienne, l’image de Sylvia dans sa robe habitait encore mon esprit vide de toute forme de pensée réactionnelle. Comme un somnambule, mes jambes m’emportèrent vers ma caverne. La marche m’aida à reprendre un courant de réflexions propice à un retour vers mon équilibre. Ce que je venais de surprendre de cette seconde vie de Sylvia devait rester dans ma tête. Elle ignorait ce que je savais et cela devait continuer ainsi. Mais, pourquoi cette belle petite bourgeoise se transformait-elle, avec un tel brio, en une sans abri à certains moments de sa vie ? Il me revint en mémoire ses mots, un peu avant de nous quitter : « Et ma vie est moins simple qu’il n’y parait. Je ne suis peut-être pas celle que vous croyez. Souvent, tout n’est qu’apparence et faux semblant. » Ses dires prenaient d’un coup tout leur sens mais ne me permettaient pas de comprendre. Je pourrais laisser tomber, oublier tout cela, reprendre le fil de ma vie, comme si Sylvia devenait un personnage onirique. Mais, impossible, ses yeux vivaient en moi, pauvres ou riches, ils ne me quittaient pas, ils n’appartenaient pas aux rêves, je les savais quelque part regardant un monde que je ne connaissais pas, des gens que j’ignorais, peut-être un homme. Mon imagination partait dans tous les sens, ma fascination se mesurait à l’aune de la grande inconnue qu’elle incarnait. Je tentai de meubler cette absence d’information et je compris alors la force de mon obsession, de ce sentiment que j’oserais maintenant qualifier d’amour. Pour l’instant ce trouble émotionnel me faisait plutôt souffrir tant il était obsédant. Le sommeil me fuyait, mes pensées tournaient en rond, devais-je cesser d’essayer de la rencontrer ? Lors de notre prochaine rencontre, faudra-t-il que je lui parle d’aujourd’hui ? Me considère-t-elle comme un jeu ? Puis-je encore espérer aboutir à une liaison ? Vais-je réussir à la voir de nouveau ? Questions sur questions qui finalement et malgré tout, me conduisirent à la décision de retourner gare St Lazare, et d’essayer de poursuivre le fil très tenu de notre courte relation. Il me fallait oublier la vision d’aujourd’hui, il me fallait occulter cette jeune bourgeoise au sommet de sa beauté et continuer comme avant, c'est-à-dire à conquérir Sylvia, une jeune SDF. Le lendemain, j’arrivais très tôt à mon travail afin de pouvoir partir vers seize heures. Comme prévu, à seize heures trente, j’arpentais les escaliers et les halls de la gare Saint Lazare, déjà denses comme une fourmilière. Il y a bien longtemps que je ne m’étais pas senti aussi nerveux, tendu, impatient. Il est vrai que pour palier les effets de ma mauvaise nuit j’avais ingurgité beaucoup de café. Sans cesse, la sonorisation inondait la gare d’annonces, si bien que j’éprouvai beaucoup de difficultés pour tenter d’entendre la petite musique de la flûte de Sylvia. Je me conduisais comme le naufragé sur une plage qui cherche à l’horizon la silhouette d’un bateau, je faisais le tour de la gare comme ce Robinson le tour de son île. Et puis, d’un coup, à un moment, tout s’arrête, sauf les battements accélérés de votre cœur, la petite mélodie enfle au fur et à mesure que vous avancez, c’est ce qui se produisit à l’approche de l’escalier de la cour de Rome. J’éprouvais un immense soulagement dés que je la vis, vêtue comme lors de notre première rencontre, je la retrouvais SDF. Je me surpris à douter de la similitude avec la jeune femme d’hier, mais |
Pour participer à la conversation, connectez-vous