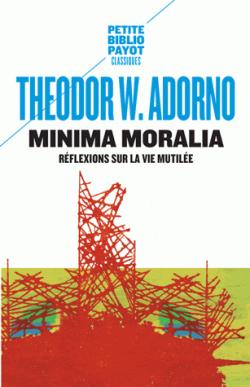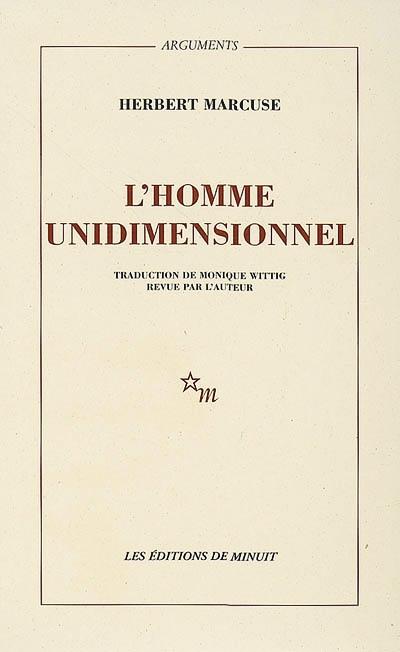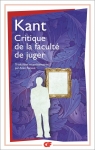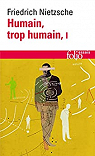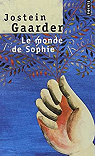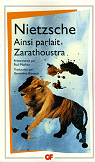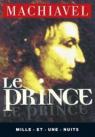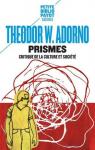Assister à l'après-midi Marxisme et École de Francfort, dans le cadre du colloque « La philosophie comme critique de la culture ? ».
- 14h : Jean-Claude Monod (CNRS-Archives Husserl)
« Kulturkritik, satire, critique sociale: quelles armes pour la philosophie ? »
- 15h : Katia Genel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Centre Marc Bloch)
« Des pathologies sociales à la santé sociale: Adorno, Habermas et Honneth »
- 16h20 : Franck Fischbach (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
« Faut-il choisir entre la critique sociale et la Kulturkritik ? »
Un colloque organisé par le centre SPH de l'Université Bordeaux Montaigne, en partenariat avec la Librairie Mollat et l'Université de Bordeaux.

Theodor W. Adorno
Éliane Kaufholz-Messmer (Traducteur)Jean-René Ladmiral (Traducteur)Miguel Abensour (Auteur de la postface, du colophon, etc.)/5 34 notes
Minima moralia est, selon Habermas, un chef-d’œuvre. Entre les moralistes français, Marx et les romantiques allemands, Adorno entreprend, à travers de courts chapitres, vignettes, instantanés, une vaste critique de la société moderne, pourchassant, au plus intime de l’existence individuelle, les puissances objectives qui déterminent et oppriment celle-ci. Ce livre, qu’il convient d’étudier comme ... >Voir plus
Éliane Kaufholz-Messmer (Traducteur)Jean-René Ladmiral (Traducteur)Miguel Abensour (Auteur de la postface, du colophon, etc.)/5 34 notes
Résumé :
Minima moralia est, selon Habermas, un chef-d’œuvre. Entre les moralistes français, Marx et les romantiques allemands, Adorno entreprend, à travers de courts chapitres, vignettes, instantanés, une vaste critique de la société moderne, pourchassant, au plus intime de l’existence individuelle, les puissances objectives qui déterminent et oppriment celle-ci. Ce livre, qu’il convient d’étudier comme ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Minima Moralia : Réflexions sur la vie mutiléeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Adorno a une pensée acérée, en digne héritier de Nietzsche son texte est fait d'aphorismes et d'une série d'essais à forme courte. Il cherche à contredire une pensée dominante qui détermine l'existence individuel en esclave d'elle-même. Que faire face à une vie de plus en plus "privatisée", objet de consommation ? Une civilisation peut-elle se reconstruire après les camps de concentration ? A la manière de Nietzsche, Adorno analyse avec beaucoup d'acuité les symptômes qui décomposent le corps social où l'individu est de plus en plus dilué, se délestant peu à peu de sa propre liberté. Et si Adorno n'offre que peu de solutions, son texte n'en reste pas moins stimulant, à une époque où l'on déplore l'absence ou l'excès de moral, il nous invite peut-être à cultiver à se construire une éthique de l'extranéité.
Citations et extraits (43)
Voir plus
Ajouter une citation
113.
Le trouble-fête. - L'affinité entre ascèse et ivresse que constate la sagesse des psychologues, le rapport d'amour-haine entre les saints et les prostituées, a une raison objectivement juste : l'ascèse rend davantage justice à l'idée de l'accomplissement de l'homme que la culture débitée en tranches. L'hostilité pour le plaisir est sans aucun doute inséparable de la connivence avec la discipline d'une société dont le propre est de demander plus qu'elle n'accorde. Mais il y a également une certaine défiance à l'égard du plaisir, née du pressentiment que le plaisir n'existe pas en ce monde. Un raisonnement de Schopenhauer exprime involontairement un tel pressentiment. Le passage de l'affirmation à la négation de la volonté de vivre s'effectue dans le développement de l'idée selon laquelle toute entrave opposée à la volonté par un obstacle "interposé entre elle et un objectif éventuel, est souffrance; par contre, lorsque cet objectif est atteint, il est source de satisfaction, de contentement, de bonheur". Mais tandis que cette "souffrance", selon l'impitoyable intuition de Schopenhauer, tend à croître au point que la mort devienne quasiment souhaitable, l'état de "satisfaction" est lui-même in satisfaisant, car
" ... le besoin et la souffrance ne nous accordent pas plus tôt un répit, que l'ennui arrive; il faut, à tout prix, quelque distraction. Ce qui fait l'occupation de tout être vivant, ce qui le tient en mouvement, c'est le désir de vivre. Eh bien, cette existence, une fois assurée, nous ne savons qu'en faire, ni à quoi l'employer! Alors intervient le second ressort qui nous met en mouvement, le désir de nous délivrer du fardeau de l'existence, de le rendre insensible, de "tuer le temps", ce qui veut dire de fuir l'ennui " (Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation , trad. Burdeau, P.U.F., p. 396)
Mais ce concept d'ennui élevé à une dignité aussi inattendue est fondamentalement bourgeois, ce que l'esprit antihistorique de Schopenhauer ne serait guère disposé à reconnaître. Il fait partie du travail aliéné dont il est le complément, il est du "temps libre" antithètique soit parce que celui-ci doit simplement reconstituer l'énergie dépensée, soit parce que pèse sur lui l'approbation du travail d'autrui. Le temps libre continue d'être une réaction au rythme de la production imposé au sujet de l'extérieur, et qui perdure forcément même dans les moments de pause. La conscience que l'existence est totalement privée de liberté - conscience que la nécessité de gagner sa vie empêche d'affleurer - ne réapparaît finalement que dans les interludes de la liberté. La nostalgie du Dimanche n'est pas le désir de retrouver le foyer après une semaine de travail, mais la nostalgie d'un état libéré de la nécessité d'un telle semaine; le Dimanche nous laisse insatisfait non parce que c'est une journée fériée, mais parce que ce qu'il avait promis apparaît aussitôt dans son non-accomplissement; tout comme le dimanche anglais, chaque dimanche est trop peu dimanche. Celui pour qui le temps s'étire péniblement attend en vain, déçu par cette occasion manquée: que demain soit la continuation d'hier. Et pourtant l'ennui de ceux qui n'ont pas besoin de travailler n'est pas fondamentalement différent. La société comme totalité inflige aux détenteurs du pouvoir ce qu'eux-mêmes font subir aux autres et les premiers ne se permettent guère ce qui est interdit aux seconds. Les bourgeois ont fait de la satiété, qui devrait être quelque chose de semblable à la béatitude, un terme injurieux. Parce que les autres ont faim, l'idéologie exige que l'absence de faim soit chose vulgaire. C'est ainsi que les bourgeois accusent les bourgeois. Eux-mêmes exemptés du travail, ils n'ont pas à faire l'éloge de la paresse: on déclare que celle-ci est ennuyeuse. L'activité fébrile dont parle Schopenhauer ne fait pas tant référence à ce qu'a d'insupportable le statut de privilégié qu'à l'ostentation avec laquelle, selon la situation historique, ce statut doit augmenter la distance sociale ou la réduire au moyen de manifestations prétendument indispensables, et démontrer ainsi l'utilité des maîtres. Et si l'on s'ennuie effectivement au sommet de la hiérarchie sociale, ce n'est pas parce qu'on souffre d'un excès de bonheur, mais parce que ce bonheur porte la marque du malheur universel, du caractère de marchandise qui livre les plaisirs à la stupidité, de la brutalité des ordres dont l'écho résonne sinistrement dans l'exubérance des maîtres et , finalement, de l'angoisse qu'inspire à ceux-ci leur propre superfluité. Celui qui profite du système du profit ne peut vivre sans éprouver de honte, et cette honte dénature même le plaisir naturel, quand bien même les excès qu'envient les philosophes n'ont probablement pas été toujours aussi ennuyeux qu'ils veulent nous le faire croire. Dire que l'ennui disparaîtrait une fois instaurée la liberté, se trouve effectivement confirmé par certaines expériences dérobées à la civilisation.
Le trouble-fête. - L'affinité entre ascèse et ivresse que constate la sagesse des psychologues, le rapport d'amour-haine entre les saints et les prostituées, a une raison objectivement juste : l'ascèse rend davantage justice à l'idée de l'accomplissement de l'homme que la culture débitée en tranches. L'hostilité pour le plaisir est sans aucun doute inséparable de la connivence avec la discipline d'une société dont le propre est de demander plus qu'elle n'accorde. Mais il y a également une certaine défiance à l'égard du plaisir, née du pressentiment que le plaisir n'existe pas en ce monde. Un raisonnement de Schopenhauer exprime involontairement un tel pressentiment. Le passage de l'affirmation à la négation de la volonté de vivre s'effectue dans le développement de l'idée selon laquelle toute entrave opposée à la volonté par un obstacle "interposé entre elle et un objectif éventuel, est souffrance; par contre, lorsque cet objectif est atteint, il est source de satisfaction, de contentement, de bonheur". Mais tandis que cette "souffrance", selon l'impitoyable intuition de Schopenhauer, tend à croître au point que la mort devienne quasiment souhaitable, l'état de "satisfaction" est lui-même in satisfaisant, car
" ... le besoin et la souffrance ne nous accordent pas plus tôt un répit, que l'ennui arrive; il faut, à tout prix, quelque distraction. Ce qui fait l'occupation de tout être vivant, ce qui le tient en mouvement, c'est le désir de vivre. Eh bien, cette existence, une fois assurée, nous ne savons qu'en faire, ni à quoi l'employer! Alors intervient le second ressort qui nous met en mouvement, le désir de nous délivrer du fardeau de l'existence, de le rendre insensible, de "tuer le temps", ce qui veut dire de fuir l'ennui " (Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation , trad. Burdeau, P.U.F., p. 396)
Mais ce concept d'ennui élevé à une dignité aussi inattendue est fondamentalement bourgeois, ce que l'esprit antihistorique de Schopenhauer ne serait guère disposé à reconnaître. Il fait partie du travail aliéné dont il est le complément, il est du "temps libre" antithètique soit parce que celui-ci doit simplement reconstituer l'énergie dépensée, soit parce que pèse sur lui l'approbation du travail d'autrui. Le temps libre continue d'être une réaction au rythme de la production imposé au sujet de l'extérieur, et qui perdure forcément même dans les moments de pause. La conscience que l'existence est totalement privée de liberté - conscience que la nécessité de gagner sa vie empêche d'affleurer - ne réapparaît finalement que dans les interludes de la liberté. La nostalgie du Dimanche n'est pas le désir de retrouver le foyer après une semaine de travail, mais la nostalgie d'un état libéré de la nécessité d'un telle semaine; le Dimanche nous laisse insatisfait non parce que c'est une journée fériée, mais parce que ce qu'il avait promis apparaît aussitôt dans son non-accomplissement; tout comme le dimanche anglais, chaque dimanche est trop peu dimanche. Celui pour qui le temps s'étire péniblement attend en vain, déçu par cette occasion manquée: que demain soit la continuation d'hier. Et pourtant l'ennui de ceux qui n'ont pas besoin de travailler n'est pas fondamentalement différent. La société comme totalité inflige aux détenteurs du pouvoir ce qu'eux-mêmes font subir aux autres et les premiers ne se permettent guère ce qui est interdit aux seconds. Les bourgeois ont fait de la satiété, qui devrait être quelque chose de semblable à la béatitude, un terme injurieux. Parce que les autres ont faim, l'idéologie exige que l'absence de faim soit chose vulgaire. C'est ainsi que les bourgeois accusent les bourgeois. Eux-mêmes exemptés du travail, ils n'ont pas à faire l'éloge de la paresse: on déclare que celle-ci est ennuyeuse. L'activité fébrile dont parle Schopenhauer ne fait pas tant référence à ce qu'a d'insupportable le statut de privilégié qu'à l'ostentation avec laquelle, selon la situation historique, ce statut doit augmenter la distance sociale ou la réduire au moyen de manifestations prétendument indispensables, et démontrer ainsi l'utilité des maîtres. Et si l'on s'ennuie effectivement au sommet de la hiérarchie sociale, ce n'est pas parce qu'on souffre d'un excès de bonheur, mais parce que ce bonheur porte la marque du malheur universel, du caractère de marchandise qui livre les plaisirs à la stupidité, de la brutalité des ordres dont l'écho résonne sinistrement dans l'exubérance des maîtres et , finalement, de l'angoisse qu'inspire à ceux-ci leur propre superfluité. Celui qui profite du système du profit ne peut vivre sans éprouver de honte, et cette honte dénature même le plaisir naturel, quand bien même les excès qu'envient les philosophes n'ont probablement pas été toujours aussi ennuyeux qu'ils veulent nous le faire croire. Dire que l'ennui disparaîtrait une fois instaurée la liberté, se trouve effectivement confirmé par certaines expériences dérobées à la civilisation.
C'EST CELUI QUI LE DIT QUI Y EST ! - Ce qui est objectivement la vérité est déjà bien difficile à déterminer - mais, dans nos rapports avec les autres, il ne faut pas s'en laisser imposer le terrorisme. Et il existe là certains critères, qui ne trompe pas, quand on vient vous objecter que ce que vous dites est "trop subjectif". Quand on fait valoir cet argument, qui plus est avec l'indignation où vibre l'unanimité rageuse des gens raisonnables, on a toute raison d'être content de soi l'espace d'un instant. En effet, les concepts de "subjectif" et d' "objectif" se sont en l'occurrence complètement inversés. Ce qu'ils appellent "objectif", c'est le jour incontesté sous lequel apparaissent les choses, leur empreinte prise telle quelle et non remise en question, la façade des faits classifiés : en somme, ce qui est subjectif. Et ce qu'ils nomment "subjectif", c'est ce qui déjoue ces apparences, qui s'engage dans une expérience spécifique de la chose, se débarrasse des idées reçues la concernant et préfère la relation à l'objet lui-même au lieu de s'en tenir à l'avis de la majorité, de ceux qui ne regardent même pas et a fortiori ne pensent pas ledit objet : en somme, l'objectif. On voit combien les accusations formelles de subjectivisme et de relativisme tiennent peu dès qu'on aborde le domaine privilégié où elles sont invoquées, à savoir le domaine des jugements esthétiques. Celui qui s'est rigoureusement soumis aux exigences d'une oeuvre d'art, à ses lois formelles immanentes et à la nécessité qui l'a façonnée, en mobilisant toutes les ressources de précision propres à sa sensibilité personnelle, il ne peut plus accorder crédit à de telles réserves qui lui objectent le caractère purement subjectif de son expérience et il mesure tout ce qu'elles ont d'illusoire. Chaque pas qui le fait avancer, grâce à sa réceptivité profondément subjective, au coeur même de la chose a incomparablement plus de valeur objective que des catégorisations englobantes et bien établies comme, par exemple, le concept de "style", dont les prétentions de scientificité ne s'achètent qu'au prix de cette expérience elle-même. C'est encore plus vrais à l'époque du positivisme et de l'industrie de consommation culturelle où nous vivons, qui confie la définition de l'objectivité aux calculs des sujets qui organisent cette société. Face à cette objectivité-là, la raison s'est réfugiée complètement, en se fermant aux influences extérieures, dans les idiosyncrasies qui se voient reprocher leur arbitraire par l'arbitraire de ceux qui ont le pouvoir, car ces derniers veulent l'impuissance des sujets, par crainte d'une objectivité qui n'est conservée (aufgehoben) que par ces sujets.
Après des millénaires de rationalité, la panique s'empare de nouveau de l'humanité, dont la domination acquise sur la nature devenue domination de l'homme excède de loin en horreur ce que les hommes eurent jamais à craindre de la nature.
La frénésie de consommation des produits les plus récents de la technique, (...) fait accepter la camelote la plus éculée et jouer le jeu de la stupidité programmée. Ne jamais se demander à quoi sert un produit, faire comme tout le monde, participer à la bousculade, voilà qui vient remplacer tant bien que mal les besoins rationnels.
Celui qui ment a honte, car chaque mensonge lui fait éprouver tout ce qu'il y a d'indigne dans l'ordre d'un monde qui le contraint au mensonge pour survivre. (...)
Cette pudeur affaiblit les mensonges de ceux qui ont une sensibilité délicate. Ils s'en tirent mal; et c'est alors que le mensonge devient proprement quelque chose d'immoral par rapport à autrui. C'est en effet le prendre pour un imbécile et lui témoigner son dédain. Au sein des pratiques éhontés de notre temps, le mensonge a perdu depuis longtemps sa fonction bien claire de nous tromper sur la réalité. Personne ne croit plus personne, tout le monde sait à quoi s'en tenir. On ne ment à autrui que pour lui signifier le peu d'intérêt qu'on lui porte, pour lui montrer qu'on n'a pas besoin de lui et qu'on se moque de ce qu'il peut bien penser. Le mensonge, qui pouvait autrefois apporter une certaine souplesse dans la communication, est devenu maintenant l'une des techniques de l'impudence, qu'utilise chaque individu pour répandre autour de lui la froideur dont il a besoin pour prospérer.
Cette pudeur affaiblit les mensonges de ceux qui ont une sensibilité délicate. Ils s'en tirent mal; et c'est alors que le mensonge devient proprement quelque chose d'immoral par rapport à autrui. C'est en effet le prendre pour un imbécile et lui témoigner son dédain. Au sein des pratiques éhontés de notre temps, le mensonge a perdu depuis longtemps sa fonction bien claire de nous tromper sur la réalité. Personne ne croit plus personne, tout le monde sait à quoi s'en tenir. On ne ment à autrui que pour lui signifier le peu d'intérêt qu'on lui porte, pour lui montrer qu'on n'a pas besoin de lui et qu'on se moque de ce qu'il peut bien penser. Le mensonge, qui pouvait autrefois apporter une certaine souplesse dans la communication, est devenu maintenant l'une des techniques de l'impudence, qu'utilise chaque individu pour répandre autour de lui la froideur dont il a besoin pour prospérer.
Lire un extrait
Videos de Theodor W. Adorno (4)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans la catégorie :
Allemagne et AutricheVoir plus
>Philosophie et disciplines connexes>Philosophie occidentale moderne>Allemagne et Autriche (278)
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Theodor W. Adorno (60)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
436 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre436 lecteurs ont répondu