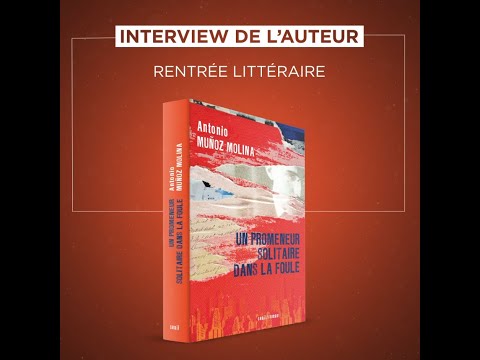Antonio Muñoz Molina/5
136 notes
Résumé :
À la fin de 1936, Ignacio Abel, architecte espagnol de renom, progressiste et républicain, monte l’escalier de la gare de Pennsylvanie, à New York, après un périple mouvementé depuis Madrid où la guerre civile a éclaté.
Hanté par les récriminations de sa femme, Adela, et taraudé par le sort incertain de ses deux jeunes enfants, Miguel et Lita, il cherche Judith Biely, sa maîtresse américaine.
L’auteur le regarde prendre le train qui doi... >Voir plus
Hanté par les récriminations de sa femme, Adela, et taraudé par le sort incertain de ses deux jeunes enfants, Miguel et Lita, il cherche Judith Biely, sa maîtresse américaine.
L’auteur le regarde prendre le train qui doi... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Dans la grande nuit des tempsVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (36)
Voir plus
Ajouter une critique
Lu en v.o. "La noche de los tiempos".
Un pave. Lourd a soulever. Mais une fois en main tu n'en sens plus le poids. C'est lui qui t'emporte et te fait partir pour une enivrante odyssee litteraire.
C'est une histoire d'amour. Enveloppee dans un roman historique. Une critique de la memoire collective de tout un peuple. Je dirais meme un traite de morale. Et malgre ses longueurs un page-turner dont on veut tourner les pages lentement pour mieux s'impregner de la psychologie des personnages, des changements insidieux qui faconneront leurs destins. Pour paraphraser un auteur celebre, les destins d'un amour en temps de cholera, en des temps alteres, malades d'une maladie collective.
C'est ecrit a la troisieme personne, par un narrateur omniscient, qui de loin en loin livre ses propres pensees. Il raconte l'histoire de l'amour d'un espagnol, Ignacio Abel, et d'une americaine, Judith Byela. Un amour cache, interdit. Parce qu'elle est jeune et libre mais lui est marie et pere de famille. Une histoire qui occupe relativement peu de pages. Beaucoup plus sont consacrees au souvenir de cette histoire. Aux pensees, aux divagations d'Ignacio quand cet amour prend la tangente. Il passe et repasse en tete les moments qu'il a passe avec elle, les missives qu'ils s'ecrivaient, et son attitude envers sa femme, envers ses enfants, quand il etait en famille, quand il ne les fuyait pas. Et Munoz Molina nous promene entre present et passe, dans les intentions d'Ignacio, ses elucubrations, ses reves, ses illusions, ses actions. Quand il se rememore son enfance pauvre, fils d'un macon et d'une concierge, et les etudes d'architecture qu'il a reussi a mener. Son mariage dans une famille bourgeoise, avec une femme plus agee que lui. Mariage d'amour ou de raison? Il ne sait pas. Il ne sait plus. Il n'a jamais su.
Le narrateur suit Ignacio pendant une courte periode, moins d'un an. le temps que tout chamboule. Sa vie familiale, bourgeoise, est balayee par sa rencontre avec cette jeune americaine, si libre, si differente des espagnoles qui l'entourent. Et son travail, la construction d'un nouveau campus universitaire, est carrement detruit. Parce que ce sont des temps de destruction, de destructions physiques inspirees par des reves de constructions politiques. Ce sont les mois d'anarchie d'avant la guerre civile, ponctues par une frenesie de violence, par les virees de tirailleurs de tous les camps qui assassinent sans discernement. Puis les mois qui suivent l'insurrection franquiste, quand les rues de Madrid sont “assurees” par les polices autoproclamees de differents partis. Un chaos que les elus et les fonctionnaires de la republique ne savent ni peuvent gerer. Une rage qui devient aveuglement, folie destructive, deraison. le narrateur, et derriere lui Munoz Molina, n'epargne aucun camp. La cruaute extreme des rebelles a son pendant dans celle des anarchistes et des communistes qui destabilise le gouvernement legitime. Un gouvernement transi, mine de l'interieur, qui tarde a s'organiser, qui envoie au front se faire tuer des recrues non entraines et mal armes.
Autour d'Ignacio foisonnent une multitude de personnages. La famille de sa femme, catholiques bien-pensants qui ont aide a la reussite de l'architecte tout en execrant ses idees de gauche. Un contremaitre de chantier devoue qui l'assiste et le protege. Des ouvriers chomeurs qui detruisent une oeuvre, esperant qu'on les embauchera pour la reconstruire. Des phalangistes qui s'embusquent pour tirer dans la foule. Un richissime americain essayant de pecher des affaires dans ces eaux glauques. Un juif allemand refugie qui finira assassine par des milices communistes. Et des personnages historiques. Cela se passant a Madrid, ce seront des personnages du camp republicain. Et rares sont ceux qui sortent agrandis sous la plume de Munoz Molina. Azana, le president quand la conflagration eclate, est aureole d'une tristesse fataliste. Par contraste, Negrin, ce scientifique qui devint le dernier president, est presente comme une force de la nature, bon vivant, le seul qui sache organiser quelque chose, le seul qui ne se laisse pas porter par des illusions, tout en restant actif et optimiste. Et comme Ignacio, professeur d'architecture, se meut dans des cercles academiques et culturels, il y a beaucoup d'ecrivains, de poetes. Garcia Lorca est imbu de lui-meme, condescendant envers ceux a qui il vole des idees, sinon des passages (envers Moreno Villa par exemple, un poete moins connu qui publia avant lui un recueil de poemes sur New-York), et peureux. La peur lui fait quitter Madrid des les premiers jours de l'insurrection pour se refugier dans son Sud. Sa peur lui coutera la vie. Juan Ramon Jimenez, le nobelise, diagnostique les evenements: “Une fete tragique et folle”. Rafael Alberti fait le clown devant des delegations etrangeres. Et Bergamin, ce fils de ministre sous la royaute, est depeint comme un enrage, un maigrichon qui s'affuble de bottes et vestes de cuir et affiche partout son pistolet a la ceinture, un intellectuel qui cautionne la violence et les meurtres: “la revolution est une chirurgie necessaire…”.
Tous ces politiques et ces intellectuels finiront par s'exiler, comme Ignacio Abel. Il acceptera in extremis l'offre d'une obscure universite americaine et, avec l'aide de Negrin, partira vers les Etats Unis. Il abandonnera sa famille, sans savoir ce qu'elle devient. Il fuit sa famille et son pays, se bercant de l'espoir, de l'illusion qu'il retrouvera Judith, que son tardif amour n'est pas lui aussi perdu. N'est-ce donc qu'une fuite ou est-ce aussi la perseverance d'accomplir son meilleur destin? L'amour avaliserait-il toutes les actions? Il nest pas sur lui-meme des fondements, des mobiles de sa fuite. Il a des pensees desenchantees: “on peut fuir le malheur et la peur aussi loin que possible, mais ou se cachera-t-on du remords?”.
Dans la grande nuit des temps est une tragedie. La tragedie d'un homme en des temps propices aux tragedies. A travers le parcours de cet homme, Munoz Molina ecrit la tragedie d'un pays, d'un peuple. Nombreux l'ont fait avant lui. Je crois quant a moi que c'est un de ceux qui l'ont fait le mieux. Sans atermoiements mais sans parti-pris. Comme il se doit pour une tragedie. Vers la fin du livre un republicain dira: “nous avons commis de telles barbaries que nous ne meritons pas de gagner”. J'ai eu l'impression que Munoz Molina pense que dans cette tragedie aucun des camps n'a “merite” de gagner. En mots pretes a Ignacio Abel, cet anti-heros: “La raison et la justice ne s'imposent pas en tuant”.
Un pave. Lourd a soulever. Mais une fois en main tu n'en sens plus le poids. C'est lui qui t'emporte et te fait partir pour une enivrante odyssee litteraire.
C'est une histoire d'amour. Enveloppee dans un roman historique. Une critique de la memoire collective de tout un peuple. Je dirais meme un traite de morale. Et malgre ses longueurs un page-turner dont on veut tourner les pages lentement pour mieux s'impregner de la psychologie des personnages, des changements insidieux qui faconneront leurs destins. Pour paraphraser un auteur celebre, les destins d'un amour en temps de cholera, en des temps alteres, malades d'une maladie collective.
C'est ecrit a la troisieme personne, par un narrateur omniscient, qui de loin en loin livre ses propres pensees. Il raconte l'histoire de l'amour d'un espagnol, Ignacio Abel, et d'une americaine, Judith Byela. Un amour cache, interdit. Parce qu'elle est jeune et libre mais lui est marie et pere de famille. Une histoire qui occupe relativement peu de pages. Beaucoup plus sont consacrees au souvenir de cette histoire. Aux pensees, aux divagations d'Ignacio quand cet amour prend la tangente. Il passe et repasse en tete les moments qu'il a passe avec elle, les missives qu'ils s'ecrivaient, et son attitude envers sa femme, envers ses enfants, quand il etait en famille, quand il ne les fuyait pas. Et Munoz Molina nous promene entre present et passe, dans les intentions d'Ignacio, ses elucubrations, ses reves, ses illusions, ses actions. Quand il se rememore son enfance pauvre, fils d'un macon et d'une concierge, et les etudes d'architecture qu'il a reussi a mener. Son mariage dans une famille bourgeoise, avec une femme plus agee que lui. Mariage d'amour ou de raison? Il ne sait pas. Il ne sait plus. Il n'a jamais su.
Le narrateur suit Ignacio pendant une courte periode, moins d'un an. le temps que tout chamboule. Sa vie familiale, bourgeoise, est balayee par sa rencontre avec cette jeune americaine, si libre, si differente des espagnoles qui l'entourent. Et son travail, la construction d'un nouveau campus universitaire, est carrement detruit. Parce que ce sont des temps de destruction, de destructions physiques inspirees par des reves de constructions politiques. Ce sont les mois d'anarchie d'avant la guerre civile, ponctues par une frenesie de violence, par les virees de tirailleurs de tous les camps qui assassinent sans discernement. Puis les mois qui suivent l'insurrection franquiste, quand les rues de Madrid sont “assurees” par les polices autoproclamees de differents partis. Un chaos que les elus et les fonctionnaires de la republique ne savent ni peuvent gerer. Une rage qui devient aveuglement, folie destructive, deraison. le narrateur, et derriere lui Munoz Molina, n'epargne aucun camp. La cruaute extreme des rebelles a son pendant dans celle des anarchistes et des communistes qui destabilise le gouvernement legitime. Un gouvernement transi, mine de l'interieur, qui tarde a s'organiser, qui envoie au front se faire tuer des recrues non entraines et mal armes.
Autour d'Ignacio foisonnent une multitude de personnages. La famille de sa femme, catholiques bien-pensants qui ont aide a la reussite de l'architecte tout en execrant ses idees de gauche. Un contremaitre de chantier devoue qui l'assiste et le protege. Des ouvriers chomeurs qui detruisent une oeuvre, esperant qu'on les embauchera pour la reconstruire. Des phalangistes qui s'embusquent pour tirer dans la foule. Un richissime americain essayant de pecher des affaires dans ces eaux glauques. Un juif allemand refugie qui finira assassine par des milices communistes. Et des personnages historiques. Cela se passant a Madrid, ce seront des personnages du camp republicain. Et rares sont ceux qui sortent agrandis sous la plume de Munoz Molina. Azana, le president quand la conflagration eclate, est aureole d'une tristesse fataliste. Par contraste, Negrin, ce scientifique qui devint le dernier president, est presente comme une force de la nature, bon vivant, le seul qui sache organiser quelque chose, le seul qui ne se laisse pas porter par des illusions, tout en restant actif et optimiste. Et comme Ignacio, professeur d'architecture, se meut dans des cercles academiques et culturels, il y a beaucoup d'ecrivains, de poetes. Garcia Lorca est imbu de lui-meme, condescendant envers ceux a qui il vole des idees, sinon des passages (envers Moreno Villa par exemple, un poete moins connu qui publia avant lui un recueil de poemes sur New-York), et peureux. La peur lui fait quitter Madrid des les premiers jours de l'insurrection pour se refugier dans son Sud. Sa peur lui coutera la vie. Juan Ramon Jimenez, le nobelise, diagnostique les evenements: “Une fete tragique et folle”. Rafael Alberti fait le clown devant des delegations etrangeres. Et Bergamin, ce fils de ministre sous la royaute, est depeint comme un enrage, un maigrichon qui s'affuble de bottes et vestes de cuir et affiche partout son pistolet a la ceinture, un intellectuel qui cautionne la violence et les meurtres: “la revolution est une chirurgie necessaire…”.
Tous ces politiques et ces intellectuels finiront par s'exiler, comme Ignacio Abel. Il acceptera in extremis l'offre d'une obscure universite americaine et, avec l'aide de Negrin, partira vers les Etats Unis. Il abandonnera sa famille, sans savoir ce qu'elle devient. Il fuit sa famille et son pays, se bercant de l'espoir, de l'illusion qu'il retrouvera Judith, que son tardif amour n'est pas lui aussi perdu. N'est-ce donc qu'une fuite ou est-ce aussi la perseverance d'accomplir son meilleur destin? L'amour avaliserait-il toutes les actions? Il nest pas sur lui-meme des fondements, des mobiles de sa fuite. Il a des pensees desenchantees: “on peut fuir le malheur et la peur aussi loin que possible, mais ou se cachera-t-on du remords?”.
Dans la grande nuit des temps est une tragedie. La tragedie d'un homme en des temps propices aux tragedies. A travers le parcours de cet homme, Munoz Molina ecrit la tragedie d'un pays, d'un peuple. Nombreux l'ont fait avant lui. Je crois quant a moi que c'est un de ceux qui l'ont fait le mieux. Sans atermoiements mais sans parti-pris. Comme il se doit pour une tragedie. Vers la fin du livre un republicain dira: “nous avons commis de telles barbaries que nous ne meritons pas de gagner”. J'ai eu l'impression que Munoz Molina pense que dans cette tragedie aucun des camps n'a “merite” de gagner. En mots pretes a Ignacio Abel, cet anti-heros: “La raison et la justice ne s'imposent pas en tuant”.
Nous ne sommes pas dans « Guerre et Paix » ici, loin de là ! Sur fond de guerre espagnole, nous assistons à la passion dévorante d'Ignacio Abel pour une jeune américaine, Judith. Ignacio est marié à Adela et a deux enfants mais sa maîtresse lui a tourné les sens. Et sa disparition brutale n'a pas mis fin aux sentiments, bien au contraire. Aussi, lorsqu'on lui offre un poste de professeur aux États-Unis, Ignacio ne réfléchit pas longtemps, espérant retrouver sa belle.
Quelle puissance ! Quel style ! C'est le tout premier roman que je lis de cet auteur, grâce à Sylvaine qui m'en a fait cadeau et que je remercie encore. Je me suis régalée ! Sans cesse, le personnage sera partagé entre les horreurs que subit son pays et les affres sentimentaux. Une phrase, dans le roman, peut résumer sa vie : « Ce que l'on a gagné en une seule minute d'éblouissement, on le perd avec autant de facilité. »
Si vous aimez les romans historiques, n'hésitez pas !
Lien : https://promenadesculturelle..
Quelle puissance ! Quel style ! C'est le tout premier roman que je lis de cet auteur, grâce à Sylvaine qui m'en a fait cadeau et que je remercie encore. Je me suis régalée ! Sans cesse, le personnage sera partagé entre les horreurs que subit son pays et les affres sentimentaux. Une phrase, dans le roman, peut résumer sa vie : « Ce que l'on a gagné en une seule minute d'éblouissement, on le perd avec autant de facilité. »
Si vous aimez les romans historiques, n'hésitez pas !
Lien : https://promenadesculturelle..
« Dans la grande nuit des temps » est une de ces oeuvres dont je repoussais depuis très longtemps la lecture, en raison de son nombre impressionnant de pages. Cela doit être une sorte de phobie, mais les pavés m'impressionnent. Et je peux vous garantir que celui-ci est très lourd et donne une très forte impression de densité lorsqu'on le feuillette.
Au final, comme bien souvent, je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir repoussé mes appréhensions. A part quelques passages vers le milieu du roman où j'ai eu des difficultés à apprécier le personnage principal pour son manque de sincérité et d'engagement, ce livre est impressionnant de maîtrise littéraire : elle réside dans sa capacité à capturer l'atmosphère d'une époque, à dompter le temps du récit et de l'Histoire, à faire vivre des personnages qui appartiennent au passé.
« La nuit est un puits sans fond où tout semble se perdre mais où tout continue d'habiter et de persister, au moins durant un certain temps, aussi longtemps que la mémoire reste claire et lucide la conscience de celui qui gît les yeux ouverts, attentif aux bruits qui prennent forme dans ce qui semble être le silence, cherchant à deviner à la respiration de l'autre s'il est encore éveillé ou s'il s'est laissé emporter par la somnolence de la jouissance accomplie. »
*
L'histoire se déroule en 1936 à Madrid, dans le contexte des événements tragiques qui ont divisé l'Espagne, des affrontements qui ont conduit le pays à la guerre civile et à l'arrivée au pouvoir de Franco.
Le roman suit le destin d'un architecte espagnol notoire, Ignacio Abel, tombé amoureux d'une jeune américaine, Judith Biely. Cette liaison est intense, passionnée et l'homme en oublierait presque qu'il a une femme et deux enfants.
Dans le tumulte des affrontements du 17 et 18 juillet 1936, Ignacio perd la trace de sa maîtresse et décide de partir la retrouver aux Etats-Unis où un poste de professeur l'attend.
*
Le roman débute alors qu'Ignacio monte les marches de la gare de Pennsylvanie à New York.
Il semble perdu au milieu de la foule qui le croise, indifférente à son désarroi. Seul avec sa petite valise usée d'avoir tant voyagé, il apparaît comme un homme usé, brisé, inquiet, tourmenté par sa fuite hors de son pays où la guerre civile vient d'éclater.
Dans le train qui le conduit, il espère, vers elle, ses pensées se bousculent dans son esprit, s'éloignent du présent, s'enfoncent dans les zones d'ombre de son passé. En regardant le paysage défiler par la fenêtre du train qui l'emmène à Burton College, son esprit voyage sans aucune chronologie sur le fil du temps, ses souvenirs s'égarent dans les recoins les plus sombres et troublants de son passé, comme autant d'instantanés, de petits fragments de vie : son pays déchiré par la guerre, sa rencontre avec Judith, l'effleurement de sa main sur sa peau, cette double vie source de tourments et de honte, cet amour passionnel qui l'envahit et le tourmente, ses manques de père, l'incertitude du futur, l'espoir de revoir un jour ses enfants.
*
Oscillant entre politique et Histoire, amour et guerre, rêve éveillé et réalité, souvenirs et imagination, « Dans la grande nuit des temps » est un roman intimiste et sensuel dans lequel l'auteur sonde avec minutie et sensibilité les émotions de son personnage principal. Cette longue et triste histoire est teintée de nostalgie et de mélancolie, de rêves et de désirs, d'espoirs et de regrets, d'erreurs et de honte. L'amour et le désamour, la tristesse et la solitude, la peur et le temps qui passe se cristallisent au fil des pages pour former une oeuvre pleine de poésie, de finesse, de profondeur mais également de douleurs et de rancoeurs.
Le lecteur se fait voyeur, spectateur de scènes intimes. C'est une histoire d'amour passionnel, mais je ne l'ai pas trouvé magnifique, ni merveilleuse. C'est un amour entaché de honte et de remords, un amour qui fait souffrir, et en cela j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Ignacio et à Judith.
Son choix de vivre dans le confort d'une vie familiale tout en ayant des plaisirs avec une autre femme plus jeune, sa décision définitive d'abandonner sa famille dans un pays en guerre pour retrouver sa maîtresse m'ont plutôt attachée à la femme trahie, belle et respectable dans sa douleur silencieuse.
Ainsi, malgré l'écriture délicate et poétique, cette histoire d'amour entachée de d'erreurs et de peines ne m'a pas permise de me fondre dans les premières pages du roman. J'ai trouvé Ignacio vaniteux, faible, égocentrique.
C'est dans la deuxième moitié du roman que mes sentiments ont évolué et que j'ai pu être véritablement comblée. En effet, la relation amoureuse, relégué au second plan, s'estompe dans les méandres de l'Histoire et Ignacio apparaît dans ce contexte, seul, fragile, vulnérable, moins lâche et égoïste.
*
La relation adultérine est bien sûr au coeur du récit, mais le roman va beaucoup plus loin qu'une simple histoire d'amour. Il entremêle avec profondeur et foisonnement, la vie de son personnage en butte à ses sentiments et à la violence des événements politiques qui secouent l'Espagne.
Le roman comporte peu d'actions et de rebondissements, mais qu'importe, c'est avant tout une grande fresque historique sur les mois qui ont précédé le soulèvement nationaliste à l'origine de la guerre civile espagnole, puis de la dictature franquiste. L'ambiance est réaliste, immersive.
« À Madrid, il a vu les visages de personnes qu'il croyait connaître depuis toujours se modifier du jour au lendemain : devenir des visages de bourreaux, ou d'illuminés, ou d'animaux en fuite, ou de bêtes menées sans résistance au sacrifice ; visages occupés tout entiers par des bouches qui crient l'enthousiasme ou la panique ; visages de morts à demi familiers et à demi transformés en une bouillie rouge par l'impact d'une balle de fusil ; visages de cire qui décidaient de la vie ou de la mort derrière une table éclairée par le cône lumineux d'une lampe, tandis que des doigts très agiles tapaient à la machine des listes de noms. »
*
Ce récit en clair-obscur est dominé par des images, des paysages, des senteurs, des sonorités, des voix, des regards, des sensations, des émotions.
C'est un voyage sensoriel dans le Madrid des années 30 : le rythme lent des phrases renferme les parfums délicats du géranium, les odeurs de tabac et de brillantine. Puis le récit avançant, d'autres odeurs se substituent, métalliques, celles du sang et de la mort qui s'incrustent dans le tableau de ce pays meurtri.
*
Lauréat du Prix Méditerranée Étranger 2012, « Dans la grande nuit des temps » est accueilli comme un chef-d'oeuvre de la littérature contemporaine espagnole.
L'auteur domine parfaitement la narration, alternant l'histoire en marche, les pensées d'Ignacio et des extraits de lettres qu'Ignacio a dans la poche de son manteau. Narrateur de l'histoire, du moins je le suppose, il accompagne son personnage comme un observateur, promenant son regard en de brefs coups de projecteur.
Le roman est extrêmement bien écrit, l'écriture très belle, serties de phrases souvent très longues et ondulantes, d'une justesse infinie quant à l'expression des émotions et des sentiments. J'ai rarement vu un auteur s'appuyer avec autant d'aisance sur les temps des verbes et la ponctuation pour traduire la fuite du temps, les sentiments. L'auteur privilégie également le style indirect et la quasi-absence de dialogues, ce qui permet à mon sens de rendre plus intenses certaines émotions.
Ces choix d'écriture parfaitement assumés par l'auteur rendent le récit dense, complexe et son rythme lent. Pourtant, une fois entrée dans le récit, j'ai trouvé la lecture fluide et agréable à lire, le style élégant, délicat, sensoriel et addictif.
Cette houle m'a emportée dans un flot de mots qui tantôt lumineux, irradié de raies de lumière, tantôt soucieux et morose, se diluant dans les errances et les doutes de la vie.
Le sifflement et le roulement du train en bruit de fond sont là pour nous faire prendre conscience que le récit prend un chemin parallèle à la réalité.
La fin est magistrale.
*
La construction du récit est habile. Antonio Muñoz Molina a un talent certain pour déambuler, tel un acrobate, sur la ligne du temps, insérant des personnages de la vie politique espagnole de l'époque, jonglant avec le destin de ses personnages de fiction, leurs rêves et leurs espoirs, leurs peurs et leurs désillusions.
Même si le temps fuit, s'écoule, inéluctable, on a souvent la sensation que l'auteur accélère, dilate, ou ralentit son cours jusqu'à le mettre en suspens pour quelques minutes. Il existe en effet plusieurs temps dans le récit, passé, présent et futur se chevauchent : celui de leur amour, L Histoire en marche, ou même celui du voyage.
« Il s'était trompé sur tout, mais plus que tout sur lui-même, sur sa place dans le temps. Passer toute sa vie à penser qu'il appartenait au présent et à l'avenir, et maintenant commencer à comprendre que s'il se sentait si décalé c'était parce que son pays était le passé. »
Le second aspect qui m'a fortement impressionnée, c'est cette façon de faire vivre les personnages à travers les souvenirs et le passé d'Ignacio. On ne les connaît que par son regard. Ils traversent le récit sans consistance, sans présence physique, comme des fantômes.
Avec subtilité, Antonio Muñoz Molina donne aux deux femmes du roman des traits très distincts : Judith illustre la modernité, le changement alors qu'Adela symbolise la tradition.
Le troisième aspect du livre qui m'a plu est la présence en arrière-plan de gares et de trains : lieux de croisement, de destinée, ils sont le carrefour de chemins de vie.
*
C'est un roman profondément introspectif qui gagne à être lu lentement. Il offre une réflexion profonde sur l'humanité et la complexité des émotions humaines. Ainsi, il aborde des nombreuses réflexions sur la vie et la perte, la fugacité du temps, la mémoire et les souvenirs, l'amour et l'obsession, la solitude et la trahison, l'attente et le désir.
L'auteur offre également une réflexion autour de la guerre et de ses conséquences, de la violence et de la peur, de la conscience morale et de l'exil.
*
Pour conclure, avec ces mille pages, « Dans la grande nuit des temps » est un long monologue intérieur qui demande de se laisser porter. Mais en lâchant prise, en se détachant du monde qui nous entoure, Antonio Muñoz Molina nous entraîne dans une spirale où des visages anonymes sont aux prises avec leurs émotions et le cours de l'Histoire.
Absorbée par l'atmosphère d'une autre époque, c'est en refermant le livre que j'ai véritablement pris conscience qu'il y avait quelque chose de brillant dans ce roman.
A découvrir bien entendu si le nombre de pages ne vous fait pas peur.
*******
« Dans la grande nuit des temps » est un roman subtil fait pour une lecture commune où la multiplicité des regards ont toute leur place pour se croiser et s'enrichir. J'ai été heureuse de partager ce moment avec Delphine(@Mouche307) et Bernard (Berni_29).
*******
Au final, comme bien souvent, je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir repoussé mes appréhensions. A part quelques passages vers le milieu du roman où j'ai eu des difficultés à apprécier le personnage principal pour son manque de sincérité et d'engagement, ce livre est impressionnant de maîtrise littéraire : elle réside dans sa capacité à capturer l'atmosphère d'une époque, à dompter le temps du récit et de l'Histoire, à faire vivre des personnages qui appartiennent au passé.
« La nuit est un puits sans fond où tout semble se perdre mais où tout continue d'habiter et de persister, au moins durant un certain temps, aussi longtemps que la mémoire reste claire et lucide la conscience de celui qui gît les yeux ouverts, attentif aux bruits qui prennent forme dans ce qui semble être le silence, cherchant à deviner à la respiration de l'autre s'il est encore éveillé ou s'il s'est laissé emporter par la somnolence de la jouissance accomplie. »
*
L'histoire se déroule en 1936 à Madrid, dans le contexte des événements tragiques qui ont divisé l'Espagne, des affrontements qui ont conduit le pays à la guerre civile et à l'arrivée au pouvoir de Franco.
Le roman suit le destin d'un architecte espagnol notoire, Ignacio Abel, tombé amoureux d'une jeune américaine, Judith Biely. Cette liaison est intense, passionnée et l'homme en oublierait presque qu'il a une femme et deux enfants.
Dans le tumulte des affrontements du 17 et 18 juillet 1936, Ignacio perd la trace de sa maîtresse et décide de partir la retrouver aux Etats-Unis où un poste de professeur l'attend.
*
Le roman débute alors qu'Ignacio monte les marches de la gare de Pennsylvanie à New York.
Il semble perdu au milieu de la foule qui le croise, indifférente à son désarroi. Seul avec sa petite valise usée d'avoir tant voyagé, il apparaît comme un homme usé, brisé, inquiet, tourmenté par sa fuite hors de son pays où la guerre civile vient d'éclater.
Dans le train qui le conduit, il espère, vers elle, ses pensées se bousculent dans son esprit, s'éloignent du présent, s'enfoncent dans les zones d'ombre de son passé. En regardant le paysage défiler par la fenêtre du train qui l'emmène à Burton College, son esprit voyage sans aucune chronologie sur le fil du temps, ses souvenirs s'égarent dans les recoins les plus sombres et troublants de son passé, comme autant d'instantanés, de petits fragments de vie : son pays déchiré par la guerre, sa rencontre avec Judith, l'effleurement de sa main sur sa peau, cette double vie source de tourments et de honte, cet amour passionnel qui l'envahit et le tourmente, ses manques de père, l'incertitude du futur, l'espoir de revoir un jour ses enfants.
*
Oscillant entre politique et Histoire, amour et guerre, rêve éveillé et réalité, souvenirs et imagination, « Dans la grande nuit des temps » est un roman intimiste et sensuel dans lequel l'auteur sonde avec minutie et sensibilité les émotions de son personnage principal. Cette longue et triste histoire est teintée de nostalgie et de mélancolie, de rêves et de désirs, d'espoirs et de regrets, d'erreurs et de honte. L'amour et le désamour, la tristesse et la solitude, la peur et le temps qui passe se cristallisent au fil des pages pour former une oeuvre pleine de poésie, de finesse, de profondeur mais également de douleurs et de rancoeurs.
Le lecteur se fait voyeur, spectateur de scènes intimes. C'est une histoire d'amour passionnel, mais je ne l'ai pas trouvé magnifique, ni merveilleuse. C'est un amour entaché de honte et de remords, un amour qui fait souffrir, et en cela j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Ignacio et à Judith.
Son choix de vivre dans le confort d'une vie familiale tout en ayant des plaisirs avec une autre femme plus jeune, sa décision définitive d'abandonner sa famille dans un pays en guerre pour retrouver sa maîtresse m'ont plutôt attachée à la femme trahie, belle et respectable dans sa douleur silencieuse.
Ainsi, malgré l'écriture délicate et poétique, cette histoire d'amour entachée de d'erreurs et de peines ne m'a pas permise de me fondre dans les premières pages du roman. J'ai trouvé Ignacio vaniteux, faible, égocentrique.
C'est dans la deuxième moitié du roman que mes sentiments ont évolué et que j'ai pu être véritablement comblée. En effet, la relation amoureuse, relégué au second plan, s'estompe dans les méandres de l'Histoire et Ignacio apparaît dans ce contexte, seul, fragile, vulnérable, moins lâche et égoïste.
*
La relation adultérine est bien sûr au coeur du récit, mais le roman va beaucoup plus loin qu'une simple histoire d'amour. Il entremêle avec profondeur et foisonnement, la vie de son personnage en butte à ses sentiments et à la violence des événements politiques qui secouent l'Espagne.
Le roman comporte peu d'actions et de rebondissements, mais qu'importe, c'est avant tout une grande fresque historique sur les mois qui ont précédé le soulèvement nationaliste à l'origine de la guerre civile espagnole, puis de la dictature franquiste. L'ambiance est réaliste, immersive.
« À Madrid, il a vu les visages de personnes qu'il croyait connaître depuis toujours se modifier du jour au lendemain : devenir des visages de bourreaux, ou d'illuminés, ou d'animaux en fuite, ou de bêtes menées sans résistance au sacrifice ; visages occupés tout entiers par des bouches qui crient l'enthousiasme ou la panique ; visages de morts à demi familiers et à demi transformés en une bouillie rouge par l'impact d'une balle de fusil ; visages de cire qui décidaient de la vie ou de la mort derrière une table éclairée par le cône lumineux d'une lampe, tandis que des doigts très agiles tapaient à la machine des listes de noms. »
*
Ce récit en clair-obscur est dominé par des images, des paysages, des senteurs, des sonorités, des voix, des regards, des sensations, des émotions.
C'est un voyage sensoriel dans le Madrid des années 30 : le rythme lent des phrases renferme les parfums délicats du géranium, les odeurs de tabac et de brillantine. Puis le récit avançant, d'autres odeurs se substituent, métalliques, celles du sang et de la mort qui s'incrustent dans le tableau de ce pays meurtri.
*
Lauréat du Prix Méditerranée Étranger 2012, « Dans la grande nuit des temps » est accueilli comme un chef-d'oeuvre de la littérature contemporaine espagnole.
L'auteur domine parfaitement la narration, alternant l'histoire en marche, les pensées d'Ignacio et des extraits de lettres qu'Ignacio a dans la poche de son manteau. Narrateur de l'histoire, du moins je le suppose, il accompagne son personnage comme un observateur, promenant son regard en de brefs coups de projecteur.
Le roman est extrêmement bien écrit, l'écriture très belle, serties de phrases souvent très longues et ondulantes, d'une justesse infinie quant à l'expression des émotions et des sentiments. J'ai rarement vu un auteur s'appuyer avec autant d'aisance sur les temps des verbes et la ponctuation pour traduire la fuite du temps, les sentiments. L'auteur privilégie également le style indirect et la quasi-absence de dialogues, ce qui permet à mon sens de rendre plus intenses certaines émotions.
Ces choix d'écriture parfaitement assumés par l'auteur rendent le récit dense, complexe et son rythme lent. Pourtant, une fois entrée dans le récit, j'ai trouvé la lecture fluide et agréable à lire, le style élégant, délicat, sensoriel et addictif.
Cette houle m'a emportée dans un flot de mots qui tantôt lumineux, irradié de raies de lumière, tantôt soucieux et morose, se diluant dans les errances et les doutes de la vie.
Le sifflement et le roulement du train en bruit de fond sont là pour nous faire prendre conscience que le récit prend un chemin parallèle à la réalité.
La fin est magistrale.
*
La construction du récit est habile. Antonio Muñoz Molina a un talent certain pour déambuler, tel un acrobate, sur la ligne du temps, insérant des personnages de la vie politique espagnole de l'époque, jonglant avec le destin de ses personnages de fiction, leurs rêves et leurs espoirs, leurs peurs et leurs désillusions.
Même si le temps fuit, s'écoule, inéluctable, on a souvent la sensation que l'auteur accélère, dilate, ou ralentit son cours jusqu'à le mettre en suspens pour quelques minutes. Il existe en effet plusieurs temps dans le récit, passé, présent et futur se chevauchent : celui de leur amour, L Histoire en marche, ou même celui du voyage.
« Il s'était trompé sur tout, mais plus que tout sur lui-même, sur sa place dans le temps. Passer toute sa vie à penser qu'il appartenait au présent et à l'avenir, et maintenant commencer à comprendre que s'il se sentait si décalé c'était parce que son pays était le passé. »
Le second aspect qui m'a fortement impressionnée, c'est cette façon de faire vivre les personnages à travers les souvenirs et le passé d'Ignacio. On ne les connaît que par son regard. Ils traversent le récit sans consistance, sans présence physique, comme des fantômes.
Avec subtilité, Antonio Muñoz Molina donne aux deux femmes du roman des traits très distincts : Judith illustre la modernité, le changement alors qu'Adela symbolise la tradition.
Le troisième aspect du livre qui m'a plu est la présence en arrière-plan de gares et de trains : lieux de croisement, de destinée, ils sont le carrefour de chemins de vie.
*
C'est un roman profondément introspectif qui gagne à être lu lentement. Il offre une réflexion profonde sur l'humanité et la complexité des émotions humaines. Ainsi, il aborde des nombreuses réflexions sur la vie et la perte, la fugacité du temps, la mémoire et les souvenirs, l'amour et l'obsession, la solitude et la trahison, l'attente et le désir.
L'auteur offre également une réflexion autour de la guerre et de ses conséquences, de la violence et de la peur, de la conscience morale et de l'exil.
*
Pour conclure, avec ces mille pages, « Dans la grande nuit des temps » est un long monologue intérieur qui demande de se laisser porter. Mais en lâchant prise, en se détachant du monde qui nous entoure, Antonio Muñoz Molina nous entraîne dans une spirale où des visages anonymes sont aux prises avec leurs émotions et le cours de l'Histoire.
Absorbée par l'atmosphère d'une autre époque, c'est en refermant le livre que j'ai véritablement pris conscience qu'il y avait quelque chose de brillant dans ce roman.
A découvrir bien entendu si le nombre de pages ne vous fait pas peur.
*******
« Dans la grande nuit des temps » est un roman subtil fait pour une lecture commune où la multiplicité des regards ont toute leur place pour se croiser et s'enrichir. J'ai été heureuse de partager ce moment avec Delphine(@Mouche307) et Bernard (Berni_29).
*******
Nous sommes en octobre 1936. Ignacio Abel a fui le chaos de la capitale espagnole pour les États-Unis d'Amérique. Cet architecte madrilène de renom y est attendu pour enseigner dans une université. Il est parti seul, dans l'urgence, laissant derrière lui sa femme Adela et leurs deux enfants. En Espagne, c'est la guerre civile. Les a-t-il abandonnés pour autant ? En rejoignant les États-Unis d'Amérique, il espère aussi retrouver Judith Biely, la jeune Américaine qu'il a aimée à Madrid et qui a rompu leur liaison parce que celle-ci devenait impossible. Mais tout, depuis un moment est devenu impossible dans une Espagne à feu et à sang.
Le narrateur, omniscient tout au long du récit, perce la foule agglutinée sur le quai de la gare de Pennsylvanie à New-York. On imagine aisément la scène, le bruit, l'ambiance. Il nous invite à nous frayer un chemin dans cette cohue, jusqu'à rejoindre Ignacio Abel, le suivre dans ce voyage où l'architecte espagnol espère retrouver son ancienne amante, mais aussi l'épier dans ses gestes et dans les méandres de ses pensées, le souvenir de ce qui fut et qui l'amène aujourd'hui à monter dans un train dans cette ville de New-York.
J'ai reconnu ici l'obsession des trains qui partent et laissent au bord des quais des rêves fracassés, des amours en partance, l'exil, la violence des guerres qui continuent malgré nos pleurs, le malheur du monde incessant.
C'est une mémoire qui se dérobe sur le bord d'un quai de gare.
J'aime les gares et les trains pour cela, - ou plutôt non je ne les aime pas à cause de cela justement, sauf en littérature ou au cinéma, les trains et leur fuite éperdue traversant le temps et les paysages.
Ce livre de plus de mille pages pourraient se résumer juste en quelques battements de coeur au bord du quai de cette gare à New-York où l'émoi d'Ignacio Abel se fait sentir à chaque fois qu'il aperçoit une jeune femme dont la silhouette lui rappelle celle de Judith. Biely...
L'histoire en elle-même pourrait tenir en quelques pages, en quelques faits. Mais se souvenir est aussi un voyage. Ce sont les réminiscences du temps qui vont nous inviter à revenir en arrière, dans ce passé encore proche, où les cendres sont encore tièdes. Remettre ses pas dans les souvenirs confus et douloureux d'un homme, c'est parfois dégringoler dans un vide abyssal.
C'est alors un balancement, une oscillation incessante qui va se mettre en marche tout au long de la suite du récit, entre un présent incertain et un passé non encore clos où les fantômes s'en échappent et où les bonheurs n'ont pas terminé leur course effrénée. Ici le futur n'est pas encore imaginé.
Le temps ne cesse de s'inviter dans ces pages somptueuses comme s'il était le personnage principal de ce livre, où notre plus grande quête de lecteur est de venir fouiller la mémoire d'un homme fugitif.
C'est aussi un passé qui couture l'intime à l'universel.
L'intime, c'est le parcours de ce fils d'un maçon et d'une concierge, devenu un architecte reconnu et célébré par son talent immense. En dépit de ses fortes convictions de républicain engagé, sans doute cette ascension sociale lui a valu de rencontrer et d'épouser une femme de la bourgeoisie espagnole conservatrice et catholique.
Désormais, la République, qu'il appelait de ses voeux comme un idéal, se déchire dans la violence et la répression. Aujourd'hui il ne trouve pas réellement sa place, ni dans sa vie, ni dans sa maison, ni dans son pays. Sa rencontre avec Judith Biely va bouleverser son existence. Avant elle, il a le sentiment que rien n'était vivant, qu'il n'existait pas. le sens de la vie, n'est-ce pas dans les bras de cette jeune femme, qu'il lui a été révélé ?
« Bien qu'elle ne soit presque plus jamais visible dans ses rêves, Judith Biely y rôde telle une absence impérieuse, celle d'une personne qui, du fait de son départ, semblera plus présente encore dans la révélation du vide qu'elle a laissé, comme le tranchant d'une lame est révélé par la blessure ouverte, et un inconnu par les traces qu'il a laissées sur le sable humide. »
Dans la grande nuit des temps écrit par Antonio Muñoz Molina fut pour moi une lecture tout d'abord laborieuse durant les premières pages, jusqu'à ce que l'éblouissement vint. Et alors...
Et alors, je suis monté dans le train, j'ai été emporté par le texte autant par sa forme inouïe, vertigineuse, que par la toile de fond historique.
Ici, il y est question en effet d'exil et d'Espagne. de la guerre civile et des terres lointaines. du passé que l'on laisse et qui ne passe pas. Des engagements, des renoncements tristes. du courage, du silence. Et aussi de ce qu'aimer veut dire...
Antonio Muñoz Molina m'a entraîné dans un récit construit en réminiscences et en digressions, où la relation d'Ignacio Abel au monde, à ceux qui l'entourent, ceux qu'il aime et qui l'aiment, est ici lié à l'Histoire de l'Espagne en train de se faire dans le bruit et la fureur.
C'est un aller-retour entre une gare de New-York et Madrid par le truchement d'un narrateur qui continue de nous entraîner dans le dédale du temps.
Dans la grande nuit des temps est un roman au fantastique pouvoir d'envoûtement et d'incarnation grâce à l'entremise des mots et du temps, dans sa dilatation, dans la manière très proustienne qu'a l'auteur de scruter un instant très court et de le faire résonner dans la durée…
L'obsession d'un amour peut-il être plus fort que la tragédie d'une guerre civile ?
D'ailleurs, est-ce un roman d'amour avec en toile de fond une fresque historique ? Ou bien l'inverse ? Les deux dimensions se côtoient, s'épousent à merveille, mêlant l'intime d'une rencontre clandestine à celle de la grande Histoire.
La beauté fracassante de ce roman vertigineux tient sans doute pour ces raisons, portée par la respiration d'une écriture sublime qui fut pour moi un ravissement.
L'Espagne meurtrie est palpable à travers les sensations si incroyablement représentées par l'auteur. C'est un roman sensoriel autant dans le plaisir des gestes amoureux que dans l'horreur infinie de la guerre.
« Il se rappelle la peur primitive, la peur qui revient avec la nuit, obscurité plus profonde et plus chargée de dangers que dans les histoires qu'on lui racontait dans son enfance. Non seulement rentrer chez soi lorsqu'il faisait encore jour et fermer les portes, en tirant targettes et verrous ; mais aussi se pelotonner comme un enfant sous les couvertures, fermer les yeux en serrant les paupières et se boucher les oreilles pour ne pas entendre, comme s'il suffisait d'avoir vu ou entendu pour attirer le malheur. »
À travers le personnage d'architecte qu'est Ignacio Abel, j'ai aimé ici rencontrer une sorte de métaphore des édifices que l'on construit si longuement et que l'on met peu de temps à les faire s'écrouler comme des châteaux de sable. La vie ressemble si souvent à cela.
Ignacio Abel est typiquement le personnage romanesque que j'aime par-dessus tout car il est rempli de doutes et d'interstices, personnage plutôt détestable au premier abord...
Est-il une sorte de déserteur, celui qui se retourne de temps en temps pour contempler le monde qu'il a quitté ? Les siens, sa famille, ses amis, son pays, sa patrie, une vie tout entière...
Est-il lâche ? Peut-être tout simplement ne trouve-t-il plus sa place dans ce temps absurde et convulsif ? Dans cette vieille Europe agonisante ?
Ce roman parle des renoncements, des trahisons, des lâchetés qui semblent reposer ici sur un seul homme.
J'ai failli me perdre dans les ténèbres de ce roman et je me suis retrouvé à chacun instant dans la lumière des personnages et les chemins tortueux qui les révèlent.
La lumière, ce fut autant celle d'une chambre mercenaire où les heures se défont que la révolte de la rue où les républicains farouches ont défendu jusqu'au bout les valeurs qui les animaient.
Le roman est traversé d'une certaines irréalité, fracturée par la frontière incertaine qui sépare le réel de l'imaginaire.
Mais ce qui rend le roman magnifique, c'est le temps qui façonne et se livre en digressions, en éclats, en convulsions, en rhizome.
C'est le temps du flux et du reflux.
Le temps de l'attente.
Le temps de l'éblouissement.
Un temps illicite.
Celui de l'amour et de la guerre.
Le temps de l'exil.
Un temps de l'oubli.
Le temps qui s'écoule étranger à nous-mêmes.
Un temps de l'impatience aussi.
Le temps délicieux et fugitif de la jouissance.
Un temps qui est une fenêtre ouverte, battant dans le vent.
Les dernières pages du récit disent effroyablement le sang qui coule, l'urine de celui qui a peur et qui fait sur lui face à l'ennemi qui tend son arme devant sa tempe, les cris de ceux qu'on torture, qu'on fusille dans une clairière ou au coin d'une rue déserte. L'espoir aussi, peut-être après, longtemps après, qui sait...
Mais ce que je retiens de ce livre, c'est le sentiment de quelque chose de tragique et de beau à la fois.
« Et quand viendra le jour du dernier voyage,
Quand partira la nef qui jamais ne revient,
Vous me verrez à bord, et mon maigre bagage,
Quasiment nu, comme les enfants de la mer. »
Antonio Machado
Merci à mes deux compagnes de voyage avec lesquelles j'ai cheminé dans cette lecture commune, Delphine (Mouche307) et Sandrine (HundredDreams).
Le narrateur, omniscient tout au long du récit, perce la foule agglutinée sur le quai de la gare de Pennsylvanie à New-York. On imagine aisément la scène, le bruit, l'ambiance. Il nous invite à nous frayer un chemin dans cette cohue, jusqu'à rejoindre Ignacio Abel, le suivre dans ce voyage où l'architecte espagnol espère retrouver son ancienne amante, mais aussi l'épier dans ses gestes et dans les méandres de ses pensées, le souvenir de ce qui fut et qui l'amène aujourd'hui à monter dans un train dans cette ville de New-York.
J'ai reconnu ici l'obsession des trains qui partent et laissent au bord des quais des rêves fracassés, des amours en partance, l'exil, la violence des guerres qui continuent malgré nos pleurs, le malheur du monde incessant.
C'est une mémoire qui se dérobe sur le bord d'un quai de gare.
J'aime les gares et les trains pour cela, - ou plutôt non je ne les aime pas à cause de cela justement, sauf en littérature ou au cinéma, les trains et leur fuite éperdue traversant le temps et les paysages.
Ce livre de plus de mille pages pourraient se résumer juste en quelques battements de coeur au bord du quai de cette gare à New-York où l'émoi d'Ignacio Abel se fait sentir à chaque fois qu'il aperçoit une jeune femme dont la silhouette lui rappelle celle de Judith. Biely...
L'histoire en elle-même pourrait tenir en quelques pages, en quelques faits. Mais se souvenir est aussi un voyage. Ce sont les réminiscences du temps qui vont nous inviter à revenir en arrière, dans ce passé encore proche, où les cendres sont encore tièdes. Remettre ses pas dans les souvenirs confus et douloureux d'un homme, c'est parfois dégringoler dans un vide abyssal.
C'est alors un balancement, une oscillation incessante qui va se mettre en marche tout au long de la suite du récit, entre un présent incertain et un passé non encore clos où les fantômes s'en échappent et où les bonheurs n'ont pas terminé leur course effrénée. Ici le futur n'est pas encore imaginé.
Le temps ne cesse de s'inviter dans ces pages somptueuses comme s'il était le personnage principal de ce livre, où notre plus grande quête de lecteur est de venir fouiller la mémoire d'un homme fugitif.
C'est aussi un passé qui couture l'intime à l'universel.
L'intime, c'est le parcours de ce fils d'un maçon et d'une concierge, devenu un architecte reconnu et célébré par son talent immense. En dépit de ses fortes convictions de républicain engagé, sans doute cette ascension sociale lui a valu de rencontrer et d'épouser une femme de la bourgeoisie espagnole conservatrice et catholique.
Désormais, la République, qu'il appelait de ses voeux comme un idéal, se déchire dans la violence et la répression. Aujourd'hui il ne trouve pas réellement sa place, ni dans sa vie, ni dans sa maison, ni dans son pays. Sa rencontre avec Judith Biely va bouleverser son existence. Avant elle, il a le sentiment que rien n'était vivant, qu'il n'existait pas. le sens de la vie, n'est-ce pas dans les bras de cette jeune femme, qu'il lui a été révélé ?
« Bien qu'elle ne soit presque plus jamais visible dans ses rêves, Judith Biely y rôde telle une absence impérieuse, celle d'une personne qui, du fait de son départ, semblera plus présente encore dans la révélation du vide qu'elle a laissé, comme le tranchant d'une lame est révélé par la blessure ouverte, et un inconnu par les traces qu'il a laissées sur le sable humide. »
Dans la grande nuit des temps écrit par Antonio Muñoz Molina fut pour moi une lecture tout d'abord laborieuse durant les premières pages, jusqu'à ce que l'éblouissement vint. Et alors...
Et alors, je suis monté dans le train, j'ai été emporté par le texte autant par sa forme inouïe, vertigineuse, que par la toile de fond historique.
Ici, il y est question en effet d'exil et d'Espagne. de la guerre civile et des terres lointaines. du passé que l'on laisse et qui ne passe pas. Des engagements, des renoncements tristes. du courage, du silence. Et aussi de ce qu'aimer veut dire...
Antonio Muñoz Molina m'a entraîné dans un récit construit en réminiscences et en digressions, où la relation d'Ignacio Abel au monde, à ceux qui l'entourent, ceux qu'il aime et qui l'aiment, est ici lié à l'Histoire de l'Espagne en train de se faire dans le bruit et la fureur.
C'est un aller-retour entre une gare de New-York et Madrid par le truchement d'un narrateur qui continue de nous entraîner dans le dédale du temps.
Dans la grande nuit des temps est un roman au fantastique pouvoir d'envoûtement et d'incarnation grâce à l'entremise des mots et du temps, dans sa dilatation, dans la manière très proustienne qu'a l'auteur de scruter un instant très court et de le faire résonner dans la durée…
L'obsession d'un amour peut-il être plus fort que la tragédie d'une guerre civile ?
D'ailleurs, est-ce un roman d'amour avec en toile de fond une fresque historique ? Ou bien l'inverse ? Les deux dimensions se côtoient, s'épousent à merveille, mêlant l'intime d'une rencontre clandestine à celle de la grande Histoire.
La beauté fracassante de ce roman vertigineux tient sans doute pour ces raisons, portée par la respiration d'une écriture sublime qui fut pour moi un ravissement.
L'Espagne meurtrie est palpable à travers les sensations si incroyablement représentées par l'auteur. C'est un roman sensoriel autant dans le plaisir des gestes amoureux que dans l'horreur infinie de la guerre.
« Il se rappelle la peur primitive, la peur qui revient avec la nuit, obscurité plus profonde et plus chargée de dangers que dans les histoires qu'on lui racontait dans son enfance. Non seulement rentrer chez soi lorsqu'il faisait encore jour et fermer les portes, en tirant targettes et verrous ; mais aussi se pelotonner comme un enfant sous les couvertures, fermer les yeux en serrant les paupières et se boucher les oreilles pour ne pas entendre, comme s'il suffisait d'avoir vu ou entendu pour attirer le malheur. »
À travers le personnage d'architecte qu'est Ignacio Abel, j'ai aimé ici rencontrer une sorte de métaphore des édifices que l'on construit si longuement et que l'on met peu de temps à les faire s'écrouler comme des châteaux de sable. La vie ressemble si souvent à cela.
Ignacio Abel est typiquement le personnage romanesque que j'aime par-dessus tout car il est rempli de doutes et d'interstices, personnage plutôt détestable au premier abord...
Est-il une sorte de déserteur, celui qui se retourne de temps en temps pour contempler le monde qu'il a quitté ? Les siens, sa famille, ses amis, son pays, sa patrie, une vie tout entière...
Est-il lâche ? Peut-être tout simplement ne trouve-t-il plus sa place dans ce temps absurde et convulsif ? Dans cette vieille Europe agonisante ?
Ce roman parle des renoncements, des trahisons, des lâchetés qui semblent reposer ici sur un seul homme.
J'ai failli me perdre dans les ténèbres de ce roman et je me suis retrouvé à chacun instant dans la lumière des personnages et les chemins tortueux qui les révèlent.
La lumière, ce fut autant celle d'une chambre mercenaire où les heures se défont que la révolte de la rue où les républicains farouches ont défendu jusqu'au bout les valeurs qui les animaient.
Le roman est traversé d'une certaines irréalité, fracturée par la frontière incertaine qui sépare le réel de l'imaginaire.
Mais ce qui rend le roman magnifique, c'est le temps qui façonne et se livre en digressions, en éclats, en convulsions, en rhizome.
C'est le temps du flux et du reflux.
Le temps de l'attente.
Le temps de l'éblouissement.
Un temps illicite.
Celui de l'amour et de la guerre.
Le temps de l'exil.
Un temps de l'oubli.
Le temps qui s'écoule étranger à nous-mêmes.
Un temps de l'impatience aussi.
Le temps délicieux et fugitif de la jouissance.
Un temps qui est une fenêtre ouverte, battant dans le vent.
Les dernières pages du récit disent effroyablement le sang qui coule, l'urine de celui qui a peur et qui fait sur lui face à l'ennemi qui tend son arme devant sa tempe, les cris de ceux qu'on torture, qu'on fusille dans une clairière ou au coin d'une rue déserte. L'espoir aussi, peut-être après, longtemps après, qui sait...
Mais ce que je retiens de ce livre, c'est le sentiment de quelque chose de tragique et de beau à la fois.
« Et quand viendra le jour du dernier voyage,
Quand partira la nef qui jamais ne revient,
Vous me verrez à bord, et mon maigre bagage,
Quasiment nu, comme les enfants de la mer. »
Antonio Machado
Merci à mes deux compagnes de voyage avec lesquelles j'ai cheminé dans cette lecture commune, Delphine (Mouche307) et Sandrine (HundredDreams).
Dans la grande nuit des temps est une vaste fresque, un projet de lecture ambitieux. Il faut se le dire dès le début, ça frôle les 1000 pages et l'intrigue peut paraître complexe. Mais ça vaut le coup. Jamais l'idée d'abandonner ne m'est venue en tête. C'est que, dans ce roman, la petite histoire rencontre la grande Histoire. Quand l'une ralentit, l'autre prend le relais et vice-versa. En 1936, Ignacio Abel débarque à New York. Son arrivée dans la métropole américaine l'amène à penser à ce qui l'y a conduit et à ce qu'il laisse derrière lui. L'idée de satisfaire ses ambitions d'architecte et de retrouver sa maitresse Judith Biely l'enchante mais il culpabilise d'avoir abandonné sa femme Adèle et ses deux enfants dans une Espagne à feu et à sang, en pleine guerre civile. Dit ainsi, il a l'air d'un beau salaud mais c'est plus complexe. Et qui peut affirmer hors de tout doute comment il réagirait dans une situation semblable ? Tiraillé entre une profession pour laquelle il n'y a pas de débouchés à cause de la situation politique, une épouse devenue bourgeoise, une belle-famille qui le méprise, une maitresse devenue une âme soeur ? Les rêves et la réalité, quoi ! Dans tous les cas, Abel revit en pensée ces dernières années et ces retours en arrières expliquent ce qui l'a mené à cette nouvelle vie.
L'auteur espagnol Antonio Munoz Molina a reconstitué cette période troublée avec beaucoup de rigueur. Son protagoniste Abel se tient renseigné des développements politiques, lit les journaux, en parle avec ses amis et collègues. Ainsi, les noms de plusieurs personnalités publiques et organisations reviennent régulièrement. En ce sens, l'index des noms propres et abréviations, à la fin de la collection Points, est très utile. Mais cette Histoire peut parfois devenir lourde pour le lecteur. Munoz Molina lui a épargné les longs passages descriptifs mais son souci du détail peut en agacer plus d'un, surtout ceux qui ne sont pas familiers avec la guerre civile espagnole et qui n'en sont pas vraiment intéressés, cherchant plutôt une lecture plaisante. Heureusement, les événements historiques sont habituellement mis en perspective avec la trame d'Abel, lequel n'est pas lié directement aux conflits, il n'en est affecté indirectement quand l'État, le principal bâilleur de fonds des grands projets de construction, a d'autres chats à fouetter et que les dirigeants changent. Et bien sûr quand les combats se rapprochent et font rage dans la capitale espagnole. En fait, on passe constamment de la politique aux épisodes sentimentaux (la guerre et l'amour !) et c'est la grande force du roman, selon moi.
L'auteur espagnol Antonio Munoz Molina a reconstitué cette période troublée avec beaucoup de rigueur. Son protagoniste Abel se tient renseigné des développements politiques, lit les journaux, en parle avec ses amis et collègues. Ainsi, les noms de plusieurs personnalités publiques et organisations reviennent régulièrement. En ce sens, l'index des noms propres et abréviations, à la fin de la collection Points, est très utile. Mais cette Histoire peut parfois devenir lourde pour le lecteur. Munoz Molina lui a épargné les longs passages descriptifs mais son souci du détail peut en agacer plus d'un, surtout ceux qui ne sont pas familiers avec la guerre civile espagnole et qui n'en sont pas vraiment intéressés, cherchant plutôt une lecture plaisante. Heureusement, les événements historiques sont habituellement mis en perspective avec la trame d'Abel, lequel n'est pas lié directement aux conflits, il n'en est affecté indirectement quand l'État, le principal bâilleur de fonds des grands projets de construction, a d'autres chats à fouetter et que les dirigeants changent. Et bien sûr quand les combats se rapprochent et font rage dans la capitale espagnole. En fait, on passe constamment de la politique aux épisodes sentimentaux (la guerre et l'amour !) et c'est la grande force du roman, selon moi.
critiques presse (4)
Ce roman est un somptueux office des ténèbres où la tragédie d'une nation rejoint celle d'un homme contraint de sacrifier ses espérances sous le gibet de l'Histoire.
Lire la critique sur le site : Lexpress
Dans la grande nuit des temps est un roman au fantastique pouvoir d'incarnation. S'y retrouve une société où les protagonistes portent chacun, sans caricature, avec leurs origines, un reflet de l'époque.
Lire la critique sur le site : LeMonde
« Dans la grande nuit des temps » est un chef-d'oeuvre narratif d'une beauté fracassante relatant une histoire politique et sentimentale sur fond de guerre civile espagnole. Le narrateur y décrit les événements avec une extrême précision, adoptant successivement plusieurs points de vue afin de saisir la réalité dans toutes ses dimensions. Il fait remonter à la surface sensations, odeurs, doutes et sentiments de l'Espagne meurtrie.
Lire la critique sur le site : LesEchos
Dans La grande nuit des temps, Antonio Muñoz Molina écrit l'hystérie de l'Espagne des années 30. Juste et implacable.
Lire la critique sur le site : Lexpress
Citations et extraits (145)
Voir plus
Ajouter une citation
L'ampleur de ce qu'on est soi-même capable de ne pas voir est surprenante, surtout lorsqu'on s'entête dans un aveuglement d'autant plus implacable qu'il est volontaire. Personne ne vous attache les mains, ne vous pousse à l'intérieur d'une cellule, ne ferme ensuite du dehors la clef et le verrou, personne ne vous met de force un bandeau sur les yeux et ne vous le noue si serré derrière la tête que vous ne puissiez pas vous en débarrasser sans que vous ayez pour autant les mains attachées. On tisse soi-même son bandeau, on tresse sa propre corde, on tend délibérément les mains pour que le nœud soit bien serré, on construit soi-même les murs de la cellule en la fermant de l'intérieur et en s'assurant que le cadenas est bien en place. On fait les pas nécessaires, l'un après l'autre, et si quelqu'un attire votre attention pour vous avertir du danger, il ne parvient qu'à renforcer votre entêtement plus encore du désastre. Parfois on est soulagé de savoir qu'on n'a pas encore touché le fond, d'autres fois qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Le doute devient une trahison inavouable qu'au fond de soi on ne reconnaît même pas.
Page 190
Page 190
Aux enterrements des morts de gauche, il y avait des forêts de drapeaux rouges et de poings levés et des cortèges de jeunes miliciens en uniforme ; aux enterrements des autres s'élevaient la fumée de l'encens répandue par des prêtres et la clameur des voix récitant le rosaire. L'étonnant était que personne ne semblait se rendre compte de la ressemblance extraordinaire entre les rituels funéraires de ceux qui se déclaraient ennemis, la célébration exaltée du courage et du sacrifice, l'âpre refus du monde réel et du présent au nom du Paradis sur Terre ou du Royaume des Cieux ; comme s'ils voulaient accélérer la venue du Jugement dernier et qu'au fond, ils haïssaient les incrédules et les tièdes beaucoup plus que les illuminés du camp adverse. Après l'enterrement du policier qui avait protégé Jimenez de Asua, la foule qui revient du cimetière attaque une église et y met le feu, les pompiers qui arrivent pour éteindre l'incendie sont accueillis à coups de fusil, l'un d'eux est tué d'une balle et le lendemain il y a un autre enterrement mais cette fois avec des chemises bleues et des curés en chasuble, des fumées d'encens et les prières du rosaire.
page 304
page 304
Au milieu du vacarme de la gare de Pennsylvanie, Ignacio Abel s’est arrêté en entendant quelqu’un l’appeler par son prénom. Je le vois d’abord de loin, parmi la foule de l’heure de pointe, une silhouette masculine identique aux autres, rapetissées par la dimension imposante du bâtiment, comme sur une photographie de l’époque : pardessus légers, gabardines, chapeaux ; chapeaux de femme au bord incliné sur l’oreille et petites plumes sur le côté ; casquettes rouges des porteurs et des employés du chemin de fer ; visages estompés par la distance ; pans de pardessus ouverts que l’énergie de la démarche fait flotter en arrière ; courants humains qui s’entrecroisent sans jamais se heurter, chaque homme et chaque femme est une silhouette semblable aux autres et pourtant dotée d’une identité aussi indiscutable que la trajectoire unique qu’elle suit à la recherche d’une destination précise ; flèches de direction, tableaux avec des noms de lieux et des heures de départ ou d’arrivée, escaliers métalliques qui résonnent et tremblent sous le galop des pas, horloges suspendues aux arcades d’acier ou couronnant des panneaux indicateurs verticaux où de grandes pages de calendrier permettent de voir de loin la date du jour. Il doit être nécessaire de tout savoir avec exactitude : ces lettres et ces chiffres, d’un rouge aussi intense que celui de la casquette des employés de la gare, indiquent un jour proche de la fin d’octobre 1936. Sur le cadran éclairé de chacune des horloges suspendues comme des ballons captifs à une grande hauteur au-dessus des têtes, il est quatre heures moins dix. À cet instant Ignacio Abel marche dans le hall de la gare, vaste espace composé de marbre, de hautes arcades métalliques, de verrières voûtées salies par la suie et qui filtrent une lumière dorée dans laquelle flottent de la poussière et la clameur des voix et des pas.
(Incipit)
(Incipit)
Il se rappelait sa mélancolie lors de ses premiers voyages hors de son pays : la sensation d’un saut dans le temps dès la frontière franchie ; il revivait la honte qu’il avait ressentie dans sa jeunesse à voir dans un journal français ou allemand des images de courses de taureaux : misérables chevaux éventrés par un coup de corne et convulsés dans leur agonie au milieu d’un bourbier de viscères, de sable et de sang ; taureaux à la langue pendante qui vomissaient du sang, une épée plantée dans leur garrot transformé en bouillie rouge par de maladroites tentatives de coup de grâce. Désormais ce n’étaient plus des taureaux ou des chevaux morts qu’il voyait dans les journaux de Paris ou aux actualités d’un cinéma où lui avaient manqué sans espoir la proximité de Judith Biely, ses mains dans la pénombre, son souffle à son oreille, la salive de ses baisers au goût de rouge à lèvres, au léger parfum de tabac ; cette fois c’étaient des hommes, des hommes qui s’entre-tuaient, cadavres jetés comme des guenilles dans les fossés, ouvriers agricoles en béret et chemise blanche, les mains levées, conduits comme du bétail par des militaires à cheval, soldats noirs de peau, aux uniformes grotesques, aux attitudes d’une cruauté, d’un enthousiasme et d’une vantardise insensés, d’un exotisme aussi sinistre que celui des bandits sur les photos sépia et les lithographies du siècle précédent, aussi étrangers au digne public européen qui assistait de loin au massacre que ces Abyssins armés de lances et de boucliers que le corps expéditionnaire de Mussolini avait mitraillés et bombardés depuis les airs pendant des mois dans une parfaite impunité.
Ignacio Abel s'obstine à pratiquer une lucidité rétrospective plus inutile encore pour le soulager de ses remords que pour corriger le passé. Il aurait voulu savoir à quel moment le désastre était devenu inévitable, quand ce qui est monstrueux avait commencé à paraître normal, était graduellement devenu aussi insignifiant que les actes les plus banals de la vie ; quand les mots qui encourageaient le crime, à qui personne n'accordait de crédit parce qu'ils se répétaient avec monotonie et n'étaient rien de plus que des mots, s'étaient transformés en crimes ; quand les crimes étaient devenus habituels au point de faire désormais partie de la vie publique normale. Aujourd'hui l'armée est le point d'appui et la colonne vertébrale de la patrie. Quand la guerre civile éclatera, nous n'accepterons pas d'être éliminés comme des lâches en tendant le cou à l'ennemi. Il existe un instant précis, unique, un point au-delà duquel le retour est impossible.
page 263
page 263
Videos de Antonio Muñoz Molina (91)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : littérature espagnoleVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Antonio Muñoz Molina (21)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3178 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3178 lecteurs ont répondu