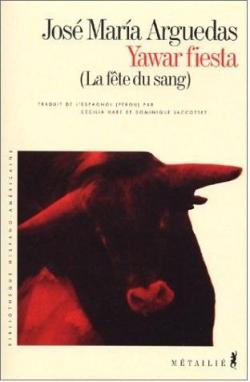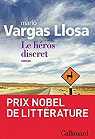José María Arguedas/5
13 notes
Résumé :
L'atmosphère des tragédies grecques antiques ? La fureur et l'austérité d'Eschyle, la truculence d'Euripide ? Oui, tout cela plane sur cette âpre épopée en forme de conte, cette histoire d'une corrida du désespoir, ultime bravade d'un peuple déchu - de ses droits, de sa langue, de sa culture : les Indiens des Andes. Arguedas brosse à grands traits le tableau d'un microcosme suspendu entre Terre et ciel, accroché aux cornes sanglantes de son taureau légendaire, Minot... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Yawar fiesta : la fête du sangVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
L'OeUVRE D'UN GRAND ÉCRIVAIN NOBÉLISABLE ET D'UN "HONNÊTE HOMME" :
Oui, c'est un chef d'oeuvre! On peut dire que la description qui est faite ici dans la présentation (résumé) du livre par "Scarbo" est particulièrement juste : il y a une vraie dimension épique dans l'affrontement, que met en scène ce récit, entre les populations autochtones amérindiennes et le groupe des notables (colons et grands propriétaires blancs, les "mistis"), entre la sierra indienne et la côte créole et "blanche", affrontement qui rejoue à sa façon le grand traumatisme et le choc civilisationnel que fut la "conquista", par une poignée d'aventuriers espagnols, du grand empire inca au XVIe siècle.
L'observation précise des faits, des coutumes et des peuples est extraordinaire et révèle l'ethno-anthropologue savant que fut aussi Arguedas, ainsi que l'enfant sensible et émerveillé qui découvrit très jeune ces modes de vie et traditions autochtones, puis à l'adolescence avec son père (voir le roman suivant, en partie autobiographique, « Les fleuves profonds »). Auparavant, orphelin de mère très tôt, à deux ans, et son père s'étant remarié, souvent absent (il était avocat itinérant), sa marâtre et sa fratrie du côté de sa belle-mère l'obligeaient à vivre avec les serviteurs indiens. C'est auprès d'eux qu'il découvre la culture et la langue quechua (qu'on écrit kechwa dans la langue). En 1921, à l'âge de dix ans, il s'échappe de la tyrannie de sa belle famille avec son frère Aristide. Ils se sont réfugiés dans une communauté indigène de la Hacienda Viseca, où ils vécurent deux ans en contact étroit avec les Indiens, parlant exclusivement leur langue, apprenant et vivant leurs coutumes… Jusqu'à ce que, en 1923, les recueille leur père, qui les emmena dans son itinérance à travers les villages et les villes de la sierra, permettant ainsi au jeune José María de parfaire sa connaissance du monde andin, pour finalement s'établir en Abancay, la capitale du département d'Apurímac (centre-sud du Pérou).
Comme romancier, figure phare de toute la mouvance indigéniste, et ayant contribué à la renouveler, José María Arguedas rejoint Ciro Alegría, son compatriote et contemporain, dans la tentative délibérée, complexe, et plus réussie que jamais d'envisager, de décrire "de l'intérieur" l'Indien des Andes, et dans le dessein de portraiturer le visage composite de la réalité péruvienne, de désigner précisément, sans faux-fuyants culpabilisés et sans illusion historique, la confluence de « tous les sangs mêlés » de son identité. Ceci est dû en bonne partie au fait qu'il est originaire de la sierra du centre-sud du Pérou (régions d'Ayacucho, Apurímac, et Cuzco, soit le coeur même du Tawantinsuyu, l'empire Inca), qui est toujours restée plus liée à la langue kechwa et à l'héritage pré-hispanique que la sierra du nord, celle de Ciro Alegría et de César Vallejo. Alors, dès le début de son écriture, Arguedas se place du point de vue de l'Indien et exprime sa vision à la fois réaliste, ancrée dans le quotidien, et imprégnée d'un "fantastique concret", parvenant à une intensité esthétique et une identification avec l'optique populaire sans équivalent dans la littérature hispano-américaine (si ce n'est peut-être, plus tard, dans les romans et nouvelles de l'écrivain mexicain Juan Rulfo, ou bien sûr du colombien García Márquez), dans une démarche qui se situe au sein des grands courants de celle-ci mais de façon vraiment originale, qui tient à la fois du « réalisme merveilleux » promu par le cubain Alejo Carpentier et du « réalisme magique » d'un García Márquez (dans «Cent ans de solitude», «…Histoire de la candide Eréndira…», «Les funérailles de la Grande Mémé» ou «Chronique d'une mort annoncée», cette dernière très proche dans sa fatalité tragique et cosmique d'un autre roman d'Arguedas : «Diamants et silex»).
De fait, les récits d'Arguedas des années 1935-1954, en particulier le charmant conte «Warma Kuyay» (dans le recueil «Agua»), et ce vigoureux roman-ci de «Yawar fiesta», témoignent de ce sentir-être-entre-deux-mondes d'Arguedas : blanc de naissance (il était issu d'une famille riche d'"hacendados", les "établis" par l'empereur Charles Quint en récompense des conquêtes et dons faits à la couronne), mais Indien de coeur. Parfaitement bilingue, il a d'abord appris le kechwa et nourri son enfance de culture andine (musique, chants, danses, cosmogonies, récits fondateurs, croyances) plus que de culture occidentale, qu'il a fini par connaître solidement tant dans sa jeunesse étudiante (il a fait une licence de littérature, puis plus tard un doctorat d'ethno-anthropologie) que dans sa maturité, mais en la "transculturant" notablement : en effet, il a "quechuisé" l'idiome espagnol et subverti l'écriture romanesque bourgeoise moderne avec des éléments empruntés à la tradition orale (y compris des chants, même aux moments-clés de la narration) et à la pensée mythique (chamanisme, danse rituelle "des ciseaux": la « danza de tijeras » , amarus, etc.).
Publié en 1941 et, dans une nouvelle version en 1958, Yawar Fiesta raconte les mouvements et conflits qui agitent un gros bourg des Andes péruviennes quand les autorités de Lima interdisent la traditionnelle corrida locale, indienne, donnée rituellement tous les ans à l'occasion de la fête nationale, pendant laquelle les habitants des villages affrontent dans les rues et sur la place centrale les taureaux. Or cette année la corrida s'annonçait mémorable avec la venue espérée du taureau le plus puissant et sauvage de la région, véritable mythe vivant, un vrai totem : le “Misitu”. le gouvernement central ordonne que la dite corrida sauvage soit remplacée par une corrida moins féroce et dangereuse, "civilisée", de type espagnol, et menée par des toreros professionnels dans une arène fermée entourée de tribune. le titre original du roman, bilingue, mi-kechwa (Yawar : le sang) /mi-espagnol (la fiesta : la fête, et donc, littéralement «la fête sanglante»), indique le thème plus général, caractéristique de toute l'oeuvre d'Arguedas, de la coexistence et du contraste entre les Indiens, dont on célèbre la dignité et les traditions, la détermination unitaire malgré la joute aux rivalités simulées, et les blancs, maîtres des lieux, qui résistent aux nouvelles dispositions (contraires à des traditions qu'eux aussi ressentent comme leur appartenant en propre, comme une particularité locale qu'ils ont intégrée à leur identité), mais qui ne se risquent pas à s'opposer au sous-préfet, représentant l'autorité gouvernementale, et incarnant la "civilisation" hispanique occidentale dominante à laquelle ils souhaitent se rattacher : les voilà pris en flagrant délit de conflit identitaire, mais honteux et culpabilisé, et donc complètement intériorisé.
Le roman se terminera par le triomphe du peuple indien ; les toreros indigènes feront irruption dans l'arène, remplaçant le torero espagnol intimidé puis terrifié. Avec «Les fleuves profonds», «Yawar fiesta» est sans conteste le meilleur roman d'Arguedas. Il nous offre un tableau haut en couleur de la vie sociale complexe du Haut-Plateau andin, où l'aspect ethnique s'entrecroise avec des facteurs socioéconomiques et culturels d'une richesse et d'une subtilité infinies. L'écrivain péruvien réussit à témoigner encore ici de toute la sensibilité indienne, et en particulier dans la langue il transmet une certaine musicalité de type choral, laquelle dans «Yawar fiesta» se coule dans le son omniprésent des instruments autochtones [Wakawak'ras(1), charango(2), harpe andine(3), grandes flûtes des hauts-plateaux(4)], vrais motifs structurant en leitmotiv le roman dans son ensemble.
Car la langue d'Arguedas est riche et poétique, musicale, au souffle puissant ; elle aussi trahit une féconde dualité linguistique entre le castillan et le kechwa (la langue vernaculaire des Indiens des Andes et des anciens Incas), son récit est parsemé de "quechuismes" dont la lecture est facilitée par les notes du traducteur en cours de texte, et le glossaire complet à la fin (qui n'est pas si long en fait : Arguedas a choisi les mots et les concepts les plus importants, les plus fréquemment employés par les Indiens, et les plus révélateurs de leur vision du monde). Quechuismes dont on prend facilement l'habitude, si bien que très vite, on n'a plus besoin de consulter le glossaire (sauf exception, alors le traducteur vient à notre secours et propose une note en cours de récit). Mais, au-delà de ce vocabulaire "métissé" ou en fusion (comme on parle de « musique-fusion »), depuis son premier roman « Agua » (1935), et plus encore dans ce roman-ci, il s'est confronté à un problème stylistique crucial pour lui : trouver une langue "naturelle" dans laquelle ses personnages indigènes (à l'époque monolingues kechwas exclusifs) pourraient s'exprimer en espagnol (car dans ses romans en castillan, ce serait tout de même trop lourd de faire constamment de la "V.O. sous-titrée" !), et sans que les dialogues sonnent faux. Problème qu'il a résolu de façon originale et pertinente par l'emploi d'une sorte de "langage inventé", assez inouï : sur une base lexicale fondamentalement espagnole, il a greffé le rythme syntaxique et l'ordonnancement du kechwa. Ce qui donne son style si particulier et reconnaissable, si profondément typique et savoureux qu'on se croirait dans les banlieues andines des gros bourgs de l'intérieur, ou au coeur d'un « ayllu » (quartier ou communauté indigène). Mais qu'on se rassure : cette trouvaille stylistique n'altère en rien la parfaite lisibilité du récit, avec ses suspenses, ses rebondissements, sa colère blanche contenue qui sourd au détour d'une phrase ou d'une réplique méprisante d'un notable ou d'une autorité envers l'Indien.
« Yawar fiesta » pose enfin, dès 1941, le problème de l'expropriation inique des Indiens des hauts plateaux, couverte par le gouvernement de Lima et par les autorités locales tout acquis aux intérêts des notables, et des diverses exactions qu'ont subies les habitants des communautés indigènes de Puquio, dans la province de Lucanas (département d'Ayacucho), symboles du Pérou entier. Mais dans cette oeuvre, l'auteur rompt avec quelques-unes des conventions du roman indigéniste traditionnel, en soulignant la dignité de l'autochtone qui a su préserver ses coutumes ancestrales malgré le mépris dans lequel les tiennent les classes dominantes et les pouvoirs publics. Ce triomphalisme est en soi plutôt inhabituel selon les canons indigénistes, généralement plus misérabilistes, et donne à comprendre le monde andin comme un corps soudé, régi par ses propres lois, affronté uniment au modèle occidentalisé dominant sur la côte du Pérou. C'est peut-être en ce sens, et en ce sens seulement, que le terme d' « utopie » qu'emploie Vargas Llosa pour stigmatiser la position d'Arguedas trouve une certaine justification.
On l'a vu, cette dualité culturelle que José María Arguedas met en scène à la fois dans son style et dans son récit, il l'a vécue dans sa chair, au plus intime de son identité. Elle s'est peu à peu transformée en déchirement et en conscience douloureuse à cause des injustices des classes dominantes envers les Indiens qui ont perduré jusqu'à nos jours. de plus, on l'a vu dans sa biographie, Arguedas vivait un conflit profond entre son amour pour la culture indigène, qu'il souhaitait "intacte", et son désir d'aider l'Indien à sortir de sa misère (et donc forcément, d'une manière ou d'une autre, être obligé de s'acculturer), une distorsion intenable entre nostalgie traditionnaliste et adhésion au progressisme socialiste. Ces contradictions ne sont pas pour rien dans la dépression qui a abouti à son suicide en 1969, à l'âge de 58 ans, malgré sa réussite personnelle et sa reconnaissance sociale, littéraire et politique (il mena à bien aux ministères de l'Éducation puis de la Culture des missions importantes couronnées de succès et assez unanimement saluées, et il fut un universitaire et un directeur de musée très apprécié).
Cette tragédie exprime les déchirures et les clivages de la société péruvienne, laquelle n'a toujours pas surmonté, en fait, le bouleversement et le désastre que fut le génocide physique (par la maltraitance, la surexploitation et le choc biologique des grandes épidémies), économique (avec le pillage des ressources et la déstructuration sociale) et culturel des civilisations amérindiennes précolombiennes, lors de la conquête espagnole. Plus qu'une "réconciliation", Arguedas prône la reconnaissance de la valeur de ces cultures amérindiennes et leur intégration plénière au sentiment et au patrimoine national, assorties des nécessaires mesures de justice sociale envers les populations autochtones. Ce mouvement, amorcé par les idées d'Arguedas qui ont infusé la société péruvienne et même l'ensemble de l'Amérique du Sud, a déjà commencé, mais il est loin d'être achevé.
Sans cette fin tragique et prématurée, avec une oeuvre extraordinaire et qui aurait pu se poursuivre, nul doute que José María Arguedas, par l'originalité et la pertinence de son style, la justesse bien informée de ses descriptions, l'ampleur et la générosité de sa vision tant humaniste que "néo-indigéniste", et l'exemplarité de sa conscience universelle, eût naturellement trouvé sa place au sein du prestigieux collège des six grands écrivains nobélisés de l'aire latino-américaine, à savoir, dans l'ordre chronologique: Gabriela Mistral (Chili, 1945), Miguel-Ángel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chili, 1971), Gabriel García Márquez (Colombie, 1982), Octavio Paz (Mexique, 1990), et Mario Vargas Llosa, son compatriote et admirateur péruvien, Nobel en 2010.
Vous pourrez lire aussi ici des commentaires critiques sur les oeuvres d'Arguedas que j'ai empruntés à une thèse (de Martine Rens), au chapitre "citations", à chaque page du site consacrée à ces livres.
■ Helgé, alias lglaviano. Ecrit en partie à l'aide des informations trouvées sur le site suivant (en espagnol) : «Biografías y vidas», http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arguedas.htm
(1)- « Wakawak'ras » (ou encore : Wajrapuko) : sorte de cor au son puissant et guerrier, fait de cornes de taureau creusées et emboîtées les unes dans les autres. Il accompagne le « wak'raykuy » ou chant des coups de corne, et le « turupukllay » la musique qui accompagne les corridas.
(2)- « Charango kirkincho » : adorable petit luth indien généralement à 5 doubles cordes, au son charmant, puissant et cristallin, clair et acidulé, dont la caisse est faite dans une carapace du petit tatou velu des Andes (et aujourd'hui en bois car le tatou kirkincho est protégé). Issu de la vihuela espagnole ou peut-être de la mandoline.
(3)- « El Arpa andina » : petite harpe indienne, qui peut se jouer assis ou debout en ambulatoire portée sur l'épaule afin d'accompagner les « dansak' » ou « danzantes de tijeras », les danseurs de la danse des ciseaux.
(4)- Grandes flûtes des Andes : soit les « toyos », sikus ou flûtes de Pan géantes ultra graves au son caverneux et percussif, ou encore la « machu kena » ou « ocona » : grande kena (flûte droite à encoche) des hauts plateaux, de 80 à 90 cms, à la voix profonde et grave, au son très chaud velouté et rond, des départements de Puno et Ayacucho au Pérou, qui se joue seule en expression individuelle à la différence des pusipías, lichiwayus, chokelas, autres grandes kenas qui se jouent en troupe, pour une expression communautaire.
Lien : http://www.biografiasyvidas...
Oui, c'est un chef d'oeuvre! On peut dire que la description qui est faite ici dans la présentation (résumé) du livre par "Scarbo" est particulièrement juste : il y a une vraie dimension épique dans l'affrontement, que met en scène ce récit, entre les populations autochtones amérindiennes et le groupe des notables (colons et grands propriétaires blancs, les "mistis"), entre la sierra indienne et la côte créole et "blanche", affrontement qui rejoue à sa façon le grand traumatisme et le choc civilisationnel que fut la "conquista", par une poignée d'aventuriers espagnols, du grand empire inca au XVIe siècle.
L'observation précise des faits, des coutumes et des peuples est extraordinaire et révèle l'ethno-anthropologue savant que fut aussi Arguedas, ainsi que l'enfant sensible et émerveillé qui découvrit très jeune ces modes de vie et traditions autochtones, puis à l'adolescence avec son père (voir le roman suivant, en partie autobiographique, « Les fleuves profonds »). Auparavant, orphelin de mère très tôt, à deux ans, et son père s'étant remarié, souvent absent (il était avocat itinérant), sa marâtre et sa fratrie du côté de sa belle-mère l'obligeaient à vivre avec les serviteurs indiens. C'est auprès d'eux qu'il découvre la culture et la langue quechua (qu'on écrit kechwa dans la langue). En 1921, à l'âge de dix ans, il s'échappe de la tyrannie de sa belle famille avec son frère Aristide. Ils se sont réfugiés dans une communauté indigène de la Hacienda Viseca, où ils vécurent deux ans en contact étroit avec les Indiens, parlant exclusivement leur langue, apprenant et vivant leurs coutumes… Jusqu'à ce que, en 1923, les recueille leur père, qui les emmena dans son itinérance à travers les villages et les villes de la sierra, permettant ainsi au jeune José María de parfaire sa connaissance du monde andin, pour finalement s'établir en Abancay, la capitale du département d'Apurímac (centre-sud du Pérou).
Comme romancier, figure phare de toute la mouvance indigéniste, et ayant contribué à la renouveler, José María Arguedas rejoint Ciro Alegría, son compatriote et contemporain, dans la tentative délibérée, complexe, et plus réussie que jamais d'envisager, de décrire "de l'intérieur" l'Indien des Andes, et dans le dessein de portraiturer le visage composite de la réalité péruvienne, de désigner précisément, sans faux-fuyants culpabilisés et sans illusion historique, la confluence de « tous les sangs mêlés » de son identité. Ceci est dû en bonne partie au fait qu'il est originaire de la sierra du centre-sud du Pérou (régions d'Ayacucho, Apurímac, et Cuzco, soit le coeur même du Tawantinsuyu, l'empire Inca), qui est toujours restée plus liée à la langue kechwa et à l'héritage pré-hispanique que la sierra du nord, celle de Ciro Alegría et de César Vallejo. Alors, dès le début de son écriture, Arguedas se place du point de vue de l'Indien et exprime sa vision à la fois réaliste, ancrée dans le quotidien, et imprégnée d'un "fantastique concret", parvenant à une intensité esthétique et une identification avec l'optique populaire sans équivalent dans la littérature hispano-américaine (si ce n'est peut-être, plus tard, dans les romans et nouvelles de l'écrivain mexicain Juan Rulfo, ou bien sûr du colombien García Márquez), dans une démarche qui se situe au sein des grands courants de celle-ci mais de façon vraiment originale, qui tient à la fois du « réalisme merveilleux » promu par le cubain Alejo Carpentier et du « réalisme magique » d'un García Márquez (dans «Cent ans de solitude», «…Histoire de la candide Eréndira…», «Les funérailles de la Grande Mémé» ou «Chronique d'une mort annoncée», cette dernière très proche dans sa fatalité tragique et cosmique d'un autre roman d'Arguedas : «Diamants et silex»).
De fait, les récits d'Arguedas des années 1935-1954, en particulier le charmant conte «Warma Kuyay» (dans le recueil «Agua»), et ce vigoureux roman-ci de «Yawar fiesta», témoignent de ce sentir-être-entre-deux-mondes d'Arguedas : blanc de naissance (il était issu d'une famille riche d'"hacendados", les "établis" par l'empereur Charles Quint en récompense des conquêtes et dons faits à la couronne), mais Indien de coeur. Parfaitement bilingue, il a d'abord appris le kechwa et nourri son enfance de culture andine (musique, chants, danses, cosmogonies, récits fondateurs, croyances) plus que de culture occidentale, qu'il a fini par connaître solidement tant dans sa jeunesse étudiante (il a fait une licence de littérature, puis plus tard un doctorat d'ethno-anthropologie) que dans sa maturité, mais en la "transculturant" notablement : en effet, il a "quechuisé" l'idiome espagnol et subverti l'écriture romanesque bourgeoise moderne avec des éléments empruntés à la tradition orale (y compris des chants, même aux moments-clés de la narration) et à la pensée mythique (chamanisme, danse rituelle "des ciseaux": la « danza de tijeras » , amarus, etc.).
Publié en 1941 et, dans une nouvelle version en 1958, Yawar Fiesta raconte les mouvements et conflits qui agitent un gros bourg des Andes péruviennes quand les autorités de Lima interdisent la traditionnelle corrida locale, indienne, donnée rituellement tous les ans à l'occasion de la fête nationale, pendant laquelle les habitants des villages affrontent dans les rues et sur la place centrale les taureaux. Or cette année la corrida s'annonçait mémorable avec la venue espérée du taureau le plus puissant et sauvage de la région, véritable mythe vivant, un vrai totem : le “Misitu”. le gouvernement central ordonne que la dite corrida sauvage soit remplacée par une corrida moins féroce et dangereuse, "civilisée", de type espagnol, et menée par des toreros professionnels dans une arène fermée entourée de tribune. le titre original du roman, bilingue, mi-kechwa (Yawar : le sang) /mi-espagnol (la fiesta : la fête, et donc, littéralement «la fête sanglante»), indique le thème plus général, caractéristique de toute l'oeuvre d'Arguedas, de la coexistence et du contraste entre les Indiens, dont on célèbre la dignité et les traditions, la détermination unitaire malgré la joute aux rivalités simulées, et les blancs, maîtres des lieux, qui résistent aux nouvelles dispositions (contraires à des traditions qu'eux aussi ressentent comme leur appartenant en propre, comme une particularité locale qu'ils ont intégrée à leur identité), mais qui ne se risquent pas à s'opposer au sous-préfet, représentant l'autorité gouvernementale, et incarnant la "civilisation" hispanique occidentale dominante à laquelle ils souhaitent se rattacher : les voilà pris en flagrant délit de conflit identitaire, mais honteux et culpabilisé, et donc complètement intériorisé.
Le roman se terminera par le triomphe du peuple indien ; les toreros indigènes feront irruption dans l'arène, remplaçant le torero espagnol intimidé puis terrifié. Avec «Les fleuves profonds», «Yawar fiesta» est sans conteste le meilleur roman d'Arguedas. Il nous offre un tableau haut en couleur de la vie sociale complexe du Haut-Plateau andin, où l'aspect ethnique s'entrecroise avec des facteurs socioéconomiques et culturels d'une richesse et d'une subtilité infinies. L'écrivain péruvien réussit à témoigner encore ici de toute la sensibilité indienne, et en particulier dans la langue il transmet une certaine musicalité de type choral, laquelle dans «Yawar fiesta» se coule dans le son omniprésent des instruments autochtones [Wakawak'ras(1), charango(2), harpe andine(3), grandes flûtes des hauts-plateaux(4)], vrais motifs structurant en leitmotiv le roman dans son ensemble.
Car la langue d'Arguedas est riche et poétique, musicale, au souffle puissant ; elle aussi trahit une féconde dualité linguistique entre le castillan et le kechwa (la langue vernaculaire des Indiens des Andes et des anciens Incas), son récit est parsemé de "quechuismes" dont la lecture est facilitée par les notes du traducteur en cours de texte, et le glossaire complet à la fin (qui n'est pas si long en fait : Arguedas a choisi les mots et les concepts les plus importants, les plus fréquemment employés par les Indiens, et les plus révélateurs de leur vision du monde). Quechuismes dont on prend facilement l'habitude, si bien que très vite, on n'a plus besoin de consulter le glossaire (sauf exception, alors le traducteur vient à notre secours et propose une note en cours de récit). Mais, au-delà de ce vocabulaire "métissé" ou en fusion (comme on parle de « musique-fusion »), depuis son premier roman « Agua » (1935), et plus encore dans ce roman-ci, il s'est confronté à un problème stylistique crucial pour lui : trouver une langue "naturelle" dans laquelle ses personnages indigènes (à l'époque monolingues kechwas exclusifs) pourraient s'exprimer en espagnol (car dans ses romans en castillan, ce serait tout de même trop lourd de faire constamment de la "V.O. sous-titrée" !), et sans que les dialogues sonnent faux. Problème qu'il a résolu de façon originale et pertinente par l'emploi d'une sorte de "langage inventé", assez inouï : sur une base lexicale fondamentalement espagnole, il a greffé le rythme syntaxique et l'ordonnancement du kechwa. Ce qui donne son style si particulier et reconnaissable, si profondément typique et savoureux qu'on se croirait dans les banlieues andines des gros bourgs de l'intérieur, ou au coeur d'un « ayllu » (quartier ou communauté indigène). Mais qu'on se rassure : cette trouvaille stylistique n'altère en rien la parfaite lisibilité du récit, avec ses suspenses, ses rebondissements, sa colère blanche contenue qui sourd au détour d'une phrase ou d'une réplique méprisante d'un notable ou d'une autorité envers l'Indien.
« Yawar fiesta » pose enfin, dès 1941, le problème de l'expropriation inique des Indiens des hauts plateaux, couverte par le gouvernement de Lima et par les autorités locales tout acquis aux intérêts des notables, et des diverses exactions qu'ont subies les habitants des communautés indigènes de Puquio, dans la province de Lucanas (département d'Ayacucho), symboles du Pérou entier. Mais dans cette oeuvre, l'auteur rompt avec quelques-unes des conventions du roman indigéniste traditionnel, en soulignant la dignité de l'autochtone qui a su préserver ses coutumes ancestrales malgré le mépris dans lequel les tiennent les classes dominantes et les pouvoirs publics. Ce triomphalisme est en soi plutôt inhabituel selon les canons indigénistes, généralement plus misérabilistes, et donne à comprendre le monde andin comme un corps soudé, régi par ses propres lois, affronté uniment au modèle occidentalisé dominant sur la côte du Pérou. C'est peut-être en ce sens, et en ce sens seulement, que le terme d' « utopie » qu'emploie Vargas Llosa pour stigmatiser la position d'Arguedas trouve une certaine justification.
On l'a vu, cette dualité culturelle que José María Arguedas met en scène à la fois dans son style et dans son récit, il l'a vécue dans sa chair, au plus intime de son identité. Elle s'est peu à peu transformée en déchirement et en conscience douloureuse à cause des injustices des classes dominantes envers les Indiens qui ont perduré jusqu'à nos jours. de plus, on l'a vu dans sa biographie, Arguedas vivait un conflit profond entre son amour pour la culture indigène, qu'il souhaitait "intacte", et son désir d'aider l'Indien à sortir de sa misère (et donc forcément, d'une manière ou d'une autre, être obligé de s'acculturer), une distorsion intenable entre nostalgie traditionnaliste et adhésion au progressisme socialiste. Ces contradictions ne sont pas pour rien dans la dépression qui a abouti à son suicide en 1969, à l'âge de 58 ans, malgré sa réussite personnelle et sa reconnaissance sociale, littéraire et politique (il mena à bien aux ministères de l'Éducation puis de la Culture des missions importantes couronnées de succès et assez unanimement saluées, et il fut un universitaire et un directeur de musée très apprécié).
Cette tragédie exprime les déchirures et les clivages de la société péruvienne, laquelle n'a toujours pas surmonté, en fait, le bouleversement et le désastre que fut le génocide physique (par la maltraitance, la surexploitation et le choc biologique des grandes épidémies), économique (avec le pillage des ressources et la déstructuration sociale) et culturel des civilisations amérindiennes précolombiennes, lors de la conquête espagnole. Plus qu'une "réconciliation", Arguedas prône la reconnaissance de la valeur de ces cultures amérindiennes et leur intégration plénière au sentiment et au patrimoine national, assorties des nécessaires mesures de justice sociale envers les populations autochtones. Ce mouvement, amorcé par les idées d'Arguedas qui ont infusé la société péruvienne et même l'ensemble de l'Amérique du Sud, a déjà commencé, mais il est loin d'être achevé.
Sans cette fin tragique et prématurée, avec une oeuvre extraordinaire et qui aurait pu se poursuivre, nul doute que José María Arguedas, par l'originalité et la pertinence de son style, la justesse bien informée de ses descriptions, l'ampleur et la générosité de sa vision tant humaniste que "néo-indigéniste", et l'exemplarité de sa conscience universelle, eût naturellement trouvé sa place au sein du prestigieux collège des six grands écrivains nobélisés de l'aire latino-américaine, à savoir, dans l'ordre chronologique: Gabriela Mistral (Chili, 1945), Miguel-Ángel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chili, 1971), Gabriel García Márquez (Colombie, 1982), Octavio Paz (Mexique, 1990), et Mario Vargas Llosa, son compatriote et admirateur péruvien, Nobel en 2010.
Vous pourrez lire aussi ici des commentaires critiques sur les oeuvres d'Arguedas que j'ai empruntés à une thèse (de Martine Rens), au chapitre "citations", à chaque page du site consacrée à ces livres.
■ Helgé, alias lglaviano. Ecrit en partie à l'aide des informations trouvées sur le site suivant (en espagnol) : «Biografías y vidas», http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arguedas.htm
(1)- « Wakawak'ras » (ou encore : Wajrapuko) : sorte de cor au son puissant et guerrier, fait de cornes de taureau creusées et emboîtées les unes dans les autres. Il accompagne le « wak'raykuy » ou chant des coups de corne, et le « turupukllay » la musique qui accompagne les corridas.
(2)- « Charango kirkincho » : adorable petit luth indien généralement à 5 doubles cordes, au son charmant, puissant et cristallin, clair et acidulé, dont la caisse est faite dans une carapace du petit tatou velu des Andes (et aujourd'hui en bois car le tatou kirkincho est protégé). Issu de la vihuela espagnole ou peut-être de la mandoline.
(3)- « El Arpa andina » : petite harpe indienne, qui peut se jouer assis ou debout en ambulatoire portée sur l'épaule afin d'accompagner les « dansak' » ou « danzantes de tijeras », les danseurs de la danse des ciseaux.
(4)- Grandes flûtes des Andes : soit les « toyos », sikus ou flûtes de Pan géantes ultra graves au son caverneux et percussif, ou encore la « machu kena » ou « ocona » : grande kena (flûte droite à encoche) des hauts plateaux, de 80 à 90 cms, à la voix profonde et grave, au son très chaud velouté et rond, des départements de Puno et Ayacucho au Pérou, qui se joue seule en expression individuelle à la différence des pusipías, lichiwayus, chokelas, autres grandes kenas qui se jouent en troupe, pour une expression communautaire.
Lien : http://www.biografiasyvidas...
Dans ce magnifique roman aux airs d'épopée, José Maria Arguedas, écrivain majeur du courant littéraire indigéniste, met en scène le conflit culturel qui existe entre la Sierra (les gens d'en haut) et la capitale Lima (ceux d'en bas), au travers de la corrida indienne qui a lieu chaque année pour la fête nationale à Puquio, petite ville des Andes. C'est aussi le tableau d'une opposition sociale, notables dominants et prédateurs soutenus par les institutions contre modestes villageois, où tout rejoue le drame premier de la conquête de cette terre andine par l'empire espagnol.
Comme dans toute son oeuvre, José Maria Arguedas sait superbement imposer la voix authentique de la culture andine sans jamais sombrer dans l'utopie archaïque.
Comme dans toute son oeuvre, José Maria Arguedas sait superbement imposer la voix authentique de la culture andine sans jamais sombrer dans l'utopie archaïque.
C'est la seconde fois que je lis ce magnifique ouvrage. J'y ai retrouvé la complexité des relations interethniques toujours à l'oeuvre dans les autres pays andins, la confrontation entre des traditions - qui sont la synthèse entre la culture andine et l'hispanité qui s'est imposée - et la "modernité" venue de la ville, et les paysages... A lire et à relire
Citations et extraits (9)
Voir plus
Ajouter une citation
[DOCUMENTAIRE]: La coutume de la "Yawar Fiesta" ou fête du sang , soit le rodéo et la corrida andins:
Cette fête de village, rejouant symboliquement des conflits à la fois historiques, culturels et sociaux, dure plusieurs jours et demande une bonne préparation.
Si elle était relativement répandue en région andine elle s'est faite plus rare, mais reprend un peu de vigueur dans une volonté (mitigée) de revalorisation des coutumes et traditions. Elle se perpétue pour la fête nationale péruvienne, soit aux alentours des 28 et 29 juillet dans différents villages comme ceux de Chalhuanca, Cotabamba ou Coyllurki entre autres.
Il semblerait que ce soit d'abord les riches propriétaires terriens d'origine espagnole qui auraient voulu des fêtes taurines recréées "chez eux", sur "leurs terres", des sortes de corridas relativement improvisées dont les protagonistes auraient été "leurs gens", opposés à une troupe de taureaux du domaine.
Une sorte de « panem et circenses » à la romaine organisé par le grand propriétaire terrien local, le notable blanc qui se prend pour une sorte de "Néron" tout puissant.
Les spectateurs sont à la fois dans les tribunes (les propriétaires, leurs hôtes et amis), maîtres des lieux et de la fête, puis le peuple composé essentiellement des travailleurs ou "wakchas" encore appelés "péones" ; en fait ce sont les travailleurs autochtones des haciendas alentour, essentiellement les populations amérindiennes de la région.
"Comme en Espagne" on réalise des corridas, mais ici, avec les moyens du bord. Alors les Indiens ont su par le passé "retourner" l’intention des blancs pour en faire une démonstration de leur force et de leur courage face aux notables, une sorte de catharsis sociale pour exorciser la grande défaite des Incas devant les conquistadores espagnols et la longue oppression qui s’ensuivit.
On dresse quelques barricades de bois, formant une arène, les gradins seront le sol du pourtour, les barricades elles-mêmes et tout ce qui permettra d'observer mieux: une charrette, un tronc, un remblais. Quant aux tribunes, se sont généralement les fenêtres ou balcons de la maison du propriétaire, parfois aussi des contremaîtres représentants de son autorité.
Et on s'y improvise "torero", avec plus d'apparat (et moins de risque) si l’on est plus haut dans la hiérarchie sociale. Et plus on est bas dans l’échelle sociale, plus frustes sont les équipements. Mais tout le monde peut participer (presque) à égalité pour faire preuve de son courage face aux taureaux sauvages.
L'"habit de lumière" des toreros indiens ou métisses est souvent un haillon à trous et la cape magnifique devient un vieux poncho, une veste ou une loque quelconque. Sauf s'il s'agit bien entendu du maître, d'un de ses fils ou du contremaître. Là on fera évidemment plus de frais.
On tentera de mettre le plus possible d'ingrédients rappelant les corridas de la péninsule ibérique: orchestre, public, arène, muletas pourpres et soyeuses (capes tauromachiques), toréadors (ou picadors), aidants servant à distraire le taureau au cas où le torero serait en difficulté ou pour mettre de l'animation, défilé préliminaire du maître des lieux saluant la foule à pied ou sur son plus bel étalon suivi des toreros, ainsi qu'un certain goût pour la "bravoure" et ...le sang!
Mais, rapidement dans le feu de la fête, des libations, des questions, des défis, les Indiens ont voulu renforcer la symbolique de l’affrontement et ont posé la question : "qu'est-ce qui se passerait si l'on opposait un condor au taureau?".
Mais comment pouvoir les faire jouter?
En attachant le condor sacré des Incas sur le dos du taureau symbole de la force et de la puissance espagnole.
Pour cela il faut encore avoir un condor et un taureau sous la main. Pour le second, pas de problème on prend dans le troupeau. Pour le premier la gageure est plus grande, il faut en attraper un sans le tuer ni le blesser.
Pour ce faire, un groupe de wakchas, choisis pour leur réputation d’habileté, d’endurance, de courage, partira dans la montagne avec un vieux cheval ou un âne. Au lieu choisit pour être survolé de temps à autre par des condors, ils égorgeront l'équidé et se cacheront à proximité de la charogne.
Souvent dans un trou creusé tout près couvert par des ponchos, de la terre, voire des branches d'arbuste. Le tout est d'attendre que l'oiseau repère l'appât, puis tourne en cercle très haut pour s'assurer que "tout va bien" avant de descendre et s'attaquer gloutonnement à la carcasse. Une fois tranquillisé, affairé à banqueter, sa panse s'alourdissant des chairs avalées, les "chasseurs" bondissent hors de leurs caches tentant d'attraper le condor par les pattes et l'extrémité des ailes. Essayant aussi de lui couvrir la tête tout en tentant d'esquiver ses coups de becs, puissants et tranchants.
Lorsque l'objectif est atteint l'oiseau est ramené triomphalement, attaché, bec lié et tenu par l'extrémité des ailes, puis gardé "au calme" dans un patio de l'hacienda.
Peu sont ceux qui auront alors droit de voir le prisonnier de marque ou de lui rendre visite avant la fête. Seuls pourront le voir le maître des lieux et les rares privilégiés qu'il aura désignés ainsi que les wackchas qui ont participé à sa capture et ont charge de s'en occuper, de le nourrir, lui donner à boire et le bichonner jusqu'au grand moment de la rencontre avec le taureau.
Place et patios intérieurs seront alors préparés pour la fête. Dans de grandes "chombas" fermenteront des hectolitres de "chicha" sorte de boisson fermentée faite à base de maïs.
On mettra à chauffer les soupes et autres mets relativement pauvres et constitués d'abats et de féculents que le "petit peuple" boira à même les assiettes profondes souvent en métal émaillé.
L'accent étant mis principalement sur la chicha ou "ak'ha", et "l'alcohol" distillé sur place ou plus tard la bière importée plus classique.
On se parera de ses plus beaux atours et si l'on n'en possède pas, on décorera ses vêtements quotidiens de chutes de tissus colorés, de fragments de miroirs et de verroterie..
On danse, on mange, on boit, on chante, on joue de la musique sans cesse, interminablement, sans jamais se lasser, comme un vrai marathon de notes.
Ce n'est que lorsque l'on a déjà bien commencé à manger et surtout à boire que l'on pourra passer au spectacle commençant par les corridas populaires dans une situation de quasi "servage" où les coups de cornes de taureaux en laissent souvent plus d'un encorné, tailladé ou étripé.
D'autant que si certains sont des habitués du bétails, experts dans l’art de maîtriser les bovins, d'autres le sont moins et en outre sont parfois déjà bien éméchés.
Ensuite, l'hacendado, le maître, fait sont tour d'arène avec ses assistants et/ou ses fils, puis il présente avec les wackchas le condor à la foule qui exulte. Oui, il y a bien un condor et on admire la taille de ses ailes, sa prestance.
Enfin il sera amarré à califourchon sur le dos du taureau et maintenu en cette position par des lanières attachées à ses pattes, cousues à même la chair du taureau!
Le taureau une fois lâché, blessé, torturé par les lanières, gêné par l'oiseau qui, ailes grandes ouvertes, tente de conserver l'équilibre, mènera un "rodéo" furieux. Où l'oiseau, bien que solidement arrimé sur l'échine du taureau, lui assène souvent des coups de becs ou s'agrippe du bec à son cuir ensanglanté pour rétablir son équilibre. Le taureau essaie furieusement mais en vain de décrocher le condor pour le tuer avec ses cornes et ses sabots.
Puis lorsqu'ils commenceront à se lasser et se calmer, les toreros amateurs entreront en lisse pour avec leurs capes ou vestes ou ponchos pour relancer le spectacle et agacer le taureau.
Après de nombreuses passes et figures laissées aux appréciations d'un public qui ne se prive guère de les donner, entreront en piste les manieurs de lassos pour attraper le taureau par cou et cornes et le maîtriser de la sorte. C’est donc toujours le condor qui "gagne" (c’est la revanche de l’Inca sur le conquistador), car alors le taureau, immobilisé, est solennellement mis à mort par son propriétaire au moyen de lances et de piques.
Si le condor survit à ce rodéo voire à plusieurs, la "yawar fiesta", la "fête du sang" se conclura par le Karcharpi (ou Kacharpari : le chant de l’adieu), sa remise en liberté en grandes pompes, son lâché vers les hauteurs Andines et le ciel dont il est le maître, non sans avoir attaché à ses plumes, les grandes rémiges caudales, des rubans colorés rappelant sa victoire.
Il a vaincu le puissant taureau, la prodigieuse force tellurique, il est bien "Apu" esprit sacré.
Et si le serpent "Amaru" représente le monde souterrain, si le Puma incarne le monde de surface, lui est bien l'Apu Kuntur, le condor sacré, maître des cieux et intercesseur de l’au-delà. Et il est aussi le représentant du Sapa Inca, l’Inca suprême : la victoire symbolique du Condor sur le taureau incarne vraiment la revanche cachée de l' Inca sur l'Espagnol !
Aujourd'hui, sauf dans les contrées très traditionnalistes, pour des fêtes semi-clandestines où les touristes ne sont pas invités, la mort n'est plus au rendez-vous. Le combat est un spectacle, le taureau n’est plus blessé, le condor n’est plus cousu mais attaché par des lanières passant sous le ventre du taureau, et lorsque le taureau et le condor ont bien fait leur boulot au milieu de l'arène, que les touristes ont fait le plein d'émotion et de photos, ils regagnent l'un sa grande cage (si c’est un condor apprivoisé, ou en zoo) et l'autre son enclos jusqu'à la prochaine représentation. Sacrifier à chaque fois un taureau, à la rigueur on pourrait l'envisager, il suffirait de prolonger les festivités par un barbecue géant, mais le condor devenu rare revient trop cher, là-bas aussi, c'est la crise ! Si c’est un condor sauvage (exceptionnel aujourd’hui car le condor est une espèce protégée), il est relâché au cours de la dite cérémonie du "Kacharpari".
Cette fête de village, rejouant symboliquement des conflits à la fois historiques, culturels et sociaux, dure plusieurs jours et demande une bonne préparation.
Si elle était relativement répandue en région andine elle s'est faite plus rare, mais reprend un peu de vigueur dans une volonté (mitigée) de revalorisation des coutumes et traditions. Elle se perpétue pour la fête nationale péruvienne, soit aux alentours des 28 et 29 juillet dans différents villages comme ceux de Chalhuanca, Cotabamba ou Coyllurki entre autres.
Il semblerait que ce soit d'abord les riches propriétaires terriens d'origine espagnole qui auraient voulu des fêtes taurines recréées "chez eux", sur "leurs terres", des sortes de corridas relativement improvisées dont les protagonistes auraient été "leurs gens", opposés à une troupe de taureaux du domaine.
Une sorte de « panem et circenses » à la romaine organisé par le grand propriétaire terrien local, le notable blanc qui se prend pour une sorte de "Néron" tout puissant.
Les spectateurs sont à la fois dans les tribunes (les propriétaires, leurs hôtes et amis), maîtres des lieux et de la fête, puis le peuple composé essentiellement des travailleurs ou "wakchas" encore appelés "péones" ; en fait ce sont les travailleurs autochtones des haciendas alentour, essentiellement les populations amérindiennes de la région.
"Comme en Espagne" on réalise des corridas, mais ici, avec les moyens du bord. Alors les Indiens ont su par le passé "retourner" l’intention des blancs pour en faire une démonstration de leur force et de leur courage face aux notables, une sorte de catharsis sociale pour exorciser la grande défaite des Incas devant les conquistadores espagnols et la longue oppression qui s’ensuivit.
On dresse quelques barricades de bois, formant une arène, les gradins seront le sol du pourtour, les barricades elles-mêmes et tout ce qui permettra d'observer mieux: une charrette, un tronc, un remblais. Quant aux tribunes, se sont généralement les fenêtres ou balcons de la maison du propriétaire, parfois aussi des contremaîtres représentants de son autorité.
Et on s'y improvise "torero", avec plus d'apparat (et moins de risque) si l’on est plus haut dans la hiérarchie sociale. Et plus on est bas dans l’échelle sociale, plus frustes sont les équipements. Mais tout le monde peut participer (presque) à égalité pour faire preuve de son courage face aux taureaux sauvages.
L'"habit de lumière" des toreros indiens ou métisses est souvent un haillon à trous et la cape magnifique devient un vieux poncho, une veste ou une loque quelconque. Sauf s'il s'agit bien entendu du maître, d'un de ses fils ou du contremaître. Là on fera évidemment plus de frais.
On tentera de mettre le plus possible d'ingrédients rappelant les corridas de la péninsule ibérique: orchestre, public, arène, muletas pourpres et soyeuses (capes tauromachiques), toréadors (ou picadors), aidants servant à distraire le taureau au cas où le torero serait en difficulté ou pour mettre de l'animation, défilé préliminaire du maître des lieux saluant la foule à pied ou sur son plus bel étalon suivi des toreros, ainsi qu'un certain goût pour la "bravoure" et ...le sang!
Mais, rapidement dans le feu de la fête, des libations, des questions, des défis, les Indiens ont voulu renforcer la symbolique de l’affrontement et ont posé la question : "qu'est-ce qui se passerait si l'on opposait un condor au taureau?".
Mais comment pouvoir les faire jouter?
En attachant le condor sacré des Incas sur le dos du taureau symbole de la force et de la puissance espagnole.
Pour cela il faut encore avoir un condor et un taureau sous la main. Pour le second, pas de problème on prend dans le troupeau. Pour le premier la gageure est plus grande, il faut en attraper un sans le tuer ni le blesser.
Pour ce faire, un groupe de wakchas, choisis pour leur réputation d’habileté, d’endurance, de courage, partira dans la montagne avec un vieux cheval ou un âne. Au lieu choisit pour être survolé de temps à autre par des condors, ils égorgeront l'équidé et se cacheront à proximité de la charogne.
Souvent dans un trou creusé tout près couvert par des ponchos, de la terre, voire des branches d'arbuste. Le tout est d'attendre que l'oiseau repère l'appât, puis tourne en cercle très haut pour s'assurer que "tout va bien" avant de descendre et s'attaquer gloutonnement à la carcasse. Une fois tranquillisé, affairé à banqueter, sa panse s'alourdissant des chairs avalées, les "chasseurs" bondissent hors de leurs caches tentant d'attraper le condor par les pattes et l'extrémité des ailes. Essayant aussi de lui couvrir la tête tout en tentant d'esquiver ses coups de becs, puissants et tranchants.
Lorsque l'objectif est atteint l'oiseau est ramené triomphalement, attaché, bec lié et tenu par l'extrémité des ailes, puis gardé "au calme" dans un patio de l'hacienda.
Peu sont ceux qui auront alors droit de voir le prisonnier de marque ou de lui rendre visite avant la fête. Seuls pourront le voir le maître des lieux et les rares privilégiés qu'il aura désignés ainsi que les wackchas qui ont participé à sa capture et ont charge de s'en occuper, de le nourrir, lui donner à boire et le bichonner jusqu'au grand moment de la rencontre avec le taureau.
Place et patios intérieurs seront alors préparés pour la fête. Dans de grandes "chombas" fermenteront des hectolitres de "chicha" sorte de boisson fermentée faite à base de maïs.
On mettra à chauffer les soupes et autres mets relativement pauvres et constitués d'abats et de féculents que le "petit peuple" boira à même les assiettes profondes souvent en métal émaillé.
L'accent étant mis principalement sur la chicha ou "ak'ha", et "l'alcohol" distillé sur place ou plus tard la bière importée plus classique.
On se parera de ses plus beaux atours et si l'on n'en possède pas, on décorera ses vêtements quotidiens de chutes de tissus colorés, de fragments de miroirs et de verroterie..
On danse, on mange, on boit, on chante, on joue de la musique sans cesse, interminablement, sans jamais se lasser, comme un vrai marathon de notes.
Ce n'est que lorsque l'on a déjà bien commencé à manger et surtout à boire que l'on pourra passer au spectacle commençant par les corridas populaires dans une situation de quasi "servage" où les coups de cornes de taureaux en laissent souvent plus d'un encorné, tailladé ou étripé.
D'autant que si certains sont des habitués du bétails, experts dans l’art de maîtriser les bovins, d'autres le sont moins et en outre sont parfois déjà bien éméchés.
Ensuite, l'hacendado, le maître, fait sont tour d'arène avec ses assistants et/ou ses fils, puis il présente avec les wackchas le condor à la foule qui exulte. Oui, il y a bien un condor et on admire la taille de ses ailes, sa prestance.
Enfin il sera amarré à califourchon sur le dos du taureau et maintenu en cette position par des lanières attachées à ses pattes, cousues à même la chair du taureau!
Le taureau une fois lâché, blessé, torturé par les lanières, gêné par l'oiseau qui, ailes grandes ouvertes, tente de conserver l'équilibre, mènera un "rodéo" furieux. Où l'oiseau, bien que solidement arrimé sur l'échine du taureau, lui assène souvent des coups de becs ou s'agrippe du bec à son cuir ensanglanté pour rétablir son équilibre. Le taureau essaie furieusement mais en vain de décrocher le condor pour le tuer avec ses cornes et ses sabots.
Puis lorsqu'ils commenceront à se lasser et se calmer, les toreros amateurs entreront en lisse pour avec leurs capes ou vestes ou ponchos pour relancer le spectacle et agacer le taureau.
Après de nombreuses passes et figures laissées aux appréciations d'un public qui ne se prive guère de les donner, entreront en piste les manieurs de lassos pour attraper le taureau par cou et cornes et le maîtriser de la sorte. C’est donc toujours le condor qui "gagne" (c’est la revanche de l’Inca sur le conquistador), car alors le taureau, immobilisé, est solennellement mis à mort par son propriétaire au moyen de lances et de piques.
Si le condor survit à ce rodéo voire à plusieurs, la "yawar fiesta", la "fête du sang" se conclura par le Karcharpi (ou Kacharpari : le chant de l’adieu), sa remise en liberté en grandes pompes, son lâché vers les hauteurs Andines et le ciel dont il est le maître, non sans avoir attaché à ses plumes, les grandes rémiges caudales, des rubans colorés rappelant sa victoire.
Il a vaincu le puissant taureau, la prodigieuse force tellurique, il est bien "Apu" esprit sacré.
Et si le serpent "Amaru" représente le monde souterrain, si le Puma incarne le monde de surface, lui est bien l'Apu Kuntur, le condor sacré, maître des cieux et intercesseur de l’au-delà. Et il est aussi le représentant du Sapa Inca, l’Inca suprême : la victoire symbolique du Condor sur le taureau incarne vraiment la revanche cachée de l' Inca sur l'Espagnol !
Aujourd'hui, sauf dans les contrées très traditionnalistes, pour des fêtes semi-clandestines où les touristes ne sont pas invités, la mort n'est plus au rendez-vous. Le combat est un spectacle, le taureau n’est plus blessé, le condor n’est plus cousu mais attaché par des lanières passant sous le ventre du taureau, et lorsque le taureau et le condor ont bien fait leur boulot au milieu de l'arène, que les touristes ont fait le plein d'émotion et de photos, ils regagnent l'un sa grande cage (si c’est un condor apprivoisé, ou en zoo) et l'autre son enclos jusqu'à la prochaine représentation. Sacrifier à chaque fois un taureau, à la rigueur on pourrait l'envisager, il suffirait de prolonger les festivités par un barbecue géant, mais le condor devenu rare revient trop cher, là-bas aussi, c'est la crise ! Si c’est un condor sauvage (exceptionnel aujourd’hui car le condor est une espèce protégée), il est relâché au cours de la dite cérémonie du "Kacharpari".
Extrait de Yawar fiesta (La fête du sang, chapitre 4 : K’ayau)
de José María Arguedas
LE CONDOR ET LE TAUREAU
« Midi et soir, les notables qui étaient allés dans les haciendas revenaient au village. Certains rentraient tout droit chez eux ; d’autres savaient qu’à cette heure, ils pouvaient discuter avec le sous-préfet dans la galerie devant l’entrée de son bureau, et ils se dirigeaient vers la place. Une fois dans le petit parc, ils jouaient des rênes et paradaient sur leurs petits chevaux nerveux, pour épater riverains et dignitaires. Ils mettaient pied à terre devant la porte de la caserne et montaient quatre à quatre les marches menant à la sous-préfecture. De plus en plus nombreux, ils se bousculaient autour du sous-préfet.
─ Vous garderez un souvenir impérissable de notre village. Cette corrida sera quelque chose.
─ Je l’espère mes amis. Même si je n’aime pas trop ces sauvageries.
─ Qu’auriez-vous dit alors des corridas d’il y a vingt ans ! On attachait un condor sur l’échine du taureau le plus sauvage pour l’énerver davantage. Becqueté par le condor, le taureau bousculait et faisait tomber les Indiens, fallait voir comme si de rien n’était ! Puis les notables entraient à cheval et à coups de javelot ils tuaient le taureau. Pour clore les festivités, on cousait des rubans multicolores sur les ailes du condor et puis, au milieu des cris et des chants, on le lâchait. Le condor s’envolait avec ses rubans. On aurait dit un cerf-volant noir géant ! Des mois et des mois plus tard, sur les cimes, le condor volait de glacier en glacier encore tout enrubanné.
─ En novembre dernier, monsieur le sous-préfet, près de vingt ans après donc, j’ai repéré un condor avec ces rubans sur le K’arwarasu. C’est comme je vous le dis ! Fallait voir ça.
Les notables formaient un groupe de plus en plus compact. Ils avaient tous leur mot à dire, quelque chose de nouveau à raconter.
─ Vous ne connaissez pas notre grande montagne, monsieur le sous-préfet. Le «Misti», le volcan d’Arequipa, n’est qu’une motte de terre en comparaison de notre glacier K’arwarasu. Il a trois pics enneigé. Et allez savoir comment ! De la neige même naissent des rochers noirs.
─ Oui, monsieur le sous-préfet ! C’est justement sur un de ces rochers noirs qu’était le condor. J’ai tiré un coup de revolver en l’air. Et le pauvre animal s’est envolé. Il a survolé les trois pics glacés avec ses rubans. Je l’ai suivi des yeux jusqu’à ce qu’il disparaisse dans les nuages qui entourent en permanence les cimes du K’arwarasu.
Parfois, le sous-préfet se lassait de les écouter parler des heures durant des corridas, des taureaux féroces, des Indiens…
─ Messieurs, si nous allions faire quelques pas.
Le sous-préfet descendait faire un tour dans le petit parc.
Puis il prenait congé d’eux et se rendait dans les échoppes des demoiselles. Mais elles aussi aimaient parler des corridas et du "Tankayllu"(1). ─ Diable ! disait-il quand il se retrouvait seul. Tout le village me parle tant de ce danseur indien que je commence à avoir envie de le voir.
Mais le juge et le capitaine chef de province, eux aussi originaire de la côte, lui dire en aparté :
─ Ce "Tankayllu"(1) est un Indien aussi pouilleux que les autres, mais ses pirouettes attirent l’attention. Quant à la corrida…
─ C’est une sauvagerie comme vous pouvez l’imaginer. Et on est plus dégoûté qu’amusé de ce que font ces abrutis d’Indiens.
Et tandis que dignitaires et notables discutaient dans la rue Bolívar et sur la place d’Armes, tandis qu’au billard, à la pharmacie, dans les salles à manger et dans les boutiques, on évoquait les «turupukllays»(2) des années précédentes, les «Wakawak’ras»(3) résonnaient dans les quatre quartiers indiens et dans les montagnes [dans les «ayllu»(4) d’altitude]. Certaines nuits, des pétards fusaient depuis K’ayau et Pichk’achuri pour éclater du côté de la rue des "mistis". »
(1)- "Tankayllu" : le taon en kechwa ; mais ici il s’agit du surnom d’un des meilleurs danseur indien du village.
(2)- «turupukllays» : la musique indienne qui accompagne les corridas andines si spéciales. Le mot désigne aussi la corrida elle-même.
(3)- «Wakawak’ras» (ou encore : Wajrapuko) : sorte de cor au son puissant et guerrier, fait de cornes de taureau creusées et emboîtées les unes dans les autres. Il accompagne le « wak’raykuy » ou chant des coups de corne, et le « turupukllay ».
(4)- « ayllu » : communauté villageoise indigène, autonome ou regroupée dans un quartier d’une ville.
(5)- «mistis» : les autochtones appellent ainsi les blancs, colons grands propriétaires et notables de Puquio.
NDLR: Helgé, alias lglaviano
de José María Arguedas
LE CONDOR ET LE TAUREAU
« Midi et soir, les notables qui étaient allés dans les haciendas revenaient au village. Certains rentraient tout droit chez eux ; d’autres savaient qu’à cette heure, ils pouvaient discuter avec le sous-préfet dans la galerie devant l’entrée de son bureau, et ils se dirigeaient vers la place. Une fois dans le petit parc, ils jouaient des rênes et paradaient sur leurs petits chevaux nerveux, pour épater riverains et dignitaires. Ils mettaient pied à terre devant la porte de la caserne et montaient quatre à quatre les marches menant à la sous-préfecture. De plus en plus nombreux, ils se bousculaient autour du sous-préfet.
─ Vous garderez un souvenir impérissable de notre village. Cette corrida sera quelque chose.
─ Je l’espère mes amis. Même si je n’aime pas trop ces sauvageries.
─ Qu’auriez-vous dit alors des corridas d’il y a vingt ans ! On attachait un condor sur l’échine du taureau le plus sauvage pour l’énerver davantage. Becqueté par le condor, le taureau bousculait et faisait tomber les Indiens, fallait voir comme si de rien n’était ! Puis les notables entraient à cheval et à coups de javelot ils tuaient le taureau. Pour clore les festivités, on cousait des rubans multicolores sur les ailes du condor et puis, au milieu des cris et des chants, on le lâchait. Le condor s’envolait avec ses rubans. On aurait dit un cerf-volant noir géant ! Des mois et des mois plus tard, sur les cimes, le condor volait de glacier en glacier encore tout enrubanné.
─ En novembre dernier, monsieur le sous-préfet, près de vingt ans après donc, j’ai repéré un condor avec ces rubans sur le K’arwarasu. C’est comme je vous le dis ! Fallait voir ça.
Les notables formaient un groupe de plus en plus compact. Ils avaient tous leur mot à dire, quelque chose de nouveau à raconter.
─ Vous ne connaissez pas notre grande montagne, monsieur le sous-préfet. Le «Misti», le volcan d’Arequipa, n’est qu’une motte de terre en comparaison de notre glacier K’arwarasu. Il a trois pics enneigé. Et allez savoir comment ! De la neige même naissent des rochers noirs.
─ Oui, monsieur le sous-préfet ! C’est justement sur un de ces rochers noirs qu’était le condor. J’ai tiré un coup de revolver en l’air. Et le pauvre animal s’est envolé. Il a survolé les trois pics glacés avec ses rubans. Je l’ai suivi des yeux jusqu’à ce qu’il disparaisse dans les nuages qui entourent en permanence les cimes du K’arwarasu.
Parfois, le sous-préfet se lassait de les écouter parler des heures durant des corridas, des taureaux féroces, des Indiens…
─ Messieurs, si nous allions faire quelques pas.
Le sous-préfet descendait faire un tour dans le petit parc.
Puis il prenait congé d’eux et se rendait dans les échoppes des demoiselles. Mais elles aussi aimaient parler des corridas et du "Tankayllu"(1). ─ Diable ! disait-il quand il se retrouvait seul. Tout le village me parle tant de ce danseur indien que je commence à avoir envie de le voir.
Mais le juge et le capitaine chef de province, eux aussi originaire de la côte, lui dire en aparté :
─ Ce "Tankayllu"(1) est un Indien aussi pouilleux que les autres, mais ses pirouettes attirent l’attention. Quant à la corrida…
─ C’est une sauvagerie comme vous pouvez l’imaginer. Et on est plus dégoûté qu’amusé de ce que font ces abrutis d’Indiens.
Et tandis que dignitaires et notables discutaient dans la rue Bolívar et sur la place d’Armes, tandis qu’au billard, à la pharmacie, dans les salles à manger et dans les boutiques, on évoquait les «turupukllays»(2) des années précédentes, les «Wakawak’ras»(3) résonnaient dans les quatre quartiers indiens et dans les montagnes [dans les «ayllu»(4) d’altitude]. Certaines nuits, des pétards fusaient depuis K’ayau et Pichk’achuri pour éclater du côté de la rue des "mistis". »
(1)- "Tankayllu" : le taon en kechwa ; mais ici il s’agit du surnom d’un des meilleurs danseur indien du village.
(2)- «turupukllays» : la musique indienne qui accompagne les corridas andines si spéciales. Le mot désigne aussi la corrida elle-même.
(3)- «Wakawak’ras» (ou encore : Wajrapuko) : sorte de cor au son puissant et guerrier, fait de cornes de taureau creusées et emboîtées les unes dans les autres. Il accompagne le « wak’raykuy » ou chant des coups de corne, et le « turupukllay ».
(4)- « ayllu » : communauté villageoise indigène, autonome ou regroupée dans un quartier d’une ville.
(5)- «mistis» : les autochtones appellent ainsi les blancs, colons grands propriétaires et notables de Puquio.
NDLR: Helgé, alias lglaviano
Extrait de Yawar fiesta (La fête du sang, chapitre 2 : le dépouillement, 4/4) SUITE 3 et FIN :
« Mais ça, ce n’était rien encore. De temps à autre, le patron envoyait des commis chercher du bétail à la ferme. Les préposés choisissaient le taureau rouge, le taureau noir, ou le taureau brun. Alors les hommes de la puna et leurs familles faisaient leurs adieux au taureau qui descendait dans la vallée, grossir le troupeau que le patron allait conduire à "l’étranger". Alors oui, ils souffraient. Ni la grêle, ni la mort même ne faisaient souffrir davantage les Indiens des hauts plateaux.
─ Rouge, noir, brun, pour le troupeau ! ordonnaient au petit jour les commis.
Les gamins et les femmes s’agitaient. Les gamins couraient auprès des taureaux étalons qui dormaient encore dans les enclos. De leurs bras, ils caressaient le museau laineux.
─ Mon petit brun ! Où vont-ils t’emmener petit père !
Le brun sortait sa langue râpeuse, humide, et se chatouillait les naseaux ; il gratifiait aussi d’une grande lèche le minois ambré du petit qui lui témoignait cet intérêt, se laissait cajoler sans se fâcher et posait ses grands yeux sur les jeunes garçons. Puis les gamins pleuraient, ils pleuraient doucement, avec leur voix de chardonneret.
─ “Pillkuchallaya ! Pillkucha !” Mon seul petit brun chéri ! Mon petit brun !
Mais les convoyeurs arrivaient, ils claquaient leurs fouets au-dessus des têtes des gamins:
─ Allez, allez, ouste !
Les convoyeurs les repoussaient sans ménagement ; et à grands coups de fouet, ils séparaient du troupeau ceux qu’ils avaient choisis.
Alors venait la grande peine. La famille se regroupait à l’entrée de la hutte pour chanter ses adieux aux taureaux qui partaient.
Le plus vieux jouait de la flûte, la grande "machu kena"(9) de l’Altiplano, ses fils, des "wakawak’ras"(10) et une des femmes, du tambour(11):
“Vacallay vaca, turullay turu,
Vacachallaya, turuchallaya.”
Vache petite vache,
taureau petit taureau,
Vache ma p’tite vache chérie,
taureau mon p’tit taureau chéri.
Les punarunas(2) braillaient, tandis que les convoyeurs rassemblaient à coups de fouet le brun, le rouge… et s’éloignaient de la ferme.
“Vacallay vaca, turullay turu”…
Vache petite vache, taureau petit taureau…
La flûte résonnait avec force dans la puna(2), la corde du tambour ronflait sur le cuir, dans les creux, dans les rochers, sur les lacs de la puna, la voix des "comuneros"(4), de la flûte, du tambour léchait l’«icchu»(12) , montait au ciel, déversait son amertume sur toute la puna, et imprégnait la terre à cœur, du fin fond du plus profond cañon jusqu’à la plus haute cime… Alors les Indiens des autres haciendas se signaient.
Mais c’étaient les gamins qui souffraient le plus. Ils pleuraient comme s’ils allaient mourir et la haine des notables grandissait dans leurs cœurs, comme se renouvelle le sang, comme croissent les os.
Voilà comment les Indiens de la puna furent dépouillés, Indiens de K’ayau, de Chaupi, de K’ollana, de K’oñani et de Pichk’achuri.»
(9)- La « machu kena » ou « ocona » : Grande kena (flûte droite à encoche) des hauts plateaux, de 80 à 90 cms, à la voix profonde et grave, des départements de Puno et Ayacucho au Pérou, qui se joue seule en expression individuelle à la différence des pusipías, lichiwayus, chokelas, autres grandes kenas qui se jouent en troupe, pour une expression communautaire.
(10)- « Wakawak’ras » (ou encore : Wajrapuko) : sorte de cor au son puissant et guerrier, fait de cornes de taureau creusées et emboîtées les unes dans les autres. Il accompagne le « wak’raykuy » ou chant des coups de corne, et le « turupukllay » la musique qui accompagne les corridas.
(11)- Un petit tambour au son clair et sec, ou grésillant s’il est agrémenté d’une corde ou d’une lanière qui contre vibre avec la peau. Peut-être une «caja» ou une «tinya», petit tambour de culture chancay (conquise par les Incas).
(12)- «icchu» : petite graminée dure et jaunâtre des maigres pâturages de l’Altiplano andin. En Ariège, Pyrénées, on l’appelle le «chispet’».
[NDLR: Helgé, alias lglaviano]
« Mais ça, ce n’était rien encore. De temps à autre, le patron envoyait des commis chercher du bétail à la ferme. Les préposés choisissaient le taureau rouge, le taureau noir, ou le taureau brun. Alors les hommes de la puna et leurs familles faisaient leurs adieux au taureau qui descendait dans la vallée, grossir le troupeau que le patron allait conduire à "l’étranger". Alors oui, ils souffraient. Ni la grêle, ni la mort même ne faisaient souffrir davantage les Indiens des hauts plateaux.
─ Rouge, noir, brun, pour le troupeau ! ordonnaient au petit jour les commis.
Les gamins et les femmes s’agitaient. Les gamins couraient auprès des taureaux étalons qui dormaient encore dans les enclos. De leurs bras, ils caressaient le museau laineux.
─ Mon petit brun ! Où vont-ils t’emmener petit père !
Le brun sortait sa langue râpeuse, humide, et se chatouillait les naseaux ; il gratifiait aussi d’une grande lèche le minois ambré du petit qui lui témoignait cet intérêt, se laissait cajoler sans se fâcher et posait ses grands yeux sur les jeunes garçons. Puis les gamins pleuraient, ils pleuraient doucement, avec leur voix de chardonneret.
─ “Pillkuchallaya ! Pillkucha !” Mon seul petit brun chéri ! Mon petit brun !
Mais les convoyeurs arrivaient, ils claquaient leurs fouets au-dessus des têtes des gamins:
─ Allez, allez, ouste !
Les convoyeurs les repoussaient sans ménagement ; et à grands coups de fouet, ils séparaient du troupeau ceux qu’ils avaient choisis.
Alors venait la grande peine. La famille se regroupait à l’entrée de la hutte pour chanter ses adieux aux taureaux qui partaient.
Le plus vieux jouait de la flûte, la grande "machu kena"(9) de l’Altiplano, ses fils, des "wakawak’ras"(10) et une des femmes, du tambour(11):
“Vacallay vaca, turullay turu,
Vacachallaya, turuchallaya.”
Vache petite vache,
taureau petit taureau,
Vache ma p’tite vache chérie,
taureau mon p’tit taureau chéri.
Les punarunas(2) braillaient, tandis que les convoyeurs rassemblaient à coups de fouet le brun, le rouge… et s’éloignaient de la ferme.
“Vacallay vaca, turullay turu”…
Vache petite vache, taureau petit taureau…
La flûte résonnait avec force dans la puna(2), la corde du tambour ronflait sur le cuir, dans les creux, dans les rochers, sur les lacs de la puna, la voix des "comuneros"(4), de la flûte, du tambour léchait l’«icchu»(12) , montait au ciel, déversait son amertume sur toute la puna, et imprégnait la terre à cœur, du fin fond du plus profond cañon jusqu’à la plus haute cime… Alors les Indiens des autres haciendas se signaient.
Mais c’étaient les gamins qui souffraient le plus. Ils pleuraient comme s’ils allaient mourir et la haine des notables grandissait dans leurs cœurs, comme se renouvelle le sang, comme croissent les os.
Voilà comment les Indiens de la puna furent dépouillés, Indiens de K’ayau, de Chaupi, de K’ollana, de K’oñani et de Pichk’achuri.»
(9)- La « machu kena » ou « ocona » : Grande kena (flûte droite à encoche) des hauts plateaux, de 80 à 90 cms, à la voix profonde et grave, des départements de Puno et Ayacucho au Pérou, qui se joue seule en expression individuelle à la différence des pusipías, lichiwayus, chokelas, autres grandes kenas qui se jouent en troupe, pour une expression communautaire.
(10)- « Wakawak’ras » (ou encore : Wajrapuko) : sorte de cor au son puissant et guerrier, fait de cornes de taureau creusées et emboîtées les unes dans les autres. Il accompagne le « wak’raykuy » ou chant des coups de corne, et le « turupukllay » la musique qui accompagne les corridas.
(11)- Un petit tambour au son clair et sec, ou grésillant s’il est agrémenté d’une corde ou d’une lanière qui contre vibre avec la peau. Peut-être une «caja» ou une «tinya», petit tambour de culture chancay (conquise par les Incas).
(12)- «icchu» : petite graminée dure et jaunâtre des maigres pâturages de l’Altiplano andin. En Ariège, Pyrénées, on l’appelle le «chispet’».
[NDLR: Helgé, alias lglaviano]
[Quand la Kena porte la colère et la peine de l’Indien…
Extrait de Yawar fiesta (La fête du sang, chapitre 2 : le dépouillement, 1/4) de José María Arguedas] DÉBUT:
[À la recherche de pâturages pour leurs troupeaux, du fait d’un accroissement de la demande à l’exportation, les mistis(1) ou blancs de Puquio(1) sont venus progressivement exproprier tous les punarunas(2), Indiens des hauts-plateaux andins, avec la complicité du gouvernement et des autorités locales, et faire main basse sur leurs terres].
« Voilà comment les bergers des pâturages de Chaupi et de K’ollana disparurent peu à peu. Les Indiens qui n’avaient plus ni bêtes, ni huttes, ni grottes, descendirent au village. Ils arrivèrent dans leur ayllu(3) comme des étrangers, traînant derrière eux leurs casseroles, leurs peaux et leurs jeunes enfants. Avant, ils étaient des punarunas(2), de vrais bergers des hauteurs ; ils descendaient au village uniquement pour les grandes fêtes. Alors ils arrivaient dans l’ayllu avec des vêtements neufs, des visages gais, et beaucoup d’argent pour la boisson, pour les gâteaux, pour acheter des outils ou des étoffes de couleur rue Bolívar. Ils entraient fièrement dans leur ayllu et on les fêtait. Mais aujourd’hui, une fois appauvris, pourchassés par les mistis, ils arrivaient amaigris, bleus de froid et affamés. Ils disaient à ceux qu’ils rencontraient:
─ Nous voici, petit père ! Nous voici donc, petit frère !
Le varayok’, le maire de l’ayllu, les recevait chez lui.
Après on les appelait au travail, et avec les comuneros(4) de l’ayllu ils bâtissaient ensemble en sept ou huit jours une maison neuve pour l’homme de la puna(2). […] De punarunas, ils devenaient comuneros des villages. Et une fois à Puquio, dans l’ayllu, ils haïssaient encore plus le notable qui les avait dépouillés de leurs terres. Dans l’ayllu, il y avait des milliers et des milliers de comuneros, tous unis, tous égaux. Là-bas, ni Don Santos, ni Don Fermín, ni Don Pedro ne pouvait les abuser. Le punaruna qui avait pleuré sur l’herbe jaune de la puna, le punaruna qui avait subi les fers, qui avait cogné sa tête contre le mur de la prison, cet « Andin » qui était arrivé le regard apeuré, maintenant qu’il était devenu comunero de Chaupi, de K’ollana ou de K’ayau, il avait le courage de regarder en face, rageusement, les notables qui entraient dans les ayllus pour demander des services. »
1- misti : les autochtones appellent ainsi les blancs, colons grands propriétaires et notables de Puquio (du kechwa pukyu, qui signifie «source»), petite ville des cordillères sud du Pérou, 3214 m, ≈15 000 habitants, capitale de la province de Lucanas, département d’Ayacucho.
2- punaruna : homme de l’altitude, indien des hauts plateaux. La puna désigne les hauteurs de la montagne, l’altiplano andin comme l’estive ou l’alpage en Pyrénées et Alpes. Runa signifie « être humain », comme "inuit", et on le retrouve dans le nom inca de la langue kechwa (ou quechua), le Runa simi (« langue des hommes » ou « langage du monde »).
3- ayllu : communauté villageoise indigène, autonome ou regroupée dans un quartier d’une ville.
4- comunero : Indien vivant dans une communauté indigène, membre d’un ayllu ; c’est le terme hispanique. En kechwa on dira : cumunkuna. C’est un américanisme du castillan qu’on peut traduire par « villageois » ou « paysan » (notion d’enracinement de l’Indien dans un terroir) ou « communards » (notion de militantisme pour un mode de vie et de structuration sociale héritées des traditions ancestrales amérindiennes). De même, dans les Andes « campesino » (paysan en français) signifie Indien plutôt qu’agriculteur, même si (ou parce que) les deux sont liés le plus souvent.
Extrait de Yawar fiesta (La fête du sang, chapitre 2 : le dépouillement, 1/4) de José María Arguedas] DÉBUT:
[À la recherche de pâturages pour leurs troupeaux, du fait d’un accroissement de la demande à l’exportation, les mistis(1) ou blancs de Puquio(1) sont venus progressivement exproprier tous les punarunas(2), Indiens des hauts-plateaux andins, avec la complicité du gouvernement et des autorités locales, et faire main basse sur leurs terres].
« Voilà comment les bergers des pâturages de Chaupi et de K’ollana disparurent peu à peu. Les Indiens qui n’avaient plus ni bêtes, ni huttes, ni grottes, descendirent au village. Ils arrivèrent dans leur ayllu(3) comme des étrangers, traînant derrière eux leurs casseroles, leurs peaux et leurs jeunes enfants. Avant, ils étaient des punarunas(2), de vrais bergers des hauteurs ; ils descendaient au village uniquement pour les grandes fêtes. Alors ils arrivaient dans l’ayllu avec des vêtements neufs, des visages gais, et beaucoup d’argent pour la boisson, pour les gâteaux, pour acheter des outils ou des étoffes de couleur rue Bolívar. Ils entraient fièrement dans leur ayllu et on les fêtait. Mais aujourd’hui, une fois appauvris, pourchassés par les mistis, ils arrivaient amaigris, bleus de froid et affamés. Ils disaient à ceux qu’ils rencontraient:
─ Nous voici, petit père ! Nous voici donc, petit frère !
Le varayok’, le maire de l’ayllu, les recevait chez lui.
Après on les appelait au travail, et avec les comuneros(4) de l’ayllu ils bâtissaient ensemble en sept ou huit jours une maison neuve pour l’homme de la puna(2). […] De punarunas, ils devenaient comuneros des villages. Et une fois à Puquio, dans l’ayllu, ils haïssaient encore plus le notable qui les avait dépouillés de leurs terres. Dans l’ayllu, il y avait des milliers et des milliers de comuneros, tous unis, tous égaux. Là-bas, ni Don Santos, ni Don Fermín, ni Don Pedro ne pouvait les abuser. Le punaruna qui avait pleuré sur l’herbe jaune de la puna, le punaruna qui avait subi les fers, qui avait cogné sa tête contre le mur de la prison, cet « Andin » qui était arrivé le regard apeuré, maintenant qu’il était devenu comunero de Chaupi, de K’ollana ou de K’ayau, il avait le courage de regarder en face, rageusement, les notables qui entraient dans les ayllus pour demander des services. »
1- misti : les autochtones appellent ainsi les blancs, colons grands propriétaires et notables de Puquio (du kechwa pukyu, qui signifie «source»), petite ville des cordillères sud du Pérou, 3214 m, ≈15 000 habitants, capitale de la province de Lucanas, département d’Ayacucho.
2- punaruna : homme de l’altitude, indien des hauts plateaux. La puna désigne les hauteurs de la montagne, l’altiplano andin comme l’estive ou l’alpage en Pyrénées et Alpes. Runa signifie « être humain », comme "inuit", et on le retrouve dans le nom inca de la langue kechwa (ou quechua), le Runa simi (« langue des hommes » ou « langage du monde »).
3- ayllu : communauté villageoise indigène, autonome ou regroupée dans un quartier d’une ville.
4- comunero : Indien vivant dans une communauté indigène, membre d’un ayllu ; c’est le terme hispanique. En kechwa on dira : cumunkuna. C’est un américanisme du castillan qu’on peut traduire par « villageois » ou « paysan » (notion d’enracinement de l’Indien dans un terroir) ou « communards » (notion de militantisme pour un mode de vie et de structuration sociale héritées des traditions ancestrales amérindiennes). De même, dans les Andes « campesino » (paysan en français) signifie Indien plutôt qu’agriculteur, même si (ou parce que) les deux sont liés le plus souvent.
Extrait de Yawar fiesta (La fête du sang, chapitre 2 : le dépouillement, 3/4) SUITE 2 :
« D’autres, pour rester sur leur terroir avec leurs bêtes, vendaient leur troupeau aux nouveaux propriétaires des pâturages. Ils recevaient dix, quinze sols pour chaque vache ; trente ou quarante centimes pour chaque brebis. Ils enterraient l’argent au pied d’une grande pierre magique, une wak’a(7), ou sur le sommet des montagnes. Ruinés, sans une seule petite brebis pour les consoler, ils devenaient les vachers du patron.
Ils se déclaraient orphelins auprès du notable qui avait pris possession du pâturage et ils pleuraient lorsque le maître venait visiter ses terres :
─ Nous voici petit papa, petit père !
Comme des chiens malades, ils se traînaient à l’entrée de la hutte.
─ Petit père ! Petit patron ! Ils se tordaient les mains et ils tournaient autour du patron ; ils gémissaient. Ils montraient le troupeau de brebis, de vaches et de chevaux bâtards et ils disaient :
─ Voilà tes petites brebis, voilà tes vaches. Tout, tout est là, taïta(8).
Au crépuscule, quand le patron s’éloignait de la ferme suivi de ses contremaîtres, les punarunas les regardaient s’en aller, tous ensemble, groupés à l’entrée de la hutte. Le soleil tombait sur leurs visages, le soleil jaune. Et les punarunas tremblaient toujours et, comme dans une blessure, leur sang brûlait dans leurs cœurs.
─ Oui ! Maître ! Oui ! Patron ! disaient-ils, quand le chapeau blanc de l’éleveur disparaissait au fil de la colline ou derrière les champs de quinoa.»
7- wak’a : lieu ou objet sacré, sorte de totem ou de fétiche naturel considéré dans une perspective animiste.
8- taïta : père ; titre à la fois respectueux et affectif, équivaut plus ou moins à « monsieur », ou à « seigneur » : Taïta Inti=Père Soleil.
« D’autres, pour rester sur leur terroir avec leurs bêtes, vendaient leur troupeau aux nouveaux propriétaires des pâturages. Ils recevaient dix, quinze sols pour chaque vache ; trente ou quarante centimes pour chaque brebis. Ils enterraient l’argent au pied d’une grande pierre magique, une wak’a(7), ou sur le sommet des montagnes. Ruinés, sans une seule petite brebis pour les consoler, ils devenaient les vachers du patron.
Ils se déclaraient orphelins auprès du notable qui avait pris possession du pâturage et ils pleuraient lorsque le maître venait visiter ses terres :
─ Nous voici petit papa, petit père !
Comme des chiens malades, ils se traînaient à l’entrée de la hutte.
─ Petit père ! Petit patron ! Ils se tordaient les mains et ils tournaient autour du patron ; ils gémissaient. Ils montraient le troupeau de brebis, de vaches et de chevaux bâtards et ils disaient :
─ Voilà tes petites brebis, voilà tes vaches. Tout, tout est là, taïta(8).
Au crépuscule, quand le patron s’éloignait de la ferme suivi de ses contremaîtres, les punarunas les regardaient s’en aller, tous ensemble, groupés à l’entrée de la hutte. Le soleil tombait sur leurs visages, le soleil jaune. Et les punarunas tremblaient toujours et, comme dans une blessure, leur sang brûlait dans leurs cœurs.
─ Oui ! Maître ! Oui ! Patron ! disaient-ils, quand le chapeau blanc de l’éleveur disparaissait au fil de la colline ou derrière les champs de quinoa.»
7- wak’a : lieu ou objet sacré, sorte de totem ou de fétiche naturel considéré dans une perspective animiste.
8- taïta : père ; titre à la fois respectueux et affectif, équivaut plus ou moins à « monsieur », ou à « seigneur » : Taïta Inti=Père Soleil.
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de José María Arguedas (8)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les classiques de la littérature sud-américaine
Quel est l'écrivain colombien associé au "réalisme magique"
Gabriel Garcia Marquez
Luis Sepulveda
Alvaro Mutis
Santiago Gamboa
10 questions
371 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature sud-américaine
, latino-américain
, amérique du sudCréer un quiz sur ce livre371 lecteurs ont répondu