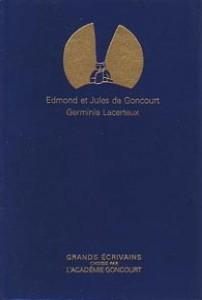Théodore de Banville/5
5 notes
Résumé :
S'opposant vigoureusement à la nouvelle poésie réaliste, Théodore de Banville (1823-1891) professe un amour exclusif de la beauté : Les Cariatides (1842) ainsi que Les Stalactites (1846) sont l'expression de cet art.
Source : http://www.universalis.fr/encyclopedie/theodore-de-banville/
Source : http://www.universalis.fr/encyclopedie/theodore-de-banville/
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les CariatidesVoir plus
Citations et extraits (23)
Voir plus
Ajouter une citation
À ma Mère
Mère, si peu qu'il soit, l'audacieux rêveur
Qui poursuit sa chimère,
Toute sa poésie, ô céleste faveur !
Appartient à sa mère.
L'artiste, le héros amoureux des dangers
Et des luttes fécondes,
Et ceux qui, se fiant aux navires légers,
S'en vont chercher des mondes,
L'apôtre qui parfois peut comme un séraphin
Épeler dans la nue,
Le savant qui dévoile Isis, et peut enfin
L'entrevoir demi-nue,
Tous ces hommes sacrés, élus mystérieux
Que l'univers écoute,
Ont eu dans le passé d'héroïques aïeux
Qui leur tracent la route.
Mais nous qui pour donner l'impérissable amour
Aux âmes étouffées,
Devons être ingénus comme à leur premier jour
Les antiques Orphées,
Nous qui, sans nous lasser, dans nos cœurs même ouvrant
Comme une source vive,
Devons désaltérer le faible et l'ignorant
Pleins d'une foi naïve,
Nous qui devons garder sur nos fronts éclatants,
Comme de frais dictames,
Le sourire immortel et fleuri du printemps
Et la douceur des femmes,
N'est-ce pas, n'est-ce pas, dis-le, toi qui me vois
Rire aux peines amères,
Que le souffle attendri qui passe dans nos voix
Est celui de nos mères ?
Petits, leurs mains calmaient nos plus vives douleurs,
Patientes et sûres :
Elles nous ont donné des mains comme les leurs
Pour toucher aux blessures.
Notre mère enchantait notre calme sommeil,
Et comme elle, sans trêve,
Quand la foule s'endort dans un espoir vermeil,
Nous enchantons son rêve.
Notre mère berçait d'un refrain triomphant
Notre âme alors si belle,
Et nous, c'est pour bercer l'homme toujours enfant
Que nous chantons comme elle.
Tout poète, ébloui par le but solennel
Pour lequel il conspire,
Est brûlé d'un amour céleste et maternel
Pour tout ce qui respire.
Et ce martyr, qui porte une blessure au flanc
Et qui n'a pas de haines,
Doit cette extase immense à celle dont le sang
Ruisselle dans ses veines.
Ô toi dont les baisers, sublime et pur lien !
À défaut de génie
M'ont donné le désir ineffable du bien,
Ma mère, sois bénie.
Et, puisque celle enfin qui l'a reçu des cieux
Et qui n'est jamais lasse,
Sait encore se faire un joyau précieux
D'un pauvre enfant sans grâce.
Va, tu peux te parer de l'objet de tes soins
Au gré de ton envie,
Car ce peu que je vaux est bien à toi du moins,
Ô moitié de ma vie !
Mère, si peu qu'il soit, l'audacieux rêveur
Qui poursuit sa chimère,
Toute sa poésie, ô céleste faveur !
Appartient à sa mère.
L'artiste, le héros amoureux des dangers
Et des luttes fécondes,
Et ceux qui, se fiant aux navires légers,
S'en vont chercher des mondes,
L'apôtre qui parfois peut comme un séraphin
Épeler dans la nue,
Le savant qui dévoile Isis, et peut enfin
L'entrevoir demi-nue,
Tous ces hommes sacrés, élus mystérieux
Que l'univers écoute,
Ont eu dans le passé d'héroïques aïeux
Qui leur tracent la route.
Mais nous qui pour donner l'impérissable amour
Aux âmes étouffées,
Devons être ingénus comme à leur premier jour
Les antiques Orphées,
Nous qui, sans nous lasser, dans nos cœurs même ouvrant
Comme une source vive,
Devons désaltérer le faible et l'ignorant
Pleins d'une foi naïve,
Nous qui devons garder sur nos fronts éclatants,
Comme de frais dictames,
Le sourire immortel et fleuri du printemps
Et la douceur des femmes,
N'est-ce pas, n'est-ce pas, dis-le, toi qui me vois
Rire aux peines amères,
Que le souffle attendri qui passe dans nos voix
Est celui de nos mères ?
Petits, leurs mains calmaient nos plus vives douleurs,
Patientes et sûres :
Elles nous ont donné des mains comme les leurs
Pour toucher aux blessures.
Notre mère enchantait notre calme sommeil,
Et comme elle, sans trêve,
Quand la foule s'endort dans un espoir vermeil,
Nous enchantons son rêve.
Notre mère berçait d'un refrain triomphant
Notre âme alors si belle,
Et nous, c'est pour bercer l'homme toujours enfant
Que nous chantons comme elle.
Tout poète, ébloui par le but solennel
Pour lequel il conspire,
Est brûlé d'un amour céleste et maternel
Pour tout ce qui respire.
Et ce martyr, qui porte une blessure au flanc
Et qui n'a pas de haines,
Doit cette extase immense à celle dont le sang
Ruisselle dans ses veines.
Ô toi dont les baisers, sublime et pur lien !
À défaut de génie
M'ont donné le désir ineffable du bien,
Ma mère, sois bénie.
Et, puisque celle enfin qui l'a reçu des cieux
Et qui n'est jamais lasse,
Sait encore se faire un joyau précieux
D'un pauvre enfant sans grâce.
Va, tu peux te parer de l'objet de tes soins
Au gré de ton envie,
Car ce peu que je vaux est bien à toi du moins,
Ô moitié de ma vie !
La Nature nous dit : Poètes,
À vous mes ruisseaux et mes prés,
À vous mon ciel bleu sur vos têtes,
À vous mes jardins diaprés !
À vous mes suaves murmures
Et mes riches illusions,
Mes épis, mes vendanges mûres
Et mes couronnes de rayons !
L’Art nous dit : À vous mes richesses,
Mes symboles, mes libertés,
Mes bijoux faits pour les duchesses,
Mes cratères aux flancs sculptés !
À vous mes étoffes de soie,
À vous mon luxe armorial
Et ma lumière qui flamboie
Comme un palais impérial !
À vous mes splendides trophées,
Mes Ovides, mes Camoëns,
Mes Glucks, mes Mozarts, mes Orphées,
Mes Cimarosas, mes Rubens !
Eh bien ! oui, l’Art et la Nature
Ont dit vrai tous les deux. À nous
La source murmurante et pure
Qui me voit baiser tes genoux !
À nous les étoffes soyeuses,
À nous tout l’azur du blason,
À nous les coupes glorieuses
Où l’on sent mourir la raison ;
À nous les horizons sans voiles,
À nous l’éclat bruyant du jour,
À nous les nuits pleines d’étoiles,
À nous les nuits pleines d’amour !
À nous le zéphyr dans la plaine,
À nous la brise sur les monts
Et tout ce dont la vie est pleine,
Et les cieux, puisque nous aimons !
À vous mes ruisseaux et mes prés,
À vous mon ciel bleu sur vos têtes,
À vous mes jardins diaprés !
À vous mes suaves murmures
Et mes riches illusions,
Mes épis, mes vendanges mûres
Et mes couronnes de rayons !
L’Art nous dit : À vous mes richesses,
Mes symboles, mes libertés,
Mes bijoux faits pour les duchesses,
Mes cratères aux flancs sculptés !
À vous mes étoffes de soie,
À vous mon luxe armorial
Et ma lumière qui flamboie
Comme un palais impérial !
À vous mes splendides trophées,
Mes Ovides, mes Camoëns,
Mes Glucks, mes Mozarts, mes Orphées,
Mes Cimarosas, mes Rubens !
Eh bien ! oui, l’Art et la Nature
Ont dit vrai tous les deux. À nous
La source murmurante et pure
Qui me voit baiser tes genoux !
À nous les étoffes soyeuses,
À nous tout l’azur du blason,
À nous les coupes glorieuses
Où l’on sent mourir la raison ;
À nous les horizons sans voiles,
À nous l’éclat bruyant du jour,
À nous les nuits pleines d’étoiles,
À nous les nuits pleines d’amour !
À nous le zéphyr dans la plaine,
À nous la brise sur les monts
Et tout ce dont la vie est pleine,
Et les cieux, puisque nous aimons !
Dernière angoisse.
Au moment de jeter dans le flot noir des villes
Ces choses de mon cœur, gracieuses ou viles,
Que boira le gouffre sans fond,
Ce gouffre aux mille voix où s’en vont toutes choses,
Et qui couvre d’oubli les tombes et les roses,
Je me sens un trouble profond.
Dans ces rhythmes polis où mon destin m’attache
Je devrais servir mieux la Muse au front sans tache ;
Au lieu de passer en riant,
Sur ces temples sculptés dont l’éclat tourbillonne
Je devrais faire luire un flambeau qui rayonne
Comme une étoile à l’Orient ;
Rebâtir avec soin les histoires anciennes,
À chaque monument redemander les siennes,
Dont le souvenir a péri ;
Chanter les dieux du Nord dont la splendeur étonne,
À côté de Vénus et du fils de Latone
Peindre la Fée et la Péri ;
Ranimer toute chose avec une syllabe,
L’ogive et ses vitraux de feu, le trèfle arabe,
Le cirque, l’église et la tour,
Le château fort tout plein de rumeurs inouïes,
Et le palais des rois, demeures éblouies
Dont chacune règne à son tour ;
Les murs Tyrrhéniens aux majestés hautaines,
Les granits de Memphis et les marbres d’Athènes
Qu’un regard du soleil ambra,
Et des temps révolus éveillant le fantôme,
Faire briller auprès d’un temple polychrome
Le Colisée et l’Alhambra !
J’aurais dû ranimer ces effroyables guerres
Dont les peuples mourants s’épouvantaient naguères,
Meurtris sous un rude talon,
Dire Attila suivi de sa farouche horde,
Charlemagne et César, et celui dont l’exorde
Fut le grand siège de Toulon !
Puis, après tous ces noms, sur la page choisie
Écrire d’autres noms d’art et de poésie,
Dont le bataillon espacé
Par des poèmes d’or, dont la splendeur enchaîne
L’époque antérieure à l’époque prochaine,
Illumine tout le passé !
Dans ce grand Panthéon, des dalles jusqu’aux cintres
Graver des noms sacrés de chanteurs et de peintres,
D’artistes rêvés ardemment ;
À chacun, soit qu’il cherche un poème sous l’arbre,
Ou qu’il jette son cœur dans la note ou le marbre,
Faire une place au monument !
Dire Moïse, Homère à la voix débordante
Qui contenait en lui Tasse, Virgile et Dante ;
Dire Gluck, penché vers l’Éden,
Mozart, Gœthe, Byron, Phidias et Shakspere,
Molière, devant qui toute louange expire,
Et Raphaël et Beethoven !
Montrer comment Rubens, Rembrandt et Michel-Ange
Mélangeaient la couleur et pétrissaient la fange
Pour en faire un Jésus en croix ;
Et comment, quand mourait notre Art paralytique
Apparurent, guidés par l’instinct prophétique,
Le grand Ingres et Delacroix !
Comment la Statuaire et la Musique aux voiles
Transparents, ont porté nos cœurs jusqu’aux étoiles ;
Nommer David, sculptant ses Dieux,
Rossini, gaieté, joie, ivresse, amour, extase,
Et Meyerbeer, titan ravi sur un Caucase
Dans l’ouragan mélodieux !
Mais surtout dire à tous que tu grandis encore,
Ô notre chêne ancien que le vieux gui décore,
Arbre qui te déchevelais
Sur le front des aïeux et jusqu’à leur épaule,
Car Gautier et Balzac sont encore la Gaule
De Villon et de Rabelais !
Montrer l’Antiquité largement compensée,
Et comparant de loin ces œuvres de pensée
Qu’un sublime destin lia,
Répéter après eux, dans leur langage énorme,
Ce que disent les vers de Marion Delorme
Aux chapitres de Lélia !
Pas à pas dans son vers suivre chaque poème,
Chaque création arrachée au ciel même,
Et surtout le vers de Musset,
Fantasio divin, qui, soit qu’il se promène
Dans les rêves du ciel ou la souffrance humaine,
Devient un vers que chacun sait !
Enfin, pour un moment traînant mes Muses blanches
Sur les hideux tréteaux et les sublimes planches,
Aller demander au public
Les noms de ceux qui font sa douleur ou son rire,
Puis, avant tous ces noms, sur le feuillet inscrire
George, Dorval et Frédérick !
Ainsi, des temps passés relevant l’hyperbole,
Et, comme un pèlerin, apportant mon obole
À tout ce qui luit fort et beau,
J’aurais voulu bâtir sur l’arène mouvante
Un monument hardi pour la gloire vivante,
Pour la gloire ancienne un tombeau !
Hélas ! ma folle Muse est une enfant bohème
Qui se consolera d’avoir fait un poème
Dont le dessin va de travers,
Pourvu qu’un beau collier pare sa gorge nue,
Et que, charmante et rose, une fille ingénue
Rie ou pleure en lisant ses vers.
Au moment de jeter dans le flot noir des villes
Ces choses de mon cœur, gracieuses ou viles,
Que boira le gouffre sans fond,
Ce gouffre aux mille voix où s’en vont toutes choses,
Et qui couvre d’oubli les tombes et les roses,
Je me sens un trouble profond.
Dans ces rhythmes polis où mon destin m’attache
Je devrais servir mieux la Muse au front sans tache ;
Au lieu de passer en riant,
Sur ces temples sculptés dont l’éclat tourbillonne
Je devrais faire luire un flambeau qui rayonne
Comme une étoile à l’Orient ;
Rebâtir avec soin les histoires anciennes,
À chaque monument redemander les siennes,
Dont le souvenir a péri ;
Chanter les dieux du Nord dont la splendeur étonne,
À côté de Vénus et du fils de Latone
Peindre la Fée et la Péri ;
Ranimer toute chose avec une syllabe,
L’ogive et ses vitraux de feu, le trèfle arabe,
Le cirque, l’église et la tour,
Le château fort tout plein de rumeurs inouïes,
Et le palais des rois, demeures éblouies
Dont chacune règne à son tour ;
Les murs Tyrrhéniens aux majestés hautaines,
Les granits de Memphis et les marbres d’Athènes
Qu’un regard du soleil ambra,
Et des temps révolus éveillant le fantôme,
Faire briller auprès d’un temple polychrome
Le Colisée et l’Alhambra !
J’aurais dû ranimer ces effroyables guerres
Dont les peuples mourants s’épouvantaient naguères,
Meurtris sous un rude talon,
Dire Attila suivi de sa farouche horde,
Charlemagne et César, et celui dont l’exorde
Fut le grand siège de Toulon !
Puis, après tous ces noms, sur la page choisie
Écrire d’autres noms d’art et de poésie,
Dont le bataillon espacé
Par des poèmes d’or, dont la splendeur enchaîne
L’époque antérieure à l’époque prochaine,
Illumine tout le passé !
Dans ce grand Panthéon, des dalles jusqu’aux cintres
Graver des noms sacrés de chanteurs et de peintres,
D’artistes rêvés ardemment ;
À chacun, soit qu’il cherche un poème sous l’arbre,
Ou qu’il jette son cœur dans la note ou le marbre,
Faire une place au monument !
Dire Moïse, Homère à la voix débordante
Qui contenait en lui Tasse, Virgile et Dante ;
Dire Gluck, penché vers l’Éden,
Mozart, Gœthe, Byron, Phidias et Shakspere,
Molière, devant qui toute louange expire,
Et Raphaël et Beethoven !
Montrer comment Rubens, Rembrandt et Michel-Ange
Mélangeaient la couleur et pétrissaient la fange
Pour en faire un Jésus en croix ;
Et comment, quand mourait notre Art paralytique
Apparurent, guidés par l’instinct prophétique,
Le grand Ingres et Delacroix !
Comment la Statuaire et la Musique aux voiles
Transparents, ont porté nos cœurs jusqu’aux étoiles ;
Nommer David, sculptant ses Dieux,
Rossini, gaieté, joie, ivresse, amour, extase,
Et Meyerbeer, titan ravi sur un Caucase
Dans l’ouragan mélodieux !
Mais surtout dire à tous que tu grandis encore,
Ô notre chêne ancien que le vieux gui décore,
Arbre qui te déchevelais
Sur le front des aïeux et jusqu’à leur épaule,
Car Gautier et Balzac sont encore la Gaule
De Villon et de Rabelais !
Montrer l’Antiquité largement compensée,
Et comparant de loin ces œuvres de pensée
Qu’un sublime destin lia,
Répéter après eux, dans leur langage énorme,
Ce que disent les vers de Marion Delorme
Aux chapitres de Lélia !
Pas à pas dans son vers suivre chaque poème,
Chaque création arrachée au ciel même,
Et surtout le vers de Musset,
Fantasio divin, qui, soit qu’il se promène
Dans les rêves du ciel ou la souffrance humaine,
Devient un vers que chacun sait !
Enfin, pour un moment traînant mes Muses blanches
Sur les hideux tréteaux et les sublimes planches,
Aller demander au public
Les noms de ceux qui font sa douleur ou son rire,
Puis, avant tous ces noms, sur le feuillet inscrire
George, Dorval et Frédérick !
Ainsi, des temps passés relevant l’hyperbole,
Et, comme un pèlerin, apportant mon obole
À tout ce qui luit fort et beau,
J’aurais voulu bâtir sur l’arène mouvante
Un monument hardi pour la gloire vivante,
Pour la gloire ancienne un tombeau !
Hélas ! ma folle Muse est une enfant bohème
Qui se consolera d’avoir fait un poème
Dont le dessin va de travers,
Pourvu qu’un beau collier pare sa gorge nue,
Et que, charmante et rose, une fille ingénue
Rie ou pleure en lisant ses vers.
En habit zinzolin.
Rondeau, à Églé
Entre les plis de votre robe close
On entrevoit le contour d’un sein rose,
Des bras hardis, un beau corps potelé,
Suave, et dans la neige modelé,
Mais dont, hélas ! un avare dispose.
Un vieux sceptique à la bile morose
Médit de vous et blasphème, et suppose
Qu’à la nature un peu d’art s’est mêlé
Entre les plis.
Moi, qu’éblouit votre fraîcheur éclose,
Je ne crois pas à la métamorphose.
Non, tout est vrai ; mon cœur ensorcelé
N’en doute pas, blanche et rieuse Églé,
Quand mon regard, comme un oiseau, se pose
Entre les plis.
Triolet, à Philis
Si j’étais le Zéphyr ailé,
J’irais mourir sur votre bouche.
Ces voiles, j’en aurais la clé
Si j’étais le Zéphyr ailé.
Près des seins pour qui je brûlai
Je me glisserais dans la couche.
Si j’étais le Zéphyr ailé,
J’irais mourir sur votre bouche.
Rondeau, à Ismène
Oui, pour le moins, laissez-moi, jeune Ismène,
Pleurer tout bas ; si jamais, inhumaine,
J’osais vous peindre avec de vrais accents
Le feu caché qu’en mes veines je sens,
Vous gémiriez, cruelle, de ma peine.
Par ce récit, l’aventure est certaine,
Je changerais en amour votre haine,
Votre froideur en désirs bien pressants,
Oui, pour le moins.
Échevelée alors, ma blonde reine,
Vos bras de lys me feraient une chaîne,
Et les baisers des baisers renaissants
M’enivreraient de leurs charmes puissants ;
Vous veilleriez avec moi la nuit pleine,
Oui, pour le moins.
Triolet, à Amarante
Je mourrai de mon désespoir
Si vous n’y trouvez un remède.
Exilé de votre boudoir,
Je mourrai de mon désespoir.
Pour votre toilette du soir
Bien heureux celui qui vous aide !
Je mourrai de mon désespoir
Si vous n’y trouvez un remède.
Rondeau redoublé, à Sylvie
Je veux vous peindre, ô belle enchanteresse,
Dans un fauteuil ouvrant ses bras dorés,
Comme Diane, en jeune chasseresse,
L’arc à la main et les cheveux poudrés.
Sur les rougeurs d’un ciel aux feux pourprés
Quelquefois passe un voile de tristesse,
Voilà pourquoi, lorsque vous sourirez,
Je veux vous peindre, ô belle enchanteresse !
Vous serez là, frivole et charmeresse,
Parmi les fleurs des jardins adorés
Où doucement le zéphyr vous caresse
Dans un fauteuil ouvrant ses bras dorés.
Auprès de vous, Madame, vous aurez
Le lévrier qui folâtre et se dresse,
Et le carquois plein de traits désœuvrés,
Comme Diane en jeune chasseresse.
Mais n’allez pas, fugitive déesse,
Chercher, pieds nus, par les bois et les prés
Un berger grec, et pâlir de tendresse,
L’arc à la main et les cheveux poudrés.
Heureusement le cadre d’or qui blesse
Vous retiendra dans ses bâtons carrés,
Et sauvera votre antique noblesse
D’enlèvements trop inconsidérés.
Je veux vous peindre.
Madrigal, à Clymène
Quoi >donc ! vous voir et vous aimer
Est un crime à vos yeux, Clymène.
Et rien ne saurait désarmer
Cette rigueur plus qu’inhumaine !
Puisque la mort de tout regret
Et de tout souci nous délivre,
J’accepte de bon cœur l’arrêt
Qui m’ordonne de ne plus vivre.
Rondeau redoublé, à Iris
Quand vous venez, ô jeune beauté blonde,
Par vos regards allumer tant de feux,
On pense voir Cypris, fille de l’Onde,
Épanouir et les Ris et les Jeux.
Chacun, épris d’un désir langoureux,
Souffre une amour à nulle autre seconde,
Et lentement voit s’entr’ouvrir les cieux
Quand vous venez, ô jeune beauté blonde !
S’il ne faut pas que votre chant réponde
Un mot d’amour à nos chants amoureux,
Pourquoi, Déesse à l’âme vagabonde,
Par vos regards allumer tant de feux ?
Laissez au vent flotter ces doux cheveux
Et découvrez cette gorge si ronde,
Si jusqu’au bout il vous plaît qu’en ces lieux
On pense voir Cypris, fille de l’Onde.
Car chacun boit à sa coupe féconde
Lorsqu’elle vient à l’Olympe neigeux
Sur les lits d’or que le plaisir inonde
Épanouir et les Ris et les Jeux.
Donc, allégez ma souffrance profonde.
C’est trop subir un destin rigoureux ;
Craignez, Iris, que mon cœur ne se fonde
À ces rayons qui partent de vos yeux
Quand vous venez !
Madrigal, à Glycère
Oui, vous m’offrez votre amitié,
Pour tous les maux que je vous conte,
Mais quoi ! c’est trop peu de moitié,
Glycère, et je n’ai pas mon compte.
Je soupire, et vous en retour
Vous me payez d’une chimère.
Pourquoi si mal traiter l’Amour ?
Ah ! vous êtes mauvaise mère !
Rondeau, à Églé
Entre les plis de votre robe close
On entrevoit le contour d’un sein rose,
Des bras hardis, un beau corps potelé,
Suave, et dans la neige modelé,
Mais dont, hélas ! un avare dispose.
Un vieux sceptique à la bile morose
Médit de vous et blasphème, et suppose
Qu’à la nature un peu d’art s’est mêlé
Entre les plis.
Moi, qu’éblouit votre fraîcheur éclose,
Je ne crois pas à la métamorphose.
Non, tout est vrai ; mon cœur ensorcelé
N’en doute pas, blanche et rieuse Églé,
Quand mon regard, comme un oiseau, se pose
Entre les plis.
Triolet, à Philis
Si j’étais le Zéphyr ailé,
J’irais mourir sur votre bouche.
Ces voiles, j’en aurais la clé
Si j’étais le Zéphyr ailé.
Près des seins pour qui je brûlai
Je me glisserais dans la couche.
Si j’étais le Zéphyr ailé,
J’irais mourir sur votre bouche.
Rondeau, à Ismène
Oui, pour le moins, laissez-moi, jeune Ismène,
Pleurer tout bas ; si jamais, inhumaine,
J’osais vous peindre avec de vrais accents
Le feu caché qu’en mes veines je sens,
Vous gémiriez, cruelle, de ma peine.
Par ce récit, l’aventure est certaine,
Je changerais en amour votre haine,
Votre froideur en désirs bien pressants,
Oui, pour le moins.
Échevelée alors, ma blonde reine,
Vos bras de lys me feraient une chaîne,
Et les baisers des baisers renaissants
M’enivreraient de leurs charmes puissants ;
Vous veilleriez avec moi la nuit pleine,
Oui, pour le moins.
Triolet, à Amarante
Je mourrai de mon désespoir
Si vous n’y trouvez un remède.
Exilé de votre boudoir,
Je mourrai de mon désespoir.
Pour votre toilette du soir
Bien heureux celui qui vous aide !
Je mourrai de mon désespoir
Si vous n’y trouvez un remède.
Rondeau redoublé, à Sylvie
Je veux vous peindre, ô belle enchanteresse,
Dans un fauteuil ouvrant ses bras dorés,
Comme Diane, en jeune chasseresse,
L’arc à la main et les cheveux poudrés.
Sur les rougeurs d’un ciel aux feux pourprés
Quelquefois passe un voile de tristesse,
Voilà pourquoi, lorsque vous sourirez,
Je veux vous peindre, ô belle enchanteresse !
Vous serez là, frivole et charmeresse,
Parmi les fleurs des jardins adorés
Où doucement le zéphyr vous caresse
Dans un fauteuil ouvrant ses bras dorés.
Auprès de vous, Madame, vous aurez
Le lévrier qui folâtre et se dresse,
Et le carquois plein de traits désœuvrés,
Comme Diane en jeune chasseresse.
Mais n’allez pas, fugitive déesse,
Chercher, pieds nus, par les bois et les prés
Un berger grec, et pâlir de tendresse,
L’arc à la main et les cheveux poudrés.
Heureusement le cadre d’or qui blesse
Vous retiendra dans ses bâtons carrés,
Et sauvera votre antique noblesse
D’enlèvements trop inconsidérés.
Je veux vous peindre.
Madrigal, à Clymène
Quoi >donc ! vous voir et vous aimer
Est un crime à vos yeux, Clymène.
Et rien ne saurait désarmer
Cette rigueur plus qu’inhumaine !
Puisque la mort de tout regret
Et de tout souci nous délivre,
J’accepte de bon cœur l’arrêt
Qui m’ordonne de ne plus vivre.
Rondeau redoublé, à Iris
Quand vous venez, ô jeune beauté blonde,
Par vos regards allumer tant de feux,
On pense voir Cypris, fille de l’Onde,
Épanouir et les Ris et les Jeux.
Chacun, épris d’un désir langoureux,
Souffre une amour à nulle autre seconde,
Et lentement voit s’entr’ouvrir les cieux
Quand vous venez, ô jeune beauté blonde !
S’il ne faut pas que votre chant réponde
Un mot d’amour à nos chants amoureux,
Pourquoi, Déesse à l’âme vagabonde,
Par vos regards allumer tant de feux ?
Laissez au vent flotter ces doux cheveux
Et découvrez cette gorge si ronde,
Si jusqu’au bout il vous plaît qu’en ces lieux
On pense voir Cypris, fille de l’Onde.
Car chacun boit à sa coupe féconde
Lorsqu’elle vient à l’Olympe neigeux
Sur les lits d’or que le plaisir inonde
Épanouir et les Ris et les Jeux.
Donc, allégez ma souffrance profonde.
C’est trop subir un destin rigoureux ;
Craignez, Iris, que mon cœur ne se fonde
À ces rayons qui partent de vos yeux
Quand vous venez !
Madrigal, à Glycère
Oui, vous m’offrez votre amitié,
Pour tous les maux que je vous conte,
Mais quoi ! c’est trop peu de moitié,
Glycère, et je n’ai pas mon compte.
Je soupire, et vous en retour
Vous me payez d’une chimère.
Pourquoi si mal traiter l’Amour ?
Ah ! vous êtes mauvaise mère !
La nuit de printemps.
C’était la veille de Mai
Un soir souriant de fête,
Et tout semblait embaumé
D’une tendresse parfaite.
De son lit à baldaquin,
Le Soleil sur son beau globe
Avait l’air d’un Arlequin
Étalant sa garde-robe,
Et sa sœur au front changeant,
Mademoiselle la Lune
Avec ses grands yeux d’argent
Regardait la Terre brune,
Et du ciel, où, comme un roi,
Chaque astre vit de ses rentes,
Contemplait avec effroi
Le lac aux eaux transparentes.
Comme, avec son air trompeur,
Colombine, qu’on attrape,
À la fin du drame a peur
De tomber dans une trappe.
Tous les jeunes Séraphins,
À cheval sur mille nues,
Agaçaient de regards fins
Leurs comètes toutes nues.
Sur son trône, le bon Dieu,
Devant qui le lys foisonne,
Comme un seigneur de haut lieu
Que sa grandeur emprisonne,
À ces intrigues d’enfants
N’ayant pas daigné descendre,
Les laissait, tout triomphants,
Le tromper comme un Cassandre.
Or, en même temps qu’aux cieux,
C’était comme un grand remue-
Ménage délicieux,
Sur la pauvre terre émue.
Des Sylphes, des Chérubins,
S’occupaient de mille choses,
Et sous leurs fronts de bambins
Roulaient de gros yeux moroses.
Quel embarras, disaient-ils
Dans leurs langages superbes ;
À ces fleurs pas de pistils,
Pas de bleuets dans ces herbes !
Dans ce ciel pas de saphirs,
Pas de feuilles à ces arbres !
Où sont nos frères Zéphyrs
Pour embaumer l’eau des marbres ?
Hélas ! comment ferons-nous ?
Nous méritons qu’on nous tance ;
Le bon Dieu sur nos genoux
Va nous mettre en pénitence !
Car hier au bal dansant,
Où, sorti pour ses affaires,
Il mariait en passant
Deux Soleils avec leurs Sphères,
Nous avons de notre main
Promis sur le divin cierge
Son mois de mai pour demain
À notre dame la Vierge !
Hélas ! jamais tout n’ira
Comme à la saison dernière,
Bien sûr on nous punira
De l’école buissonnière.
Pour ce Mai qu’on nous promet
Ils versent des pleurs de rage,
Et vite chacun se met
À commencer son ouvrage.
Penchés sur les arbrisseaux,
Les uns, au milieu des prées,
Avec de petits pinceaux
Peignent les fleurs diaprées,
Et, de face ou de profil,
Après les branches ouvertes
Attachent avec un fil
De petites feuilles vertes.
Les autres au papillon
Mettent l’azur de ses ailes,
Qu’ils prennent sur un rayon
Peint des couleurs les plus belles.
Des Ariels dans les cieux,
Assis près de leurs amantes,
Agitent des miroirs bleus
Au-dessus des eaux dormantes.
Sur la vague aux cheveux verts
Les Ondins peignent la moire,
Et lui serinent des vers
Trouvés dans un vieux grimoire.
Les Sylphes blonds dans son vol
Arrêtent l’oiseau qui chante,
Et lui disent : Rossignol,
Apprends ta chanson touchante ;
Car il faut que pour demain
On ait la chanson nouvelle.
Puis le cahier d’une main,
De l’autre ils lui tiennent l’aile
Et ceux-là, portant des fleurs
Et de jolis flacons d’ambre,
S’en vont, doux ensorceleurs,
Voir mainte petite chambre,
Où mainte enfant, lys pâli,
Écoute, endormie et nue,
Fredonner un bengali
Dans son âme d’ingénue.
Ils étendent en essaim
Mille roses sur sa lèvre,
Un peu de neige à son sein,
Dans son cœur un peu de fièvre.
Aucun ne sera puni,
La Vierge sera contente :
Car nous avons tout fourni,
Ce qui charme et ce qui tente !
Et Sylphes, et Chérubins,
Ce joli torrent sans digue,
Vont se délasser aux bains
Du bruit et de la fatigue.
Dieu soit béni, disent-ils,
Nous avons fini la chose !
Aux fleurs voici les pistils,
Des parfums, du satin rose ;
Au papillon bleu son vol,
Aux bois rajeunis leur ombre,
Son doux chant au rossignol
Caché dans la forêt sombre !
Voici leur saphir aux cieux
Dans la lumière fleurie,
À l’herbe ses bleuets bleus,
Pour que la Vierge sourie !
Mais ce n’est pas tout encor,
Car ils me disent : Poète !
Voilà mille rimes d’or,
Pour que tu sois de la fête.
Prends-les, tu feras des chants
Que nous apprendrons aux roses,
Pour les dire lorsqu’aux champs
Elles s’éveillent mi-closes.
Et certes mon rêve ailé
Eût fait une hymne bien belle
Si ce qu’ils m’ont révélé
Fût resté dans ma cervelle.
Ils murmuraient, Dieu le sait,
Des rimes si bien éprises !
Mais le Zéphyr qui passait
En passant me les a prises !
C’était la veille de Mai
Un soir souriant de fête,
Et tout semblait embaumé
D’une tendresse parfaite.
De son lit à baldaquin,
Le Soleil sur son beau globe
Avait l’air d’un Arlequin
Étalant sa garde-robe,
Et sa sœur au front changeant,
Mademoiselle la Lune
Avec ses grands yeux d’argent
Regardait la Terre brune,
Et du ciel, où, comme un roi,
Chaque astre vit de ses rentes,
Contemplait avec effroi
Le lac aux eaux transparentes.
Comme, avec son air trompeur,
Colombine, qu’on attrape,
À la fin du drame a peur
De tomber dans une trappe.
Tous les jeunes Séraphins,
À cheval sur mille nues,
Agaçaient de regards fins
Leurs comètes toutes nues.
Sur son trône, le bon Dieu,
Devant qui le lys foisonne,
Comme un seigneur de haut lieu
Que sa grandeur emprisonne,
À ces intrigues d’enfants
N’ayant pas daigné descendre,
Les laissait, tout triomphants,
Le tromper comme un Cassandre.
Or, en même temps qu’aux cieux,
C’était comme un grand remue-
Ménage délicieux,
Sur la pauvre terre émue.
Des Sylphes, des Chérubins,
S’occupaient de mille choses,
Et sous leurs fronts de bambins
Roulaient de gros yeux moroses.
Quel embarras, disaient-ils
Dans leurs langages superbes ;
À ces fleurs pas de pistils,
Pas de bleuets dans ces herbes !
Dans ce ciel pas de saphirs,
Pas de feuilles à ces arbres !
Où sont nos frères Zéphyrs
Pour embaumer l’eau des marbres ?
Hélas ! comment ferons-nous ?
Nous méritons qu’on nous tance ;
Le bon Dieu sur nos genoux
Va nous mettre en pénitence !
Car hier au bal dansant,
Où, sorti pour ses affaires,
Il mariait en passant
Deux Soleils avec leurs Sphères,
Nous avons de notre main
Promis sur le divin cierge
Son mois de mai pour demain
À notre dame la Vierge !
Hélas ! jamais tout n’ira
Comme à la saison dernière,
Bien sûr on nous punira
De l’école buissonnière.
Pour ce Mai qu’on nous promet
Ils versent des pleurs de rage,
Et vite chacun se met
À commencer son ouvrage.
Penchés sur les arbrisseaux,
Les uns, au milieu des prées,
Avec de petits pinceaux
Peignent les fleurs diaprées,
Et, de face ou de profil,
Après les branches ouvertes
Attachent avec un fil
De petites feuilles vertes.
Les autres au papillon
Mettent l’azur de ses ailes,
Qu’ils prennent sur un rayon
Peint des couleurs les plus belles.
Des Ariels dans les cieux,
Assis près de leurs amantes,
Agitent des miroirs bleus
Au-dessus des eaux dormantes.
Sur la vague aux cheveux verts
Les Ondins peignent la moire,
Et lui serinent des vers
Trouvés dans un vieux grimoire.
Les Sylphes blonds dans son vol
Arrêtent l’oiseau qui chante,
Et lui disent : Rossignol,
Apprends ta chanson touchante ;
Car il faut que pour demain
On ait la chanson nouvelle.
Puis le cahier d’une main,
De l’autre ils lui tiennent l’aile
Et ceux-là, portant des fleurs
Et de jolis flacons d’ambre,
S’en vont, doux ensorceleurs,
Voir mainte petite chambre,
Où mainte enfant, lys pâli,
Écoute, endormie et nue,
Fredonner un bengali
Dans son âme d’ingénue.
Ils étendent en essaim
Mille roses sur sa lèvre,
Un peu de neige à son sein,
Dans son cœur un peu de fièvre.
Aucun ne sera puni,
La Vierge sera contente :
Car nous avons tout fourni,
Ce qui charme et ce qui tente !
Et Sylphes, et Chérubins,
Ce joli torrent sans digue,
Vont se délasser aux bains
Du bruit et de la fatigue.
Dieu soit béni, disent-ils,
Nous avons fini la chose !
Aux fleurs voici les pistils,
Des parfums, du satin rose ;
Au papillon bleu son vol,
Aux bois rajeunis leur ombre,
Son doux chant au rossignol
Caché dans la forêt sombre !
Voici leur saphir aux cieux
Dans la lumière fleurie,
À l’herbe ses bleuets bleus,
Pour que la Vierge sourie !
Mais ce n’est pas tout encor,
Car ils me disent : Poète !
Voilà mille rimes d’or,
Pour que tu sois de la fête.
Prends-les, tu feras des chants
Que nous apprendrons aux roses,
Pour les dire lorsqu’aux champs
Elles s’éveillent mi-closes.
Et certes mon rêve ailé
Eût fait une hymne bien belle
Si ce qu’ils m’ont révélé
Fût resté dans ma cervelle.
Ils murmuraient, Dieu le sait,
Des rimes si bien éprises !
Mais le Zéphyr qui passait
En passant me les a prises !
Videos de Théodore de Banville (5)
Voir plusAjouter une vidéo
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Théodore de Banville (38)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Amants de la Littérature
Grâce à Shakespeare, ils sont certainement les plus célèbres, les plus appréciés et les plus ancrés dans les mémoires depuis des siècles...
Hercule Poirot & Miss Marple
Pyrame & Thisbé
Roméo & Juliette
Sherlock Holmes & John Watson
10 questions
5261 lecteurs ont répondu
Thèmes :
amants
, amour
, littératureCréer un quiz sur ce livre5261 lecteurs ont répondu