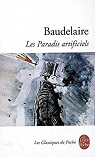Citations sur L'Art romantique (46)
Nous avons vu bien des choses déclarées jadis absurdes, qui sont devenues plus tard des modèles adoptés par la foule.
L’enfant voit tout en nouveauté ; il est toujours ivre. Rien ne ressemble plus à ce qu’on appelle l’inspiration, que la joie avec laquelle l’enfant absorbe la forme et la couleur. J’oserai pousser plus loin ; j’affirme que l’inspiration a quelque rapport avec la congestion, et que toute pensée sublime est accompagnée d’une secousse nerveuse, plus ou moins forte, qui retentit jusque dans le cervelet. L’homme de génie a les nerfs solides ; l’enfant les a faibles. Chez l’un, la raison a pris une place considérable ; chez l’autre, la sensibilité occupe presque tout l’être. Mais le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté, l’enfance douée maintenant, pour s’exprimer, d’organes virils et de l’esprit analytique qui lui permet d’ordonner la somme de matériaux involontairement amassée. C’est à cette curiosité profonde et joyeuse qu’il faut attribuer l’œil fixe et animalement extatique des enfants devant le nouveau, quel qu’il soit, visage ou paysage, lumière, dorure, couleurs, étoffes chatoyantes, enchantement de la beauté embellie par la toilette. Un de mes amis me disait un jour qu’étant fort petit, il assistait à la toilette de son père, et qu’alors il contemplait, avec une stupeur mêlée de délices, les muscles des bras, les dégradations de couleurs de la peau nuancée de rose et de jaune, et le réseau bleuâtre des veines. Le tableau de la vie extérieure le pénétrait déjà de respect et s’emparait de son cerveau. Déjà la forme l’obsédait et le possédait. La prédestination montrait précocement le bout de son nez. La damnation était faite. Ai-je besoin de dire que cet enfant est aujourd’hui un peintre célèbre ?
J'ai maintes fois été étonné que la grande gloire de Balzac fût de passer pour un observateur ; il m'avait toujours semblé que son principal mérite était d'être visionnaire, et visionnaire passionné.
Qui parle mieux de la peinture que notre grand Delacroix ? Diderot, Goethe, Shakespeare, autant de producteurs, autant d’admirables critiques. La poésie a existé, s’est affirmée la première, et elle a engendré l’étude des règles. Telle est l’histoire incontestée du travail humain. Or, comme chacun est le diminutif de tout le monde, comme l’histoire d’un cerveau individuel représente en petit l’histoire du cerveau universel, il serait juste et naturel de supposer (à défaut des preuves qui existent) que l’élaboration des pensées de Wagner a été analogue au travail de l’humanité.
THÉOPHILE GAUTIER
Le cri du sentiment est toujours absurde ; mais il est sublime, parce qu’il est absurde. Quia absurdum !
Que faut-il au républicain ?
Du cœur, du fer, un peu de pain !
Du cœur pour se venger[1],
Du fer pour l’étranger,
Et du pain pour ses frères !
Voilà ce que dit la Carmagnole ; voilà le cri absurde et sublime.
Désirez-vous, dans un autre ordre de sentiments, l’analogue exact ? Ouvrez Théophile Gautier : l’amante courageuse et ivre de son amour veut enlever l’amant, lâche, indécis, qui résiste et objecte que le désert est sans ombrage et sans eau, et la fuite pleine de dangers. Sur quel ton répond-elle ? Sur le ton absolu du sentiment :
Mes cils te feront de l’ombre !
Ensemble nous dormirons
Sous mes cheveux, tente sombre,
Fuyons ! Fuyons !
Sous le bonheur mon cœur ploie !
Si l’eau manque aux stations,
Bois les larmes de ma joie !
Fuyons ! Fuyons !
Il serait facile de trouver dans le même poëte d’autres exemples de la même qualité :
J’ai demandé la vie à l’amour qui la donne !
Mais vainement ........
s’écrie don Juan, que le poëte, dans le pays des âmes, prie de lui expliquer l’énigme de la vie.
Or j’ai voulu tout d’abord prouver que Théophile Gautier possédait, tout aussi bien que s’il n’était pas un parfait artiste, cette fameuse qualité que les badauds de la critique s’obstinent à lui refuser : le sentiment. Que de fois il a exprimé, et avec quelle magie de langage ! ce qu’il y a de plus délicat dans la tendresse et dans la mélancolie ! Peu de personnes ont daigné étudier ces fleurs merveilleuses, je ne sais trop pourquoi, et je n’y vois pas d’autre motif que la répugnance native des Français pour la perfection. Parmi les innombrables préjugés dont la France est si fière, notons cette idée qui court les rues, et qui naturellement est écrite en tête des préceptes de la critique vulgaire, à savoir qu’un ouvrage trop bien écrit doit manquer de sentiment. Le sentiment, par sa nature populaire et familière, attire exclusivement la foule, que ses précepteurs habituels éloignent autant que possible des ouvrages bien écrits. Aussi bien avouons tout de suite que Théophile Gautier, feuilletoniste très-accrédité, est mal connu comme romancier, mal apprécié comme conteur de voyages, et presque inconnu comme poëte, surtout si l’on veut mettre en balance la mince popularité de ses poésies avec leurs brillants et immenses mérites.
Victor Hugo, dans une de ses odes, nous représente Paris à l’état de ville morte, et dans ce rêve lugubre et plein de grandeur, dans cet amas de ruines douteuses lavées par une eau qui se brisait à tous les ponts sonores, rendue maintenant aux joncs murmurants et penchés, il aperçoit encore trois monuments d’une nature plus solide, plus indestructible, qui suffisent à raconter notre histoire. Figurez-vous, je vous prie, la langue française à l’état de langue morte. Dans les écoles des nations nouvelles, on enseigne la langue d’un peuple qui fut grand, du peuple français. Dans quels auteurs supposez-vous que les professeurs, les linguistes d’alors, puiseront la connaissance des principes et des grâces de la langue française ? Sera-ce, je vous prie, dans les capharnaüms du sentiment ou de ce que vous appelez le sentiment ? Mais ces productions, qui sont vos préférées, seront, grâce à leur incorrection, les moins intelligibles et les moins traduisibles ; car il n’y a rien qui soit plus obscur que l’erreur et le désordre. Si dans ces époques, situées moins loin peut-être que ne l’imagine l’orgueil moderne, les poésies de Théophile Gautier sont retrouvées par quelque savant amoureux de beauté, je devine, je comprends, je vois sa joie. Voilà donc la vraie langue française ! la langue des grands esprits et des esprits raffinés ! Avec quel délice son œil se promènera dans tous ces poëmes si purs et si précieusement ornés ! Comme toutes les ressources de notre belle langue, incomplétement connues, seront devinées et appréciées ! Et que de gloire pour le traducteur intelligent qui voudra lutter contre ce grand poëte, immortalité embaumée dans des décombres plus soigneux que la mémoire de ses contemporains ! Vivant, il avait souffert de l’ingratitude des siens ; il a attendu longtemps ; mais enfin le voilà récompensé. Des commentateurs clairvoyants établissent le lien littéraire qui nous unit au xvie siècle. L’histoire des générations s’illumine. Victor Hugo est enseigné et paraphrasé dans les universités ; mais aucun lettré n’ignore que l’étude de ses resplendissantes poésies doit être complétée par l’étude des poésies de Gautier. Quelques-uns observent même que pendant que le majestueux poëte était entraîné par des enthousiasmes quelquefois peu propices à son art, le poëte précieux, plus fidèle, plus concentré, n’en est jamais sorti. D’autres s’aperçoivent qu’il a même ajouté des forces à la poésie française, qu’il en a agrandi le répertoire et augmenté le dictionnaire, sans jamais manquer aux règles les plus sévères de la langue que sa naissance lui commandait de parler.
Heureux homme ! homme digne d’envie ! il n’a aimé que le Beau ; il n’a cherché que le Beau ; et quand un objet grotesque ou hideux s’est offert à ses yeux, il a su encore en extraire une mystérieuse et symbolique beauté ! Homme doué d’une faculté unique, puissante comme la Fatalité, il a exprimé, sans fatigue, sans effort, toutes les attitudes, tous les regards, toutes les couleurs qu’adopte la nature, ainsi que le sens intime contenu dans tous les objets qui s’offrent à la contemplation de l’œil humain.
Sa gloire est double et une en même temps. Pour lui l’idée et l’expression ne sont pas deux choses contradictoires qu’on ne peut accorder que par un grand effort ou par de lâches concessions. À lui seul peut-être il appartient de dire sans emphase : Il n’y a pas d’idées inexprimables ! Si, pour arracher à l’avenir la justice due à Théophile Gautier, j’ai supposé la France disparue, c’est parce que je sais que l’esprit humain, quand il consent à sortir du présent, conçoit mieux l’idée de justice. Tel le voyageur, en s’élevant, comprend mieux la topographie du pays qui l’environne. Je ne veux pas crier, comme les prophètes cruels : Ces temps sont proches ! Je n’appelle aucun désastre, même pour donner la gloire à mes amis. J’ai construit une fable pour faciliter la démonstration aux esprits faibles ou aveugles. Car parmi les vivants clairvoyants, qui ne comprend qu’on citera un jour Théophile Gautier, comme on cite La Bruyère, Buffon, Chateaubriand, c’est-à-dire comme un des maîtres les plus sûrs et les plus rares en matière de langue et de style ?
Variante : Pour le danger. — Pour se venger est plus dans le ton de ce chant, que Goethe aurait pu appeler, plus justement que la Marseillaise, l’hymne de la canaille.
Le cri du sentiment est toujours absurde ; mais il est sublime, parce qu’il est absurde. Quia absurdum !
Que faut-il au républicain ?
Du cœur, du fer, un peu de pain !
Du cœur pour se venger[1],
Du fer pour l’étranger,
Et du pain pour ses frères !
Voilà ce que dit la Carmagnole ; voilà le cri absurde et sublime.
Désirez-vous, dans un autre ordre de sentiments, l’analogue exact ? Ouvrez Théophile Gautier : l’amante courageuse et ivre de son amour veut enlever l’amant, lâche, indécis, qui résiste et objecte que le désert est sans ombrage et sans eau, et la fuite pleine de dangers. Sur quel ton répond-elle ? Sur le ton absolu du sentiment :
Mes cils te feront de l’ombre !
Ensemble nous dormirons
Sous mes cheveux, tente sombre,
Fuyons ! Fuyons !
Sous le bonheur mon cœur ploie !
Si l’eau manque aux stations,
Bois les larmes de ma joie !
Fuyons ! Fuyons !
Il serait facile de trouver dans le même poëte d’autres exemples de la même qualité :
J’ai demandé la vie à l’amour qui la donne !
Mais vainement ........
s’écrie don Juan, que le poëte, dans le pays des âmes, prie de lui expliquer l’énigme de la vie.
Or j’ai voulu tout d’abord prouver que Théophile Gautier possédait, tout aussi bien que s’il n’était pas un parfait artiste, cette fameuse qualité que les badauds de la critique s’obstinent à lui refuser : le sentiment. Que de fois il a exprimé, et avec quelle magie de langage ! ce qu’il y a de plus délicat dans la tendresse et dans la mélancolie ! Peu de personnes ont daigné étudier ces fleurs merveilleuses, je ne sais trop pourquoi, et je n’y vois pas d’autre motif que la répugnance native des Français pour la perfection. Parmi les innombrables préjugés dont la France est si fière, notons cette idée qui court les rues, et qui naturellement est écrite en tête des préceptes de la critique vulgaire, à savoir qu’un ouvrage trop bien écrit doit manquer de sentiment. Le sentiment, par sa nature populaire et familière, attire exclusivement la foule, que ses précepteurs habituels éloignent autant que possible des ouvrages bien écrits. Aussi bien avouons tout de suite que Théophile Gautier, feuilletoniste très-accrédité, est mal connu comme romancier, mal apprécié comme conteur de voyages, et presque inconnu comme poëte, surtout si l’on veut mettre en balance la mince popularité de ses poésies avec leurs brillants et immenses mérites.
Victor Hugo, dans une de ses odes, nous représente Paris à l’état de ville morte, et dans ce rêve lugubre et plein de grandeur, dans cet amas de ruines douteuses lavées par une eau qui se brisait à tous les ponts sonores, rendue maintenant aux joncs murmurants et penchés, il aperçoit encore trois monuments d’une nature plus solide, plus indestructible, qui suffisent à raconter notre histoire. Figurez-vous, je vous prie, la langue française à l’état de langue morte. Dans les écoles des nations nouvelles, on enseigne la langue d’un peuple qui fut grand, du peuple français. Dans quels auteurs supposez-vous que les professeurs, les linguistes d’alors, puiseront la connaissance des principes et des grâces de la langue française ? Sera-ce, je vous prie, dans les capharnaüms du sentiment ou de ce que vous appelez le sentiment ? Mais ces productions, qui sont vos préférées, seront, grâce à leur incorrection, les moins intelligibles et les moins traduisibles ; car il n’y a rien qui soit plus obscur que l’erreur et le désordre. Si dans ces époques, situées moins loin peut-être que ne l’imagine l’orgueil moderne, les poésies de Théophile Gautier sont retrouvées par quelque savant amoureux de beauté, je devine, je comprends, je vois sa joie. Voilà donc la vraie langue française ! la langue des grands esprits et des esprits raffinés ! Avec quel délice son œil se promènera dans tous ces poëmes si purs et si précieusement ornés ! Comme toutes les ressources de notre belle langue, incomplétement connues, seront devinées et appréciées ! Et que de gloire pour le traducteur intelligent qui voudra lutter contre ce grand poëte, immortalité embaumée dans des décombres plus soigneux que la mémoire de ses contemporains ! Vivant, il avait souffert de l’ingratitude des siens ; il a attendu longtemps ; mais enfin le voilà récompensé. Des commentateurs clairvoyants établissent le lien littéraire qui nous unit au xvie siècle. L’histoire des générations s’illumine. Victor Hugo est enseigné et paraphrasé dans les universités ; mais aucun lettré n’ignore que l’étude de ses resplendissantes poésies doit être complétée par l’étude des poésies de Gautier. Quelques-uns observent même que pendant que le majestueux poëte était entraîné par des enthousiasmes quelquefois peu propices à son art, le poëte précieux, plus fidèle, plus concentré, n’en est jamais sorti. D’autres s’aperçoivent qu’il a même ajouté des forces à la poésie française, qu’il en a agrandi le répertoire et augmenté le dictionnaire, sans jamais manquer aux règles les plus sévères de la langue que sa naissance lui commandait de parler.
Heureux homme ! homme digne d’envie ! il n’a aimé que le Beau ; il n’a cherché que le Beau ; et quand un objet grotesque ou hideux s’est offert à ses yeux, il a su encore en extraire une mystérieuse et symbolique beauté ! Homme doué d’une faculté unique, puissante comme la Fatalité, il a exprimé, sans fatigue, sans effort, toutes les attitudes, tous les regards, toutes les couleurs qu’adopte la nature, ainsi que le sens intime contenu dans tous les objets qui s’offrent à la contemplation de l’œil humain.
Sa gloire est double et une en même temps. Pour lui l’idée et l’expression ne sont pas deux choses contradictoires qu’on ne peut accorder que par un grand effort ou par de lâches concessions. À lui seul peut-être il appartient de dire sans emphase : Il n’y a pas d’idées inexprimables ! Si, pour arracher à l’avenir la justice due à Théophile Gautier, j’ai supposé la France disparue, c’est parce que je sais que l’esprit humain, quand il consent à sortir du présent, conçoit mieux l’idée de justice. Tel le voyageur, en s’élevant, comprend mieux la topographie du pays qui l’environne. Je ne veux pas crier, comme les prophètes cruels : Ces temps sont proches ! Je n’appelle aucun désastre, même pour donner la gloire à mes amis. J’ai construit une fable pour faciliter la démonstration aux esprits faibles ou aveugles. Car parmi les vivants clairvoyants, qui ne comprend qu’on citera un jour Théophile Gautier, comme on cite La Bruyère, Buffon, Chateaubriand, c’est-à-dire comme un des maîtres les plus sûrs et les plus rares en matière de langue et de style ?
Variante : Pour le danger. — Pour se venger est plus dans le ton de ce chant, que Goethe aurait pu appeler, plus justement que la Marseillaise, l’hymne de la canaille.
L’ÉCOLE PAÏENNE
Il s’est passé dans l’année qui vient de s’écouler un fait considérable. Je ne dis pas qu’il soit le plus important, mais il est l’un des plus importants, ou plutôt l’un des plus symptomatiques.
Dans un banquet commémoratif de la révolution de Février, un toast a été porté au dieu Pan, oui, au dieu Pan, par un de ces jeunes gens qu’on peut qualifier d’instruits et d’intelligents.
— Mais, lui disais-je, qu’est-ce que le dieu Pan a de commun avec la révolution ?
— Comment donc ? répondait-il ; mais c’est le dieu Pan qui fait la révolution. Il est la révolution.
— D’ailleurs, n’est-il pas mort depuis longtemps ? Je croyais qu’on avait entendu planer une grande voix au dessus de la Méditerranée, et que cette voix mystérieuse, qui roulait depuis les colonnes d’Hercule jusqu’aux rivages asiatiques, avait dit au vieux monde : Le dieu Pan est mort !
— C’est un bruit qu’on fait courir. Ce sont de mauvaises langues ; mais il n’en est rien. Non, le dieu Pan n’est pas mort ! le dieu Pan vit encore, reprit-il en levant les yeux au ciel avec un attendrissement fort bizarre… Il va revenir.
Il parlait du dieu Pan comme du prisonnier de Sainte-Hélène.
— Eh quoi, lui dis-je, seriez-vous donc païen ?
— Mais oui, sans doute ; ignorez-vous donc que le Paganisme bien compris, bien entendu, peut seul sauver le monde ? Il faut revenir aux vraies doctrines, obscurcies un instant par l’infâme Galiléen. D’ailleurs, Junon m’a jeté un regard favorable, un regard qui m’a pénétré jusqu’à l’âme. J’étais triste et mélancolique au milieu de la foule, regardant le cortége et implorant avec des yeux amoureux cette belle divinité, quand un de ses regards, bienveillant et profond, est venu me relever et m’encourager.
— Junon vous a jeté un de ses regards de vache, Bôôpis Êrê. Le malheureux est peut-être fou.
— Mais ne voyez-vous pas, dit une troisième personne, qu’il s’agit de la cérémonie du bœuf gras. Il regardait toutes ces femmes roses avec des yeux païens, et Ernestine, qui est engagée à l’Hippodrome et qui jouait le rôle de Junon, lui a fait un œil plein de souvenirs, un véritable œil de vache.
— Ernestine tant que vous voudrez, dit le païen mécontent. Vous cherchez à me désillusionner. Mais l’effet moral n’en a pas moins été produit, et je regarde ce coup d’œil comme un bon présage.
Il me semble que cet excès de paganisme est le fait d’un homme qui a trop lu et mal lu Henri Heine et sa littérature pourrie de sentimentalisme matérialiste.
Et puisque j’ai prononcé le nom de ce coupable célèbre, autant vous raconter tout de suite un trait de lui qui me met hors de moi chaque fois que j’y pense. Henri Heine raconte dans un de ses livres que, se promenant au milieu de montagnes sauvages, au bord de précipices terribles, au sein d’un chaos de glaces et de neiges, il fait la rencontre d’un de ces religieux qui, accompagnés d’un chien, vont à la découverte des voyageurs perdus et agonisants. Quelques instants auparavant, l’auteur venait de se livrer aux élans solitaires de sa haine voltairienne contre les calotins. Il regarde quelque temps l’homme-humanité qui poursuit sa sainte besogne ; un combat se livre dans son âme orgueilleuse, et enfin, après une douloureuse hésitation, il se résigne et prend une belle résolution : Eh bien, non ! je n’écrirai pas contre cet homme !
Quelle générosité ! Les pieds dans de bonnes pantoufles, au coin d’un bon feu, entouré des adulations d’une société voluptueuse, monsieur l’homme célèbre fait le serment de ne pas diffamer un pauvre diable de religieux qui ignorera toujours son nom et ses blasphèmes, et le sauvera lui-même, le cas échéant !
Non, jamais Voltaire n’eût écrit une pareille turpitude. Voltaire avait trop de goût ; d’ailleurs, il était encore homme d’action, et il aimait les hommes.
Revenons à l’Olympe. Depuis quelque temps, j’ai tout l’Olympe à mes trousses, et j’en souffre beaucoup ; je reçois des dieux sur la tête comme on reçoit des cheminées. Il me semble que je fais un mauvais rêve, que je roule à travers le vide et qu’une foule d’idoles de bois, de fer, d’or et d’argent, tombent avec moi, me poursuivent dans ma chute, me cognent et me brisent la tête et les reins.
Impossible de faire un pas, de prononcer un mot sans butter contre un fait païen.
Exprimez-vous la crainte, la tristesse de voir l’espèce humaine s’amoindrir, la santé publique dégénérer par une mauvaise hygiène, il y aura à côté de vous un poëte pour répondre : « Comment voulez-vous que les femmes fassent de beaux enfants dans un pays où elles adorent un vilain pendu ! » — Le joli fanatisme !
La ville est sens dessus dessous. Les boutiques se ferment. Les femmes font à la hâte leurs provisions, les rues se dépavent, tous les cœurs sont serrés par l’angoisse d’un grand événement. Le pavé sera prochainement inondé de sang. — Vous rencontrez un animal plein de béatitude ; il a sous le bras des bouquins étranges et hiéroglyphiques. — Et vous, lui dites-vous, quel parti prenez-vous ? — Mon cher, répond-il d’une voix douce, je viens de découvrir de nouveaux renseignements très-curieux sur le mariage d’Isis et d’Osiris. — Que le diable vous emporte Qu’Isis et Osiris fassent beaucoup d’enfants et qu’ils nous f… la paix !
Cette folie, innocente en apparence, va souvent très loin. Il y a quelques années, Daumier fit un ouvrage remarquable, l’Histoire ancienne, qui était pour ainsi dire la meilleure paraphrase du mot célèbre : Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ? Daumier s’est abattu brutalement sur l’antiquité et la mythologie, et a craché dessus. Et le bouillant Achille, et le prudent Ulysse, et la sage Pénélope, et Télémaque, ce grand dadais, et la belle Hélène, qui perdit Troie, et la brûlante Sapho, cette patronne des hystériques, et tous enfin nous apparurent dans une laideur bouffonne qui rappelait ces vieilles carcasses d’acteurs classiques qui prennent une prise de tabac dans les coulisses. Eh bien ! j’ai vu un écrivain de talent pleurer devant ces estampes, devant ce blasphème amusant et utile. Il était indigné, il appelait cela une impiété. Le malheureux avait encore besoin d’une religion.
Bien des gens ont encouragé de leur argent et de leurs applaudissements cette déplorable manie, qui tend à faire de l’homme un être inerte et de l’écrivain un mangeur d’opium.
Au point de vue purement littéraire, ce n’est pas autre chose qu’un pastiche inutile et dégoûtant. S’est-on assez moqué des rapins naïfs qui s’évertuaient à copier le Cimabuë ; des écrivains à dague, à pourpoint et à lame de Tolède ? Et vous, malheureux néo-païens, que faites-vous, si ce n’est la même besogne ? Pastiche, pastiche ! Vous avez sans doute perdu votre âme quelque part, dans quelque mauvais endroit, pour que vous couriez ainsi à travers le passé comme des corps vides pour en ramasser une de rencontre dans les détritus anciens ? Qu’attendez-vous du ciel ou de la sottise du public ? Une fortune suffisante pour élever dans vos mansardes des autels à Priape et à Bacchus ? Les plus logiques d’entre vous seront les plus cyniques. Ils en élèveront au dieu Crepitus.
Est-ce le dieu Crepitus qui vous fera de la tisane le lendemain de vos stupides cérémonies ? Est-ce Vénus Aphrodite ou Vénus Mercenaire qui soulagera les maux qu’elle vous aura causés ? Toutes ces statues de marbre seront-elles des femmes dévouées au jour de l’agonie, au jour du remords, au jour de l’impuissance ? Buvez-vous des bouillons d’ambroisie ? mangez-vous des côtelettes de Paros ? Combien prête-t-on sur une lyre au Mont-de-Piété ?
Congédier la passion et la raison, c’est tuer la littérature. Renier les efforts de la société précédente, chrétienne et philosophique, c’est se suicider, c’est refuser la force et les moyens de perfectionnement. S’environner exclusivement des séductions de l’art physique, c’est créer des grandes chances de perdition. Pendant longtemps, bien longtemps, vous ne pourrez voir, aimer, sentir que le beau, rien que le beau. Je prends le mot dans un sens restreint. Le monde ne vous apparaîtra que sous sa forme matérielle. Les ressorts qui le font se mouvoir resteront longtemps cachés.
Puissent la religion et la philosophie venir un jour, comme forcées par le cri d’un désespéré ! Telle sera toujours la destinée des insensés qui ne voient dans la nature que des rhythmes et des formes. Encore la philosophie ne leur apparaîtra-t-elle d’abord que comme un jeu intéressant, une gymnastique agréable, une escrime dans le vide. Mais combien ils seront châtiés ! Tout enfant dont l’esprit poétique sera surexcité, dont le spectacle excitant de mœurs actives et laborieuses ne frappera pas incessamment les yeux, qui entendra sans cesse parler de gloire et de volupté, dont les sens seront journellement caressés, irrités, effrayés, allumés et satisfaits par des objets d’art, deviendra le plus malheureux des hommes et rendra les autres malheureux. À douze ans il retroussera les jupes de sa nourrice, et si la puissance dans le crime ou dans l’art ne l’élève pas au-dessus des fortunes vulgaires, à trente ans il crèvera à l’hôpital. Son âme, sans cesse irritée et inassouvie, s’en va à travers le monde, le monde occupé et laborieux ; elle s’en va, dis-je, comme une prostituée, criant : Plastique ! plastique ! La plastique, cet affreux mot me donne la chair de poule, la plastique l’a empoisonné, et cependant il ne peut vivre que par ce poison. Il a banni la raison de son cœur, et, par un juste châtiment, la raison refuse de rentrer en lui. Tout ce qui peut lui arriver de plus heureux, c’est que la nature le frappe d’un effrayant rappel à l’ordre. En effet, telle est la loi de la vie, que, qui refuse les jouissances pures de l’activité honnête, ne peut sentir que les jouissances terribles du vice. Le péché contient son enfer, et la nature dit de temps en temps à la douleur et à la misère : Allez vaincre ces rebelles !
L’utile, le vrai, le bon, le vraiment aimable, toutes ces choses lui seront inconnu
Il s’est passé dans l’année qui vient de s’écouler un fait considérable. Je ne dis pas qu’il soit le plus important, mais il est l’un des plus importants, ou plutôt l’un des plus symptomatiques.
Dans un banquet commémoratif de la révolution de Février, un toast a été porté au dieu Pan, oui, au dieu Pan, par un de ces jeunes gens qu’on peut qualifier d’instruits et d’intelligents.
— Mais, lui disais-je, qu’est-ce que le dieu Pan a de commun avec la révolution ?
— Comment donc ? répondait-il ; mais c’est le dieu Pan qui fait la révolution. Il est la révolution.
— D’ailleurs, n’est-il pas mort depuis longtemps ? Je croyais qu’on avait entendu planer une grande voix au dessus de la Méditerranée, et que cette voix mystérieuse, qui roulait depuis les colonnes d’Hercule jusqu’aux rivages asiatiques, avait dit au vieux monde : Le dieu Pan est mort !
— C’est un bruit qu’on fait courir. Ce sont de mauvaises langues ; mais il n’en est rien. Non, le dieu Pan n’est pas mort ! le dieu Pan vit encore, reprit-il en levant les yeux au ciel avec un attendrissement fort bizarre… Il va revenir.
Il parlait du dieu Pan comme du prisonnier de Sainte-Hélène.
— Eh quoi, lui dis-je, seriez-vous donc païen ?
— Mais oui, sans doute ; ignorez-vous donc que le Paganisme bien compris, bien entendu, peut seul sauver le monde ? Il faut revenir aux vraies doctrines, obscurcies un instant par l’infâme Galiléen. D’ailleurs, Junon m’a jeté un regard favorable, un regard qui m’a pénétré jusqu’à l’âme. J’étais triste et mélancolique au milieu de la foule, regardant le cortége et implorant avec des yeux amoureux cette belle divinité, quand un de ses regards, bienveillant et profond, est venu me relever et m’encourager.
— Junon vous a jeté un de ses regards de vache, Bôôpis Êrê. Le malheureux est peut-être fou.
— Mais ne voyez-vous pas, dit une troisième personne, qu’il s’agit de la cérémonie du bœuf gras. Il regardait toutes ces femmes roses avec des yeux païens, et Ernestine, qui est engagée à l’Hippodrome et qui jouait le rôle de Junon, lui a fait un œil plein de souvenirs, un véritable œil de vache.
— Ernestine tant que vous voudrez, dit le païen mécontent. Vous cherchez à me désillusionner. Mais l’effet moral n’en a pas moins été produit, et je regarde ce coup d’œil comme un bon présage.
Il me semble que cet excès de paganisme est le fait d’un homme qui a trop lu et mal lu Henri Heine et sa littérature pourrie de sentimentalisme matérialiste.
Et puisque j’ai prononcé le nom de ce coupable célèbre, autant vous raconter tout de suite un trait de lui qui me met hors de moi chaque fois que j’y pense. Henri Heine raconte dans un de ses livres que, se promenant au milieu de montagnes sauvages, au bord de précipices terribles, au sein d’un chaos de glaces et de neiges, il fait la rencontre d’un de ces religieux qui, accompagnés d’un chien, vont à la découverte des voyageurs perdus et agonisants. Quelques instants auparavant, l’auteur venait de se livrer aux élans solitaires de sa haine voltairienne contre les calotins. Il regarde quelque temps l’homme-humanité qui poursuit sa sainte besogne ; un combat se livre dans son âme orgueilleuse, et enfin, après une douloureuse hésitation, il se résigne et prend une belle résolution : Eh bien, non ! je n’écrirai pas contre cet homme !
Quelle générosité ! Les pieds dans de bonnes pantoufles, au coin d’un bon feu, entouré des adulations d’une société voluptueuse, monsieur l’homme célèbre fait le serment de ne pas diffamer un pauvre diable de religieux qui ignorera toujours son nom et ses blasphèmes, et le sauvera lui-même, le cas échéant !
Non, jamais Voltaire n’eût écrit une pareille turpitude. Voltaire avait trop de goût ; d’ailleurs, il était encore homme d’action, et il aimait les hommes.
Revenons à l’Olympe. Depuis quelque temps, j’ai tout l’Olympe à mes trousses, et j’en souffre beaucoup ; je reçois des dieux sur la tête comme on reçoit des cheminées. Il me semble que je fais un mauvais rêve, que je roule à travers le vide et qu’une foule d’idoles de bois, de fer, d’or et d’argent, tombent avec moi, me poursuivent dans ma chute, me cognent et me brisent la tête et les reins.
Impossible de faire un pas, de prononcer un mot sans butter contre un fait païen.
Exprimez-vous la crainte, la tristesse de voir l’espèce humaine s’amoindrir, la santé publique dégénérer par une mauvaise hygiène, il y aura à côté de vous un poëte pour répondre : « Comment voulez-vous que les femmes fassent de beaux enfants dans un pays où elles adorent un vilain pendu ! » — Le joli fanatisme !
La ville est sens dessus dessous. Les boutiques se ferment. Les femmes font à la hâte leurs provisions, les rues se dépavent, tous les cœurs sont serrés par l’angoisse d’un grand événement. Le pavé sera prochainement inondé de sang. — Vous rencontrez un animal plein de béatitude ; il a sous le bras des bouquins étranges et hiéroglyphiques. — Et vous, lui dites-vous, quel parti prenez-vous ? — Mon cher, répond-il d’une voix douce, je viens de découvrir de nouveaux renseignements très-curieux sur le mariage d’Isis et d’Osiris. — Que le diable vous emporte Qu’Isis et Osiris fassent beaucoup d’enfants et qu’ils nous f… la paix !
Cette folie, innocente en apparence, va souvent très loin. Il y a quelques années, Daumier fit un ouvrage remarquable, l’Histoire ancienne, qui était pour ainsi dire la meilleure paraphrase du mot célèbre : Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ? Daumier s’est abattu brutalement sur l’antiquité et la mythologie, et a craché dessus. Et le bouillant Achille, et le prudent Ulysse, et la sage Pénélope, et Télémaque, ce grand dadais, et la belle Hélène, qui perdit Troie, et la brûlante Sapho, cette patronne des hystériques, et tous enfin nous apparurent dans une laideur bouffonne qui rappelait ces vieilles carcasses d’acteurs classiques qui prennent une prise de tabac dans les coulisses. Eh bien ! j’ai vu un écrivain de talent pleurer devant ces estampes, devant ce blasphème amusant et utile. Il était indigné, il appelait cela une impiété. Le malheureux avait encore besoin d’une religion.
Bien des gens ont encouragé de leur argent et de leurs applaudissements cette déplorable manie, qui tend à faire de l’homme un être inerte et de l’écrivain un mangeur d’opium.
Au point de vue purement littéraire, ce n’est pas autre chose qu’un pastiche inutile et dégoûtant. S’est-on assez moqué des rapins naïfs qui s’évertuaient à copier le Cimabuë ; des écrivains à dague, à pourpoint et à lame de Tolède ? Et vous, malheureux néo-païens, que faites-vous, si ce n’est la même besogne ? Pastiche, pastiche ! Vous avez sans doute perdu votre âme quelque part, dans quelque mauvais endroit, pour que vous couriez ainsi à travers le passé comme des corps vides pour en ramasser une de rencontre dans les détritus anciens ? Qu’attendez-vous du ciel ou de la sottise du public ? Une fortune suffisante pour élever dans vos mansardes des autels à Priape et à Bacchus ? Les plus logiques d’entre vous seront les plus cyniques. Ils en élèveront au dieu Crepitus.
Est-ce le dieu Crepitus qui vous fera de la tisane le lendemain de vos stupides cérémonies ? Est-ce Vénus Aphrodite ou Vénus Mercenaire qui soulagera les maux qu’elle vous aura causés ? Toutes ces statues de marbre seront-elles des femmes dévouées au jour de l’agonie, au jour du remords, au jour de l’impuissance ? Buvez-vous des bouillons d’ambroisie ? mangez-vous des côtelettes de Paros ? Combien prête-t-on sur une lyre au Mont-de-Piété ?
Congédier la passion et la raison, c’est tuer la littérature. Renier les efforts de la société précédente, chrétienne et philosophique, c’est se suicider, c’est refuser la force et les moyens de perfectionnement. S’environner exclusivement des séductions de l’art physique, c’est créer des grandes chances de perdition. Pendant longtemps, bien longtemps, vous ne pourrez voir, aimer, sentir que le beau, rien que le beau. Je prends le mot dans un sens restreint. Le monde ne vous apparaîtra que sous sa forme matérielle. Les ressorts qui le font se mouvoir resteront longtemps cachés.
Puissent la religion et la philosophie venir un jour, comme forcées par le cri d’un désespéré ! Telle sera toujours la destinée des insensés qui ne voient dans la nature que des rhythmes et des formes. Encore la philosophie ne leur apparaîtra-t-elle d’abord que comme un jeu intéressant, une gymnastique agréable, une escrime dans le vide. Mais combien ils seront châtiés ! Tout enfant dont l’esprit poétique sera surexcité, dont le spectacle excitant de mœurs actives et laborieuses ne frappera pas incessamment les yeux, qui entendra sans cesse parler de gloire et de volupté, dont les sens seront journellement caressés, irrités, effrayés, allumés et satisfaits par des objets d’art, deviendra le plus malheureux des hommes et rendra les autres malheureux. À douze ans il retroussera les jupes de sa nourrice, et si la puissance dans le crime ou dans l’art ne l’élève pas au-dessus des fortunes vulgaires, à trente ans il crèvera à l’hôpital. Son âme, sans cesse irritée et inassouvie, s’en va à travers le monde, le monde occupé et laborieux ; elle s’en va, dis-je, comme une prostituée, criant : Plastique ! plastique ! La plastique, cet affreux mot me donne la chair de poule, la plastique l’a empoisonné, et cependant il ne peut vivre que par ce poison. Il a banni la raison de son cœur, et, par un juste châtiment, la raison refuse de rentrer en lui. Tout ce qui peut lui arriver de plus heureux, c’est que la nature le frappe d’un effrayant rappel à l’ordre. En effet, telle est la loi de la vie, que, qui refuse les jouissances pures de l’activité honnête, ne peut sentir que les jouissances terribles du vice. Le péché contient son enfer, et la nature dit de temps en temps à la douleur et à la misère : Allez vaincre ces rebelles !
L’utile, le vrai, le bon, le vraiment aimable, toutes ces choses lui seront inconnu
Il serait prodigieux qu’un critique devînt poëte, et il est impossible qu’un poëte ne contienne pas un critique. Le lecteur ne sera donc pas étonné que je considère le poëte comme le meilleur de tous les critiques.
De ces trois traductions, vous pourriez noter facilement les différences. Wagner indique une troupe d’anges qui apportent un vase sacré ; Liszt voit un monument miraculeusement beau, qui se reflète dans un mirage vaporeux. Ma rêverie est beaucoup moins illustrée d’objets matériels : elle est plus vague et plus abstraite. Mais l’important est ici de s’attacher aux ressemblances. Peu nombreuses, elles constitueraient encore une preuve suffisante ; mais, par bonheur, elles sont nombreuses et saisissantes jusqu’au superflu. Dans les trois traductions nous trouvons la sensation de la béatitude spirituelle et physique ; de l’isolement ; de la contemplation de quelque chose infiniment grand et infiniment beau ; d’une lumière intense qui réjouit les yeux et l’âme jusqu’à la pâmoison ; et enfin la sensation de l’espace étendu jusqu’aux dernières limites concevables.
Aucun musicien n’excelle, comme Wagner, à peindre l’espace et la profondeur, matériels et spirituels. C’est une remarque que plusieurs esprits, et des meilleurs, n’ont pu s’empêcher de faire en plusieurs occasions. Il possède l’art de traduire, par des gradations subtiles, tout ce qu’il y a d’excessif, d’immense, d’ambitieux, dans l’homme spirituel et naturel. Il semble parfois, en écoutant cette musique ardente et despotique, qu’on retrouve peintes sur le fond des ténèbres, déchiré par la rêverie, les vertigineuses conceptions de l’opium.
Aucun musicien n’excelle, comme Wagner, à peindre l’espace et la profondeur, matériels et spirituels. C’est une remarque que plusieurs esprits, et des meilleurs, n’ont pu s’empêcher de faire en plusieurs occasions. Il possède l’art de traduire, par des gradations subtiles, tout ce qu’il y a d’excessif, d’immense, d’ambitieux, dans l’homme spirituel et naturel. Il semble parfois, en écoutant cette musique ardente et despotique, qu’on retrouve peintes sur le fond des ténèbres, déchiré par la rêverie, les vertigineuses conceptions de l’opium.
RICHARD WAGNER
ET
TANNHÄUSER
À PARIS
Le lecteur comprendra tout à l’heure pourquoi je souligne ces passages. Je prends maintenant le livre de Liszt, et je l’ouvre à la page où l’imagination de l’illustre pianiste (qui est un artiste et un philosophe) traduit à sa manière le même morceau :
« Cette introduction renferme et révèle l’élément mystique, toujours présent et toujours caché dans la pièce… Pour nous apprendre l’inénarrable puissance de ce secret, Wagner nous montre d’abord la beauté ineffable du sanctuaire, habité par un Dieu qui venge les opprimés et ne demande qu’amour et foi à ses fidèles. Il nous initie au Saint-Graal ; il fait miroiter à nos yeux le temple de bois incorruptible, aux murs odorants, aux portes d’or, aux solives d’asbeste, aux colonnes d’opale, aux parois de cymophane, dont les splendides portiques ne sont approchés que de ceux qui ont le cœur élevé et les mains pures. Il ne nous le fait point apercevoir dans son imposante et réelle structure, mais, comme ménageant nos faibles sens, il nous le montre d’abord reflété dans quelque onde azurée ou reproduit par quelque nuage irisé.
C’est au commencement une large nappe dormante de mélodie, un éther vaporeux qui s’étend, pour que le tableau sacré s’y dessine nos yeux profanes ; effet exclusivement confié aux violons, divisés en huit pupitres différents, qui, après plusieurs mesures de sons harmoniques, continuent dans les plus hautes notes de leurs registres. Le motif est ensuite repris par les instruments à vent les plus doux ; les cors et les bassons, en s’y joignant, préparent l’entrée des trompettes et des trombones, qui répètent la mélodie pour la quatrième fois, avec un éclat éblouissant de coloris, comme si dans cet instant unique l’édifice saint avait brillé devant nos regards aveuglés, dans toute sa magnificence lumineuse et radiante. Mais le vif étincellement, amené par degrés à cette intensité de rayonnement solaire, s’éteint avec rapidité, comme une lueur céleste. La transparente vapeur des nuées se referme, la vision disparaît peu à peu dans le même encens diapré au milieu duquel elle est apparue, et le morceau se termine par les premières six mesures, devenues plus éthérées encore. Son caractère d’idéale mysticité est surtout rendu sensible par le pianissimo toujours conservé dans l’orchestre, et qu’interrompt à peine le court moment où les cuivres font resplendir les merveilleuses lignes du seul motif de cette introduction. Telle est l’image qui, à l’audition de ce sublime adagio, se présente d’abord à nos sens émus. »
M’est-il permis à moi-même de raconter, de rendre avec des paroles la traduction inévitable que mon imagination fit du même morceau, lorsque je l’entendis pour la première fois, les yeux fermés, et que je me sentis pour ainsi dire enlevé de terre ? Je n’oserais certes pas parler avec complaisance de mes rêveries, s’il n’était pas utile de les joindre ici aux rêveries précédentes. Le lecteur sait quel but nous poursuivons : démontrer que la véritable musique suggère des idées analogues dans des cerveaux différents. D’ailleurs, il ne serait pas ridicule ici de raisonner a priori, sans analyse et sans comparaisons ; car ce qui serait vraiment surprenant, c’est que le son ne pût pas suggérer la couleur, que les couleurs ne pussent pas donner l’idée d’une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire des idées ; les choses s’étant toujours exprimées par une analogie réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité.
La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Je poursuis donc. Je me souviens que, dès les premières mesures, je subis une de ces impressions heureuses que presque tous les hommes imaginatifs ont connues, par le rêve, dans le sommeil. Je me sentis délivré des liens de la pesanteur, et je retrouvai par le souvenir l’extraordinaire volupté qui circule dans les lieux hauts (notons en passant que je ne connaissais pas le programme cité tout à l’heure). Ensuite je me peignis involontairement l’état délicieux d’un homme en proie à une grande rêverie dans une solitude absolue, mais une solitude avec un immense horizon et une large lumière diffuse ; l’immensité sans autre décor qu’elle-même. Bientôt j’éprouvai la sensation d’une clarté plus vive, d’une intensité de lumière croissant avec une telle rapidité, que les nuances fournies par le dictionnaire ne suffiraient pas à exprimer ce surcroît toujours renaissant d’ardeur et de blancheur. Alors je conçus pleinement l’idée d’une âme se mouvant dans un milieu lumineux, d’une extase faite de volupté et de connaissance, et planant au-dessus et bien loin du monde naturel.
De ces trois traductions, vous pourriez noter facilement les différences. Wagner indique une troupe d’anges qui apportent un vase sacré ; Liszt voit un monument miraculeusement beau, qui se reflète dans un mirage vaporeux. Ma rêverie est beaucoup moins illustrée d’objets matériels : elle est plus vague et plus abstraite. Mais l’important est ici de s’attacher aux ressemblances. Peu nombreuses, elles constitueraient encore une preuve suffisante ; mais, par bonheur, elles sont nombreuses et saisissantes jusqu’au superflu. Dans les trois traductions nous trouvons la sensation de la béatitude spirituelle et physique ; de l’isolement ; de la contemplation de quelque chose infiniment grand et infiniment beau ; d’une lumière intense qui réjouit les yeux et l’âme jusqu’à la pâmoison ; et enfin la sensation de l’espace étendu jusqu’aux dernières limites concevables.
ET
TANNHÄUSER
À PARIS
Le lecteur comprendra tout à l’heure pourquoi je souligne ces passages. Je prends maintenant le livre de Liszt, et je l’ouvre à la page où l’imagination de l’illustre pianiste (qui est un artiste et un philosophe) traduit à sa manière le même morceau :
« Cette introduction renferme et révèle l’élément mystique, toujours présent et toujours caché dans la pièce… Pour nous apprendre l’inénarrable puissance de ce secret, Wagner nous montre d’abord la beauté ineffable du sanctuaire, habité par un Dieu qui venge les opprimés et ne demande qu’amour et foi à ses fidèles. Il nous initie au Saint-Graal ; il fait miroiter à nos yeux le temple de bois incorruptible, aux murs odorants, aux portes d’or, aux solives d’asbeste, aux colonnes d’opale, aux parois de cymophane, dont les splendides portiques ne sont approchés que de ceux qui ont le cœur élevé et les mains pures. Il ne nous le fait point apercevoir dans son imposante et réelle structure, mais, comme ménageant nos faibles sens, il nous le montre d’abord reflété dans quelque onde azurée ou reproduit par quelque nuage irisé.
C’est au commencement une large nappe dormante de mélodie, un éther vaporeux qui s’étend, pour que le tableau sacré s’y dessine nos yeux profanes ; effet exclusivement confié aux violons, divisés en huit pupitres différents, qui, après plusieurs mesures de sons harmoniques, continuent dans les plus hautes notes de leurs registres. Le motif est ensuite repris par les instruments à vent les plus doux ; les cors et les bassons, en s’y joignant, préparent l’entrée des trompettes et des trombones, qui répètent la mélodie pour la quatrième fois, avec un éclat éblouissant de coloris, comme si dans cet instant unique l’édifice saint avait brillé devant nos regards aveuglés, dans toute sa magnificence lumineuse et radiante. Mais le vif étincellement, amené par degrés à cette intensité de rayonnement solaire, s’éteint avec rapidité, comme une lueur céleste. La transparente vapeur des nuées se referme, la vision disparaît peu à peu dans le même encens diapré au milieu duquel elle est apparue, et le morceau se termine par les premières six mesures, devenues plus éthérées encore. Son caractère d’idéale mysticité est surtout rendu sensible par le pianissimo toujours conservé dans l’orchestre, et qu’interrompt à peine le court moment où les cuivres font resplendir les merveilleuses lignes du seul motif de cette introduction. Telle est l’image qui, à l’audition de ce sublime adagio, se présente d’abord à nos sens émus. »
M’est-il permis à moi-même de raconter, de rendre avec des paroles la traduction inévitable que mon imagination fit du même morceau, lorsque je l’entendis pour la première fois, les yeux fermés, et que je me sentis pour ainsi dire enlevé de terre ? Je n’oserais certes pas parler avec complaisance de mes rêveries, s’il n’était pas utile de les joindre ici aux rêveries précédentes. Le lecteur sait quel but nous poursuivons : démontrer que la véritable musique suggère des idées analogues dans des cerveaux différents. D’ailleurs, il ne serait pas ridicule ici de raisonner a priori, sans analyse et sans comparaisons ; car ce qui serait vraiment surprenant, c’est que le son ne pût pas suggérer la couleur, que les couleurs ne pussent pas donner l’idée d’une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire des idées ; les choses s’étant toujours exprimées par une analogie réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité.
La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Je poursuis donc. Je me souviens que, dès les premières mesures, je subis une de ces impressions heureuses que presque tous les hommes imaginatifs ont connues, par le rêve, dans le sommeil. Je me sentis délivré des liens de la pesanteur, et je retrouvai par le souvenir l’extraordinaire volupté qui circule dans les lieux hauts (notons en passant que je ne connaissais pas le programme cité tout à l’heure). Ensuite je me peignis involontairement l’état délicieux d’un homme en proie à une grande rêverie dans une solitude absolue, mais une solitude avec un immense horizon et une large lumière diffuse ; l’immensité sans autre décor qu’elle-même. Bientôt j’éprouvai la sensation d’une clarté plus vive, d’une intensité de lumière croissant avec une telle rapidité, que les nuances fournies par le dictionnaire ne suffiraient pas à exprimer ce surcroît toujours renaissant d’ardeur et de blancheur. Alors je conçus pleinement l’idée d’une âme se mouvant dans un milieu lumineux, d’une extase faite de volupté et de connaissance, et planant au-dessus et bien loin du monde naturel.
De ces trois traductions, vous pourriez noter facilement les différences. Wagner indique une troupe d’anges qui apportent un vase sacré ; Liszt voit un monument miraculeusement beau, qui se reflète dans un mirage vaporeux. Ma rêverie est beaucoup moins illustrée d’objets matériels : elle est plus vague et plus abstraite. Mais l’important est ici de s’attacher aux ressemblances. Peu nombreuses, elles constitueraient encore une preuve suffisante ; mais, par bonheur, elles sont nombreuses et saisissantes jusqu’au superflu. Dans les trois traductions nous trouvons la sensation de la béatitude spirituelle et physique ; de l’isolement ; de la contemplation de quelque chose infiniment grand et infiniment beau ; d’une lumière intense qui réjouit les yeux et l’âme jusqu’à la pâmoison ; et enfin la sensation de l’espace étendu jusqu’aux dernières limites concevables.
MARCELINE DESBORDES-VALMORE
Plus d’une fois un de vos amis, comme vous lui faisiez confidence d’un de vos goûts ou d’une de vos passions, ne vous a-t-il pas dit : « Voilà qui est singulier ! car cela est en complet désaccord avec toutes vos autres passions et avec votre doctrine ? » Et vous répondiez : « C’est possible, mais c’est ainsi. J’aime cela ; je l’aime, probablement à cause même de la violente contradiction qu’y trouve tout mon être. »
Tel est mon cas vis-à-vis de Mme Desbordes-Valmore. Si le cri, si le soupir naturel d’une âme d’élite, si l’ambition désespérée du cœur, si les facultés soudaines, irréfléchies, si tout ce qui est gratuit et vient de Dieu, suffisent à faire le grand poëte, Marceline Valmore est et sera toujours un grand poëte. Il est vrai que si vous prenez le temps de remarquer tout ce qui lui manque de ce qui peut s’acquérir par le travail, sa grandeur se trouvera singulièrement diminuée ; mais au moment même où vous vous sentirez le plus impatienté et désolé par la négligence, par le cahot, par le trouble, que vous prenez, vous, homme réfléchi et toujours responsable, pour un parti pris de paresse, une beauté soudaine, inattendue, non égalable, se dresse, et vous voilà enlevé irrésistiblement au fond du ciel poétique. Jamais aucun poëte ne fut plus naturel ; aucun ne fut jamais moins artificiel. Personne n’a pu imiter ce charme, parce qu’il est tout original et natif.
Si jamais homme désira pour sa femme ou sa fille les dons et les honneurs de la Muse, il n’a pu les désirer d’une autre nature que ceux qui furent accordés à Mme Valmore. Parmi le personnel assez nombreux des femmes qui se sont de nos jours jetées dans le travail littéraire, il en est bien peu dont les ouvrages n’aient été, sinon une désolation pour leur famille, pour leur amant même (car les hommes les moins pudiques aiment la pudeur dans l’objet aimé), au moins entachés d’un de ces ridicules masculins qui prennent dans la femme les proportions d’une monstruosité. Nous avons connu la femme-auteur philanthrope, la prêtresse systématique de l’amour, la poëtesse républicaine, la poëtesse de l’avenir, fouriériste ou saint-simonienne ; et nos yeux, amoureux du beau, n’ont jamais pu s’accoutumer à toutes ces laideurs compassées, à toutes ces scélératesses impies (il y a même des poëtesses de l’impiété), à tous ces sacriléges pastiches de l’esprit mâle.
Mme Desbordes-Valmore fut femme, fut toujours femme et ne fut absolument que femme ; mais elle fut à un degré extraordinaire l’expression poétique de toutes les beautés naturelles de la femme. Qu’elle chante les langueurs du désir dans la jeune fille, la désolation morne d’un Ariane abandonnée ou les chauds enthousiasmes de la charité maternelle, son chant garde toujours l’accent délicieux de la femme ; pas d’emprunt, pas d’ornement factice, rien que l’éternel féminin, comme dit le poëte allemand. C’est donc dans sa sincérité même que Mme Valmore a trouvé sa récompense, c’est-à-dire une gloire que nous croyons aussi solide que celle des artistes parfaits. Cette torche qu’elle agite à nos yeux pour éclairer les mystérieux bocages du sentiment, ou qu’elle pose, pour le raviver, sur notre plus intime souvenir, amoureux ou filial, cette torche, elle l’a allumée au plus profond de son propre cœur. Victor Hugo a exprimé magnifiquement, comme tout ce qu’il exprime, les beautés et les enchantements de la vie de famille ; mais seulement dans les poésies de l’ardente Marceline vous trouverez cette chaleur de couvée maternelle, dont quelques-uns, parmi les fils de la femme, moins ingrats que les autres, ont gardé le délicieux souvenir. Si je ne craignais pas qu’une comparaison trop animale fût prise pour un manque de respect envers cette adorable femme, je dirais que je trouve en elle la grâce, l’inquiétude, la souplesse et la violence de la femelle, chatte ou lionne, amoureuse de ses petits.
On a dit que Mme Valmore, dont les premières poésies datent déjà de fort loin (1818), avait été de notre temps rapidement oubliée. Oubliée par qui, je vous prie ? Par ceux-là qui, ne sentant rien, ne peuvent se souvenir de rien. Elle a les grandes et vigoureuses qualités qui s’imposent à la mémoire, les trouées profondes faites à l’improviste dans le cœur, les explosions magiques de la passion. Aucun auteur ne cueille plus facilement la formule unique du sentiment, le sublime qui s’ignore. Comme les soins les plus simples et les plus faciles sont un obstacle invincible à cette plume fougueuse et inconsciente, en revanche ce qui est pour toute autre objet d’une laborieuse recherche vient naturellement s’offrir à elle ; c’est une perpétuelle trouvaille. Elle trace des merveilles avec l’insouciance qui préside aux billets destinés à la boîte aux lettres. Âme charitable et passionnée, comme elle se définit bien, mais toujours involontairement, dans ce vers :
Tant que l’on peut donner, on ne peut pas mourir !
Âme trop sensible, sur qui les aspérités de la vie laissaient une empreinte ineffaçable, à elle surtout, désireuse du Léthé, il était permis de s’écrier :
Mais si de la mémoire on ne doit pas guérir,
À quoi sert, ô mon âme, à quoi sert de mourir ?
Certes, personne n’eut plus qu’elle le droit d’écrire en tête d’un récent volume :
Prisonnière en ce livre une âme est renfermée !
Au moment où la mort est venue pour la retirer de ce monde où elle savait si bien souffrir, et la porter vers le ciel dont elle désirait si ardemment les paisibles joies, Mme Desbordes-Valmore, prêtresse infatigable de la Muse, et qui ne savait pas se taire, parce qu’elle était toujours pleine de cris et de chants qui voulaient s’épancher, préparait encore un volume, dont les épreuves venaient une à une s’étaler sur le lit de douleur qu’elle ne quittait plus depuis deux ans. Ceux qui l’aidaient pieusement dans cette préparation de ses adieux m’ont dit que nous y trouverions tout l’éclat d’une vitalité qui ne se sentait jamais si bien vivre que dans la douleur. Hélas ! ce livre sera une couronne posthume à ajouter à toutes celles, déjà si brillantes, dont doit être parée une de nos tombes les plus fleuries.
Je me suis toujours plu à chercher dans la nature extérieure et visible des exemples et des métaphores qui me servissent à caractériser les jouissances et les impressions d’un ordre spirituel. Je rêve à ce que me faisait éprouver la poésie de Mme Valmore quand je la parcourus avec ces yeux de l’adolescence qui sont, chez les hommes nerveux, à la fois si ardents et si clairvoyants. Cette poésie m’apparaît comme un jardin ; mais ce n’est pas la solennité grandiose de Versailles ; ce n’est pas non plus le pittoresque vaste et théâtral de la savante Italie, qui connaît si bien l’art d’édifier des jardins (ædificat hortos) ; pas même, non, pas même la Vallée des Flûtes ou le Ténare de notre vieux Jean-Paul. C’est un simple jardin anglais, romantique et romanesque. Des massifs de fleurs y représentent les abondantes expressions du sentiment. Des étangs, limpides et immobiles, qui réfléchissent toutes choses s’appuyant à l’envers sur la voûte renversée des cieux, figurent la profonde résignation toute parsemée de souvenirs. Rien ne manque à ce charmant jardin d’un autre âge, ni quelques ruines gothiques se cachant dans un lieu agreste, ni le mausolée inconnu qui, au détour d’une allée, surprend notre âme et lui recommande de penser à l’éternité. Des allées sinueuses et ombragées aboutissent à des horizons subits. Ainsi la pensée du poëte, après avoir suivi de capricieux méandres, débouche sur les vastes perspectives du passé ou de l’avenir ; mais ces ciels sont trop vastes pour être généralement purs, et la température du climat trop chaude pour n’y pas amasser des orages. Le promeneur, en contemplant ces étendues voilées de deuil, sent monter à ses yeux les pleurs de l’hystérie, hysterical tears. Les fleurs se penchent vaincues, et les oiseaux ne parlent qu’à voix basse. Après un éclair précurseur, un coup de tonnerre a retenti : c’est l’explosion lyrique ; enfin un déluge inévitable de larmes rend à toutes ces choses, prostrées, souffrantes et découragées, la fraîcheur et la solidité d’une nouvelle jeunesse !
Plus d’une fois un de vos amis, comme vous lui faisiez confidence d’un de vos goûts ou d’une de vos passions, ne vous a-t-il pas dit : « Voilà qui est singulier ! car cela est en complet désaccord avec toutes vos autres passions et avec votre doctrine ? » Et vous répondiez : « C’est possible, mais c’est ainsi. J’aime cela ; je l’aime, probablement à cause même de la violente contradiction qu’y trouve tout mon être. »
Tel est mon cas vis-à-vis de Mme Desbordes-Valmore. Si le cri, si le soupir naturel d’une âme d’élite, si l’ambition désespérée du cœur, si les facultés soudaines, irréfléchies, si tout ce qui est gratuit et vient de Dieu, suffisent à faire le grand poëte, Marceline Valmore est et sera toujours un grand poëte. Il est vrai que si vous prenez le temps de remarquer tout ce qui lui manque de ce qui peut s’acquérir par le travail, sa grandeur se trouvera singulièrement diminuée ; mais au moment même où vous vous sentirez le plus impatienté et désolé par la négligence, par le cahot, par le trouble, que vous prenez, vous, homme réfléchi et toujours responsable, pour un parti pris de paresse, une beauté soudaine, inattendue, non égalable, se dresse, et vous voilà enlevé irrésistiblement au fond du ciel poétique. Jamais aucun poëte ne fut plus naturel ; aucun ne fut jamais moins artificiel. Personne n’a pu imiter ce charme, parce qu’il est tout original et natif.
Si jamais homme désira pour sa femme ou sa fille les dons et les honneurs de la Muse, il n’a pu les désirer d’une autre nature que ceux qui furent accordés à Mme Valmore. Parmi le personnel assez nombreux des femmes qui se sont de nos jours jetées dans le travail littéraire, il en est bien peu dont les ouvrages n’aient été, sinon une désolation pour leur famille, pour leur amant même (car les hommes les moins pudiques aiment la pudeur dans l’objet aimé), au moins entachés d’un de ces ridicules masculins qui prennent dans la femme les proportions d’une monstruosité. Nous avons connu la femme-auteur philanthrope, la prêtresse systématique de l’amour, la poëtesse républicaine, la poëtesse de l’avenir, fouriériste ou saint-simonienne ; et nos yeux, amoureux du beau, n’ont jamais pu s’accoutumer à toutes ces laideurs compassées, à toutes ces scélératesses impies (il y a même des poëtesses de l’impiété), à tous ces sacriléges pastiches de l’esprit mâle.
Mme Desbordes-Valmore fut femme, fut toujours femme et ne fut absolument que femme ; mais elle fut à un degré extraordinaire l’expression poétique de toutes les beautés naturelles de la femme. Qu’elle chante les langueurs du désir dans la jeune fille, la désolation morne d’un Ariane abandonnée ou les chauds enthousiasmes de la charité maternelle, son chant garde toujours l’accent délicieux de la femme ; pas d’emprunt, pas d’ornement factice, rien que l’éternel féminin, comme dit le poëte allemand. C’est donc dans sa sincérité même que Mme Valmore a trouvé sa récompense, c’est-à-dire une gloire que nous croyons aussi solide que celle des artistes parfaits. Cette torche qu’elle agite à nos yeux pour éclairer les mystérieux bocages du sentiment, ou qu’elle pose, pour le raviver, sur notre plus intime souvenir, amoureux ou filial, cette torche, elle l’a allumée au plus profond de son propre cœur. Victor Hugo a exprimé magnifiquement, comme tout ce qu’il exprime, les beautés et les enchantements de la vie de famille ; mais seulement dans les poésies de l’ardente Marceline vous trouverez cette chaleur de couvée maternelle, dont quelques-uns, parmi les fils de la femme, moins ingrats que les autres, ont gardé le délicieux souvenir. Si je ne craignais pas qu’une comparaison trop animale fût prise pour un manque de respect envers cette adorable femme, je dirais que je trouve en elle la grâce, l’inquiétude, la souplesse et la violence de la femelle, chatte ou lionne, amoureuse de ses petits.
On a dit que Mme Valmore, dont les premières poésies datent déjà de fort loin (1818), avait été de notre temps rapidement oubliée. Oubliée par qui, je vous prie ? Par ceux-là qui, ne sentant rien, ne peuvent se souvenir de rien. Elle a les grandes et vigoureuses qualités qui s’imposent à la mémoire, les trouées profondes faites à l’improviste dans le cœur, les explosions magiques de la passion. Aucun auteur ne cueille plus facilement la formule unique du sentiment, le sublime qui s’ignore. Comme les soins les plus simples et les plus faciles sont un obstacle invincible à cette plume fougueuse et inconsciente, en revanche ce qui est pour toute autre objet d’une laborieuse recherche vient naturellement s’offrir à elle ; c’est une perpétuelle trouvaille. Elle trace des merveilles avec l’insouciance qui préside aux billets destinés à la boîte aux lettres. Âme charitable et passionnée, comme elle se définit bien, mais toujours involontairement, dans ce vers :
Tant que l’on peut donner, on ne peut pas mourir !
Âme trop sensible, sur qui les aspérités de la vie laissaient une empreinte ineffaçable, à elle surtout, désireuse du Léthé, il était permis de s’écrier :
Mais si de la mémoire on ne doit pas guérir,
À quoi sert, ô mon âme, à quoi sert de mourir ?
Certes, personne n’eut plus qu’elle le droit d’écrire en tête d’un récent volume :
Prisonnière en ce livre une âme est renfermée !
Au moment où la mort est venue pour la retirer de ce monde où elle savait si bien souffrir, et la porter vers le ciel dont elle désirait si ardemment les paisibles joies, Mme Desbordes-Valmore, prêtresse infatigable de la Muse, et qui ne savait pas se taire, parce qu’elle était toujours pleine de cris et de chants qui voulaient s’épancher, préparait encore un volume, dont les épreuves venaient une à une s’étaler sur le lit de douleur qu’elle ne quittait plus depuis deux ans. Ceux qui l’aidaient pieusement dans cette préparation de ses adieux m’ont dit que nous y trouverions tout l’éclat d’une vitalité qui ne se sentait jamais si bien vivre que dans la douleur. Hélas ! ce livre sera une couronne posthume à ajouter à toutes celles, déjà si brillantes, dont doit être parée une de nos tombes les plus fleuries.
Je me suis toujours plu à chercher dans la nature extérieure et visible des exemples et des métaphores qui me servissent à caractériser les jouissances et les impressions d’un ordre spirituel. Je rêve à ce que me faisait éprouver la poésie de Mme Valmore quand je la parcourus avec ces yeux de l’adolescence qui sont, chez les hommes nerveux, à la fois si ardents et si clairvoyants. Cette poésie m’apparaît comme un jardin ; mais ce n’est pas la solennité grandiose de Versailles ; ce n’est pas non plus le pittoresque vaste et théâtral de la savante Italie, qui connaît si bien l’art d’édifier des jardins (ædificat hortos) ; pas même, non, pas même la Vallée des Flûtes ou le Ténare de notre vieux Jean-Paul. C’est un simple jardin anglais, romantique et romanesque. Des massifs de fleurs y représentent les abondantes expressions du sentiment. Des étangs, limpides et immobiles, qui réfléchissent toutes choses s’appuyant à l’envers sur la voûte renversée des cieux, figurent la profonde résignation toute parsemée de souvenirs. Rien ne manque à ce charmant jardin d’un autre âge, ni quelques ruines gothiques se cachant dans un lieu agreste, ni le mausolée inconnu qui, au détour d’une allée, surprend notre âme et lui recommande de penser à l’éternité. Des allées sinueuses et ombragées aboutissent à des horizons subits. Ainsi la pensée du poëte, après avoir suivi de capricieux méandres, débouche sur les vastes perspectives du passé ou de l’avenir ; mais ces ciels sont trop vastes pour être généralement purs, et la température du climat trop chaude pour n’y pas amasser des orages. Le promeneur, en contemplant ces étendues voilées de deuil, sent monter à ses yeux les pleurs de l’hystérie, hysterical tears. Les fleurs se penchent vaincues, et les oiseaux ne parlent qu’à voix basse. Après un éclair précurseur, un coup de tonnerre a retenti : c’est l’explosion lyrique ; enfin un déluge inévitable de larmes rend à toutes ces choses, prostrées, souffrantes et découragées, la fraîcheur et la solidité d’une nouvelle jeunesse !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Charles Baudelaire (131)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Baudelaire
Dans quelle ville est né Charles Baudelaire ?
Bordeaux
Paris
Lille
Lyon
12 questions
415 lecteurs ont répondu
Thème :
Charles BaudelaireCréer un quiz sur ce livre415 lecteurs ont répondu