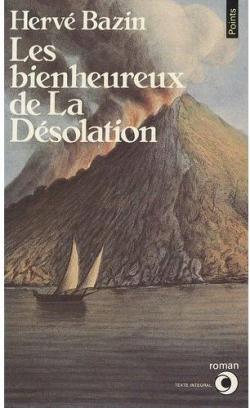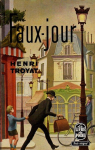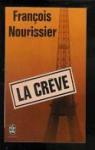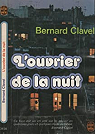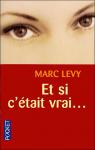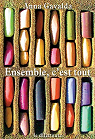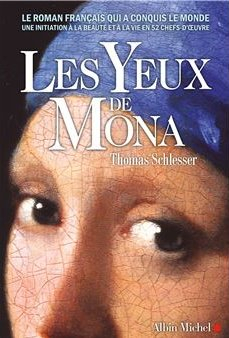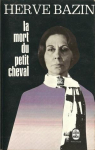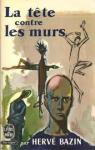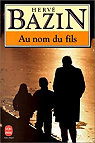Hervé Bazin/5
113 notes
Résumé :
Une éruption volcanique projette une petite communauté insulaire, sans transition, du Moyen Age en plein XXe siècle, de la vie la plus rude aux facilités de la société de consommation. Ces hommes et ces femmes regardent le progrès et ce qui en résulte avec les yeux d'habitants d'une autre planète. Deux ans... Et ils n'ont de cesse de retrouver leur île désolée. Ce n'est pas une fiction sociologique mais une histoire vraie qui, en 1963, a passionné les sociologues. N... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les bienheureux de La DésolationVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (15)
Voir plus
Ajouter une critique
[Lecture induite par la note de Kabuto, que je remercie vivement]
En 1961, les quelque 300 habitants de l'île Tristan da Cunha, dite La Désolation pour ses conditions météorologiques extrêmes, ses maigres ressources hormis les langoustes et son isolement géographique inégalé, l'abandonnèrent à cause d'une éruption volcanique et rejoignirent la métropole britannique, où ils furent accueillis avec une ferveur médiatique et une générosité inhabituelles. Logés, assurés d'un emploi, d'instruction pour les enfants, de prise en charge sanitaire, paraissant s'intégrer à un mode de vie qui semblait constituer la modernisation du leur d'un siècle et demi, ils décidèrent pourtant presque unanimement de regagner leur île deux ans plus tard, une fois le danger passé, malgré le désarroi des Britanniques qui eurent tôt fait de lire dans cette décision à la fois de l'ingratitude et une critique portée à leur modèle social. La question qui inspire le livre, dans ces années de boom économique, et qui reste d'actualité est : pourquoi ? En France, lors de sa rédaction, Mai 68 vient de s'écouler, et pourtant le fait divers ne semble pas avoir été aperçu.
Hervé Bazin choisit de le traiter d'une manière originale : il écrit indiscutablement un roman, non un reportage ; ses chapitres le scandent de manière strictement chronologique : « Tristan l'ancien », « L'exil », « L'essai », « Le choix », « Le retour », « L'épreuve », « La reprise », « Tristan le nouveau » ; cependant la documentation est typiquement journalistique, riche en détails événementiels, pauvre en rebondissements et construction romanesque, surabondante en personnages nommé mais non analysés, qui sont même difficilement reconnaissables car les décrire eût été faire oeuvre de fiction. La trame est secondaire vis-à-vis de ladite question omniprésente, qui se décline dans l'attachement pour la vie ancienne, l'inadaptation à la vie anglaise, les difficultés du retour et l'évolution de la vie nouvelle influencée par l'expérience migratoire et le remplacement générationnel.
Dans un certain nombre de critiques que j'ai lues, on a noté que les Tristans ne se seraient pas habitués à la modernité. Influencé sans doute par mes lectures récentes, je suis totalement en désaccord. Il me semble au contraire que la modernité ne pose pas problème, et que la réponse à la question posée est bien plus subtile, et totalement « gorzienne » : les Tristans sont aliénés par leur vie en Angleterre, à la fois à cause de la « charité » reçue et surtout du travail servile auquel il sont assujettis, un travail « hétéronome » et disqualifié, absolument l'opposé de leurs activités « autonomes », fortement qualifiées pour la survie dans un environnement aussi hostile que le leur ancestral, et nécessitant une solidarité que ne peuvent garantir que l'égalité et la frugalité les plus poussées. Inversement, l'inégalité sociale, le gaspillage, la concurrence, bref tous les éléments constitutifs du capitalisme qu'ils découvrent en Angleterre, en même temps que l'absence de bonheur et un certain nombre de maladies, et non la modernité, les en dégoûtent et rebutent. Cette explication justifie aussi que les défections, c'est-à-dire les Tristans qui resteront en Angleterre, se comptent parmi les jeunes femmes, au nombre de quatre, qui trouvent des époux locaux, étant celles dont le destin – le mariage et l'enfantement – est le moins susceptible d'être « aliénant », alors qu'aucun jeune homme insulaire ne parvient à se faire accompagner d'une fiancée britannique. Il n'est donc pas question d'inadaptation à la modernité, de refus du changement, ni de la technique, comme le démontrent les derniers chapitres et tel que le souligne le dialogue – de sourds – avec le journaliste anglais, Hugh Folkes, qui a suivi la communauté dès son arrivée en Angleterre et jusqu'à sa réinstallation à Tristan, mais dont la compréhension semble toujours être « décalée » donc défectueuse.
J'ai eu un peu de mal à « entrer » dans le style du livre, seule marque littéraire qui, peut-être justement pour être la seule, m'a semblé parfois exagérément et inutilement travaillée, tantôt allusive tantôt opulente dans les descriptions des lieux, peut-être simplement démodée. Puis j'ai été captivé de façon croissante au fil des pages, ce qui peut signifier éventuellement la simple habitude à la prose.
En 1961, les quelque 300 habitants de l'île Tristan da Cunha, dite La Désolation pour ses conditions météorologiques extrêmes, ses maigres ressources hormis les langoustes et son isolement géographique inégalé, l'abandonnèrent à cause d'une éruption volcanique et rejoignirent la métropole britannique, où ils furent accueillis avec une ferveur médiatique et une générosité inhabituelles. Logés, assurés d'un emploi, d'instruction pour les enfants, de prise en charge sanitaire, paraissant s'intégrer à un mode de vie qui semblait constituer la modernisation du leur d'un siècle et demi, ils décidèrent pourtant presque unanimement de regagner leur île deux ans plus tard, une fois le danger passé, malgré le désarroi des Britanniques qui eurent tôt fait de lire dans cette décision à la fois de l'ingratitude et une critique portée à leur modèle social. La question qui inspire le livre, dans ces années de boom économique, et qui reste d'actualité est : pourquoi ? En France, lors de sa rédaction, Mai 68 vient de s'écouler, et pourtant le fait divers ne semble pas avoir été aperçu.
Hervé Bazin choisit de le traiter d'une manière originale : il écrit indiscutablement un roman, non un reportage ; ses chapitres le scandent de manière strictement chronologique : « Tristan l'ancien », « L'exil », « L'essai », « Le choix », « Le retour », « L'épreuve », « La reprise », « Tristan le nouveau » ; cependant la documentation est typiquement journalistique, riche en détails événementiels, pauvre en rebondissements et construction romanesque, surabondante en personnages nommé mais non analysés, qui sont même difficilement reconnaissables car les décrire eût été faire oeuvre de fiction. La trame est secondaire vis-à-vis de ladite question omniprésente, qui se décline dans l'attachement pour la vie ancienne, l'inadaptation à la vie anglaise, les difficultés du retour et l'évolution de la vie nouvelle influencée par l'expérience migratoire et le remplacement générationnel.
Dans un certain nombre de critiques que j'ai lues, on a noté que les Tristans ne se seraient pas habitués à la modernité. Influencé sans doute par mes lectures récentes, je suis totalement en désaccord. Il me semble au contraire que la modernité ne pose pas problème, et que la réponse à la question posée est bien plus subtile, et totalement « gorzienne » : les Tristans sont aliénés par leur vie en Angleterre, à la fois à cause de la « charité » reçue et surtout du travail servile auquel il sont assujettis, un travail « hétéronome » et disqualifié, absolument l'opposé de leurs activités « autonomes », fortement qualifiées pour la survie dans un environnement aussi hostile que le leur ancestral, et nécessitant une solidarité que ne peuvent garantir que l'égalité et la frugalité les plus poussées. Inversement, l'inégalité sociale, le gaspillage, la concurrence, bref tous les éléments constitutifs du capitalisme qu'ils découvrent en Angleterre, en même temps que l'absence de bonheur et un certain nombre de maladies, et non la modernité, les en dégoûtent et rebutent. Cette explication justifie aussi que les défections, c'est-à-dire les Tristans qui resteront en Angleterre, se comptent parmi les jeunes femmes, au nombre de quatre, qui trouvent des époux locaux, étant celles dont le destin – le mariage et l'enfantement – est le moins susceptible d'être « aliénant », alors qu'aucun jeune homme insulaire ne parvient à se faire accompagner d'une fiancée britannique. Il n'est donc pas question d'inadaptation à la modernité, de refus du changement, ni de la technique, comme le démontrent les derniers chapitres et tel que le souligne le dialogue – de sourds – avec le journaliste anglais, Hugh Folkes, qui a suivi la communauté dès son arrivée en Angleterre et jusqu'à sa réinstallation à Tristan, mais dont la compréhension semble toujours être « décalée » donc défectueuse.
J'ai eu un peu de mal à « entrer » dans le style du livre, seule marque littéraire qui, peut-être justement pour être la seule, m'a semblé parfois exagérément et inutilement travaillée, tantôt allusive tantôt opulente dans les descriptions des lieux, peut-être simplement démodée. Puis j'ai été captivé de façon croissante au fil des pages, ce qui peut signifier éventuellement la simple habitude à la prose.
C'est une grosse déception! Après avoir lu et apprécié "Vipère au poing" je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi plat de cet auteur.
Tout d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages. On s'y perd, on les confond.
Ensuite, aucun de ces personnages n'est décrit. On ne peut pas s'y attacher. Leurs sentiments sont très peu décrits, leur psychologie n'est pas du tout développée (d'où le fait de ne pas différencier les différentes personnes, ils sont simplement cités). J'aurais aimé connaître leur ressenti par rapport au fait de tout quitter pour fuir, de devoir s'adapter à la modernité. J'aurais aimé que l'auteur s'attarde un peu plus à ce niveau.
De plus, on peut dire qu'on assiste à une succession de faits sans pouvoir se sentir concerné car l'auteur ne fait que les survoler. On a l'impression que l'histoire est bâclée, de lire plusieurs fois la même chose. En résumé, c'est mou! J'ai l'impression que l'auteur a pris un article de journal et a essayé de le romancer.
Enfin, si on s'ennuie, il est probable que ça soit à cause du peu de dialogues. Cela aurait donné plus de rythme et aurait rendu le roman plus agréable à lire.
Vous l'aurez compris, je n'ai pas aimé et je ne le conseille pas du tout. Il est rare que je descende un bouquin à ce point mais je m'attendais à beaucoup mieux!
Tout d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages. On s'y perd, on les confond.
Ensuite, aucun de ces personnages n'est décrit. On ne peut pas s'y attacher. Leurs sentiments sont très peu décrits, leur psychologie n'est pas du tout développée (d'où le fait de ne pas différencier les différentes personnes, ils sont simplement cités). J'aurais aimé connaître leur ressenti par rapport au fait de tout quitter pour fuir, de devoir s'adapter à la modernité. J'aurais aimé que l'auteur s'attarde un peu plus à ce niveau.
De plus, on peut dire qu'on assiste à une succession de faits sans pouvoir se sentir concerné car l'auteur ne fait que les survoler. On a l'impression que l'histoire est bâclée, de lire plusieurs fois la même chose. En résumé, c'est mou! J'ai l'impression que l'auteur a pris un article de journal et a essayé de le romancer.
Enfin, si on s'ennuie, il est probable que ça soit à cause du peu de dialogues. Cela aurait donné plus de rythme et aurait rendu le roman plus agréable à lire.
Vous l'aurez compris, je n'ai pas aimé et je ne le conseille pas du tout. Il est rare que je descende un bouquin à ce point mais je m'attendais à beaucoup mieux!
En 1960, l'île Tristan voit son volcan se réveiller. Pour les deux cent soixante habitants, c'est le chaos. Bientôt, ils sont rapatriés en Angleterre où on les loge dans un ancien poste militaire avant de les conduire dans une petite ville côtière. Pour les Anglais, le fait que les nouveaux-venus ne puissent qu'être heureux d'avoir échangé un mode de vie arriéré aux avantages de la civilisation ne fait aucun doute. Pourtant les Tristans vont, pour la plupart parvenir à rentrer et ils n'auront de cesse de réaménager leur île afin de la rendre plus sûre et plus vivable. Certains feront des allers et retours entre l'Angleterre et l'île et d'autres choisiront de rester au Royaume-Uni. L'histoire de ces bienheureux est racontée par Hervé Bazin avec précision et sobriété. C'est un récit sans emphase ni grande envolée lyrique : il est de plus écrit dans une langue sobre mais précise et émouvante, ce qui explique l'intérêt que j'ai porté à ce livre.
Un des personnages, Simon, déclare :
"L'exil nous a beaucoup servi. Il nous a montré que nous avions raison de défendre un privilège : celui de dire oui à ce que nous sommes. Celui, je lâche le mot, tant pis ! d'y trouver le bonheur."
Ce bonheur passe, à Tristan, par l'adoption d'une certaine modernité et le respect d'un mode de vie austère.
Beau livre qui nous renvoie à la dignité et à l'obstination de ces Tristans, qui surent être honnêtes avec eux-mêmes et opiniâtres et grâce auxquels l'île ne s'est pas dépeuplée.
Un des personnages, Simon, déclare :
"L'exil nous a beaucoup servi. Il nous a montré que nous avions raison de défendre un privilège : celui de dire oui à ce que nous sommes. Celui, je lâche le mot, tant pis ! d'y trouver le bonheur."
Ce bonheur passe, à Tristan, par l'adoption d'une certaine modernité et le respect d'un mode de vie austère.
Beau livre qui nous renvoie à la dignité et à l'obstination de ces Tristans, qui surent être honnêtes avec eux-mêmes et opiniâtres et grâce auxquels l'île ne s'est pas dépeuplée.
Roman inspirée d'une histoire authentique. La petite île volcanique de Tristan est l'une des terres les plus isolées du monde. Au début des années soixante, environ deux cent habitants y vivent dans un isolement uniquement brisé par la venue d'un bateau tous les deux ou trois mois. Et voilà qu'un beau jour, le volcan décide de se réveiller. Après avoir pas mal rechignés, les locaux acceptent l'évacuation et se retrouvent à vivre deux ans en Angleterre, Tristan étant un territoire britannique. Là, ils se prennent de plein fouet l'assommante modernité du vingtième siècle. Une chance pour eux, croit l'Angleterre. Les insulaires ne sont pas du même avis. Habitués à la nature, à la mer, au calme, mais surtout à jouir de leur indépendance, à être leurs propres patrons, à construire leurs propres maisons et suivre leurs propres horaires, les contraintes de la modernité que tente de compenser un consumérisme frénétique les laissent froids. Et à quelques exceptions prêt, ils retourneront sur leur île.
C'est à peu près l'histoire réelle et le synopsis que l'on trouve au dos du roman, et Hervé Bazin le suit très scrupuleusement. Ainsi Les bienheureux de la désolation ne réserve pas vraiment de surprise, tout y est connu d'avance. le récit ne manque pas d'intérêt, cependant. Comme l'auteur s'attache avant tout à suivre une communauté, les personnages sont peu développés : ils ne servent qu'à représenter l'ensemble de la population de l'île. Ça leur donne un côté jetable, il n'y a personne qui soit particulièrement bien défini ou attachant. le contraste entre la vie sur la petite l'île, Tristan, et celle sur la grande île, l'Angleterre, est exactement comme on peut se l'imaginer. Les insulaires restent attachés à leur indépendance, préférant braver une tempête en barque et ne quasiment rien gagner plutôt que de passer leurs journées à laver des voitures pour un salaire quatre fois plus élevé, préférant leur économie du partage et de l'échange plutôt que celle de l'accumulation et de la subordination. L'auteur leur prête régulièrement des petites phrases piquantes, pleine d'une justesse naïve, où leur instinct les fait critiquer le nouveau monde qu'il découvrent.
Mais le roman est le plus intéressant quand il devient nuancé. Ainsi, si la plupart des insulaires retournent sur leur île, certains se laissent dévorer par la modernité. Habitués à n'avoir qu'une ou deux dizaines d'amoureux potentiels, les voilà qui en ont des millions. Il y a l'eau chaude, les supermarchés, la musique et la danse moderne. Et, mieux encore, il y a l'éducation. Ainsi, même quand rentrent ceux qui en ont la force, ils rentrent changés. Ils ramènent avec eux un désir de technique, l'envie d'avoir routes, voitures, port, bloc opératoire... La petite utopie qui est esquissée, celle d'un idéal de vie simple en communauté, ne peut pas vivre séparément du monde moderne. Elle doit lui emprunter certaines choses, et en repousser activement d'autres. Elle veut son indépendance, mais dépend de l'extérieur pour tous les objets manufacturés, l'éducation, la culture... Et le serpent se mord la queue : il profitent des avantages de la modernité sans en assumer les inconvénients, qu'ils laissent volontiers aux continentaux. On les comprend. Et, faute d'une économie de l'abondance, on voit mal le modèle de l'île Tristan se développer ailleurs, à plus grande échelle.
"Étrange histoire! dit Hugh.Vous vous êtes retirés hors du monde, mais dépendant de lui, pour ce que vous en recevez. Vous vivez dans l'air pur, le calme, la liberté, à condition que d'autres, qui fabriquent vos moteurs, s'enfument dans leurs usines. Toute légende à ses limites et la votre a reçu un coup de pouce. "
Lien : http://lespagesdenomic.blogs..
C'est à peu près l'histoire réelle et le synopsis que l'on trouve au dos du roman, et Hervé Bazin le suit très scrupuleusement. Ainsi Les bienheureux de la désolation ne réserve pas vraiment de surprise, tout y est connu d'avance. le récit ne manque pas d'intérêt, cependant. Comme l'auteur s'attache avant tout à suivre une communauté, les personnages sont peu développés : ils ne servent qu'à représenter l'ensemble de la population de l'île. Ça leur donne un côté jetable, il n'y a personne qui soit particulièrement bien défini ou attachant. le contraste entre la vie sur la petite l'île, Tristan, et celle sur la grande île, l'Angleterre, est exactement comme on peut se l'imaginer. Les insulaires restent attachés à leur indépendance, préférant braver une tempête en barque et ne quasiment rien gagner plutôt que de passer leurs journées à laver des voitures pour un salaire quatre fois plus élevé, préférant leur économie du partage et de l'échange plutôt que celle de l'accumulation et de la subordination. L'auteur leur prête régulièrement des petites phrases piquantes, pleine d'une justesse naïve, où leur instinct les fait critiquer le nouveau monde qu'il découvrent.
Mais le roman est le plus intéressant quand il devient nuancé. Ainsi, si la plupart des insulaires retournent sur leur île, certains se laissent dévorer par la modernité. Habitués à n'avoir qu'une ou deux dizaines d'amoureux potentiels, les voilà qui en ont des millions. Il y a l'eau chaude, les supermarchés, la musique et la danse moderne. Et, mieux encore, il y a l'éducation. Ainsi, même quand rentrent ceux qui en ont la force, ils rentrent changés. Ils ramènent avec eux un désir de technique, l'envie d'avoir routes, voitures, port, bloc opératoire... La petite utopie qui est esquissée, celle d'un idéal de vie simple en communauté, ne peut pas vivre séparément du monde moderne. Elle doit lui emprunter certaines choses, et en repousser activement d'autres. Elle veut son indépendance, mais dépend de l'extérieur pour tous les objets manufacturés, l'éducation, la culture... Et le serpent se mord la queue : il profitent des avantages de la modernité sans en assumer les inconvénients, qu'ils laissent volontiers aux continentaux. On les comprend. Et, faute d'une économie de l'abondance, on voit mal le modèle de l'île Tristan se développer ailleurs, à plus grande échelle.
"Étrange histoire! dit Hugh.Vous vous êtes retirés hors du monde, mais dépendant de lui, pour ce que vous en recevez. Vous vivez dans l'air pur, le calme, la liberté, à condition que d'autres, qui fabriquent vos moteurs, s'enfument dans leurs usines. Toute légende à ses limites et la votre a reçu un coup de pouce. "
Lien : http://lespagesdenomic.blogs..
Bazin Hervé
Les bienheureux de la Désolation
Histoire réelle et romancée malgré tout
Vers 1960 l'ile Tristan da Cumba minuscule ile du sud Afrique où vit deux trois cent personnes en totale autarcie, est victime du volcan qui se réveille. L'Angleterre va faire le maximum pour les sauver et les rapatrier en Angleterre. Mais, mais que de difficultés, pour eux de se retrouver dans un pays, dans des maisons, des voitures, des routes, des gens avec des idées spéciales, de travailler, d'avoir des heures de travail
Comme si on les avait projetés dans une autre dimension deux siècles de différences
Déjà ce manque d'air et cette différence fait que plusieurs décèdent rapidement
Ah oui ils sont aidés, ils reçoivent des dons pour survivre, mais ne savent pas toujours de quoi il s'agit.
Ils ne comprennent pas le concept de patron, employé etc et l'auteur dit
« il s'est assis dans l'encoignure, dans l'ombre, rêvant à ces miracles si peu connus des hommes : un jour qui suive l'autre et qui ne soit pas le même ; le choix de sa peine, accomplie dans la sueur du plaisir ; une vie si riche d'air que nul n'ait eu l'idée de la servir comprimée en trois semaines de vacances, de l'air irrespirable des usines et autres «
La nature, leur vie libre, les oiseaux, leur vie faite de leur mains, pour tout, la terre qui les nourrit, les vêtements qu'ils fabriquent, cette vie libre dans le plus grand des termes.
Pourtant l'état, la croix rouge etc tentent le mieux pour eux, mais ne les comprennent pas toujours
Et après des études par des sismologues et savant permettra à certains de pouvoir reconstruire ce petit paradis la pêche à leur gré,
Comme quoi le paradis serait si facile à atteindre et que le matériel n'apporte pas le bonheur, la nature peut être un meilleur bonheur
Les bienheureux de la Désolation
Histoire réelle et romancée malgré tout
Vers 1960 l'ile Tristan da Cumba minuscule ile du sud Afrique où vit deux trois cent personnes en totale autarcie, est victime du volcan qui se réveille. L'Angleterre va faire le maximum pour les sauver et les rapatrier en Angleterre. Mais, mais que de difficultés, pour eux de se retrouver dans un pays, dans des maisons, des voitures, des routes, des gens avec des idées spéciales, de travailler, d'avoir des heures de travail
Comme si on les avait projetés dans une autre dimension deux siècles de différences
Déjà ce manque d'air et cette différence fait que plusieurs décèdent rapidement
Ah oui ils sont aidés, ils reçoivent des dons pour survivre, mais ne savent pas toujours de quoi il s'agit.
Ils ne comprennent pas le concept de patron, employé etc et l'auteur dit
« il s'est assis dans l'encoignure, dans l'ombre, rêvant à ces miracles si peu connus des hommes : un jour qui suive l'autre et qui ne soit pas le même ; le choix de sa peine, accomplie dans la sueur du plaisir ; une vie si riche d'air que nul n'ait eu l'idée de la servir comprimée en trois semaines de vacances, de l'air irrespirable des usines et autres «
La nature, leur vie libre, les oiseaux, leur vie faite de leur mains, pour tout, la terre qui les nourrit, les vêtements qu'ils fabriquent, cette vie libre dans le plus grand des termes.
Pourtant l'état, la croix rouge etc tentent le mieux pour eux, mais ne les comprennent pas toujours
Et après des études par des sismologues et savant permettra à certains de pouvoir reconstruire ce petit paradis la pêche à leur gré,
Comme quoi le paradis serait si facile à atteindre et que le matériel n'apporte pas le bonheur, la nature peut être un meilleur bonheur
Citations et extraits (23)
Voir plus
Ajouter une citation
Et les articles, les émissions se succèdent. Ils sont sauvés. Ils sont à bord d'un paquebot hollandais. Mornes, mais résignés, pleins de gratitude envers la mère patrie, ils sont arrivés au Cap où ils ont découvert les autos, les avions, les vélos, les immeubles de vingt étages, les postes de télé, les feux de circulation, les enseignes au néon, tout un monde inconnu, fabuleux. Bien sûr, explique-t-on, ils en avaient entendu parler ; ils recevaient quelques illustrés, ils rêvaient dessus : mais à peu près comme nous-mêmes, dans les romans de science-fiction, nous rêvons aux habitants d'une autre planète. Ils n'évoquaient cet univers étrange, mythique, qu'avec réticence. Les magazines, hélas ! se complaisent dans le terrifiant : champignons atomiques, révoltes, crimes, chutes d'avions, guérillas, désastres en tous genres et la puissance même de ce monde infernal - puissant, peut-être, parce qu'infernal - les détournait de nous. Maintenant ils voient ils touchent ; ils s'aperçoivent que la joie, les fleurs, la bonté, les petites filles rieuses existent aussi, malgré le reste, dans les Extérieurs. C'est peut-être ce qui les étonne le plus, avec un certain nombre d'institutions qui nous sont familières et dont ils ne soupçonnaient ni le rôle ni même l'existence : la douane par exemple ou la police. Mais c'est la foule des grandes artères qui a tiré d'un vieillard le cri le plus surprenant :
- Nous ne savions pas que nous étions si peu !
- Nous ne savions pas que nous étions si peu !
Le bonheur dans le dénuement, c'est une réussite ; c'est aussi une leçon vite tournée en scandale par ceux qu'humilie secrètement l'esclavage de leurs besoins.
« Certes, on les verra toujours calmes, discrets, polis, la bouche pleine de mercis, l’œil seul disant hélas et le voilant de la paupière pour ne fâcher personne. Ils ont d'instinct compris que rien n'est plus scandaleux que de se sentir jugé par qui doit rendre grâces. Ils n'avoueront jamais le sentiment qui les habite : "Vous dessus, moi dessous, n'est-ce pas ? Et dans un sens, c'est vrai. Mais si je vous dis que pour moi davantage n'est pas mieux, que je ne veux pas vivre comme vous, le nez bas, le boyau long, la main croche... figurez-vous, monsieur, qu'à mon idée les choses se renversent." Ne flattant pas, mentant mal, ne fracassant jamais, ils se taisent. Mais dès qu'ils sont entre eux ou entourés d'amis, ils se gênent moins. À défaut d'être féroces, ils peuvent devenir caustiques et, dans l'insolence de la seule naïveté, pénétrants... » (p. 120)
« - [… Hugh Folkes dit :] Qu'est-ce que le nécessaire, sinon le superflu d'hier ?
- Ça non ! dit Joss. Quand l'ampoule succède à la lampe à huile, le tracteur au bœuf, il s'agit d'un nouveau nécessaire, qui surclasse l'ancien, hors d'époque. Mais le vison, le diamant, le caviar seront toujours superflus.
- Et puis il y a le superflu provisoire, dit Simon. Je veux dire : ce nécessaire qui ne peut pas être accordé à tous et dont nul ne saurait jouir seul, sans privilège, donc sans injustice. » (p. 237-238)
- Ça non ! dit Joss. Quand l'ampoule succède à la lampe à huile, le tracteur au bœuf, il s'agit d'un nouveau nécessaire, qui surclasse l'ancien, hors d'époque. Mais le vison, le diamant, le caviar seront toujours superflus.
- Et puis il y a le superflu provisoire, dit Simon. Je veux dire : ce nécessaire qui ne peut pas être accordé à tous et dont nul ne saurait jouir seul, sans privilège, donc sans injustice. » (p. 237-238)
Quand l'ampoule succède à la lampe à huile, le tracteur au bœuf, il s'agit d'un nouveau nécessaire, qui surclasse l'ancien, hors d'époque. Mais le vison, le diamant, le caviar seront toujours superflus.
Videos de Hervé Bazin (43)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Hervé Bazin (38)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Hervé Bazin
Né à Angers en ...
1901
1911
1921
1931
12 questions
56 lecteurs ont répondu
Thème :
Hervé BazinCréer un quiz sur ce livre56 lecteurs ont répondu