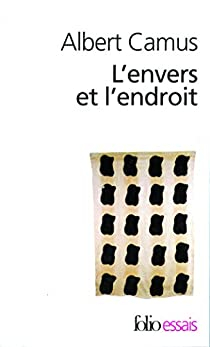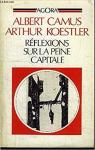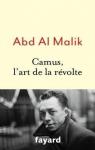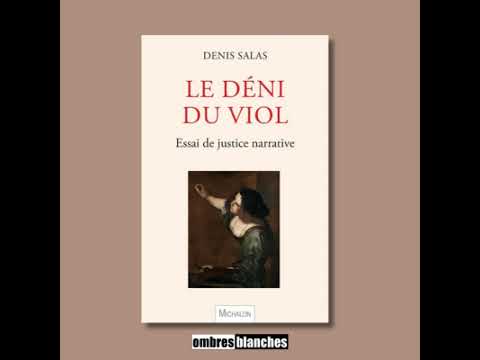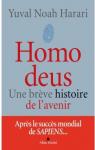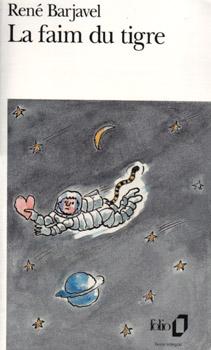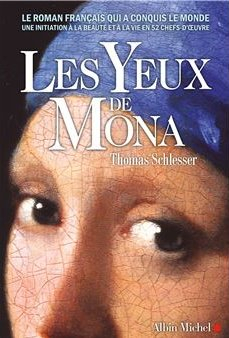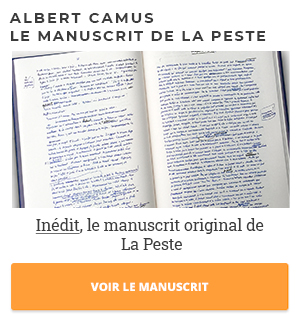Albert Camus/5
283 notes
Résumé :
Les essais qui sont réunis dans ce volume ont été écrits en 1935 et 1936, lorsque Camus avait vingt-deux ans. On a pu dire que ce petit livre contient ce que Camus a écrit de meilleur. Dans une importante préface qui date de 1958, Albert Camus situe ces essais dans la structure générale de son œuvre et il conclut que, "si j'ai beaucoup marché depuis ce livre, je n'ai pas tellement progressé ". On trouve, en effet, tous les thèmes majeurs de l’œuvre de Camus dans ces... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'Envers et l'EndroitVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (31)
Voir plus
Ajouter une critique
L'année dernière, j'ai fait un pèlerinage à Lourmarin, pour me recueillir sur la tombe du grand Nobel français Albert Camus et cela en l'excellente compagnie d'oran, Michèle (d'Avignon) pour ses nombreux ami(e)s sur Babelio, la grande experte de ce phénomène littéraire rare.
Le résultat de cette visite a été, bien entendu, que je suis rentré plein de livres de et sur Camus. Deux d'entre eux ont fait l'objet d'une critique de ma part : de l'auteur "Réflexions sur le terrorisme" (le 31 mai 2018) et un sur l'auteur "Camus ou les promesses de la vie" de Daniel Rondeau (tout de suite à mon retour, le 21 juin 2017).
"L'Envers et l'Endroit" est un "petit" livre, si l'on retient comme seul critère le nombre de pages, tout juste 120. Mais comme le grand maître l'a souhaité dans ses Carnets (VII) : "Je demande une seule chose, et je la demande humblement, bien que je sache qu'elle est exorbitante : être lu avec attention". (Source : "Albert Camus de Tipasa à Lourmarin une exposition pour le centenaire", page 143). Je ne trouve nullement qu'il s'agisse d'une requête exorbitante, quoique ses paroles m'aient incité à lire cette oeuvre avec extra attention. On n'ignore pas une demande, par ailleurs si légitime, à ce génie de la littérature française.
Dans la préface - à la 2ème édition - l'auteur note : "La valeur de témoignage de ce petit livre est, pour moi, considérable. Je dis bien pour moi, car c'est devant moi qu'il témoigne, c'est de moi qu'il exige une fidélité dont je suis le seul à connaître la profondeur et les difficultés".
Je crois que cette phrase est réellement révélatrice pour le souci d'exactitude qui caractérise toute son oeuvre.
Cette préface à ses 5 courts essais, écrits entre 1935 et 1936, lorsque Camus avait 22 ans, demande effectivement une certaine dose d'attention et même de concentration, si l'on veut pleinement apprécier le chemin parcouru par l'artiste depuis sa jeunesse en Algérie.
Le premier essai, intitulé "L'Ironie", nous brosse le portrait de 3 vieilles personnes faces à la mort. le thème clé en est la solitude. L'isolement de la vieille dame paralysée, confrontée à l'incompréhension de sa propre fille, mais qui semble revivre lorsqu'un jeune homme (Camus ?) s'intéresse à elle. le vieil homme qui réalise que "n'être plus écouté : c'est cela qui est terrible lorsqu'on est vieux". "Se faire écouter était son seul vice". Mais ses histoires n'intéressent plus les jeunes : "Il n'était même plus amusant ; il était vieux". le destin de la grand-mère de soixante-dix ans est semblable et pourtant different. "La mort pour tous, mais à chacun sa mort". Et la petite phrase de conclusion : "Après tout, le soleil nous chauffe quand même les os".
Aussi dans le 2ème "Entre oui et non", nous avons droit à quelques vérités camusiennes. Que penser de : "... les seuls paradis sont ceux qu'on a perdus..." et "Oui, c'est peut-être cela le bonheur, le sentiment apitoyé de notre malheur" ? Ici, l'auteur nous parle de sa mère Hélène, en partie sourde et totalement analphabète, et de son père Lucien qu'il n'a jamais connu, puisque le pauvre homme est mort dans la douleur sur le champ de bataille de la Marne, en octobre 1914, lorsque son fils, né le 7 novembre 1913, n'avait même pas un an.
En lisant le 3ème essai "La mort dans l'âme", j'ai eu l'impression que Meursault était sorti d'un des chefs-d'oeuvres de Camus "L'étranger", ou du moins sa préfiguration car ce roman de 1942 est bien ultérieur à l'essai. Toujours est-il, que j'ai suivi ce jeune Meursault déambuler sur la Place Wenceslas et le long de la rivière Vlatava à Prague et ensuite, en passant par la Moravie et Vienne, à Vicence en Italie. Bizarre !
Le 4ème "Amour de vivre", situé à Palma et Ibiza, en Espagne, pays pour lequel l'auteur a une profonde sympathie "...le peuple espagnol est un des rares en Europe qui soit civilisé" (page 100), m'a légèrement déçu. Toutefois, il y a cette phrase mémorable : "Mais il n'y a pas de limites pour aimer et que m'importe de mal éteindre si je peux tout embrasser" (page 109).
Dans le 5ème et dernier essai "L'Envers et l'Endroit", une femme solitaire achète avec son faible héritage une concession au cimetière de sa ville. Il s'agit d'un somptueux caveau, "sobre de lignes, en marbre noir, un vrai trésor à tout dire..." "Cette affaire la contenta si profondément qu'elle fut prise d'un véritable amour pour son tombeau".
Ce qui m'a fasciné le plus dans cet ouvrage du jeune Albert Camus, outre sa richesse littéraire légendaire bien sûr, c'est sa compréhension merveilleuse de la psyché particulière des vieilles personnes, qui se trouvaient à l'autre bout du cycle de l'existence où l'auteur lui-même se situait. Comment il a superbement traduit leur solitude, leur dépendance des autres et leurs angoisses devant la mort, cette inconnue.
Le résultat de cette visite a été, bien entendu, que je suis rentré plein de livres de et sur Camus. Deux d'entre eux ont fait l'objet d'une critique de ma part : de l'auteur "Réflexions sur le terrorisme" (le 31 mai 2018) et un sur l'auteur "Camus ou les promesses de la vie" de Daniel Rondeau (tout de suite à mon retour, le 21 juin 2017).
"L'Envers et l'Endroit" est un "petit" livre, si l'on retient comme seul critère le nombre de pages, tout juste 120. Mais comme le grand maître l'a souhaité dans ses Carnets (VII) : "Je demande une seule chose, et je la demande humblement, bien que je sache qu'elle est exorbitante : être lu avec attention". (Source : "Albert Camus de Tipasa à Lourmarin une exposition pour le centenaire", page 143). Je ne trouve nullement qu'il s'agisse d'une requête exorbitante, quoique ses paroles m'aient incité à lire cette oeuvre avec extra attention. On n'ignore pas une demande, par ailleurs si légitime, à ce génie de la littérature française.
Dans la préface - à la 2ème édition - l'auteur note : "La valeur de témoignage de ce petit livre est, pour moi, considérable. Je dis bien pour moi, car c'est devant moi qu'il témoigne, c'est de moi qu'il exige une fidélité dont je suis le seul à connaître la profondeur et les difficultés".
Je crois que cette phrase est réellement révélatrice pour le souci d'exactitude qui caractérise toute son oeuvre.
Cette préface à ses 5 courts essais, écrits entre 1935 et 1936, lorsque Camus avait 22 ans, demande effectivement une certaine dose d'attention et même de concentration, si l'on veut pleinement apprécier le chemin parcouru par l'artiste depuis sa jeunesse en Algérie.
Le premier essai, intitulé "L'Ironie", nous brosse le portrait de 3 vieilles personnes faces à la mort. le thème clé en est la solitude. L'isolement de la vieille dame paralysée, confrontée à l'incompréhension de sa propre fille, mais qui semble revivre lorsqu'un jeune homme (Camus ?) s'intéresse à elle. le vieil homme qui réalise que "n'être plus écouté : c'est cela qui est terrible lorsqu'on est vieux". "Se faire écouter était son seul vice". Mais ses histoires n'intéressent plus les jeunes : "Il n'était même plus amusant ; il était vieux". le destin de la grand-mère de soixante-dix ans est semblable et pourtant different. "La mort pour tous, mais à chacun sa mort". Et la petite phrase de conclusion : "Après tout, le soleil nous chauffe quand même les os".
Aussi dans le 2ème "Entre oui et non", nous avons droit à quelques vérités camusiennes. Que penser de : "... les seuls paradis sont ceux qu'on a perdus..." et "Oui, c'est peut-être cela le bonheur, le sentiment apitoyé de notre malheur" ? Ici, l'auteur nous parle de sa mère Hélène, en partie sourde et totalement analphabète, et de son père Lucien qu'il n'a jamais connu, puisque le pauvre homme est mort dans la douleur sur le champ de bataille de la Marne, en octobre 1914, lorsque son fils, né le 7 novembre 1913, n'avait même pas un an.
En lisant le 3ème essai "La mort dans l'âme", j'ai eu l'impression que Meursault était sorti d'un des chefs-d'oeuvres de Camus "L'étranger", ou du moins sa préfiguration car ce roman de 1942 est bien ultérieur à l'essai. Toujours est-il, que j'ai suivi ce jeune Meursault déambuler sur la Place Wenceslas et le long de la rivière Vlatava à Prague et ensuite, en passant par la Moravie et Vienne, à Vicence en Italie. Bizarre !
Le 4ème "Amour de vivre", situé à Palma et Ibiza, en Espagne, pays pour lequel l'auteur a une profonde sympathie "...le peuple espagnol est un des rares en Europe qui soit civilisé" (page 100), m'a légèrement déçu. Toutefois, il y a cette phrase mémorable : "Mais il n'y a pas de limites pour aimer et que m'importe de mal éteindre si je peux tout embrasser" (page 109).
Dans le 5ème et dernier essai "L'Envers et l'Endroit", une femme solitaire achète avec son faible héritage une concession au cimetière de sa ville. Il s'agit d'un somptueux caveau, "sobre de lignes, en marbre noir, un vrai trésor à tout dire..." "Cette affaire la contenta si profondément qu'elle fut prise d'un véritable amour pour son tombeau".
Ce qui m'a fasciné le plus dans cet ouvrage du jeune Albert Camus, outre sa richesse littéraire légendaire bien sûr, c'est sa compréhension merveilleuse de la psyché particulière des vieilles personnes, qui se trouvaient à l'autre bout du cycle de l'existence où l'auteur lui-même se situait. Comment il a superbement traduit leur solitude, leur dépendance des autres et leurs angoisses devant la mort, cette inconnue.
L'essence de l'oeuvre d'un des plus grands penseurs du XXe siècle se retrouve condensée ici dans ces récits courts, entre fiction et réflexions personnelles, dont le caractère autobiographique sous-jacent paraît néanmoins hésiter à émerger et à s'assumer franchement en tant que tel.
Tout premiers «essais maladroits», dirait Camus, d'un jeune homme qui, à 22 ans, ne sait pas grand-chose sur la vie et le dit «avec gaucherie».
L'auteur, tout en reconnaissant l'importance fondamentale de ces textes, écrits entre 1935 et 1936, pour le développement de sa pensée et de son oeuvre philosophique postérieure, les avait tout de même toujours considérés comme étant inaboutis, affichant peu de «valeur littéraire».
Présentés tel quel dans la préface à la réimpression tardive de L'ENVERS ET L'ENDROIT, enfin consentie par Camus en 1958, on pourrait légitimement en ouvrant le recueil, s'attendre à se retrouver face à une oeuvre dont l'intérêt serait avant tout biographique et ontogénique.
Il ne s'agit pourtant pas, en tout cas de mon point de vue, d'un ouvrage mineur par rapport aux textes littéraires consacrés de l'écrivain. L'ENVERS ET L'ENDROIT me semble loin de correspondre à la sévérité du jugement
exprimé par l'auteur. Et puis, Camus ne rajoute-t-il pas plus loin:
«Dans le secret de mon coeur, je ne me sens d'humilité que devant les vies les plus pauvres ou les grandes aventures de l'esprit. Entre les deux se trouve aujourd'hui une société qui fait rire».
L'envers de son sentiment d'indifférence éprouvé face à l'admiration de la critique pour son oeuvre de la maturité, son «mauvais orgueil» peu sympathique devant les concessions requises pour «séduire l'adversaire» (on pensera ici surtout à sa célèbre rivalité avec Sartre), son «ingratitude» souvent pointée vis-à-vis des compliments et des prix reçus (« ce n'est pas cela..»), se seraient enfin trouvées pleinement expliquées et justifiées, nous confiera-t-il alors, «en relisant L'ENVERS ET L'ENDROIT après tant d'années ».
«C'est cela..!», s'était-il entendu exclamé, «une vieille femme, une mère silencieuse, la pauvreté, la lumière sur les oliviers d'Italie, l'amour solitaire et peuplé, tout ce qui témoigne, à mes propres yeux, de la vérité» (...) «deux ou trois images simples sur lesquelles le coeur une première fois s'est ouvert».
Quelle surprise, cependant, pour nous autres, ses lecteurs, la découverte ensuite de la beauté naturelle et sans fard de ces courts textes!
Récits certes d'une grande "simplicité" formelle mais en même temps d'une densité absolument renversante, surtout si l'on songe un instant à l'âge de l'auteur au moment de leur rédaction!
Présentant par moment, pourquoi pas, ce caractère «brut» particulier aux oeuvres de jeunesse, la qualité exquise de la plume de Camus, loin d'être maladroite, révèle déjà l'acuité, la sobriété, le lyrisme dépouillé de tout artifice, qui feraient la renommée ultérieure du style de l'écrivain. Touchante de sincérité et d'humanisme, dépourvue d'effets superflus de langage, parcourue de superbes tournures plus succinctes et elliptiques que nulle part ailleurs chez l'auteur, la prose du jeune Camus regorge de subtilités, de sens et de vérités à méditer sur la condition humaine.
Quelles prodigieuses intuitions ne recèlent ses raisonnements souvent en apparence paradoxaux et inusités !
Quelle profondeur de pensée dans ces propos à l'air pourtant si spontanés, en ces phrases agencées avec toute la fraîcheur syntaxique de son âge!
Tels, par exemple, les propos de cet homme revenu dans son pays revoir sa mère, dans une maison de son vieux quartier d'enfance, et qui se souvient :
« Lentes, paisibles et graves, ces heures reviennent, aussi fortes, aussi émouvantes – parce que c'est le soir, que l'heure est triste et qu'il y a une sorte de désir vague dans le ciel sans lumière. Chaque geste retrouvé me révèle à moi-même. On m'a dit un jour : «C'est difficile de vivre». Une autre fois, quelqu'un a murmuré : «La pire erreur, c'est encore de faire souffrir». Quand tout est fini, la soif de vivre est éteinte. Est-ce là ce qu'on appelle le bonheur ? En longeant ces souvenirs, nous revêtons tout du même vêtement discret et la mort nous apparaît comme une toile de fond aux tons vieillis. Nous revenons sur nous-mêmes. Nous sentons notre détresse et nous en aimons mieux. Oui, c'est peut-être cela le bonheur, le sentiment apitoyé de notre malheur.»
Entre « simplicité» dépouillée et « grande aventure de l'esprit » précisément, pour reprendre les mots dont se servait Camus pour parler des seules choses qui, d'après lui, seraient dignes d'admiration chez un écrivain : voilà qui pourrait à mon avis bien résumer et situer ces magnifiques textes de jeunesse de l'auteur.
L'éclat de sa pensée originale y est omniprésent, on assiste pour ainsi dire à sa naissance, et l'on ne peut que s'attendrir face à la nudité naturelle et à l'innocence de ses premières abstractions.
Faites à la fois d'ombre et désespérance, une lumière éclatante, méditerranéenne en rejaillit néanmoins à tout moment, insistante, suffisante en soi à justifier le bonheur d'être vivant: le revers de la médaille, dit-on.
L'endroit du désespoir de vivre, retourné ici en amour de vivre. L'intervalle entre le non et le oui, entre le dégout et l'espérance, entre l'ironie et le don de soi, momentanément effacés, suspendus pour nous au-dessus de cet océan d'angoisse face à l'inhumain qui menace de nous engloutir dès qu'on ouvre les yeux.
Le retour possible à la simplicité, à cette «grâce sans prix» qui n'est jamais aussi manifeste que dans la pauvreté où, inexplicablement, elle se révèle si volontiers, ce qui semble littéralement fasciner le jeune Camus.
La lumière de la pensée se détachant du nuage noir qui persiste à voiler notre regard, révélant soudain à nos yeux l'envers des choses, parce que cette émotion-là nous délivre et nous rend présent «notre royaume en ce monde » (Camus s'amuse ici à détourner les célèbres paroles de Jésus : «Mon royaume n'est pas de ce monde»).
Les cinq récits courts qui composent L'ENVERS ET L'ENDROIT ont pour titre : «L'ironie» , «Entre oui et non», «La mort dans l'âme», «Amour de vivre» et «L'envers et l'endroit».
Titres emblématiques s'il en est, de la pensée philosophique qui sera développée ultérieurement par Camus, centrée sur le désespoir et l'absurde de l'existence, sur la révolte aussi et le don de soi nécessaires pour y faire face.
Cinq «essais» mettant en scène des histoires banales, de tous les jours, vécues par des gens de peu, histoires d'exil intérieur et de retour au bercail, du temps qui passe et de l'âge vieillissant, de la froidure du nord et de la chaleur méditerranéenne…
Une vielle femme qu'on avait laissée à la fenêtre regardant de jeunes gens indifférents partir au cinéma, avant d'éteindre la lumière et rester dans le noir comme à chaque fois qu'elle se retrouve seule; un vieil homme qui lui, ne supporte pas la solitude des vieux et rechigne à rentrer chez lui à l'heure du dîner; les souvenirs liés à une enfance pauvre quand on descendait les chaises devant la maison pour gouter le soir, ce plaisir qu'on n'a jamais retrouvé par ailleurs; un retour d'exil, et à l'amour, seule possibilité de rédemption qui s'offre à l'homme; une mère silencieuse que l'on revoit après une absence prolongée; les repères que l'on perd parfois en voyage à l'étranger, la peur mais aussi l'ivresse de vouloir mettre «le monde entre nos mains»…
Combien d'heures vive-t-on vraiment au cours de toute une existence? Combien de victimes nécessaires à un instant bref de bonheur égocentrique? «La vocation de l'homme est d'être égoïste, c'est-à-dire désespéré».
Le jeune Camus semble avoir déjà tout compris. L'amour de la vie ne peut être dissocié de ce désespoir secret.
L'ironie et l'absurdité qu'un regard lucide pourrait nous faire voir au fond des choses, conclut-il, du haut de ses vingt ans, ne devrait pas pour autant nous priver de la liberté de pouvoir choisir de «vivre comme si…» :
«Les hommes et leur absurdité ? Mais voici le sourire du ciel. La lumière gonfle et c'est bientôt l'été ? Mais voici les yeux et la voix de ceux qu'il faut aimer. Je tiens au monde par tous mes gestes, aux hommes par toute ma pitié et ma reconnaissance.»
Choix qu'il résumerait si bien, quelques années plus tard, dans un formule devenue depuis emblématique de sa pensée et de son oeuvre: «aimer les hommes avant les idées».
...
"Envers et l 'endroit" , est un ensemble d 'essais écrits par Albert Camus en 1935 et 1936 .A l 'époque le philosophe était âgé de vint-deux-ans .Ce livre contient ce que l 'écrivain a écrit de meilleur .On y trouve tous les thèmes majeurs de l 'oeuvre de Camus .
Dans la préface ,Camus affirma :"Une oeuvre d 'homme n 'est rien d 'autre que ce long cheminement pour retrouver par les détours de l 'art les deux ou trois images simples et grandes sur lesquelles le cœur une première fois s 'est ouvert ".Il évoqua sa mère ,son enfance ,"le monde de pauvreté et de lumière",où il a vécu :"Pour corriger une indifférence naturelle ,je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil .La misère m 'empêcha de croire que
tout est bien sous le soleil et dans l 'Histoire ;le soleil m 'apprit que l 'Histoire n 'est pas tout ".
Dans le cours de l 'essai , il développa les thèmes majeurs de son oeuvre future : la lucidité face à l 'absurdité du monde ,le scandale de la mort , le déchirement de la conscience ,explicitant ainsi un titre alternatif qui annonçait déjà celui ,en forme de dilemme fondamental ,de l 'Exil et le royaume (...) Je tiens au monde par tous mes gestes , aux hommes par ma pitié et ma reconnaissance .Entre cet endroit et cet envers du monde,je n 'aime pas qu 'on choisisse ".Le grand courage ,c 'est encore de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort ".
Présentation d ' André Dumas .
Dans la préface ,Camus affirma :"Une oeuvre d 'homme n 'est rien d 'autre que ce long cheminement pour retrouver par les détours de l 'art les deux ou trois images simples et grandes sur lesquelles le cœur une première fois s 'est ouvert ".Il évoqua sa mère ,son enfance ,"le monde de pauvreté et de lumière",où il a vécu :"Pour corriger une indifférence naturelle ,je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil .La misère m 'empêcha de croire que
tout est bien sous le soleil et dans l 'Histoire ;le soleil m 'apprit que l 'Histoire n 'est pas tout ".
Dans le cours de l 'essai , il développa les thèmes majeurs de son oeuvre future : la lucidité face à l 'absurdité du monde ,le scandale de la mort , le déchirement de la conscience ,explicitant ainsi un titre alternatif qui annonçait déjà celui ,en forme de dilemme fondamental ,de l 'Exil et le royaume (...) Je tiens au monde par tous mes gestes , aux hommes par ma pitié et ma reconnaissance .Entre cet endroit et cet envers du monde,je n 'aime pas qu 'on choisisse ".Le grand courage ,c 'est encore de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort ".
Présentation d ' André Dumas .
En ouverture de ses « Carnets », Albert Camus écrit : « l'oeuvre est un aveu, il me faut témoigner. » (Carnets I, mai 1935, La Pléiade, 795).
Dans la préface de l'édition de L'Envers et l'endroit publiée en 1958, Camus fait état de la forme maladroite de son essai, puis dit encore ceci :
« La question de sa valeur littéraire étant réglée, je puis avouer, en effet, que la valeur de témoignage de ce petit livre est, pour moi, considérable. Je dis bien pour moi, car c'est devant moi qu'il témoigne, c'est de moi qu'il exige une fidélité dont je suis seul à connaître la profondeur et les difficultés. Je voudrais essayer de dire pourquoi. »
Je renvoie les lecteurs de l'essai aux très intéressantes critiques déjà publiées sur Babelio, celle de Kielosa en particulier, qui expose assez largement le contenu des cinq chapitres, car j'aimerais pour ma part dire quelques mots à propos de ce « pourquoi ».
La première des raisons pour laquelle cet essai, écrit par un jeune homme de vingt-deux ans, a valeur de témoignage pour Camus, réside dans son caractère d'authentique sincérité. Au philosophe Brice Parain, son aîné, qui prétendait que ce petit livre contenait ce que Camus avait écrit de meilleur, ce denier répond ceci : « Non, il se trompe parce qu'à vingt-deux ans, sauf génie, on sait à peine écrire. Mais je comprends ce que Parain [...] veut dire. Il veut dire, et il a raison, qu'il y a plus de véritable amour dans ces pages maladroites que dans toutes celles qui ont suivi. »
L'autre raison majeure est que pour Camus la source de toute son oeuvre est dans L'Envers et l'Endroit. Cette source, il faut la chercher dans l'enfance même de l'auteur. Malgré la pauvreté, une mère silencieuse, un père disparu dans les premiers mois de sa vie, c'est le sentiment de chaleur et de richesse qui domine. Ce fut un « monde de pauvreté et de lumière », écrit-il, dont le souvenir le préserve encore des dangers qui menacent tout artiste : « le ressentiment et la satisfaction ».
Prémuni des satisfactions vaniteuses liées au métier d'écrivain, il se souvient que les moments de contentement furent toujours pour lui ceux où l'intelligence et l'imagination s'unissaient dans la conception d'une oeuvre, la suite n'étant qu'une « longue peine ».
C'est dans cette vie de pauvreté qu'il a le plus sûrement acquis le véritable sens de la vie, et c'est à partir de celle-ci que Camus, dès cet essai, témoigne de son temps et de la condition humaine. Quant à la lumière, il n'est pas indifférent de prendre le mot au sens figuré, mais il s'agit surtout de la bonne, belle et heureuse lumière de ce pays d'enfance que fut l'Algérie : « en Afrique, la mer et le soleil ne coûtent rien ».
«...je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil » écrit-il « La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire ; le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. »
Sur la vie elle-même, il n'hésite pas à écrire qu'il n'en sait pas plus que ce qui est dit dans L'Envers et l'Endroit, et se rend compte à quel point son intuition première qui lui faisait dire « Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre », était vraie.
Enfin, posant son regard bienveillant sur cette première oeuvre maladroite (c'est Camus qui le dit, ce n'est pas moi, car je puis dire que j'y ai trouvé des pages admirables), et se projetant dans son oeuvre à venir, dont il continue de penser au moment de la rédaction de cette préface qu'elle n'est pas commencée, son rêve, écrit-il, est que cette dernière ressemble à L'envers et l'endroit, que celle-ci mette au centre « l'admirable silence d'une mère et l'effort d'un homme pour retrouver une justice ou un amour qui équilibre ce silence. »
Je laisse à présent les lecteurs découvrir cette oeuvre fondatrice. J'avais souvenir d'une lointaine première lecture. Cette deuxième lecture m'a permis de constater à nouveau combien cette oeuvre est riche en elle-même et fondamentale pour notre connaissance de l'oeuvre de Camus, et ô combien elle est une extraordinaire leçon d'humilité.
Dans la préface de l'édition de L'Envers et l'endroit publiée en 1958, Camus fait état de la forme maladroite de son essai, puis dit encore ceci :
« La question de sa valeur littéraire étant réglée, je puis avouer, en effet, que la valeur de témoignage de ce petit livre est, pour moi, considérable. Je dis bien pour moi, car c'est devant moi qu'il témoigne, c'est de moi qu'il exige une fidélité dont je suis seul à connaître la profondeur et les difficultés. Je voudrais essayer de dire pourquoi. »
Je renvoie les lecteurs de l'essai aux très intéressantes critiques déjà publiées sur Babelio, celle de Kielosa en particulier, qui expose assez largement le contenu des cinq chapitres, car j'aimerais pour ma part dire quelques mots à propos de ce « pourquoi ».
La première des raisons pour laquelle cet essai, écrit par un jeune homme de vingt-deux ans, a valeur de témoignage pour Camus, réside dans son caractère d'authentique sincérité. Au philosophe Brice Parain, son aîné, qui prétendait que ce petit livre contenait ce que Camus avait écrit de meilleur, ce denier répond ceci : « Non, il se trompe parce qu'à vingt-deux ans, sauf génie, on sait à peine écrire. Mais je comprends ce que Parain [...] veut dire. Il veut dire, et il a raison, qu'il y a plus de véritable amour dans ces pages maladroites que dans toutes celles qui ont suivi. »
L'autre raison majeure est que pour Camus la source de toute son oeuvre est dans L'Envers et l'Endroit. Cette source, il faut la chercher dans l'enfance même de l'auteur. Malgré la pauvreté, une mère silencieuse, un père disparu dans les premiers mois de sa vie, c'est le sentiment de chaleur et de richesse qui domine. Ce fut un « monde de pauvreté et de lumière », écrit-il, dont le souvenir le préserve encore des dangers qui menacent tout artiste : « le ressentiment et la satisfaction ».
Prémuni des satisfactions vaniteuses liées au métier d'écrivain, il se souvient que les moments de contentement furent toujours pour lui ceux où l'intelligence et l'imagination s'unissaient dans la conception d'une oeuvre, la suite n'étant qu'une « longue peine ».
C'est dans cette vie de pauvreté qu'il a le plus sûrement acquis le véritable sens de la vie, et c'est à partir de celle-ci que Camus, dès cet essai, témoigne de son temps et de la condition humaine. Quant à la lumière, il n'est pas indifférent de prendre le mot au sens figuré, mais il s'agit surtout de la bonne, belle et heureuse lumière de ce pays d'enfance que fut l'Algérie : « en Afrique, la mer et le soleil ne coûtent rien ».
«...je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil » écrit-il « La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire ; le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. »
Sur la vie elle-même, il n'hésite pas à écrire qu'il n'en sait pas plus que ce qui est dit dans L'Envers et l'Endroit, et se rend compte à quel point son intuition première qui lui faisait dire « Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre », était vraie.
Enfin, posant son regard bienveillant sur cette première oeuvre maladroite (c'est Camus qui le dit, ce n'est pas moi, car je puis dire que j'y ai trouvé des pages admirables), et se projetant dans son oeuvre à venir, dont il continue de penser au moment de la rédaction de cette préface qu'elle n'est pas commencée, son rêve, écrit-il, est que cette dernière ressemble à L'envers et l'endroit, que celle-ci mette au centre « l'admirable silence d'une mère et l'effort d'un homme pour retrouver une justice ou un amour qui équilibre ce silence. »
Je laisse à présent les lecteurs découvrir cette oeuvre fondatrice. J'avais souvenir d'une lointaine première lecture. Cette deuxième lecture m'a permis de constater à nouveau combien cette oeuvre est riche en elle-même et fondamentale pour notre connaissance de l'oeuvre de Camus, et ô combien elle est une extraordinaire leçon d'humilité.
Le 23 juin (2018), à Lourmarin, Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus nous invitent à une conférence donnée par Franck Planeille « La mort dans l'âme » ( il a, entre autre, établi, présenté et annoté l'édition de la correspondance Camus-Char, proposé une étude de l'Etranger chez Bordas…) Pour moi, cette re (re…)lecture de cet essai regroupant cinq textes , publié en 1937 chez Charlot, le fondateur des Vraies Richesses, s'imposait pour me sustenter avec plus de force de ce que révèlera Franck. Composition de jeunesse qui, même si elle est présentée, par certains, comme d'inégale valeur au regard de l'intégralité de son oeuvre, rédigée avec une certaine impulsivité, porte le sceau de sa personnalité, reflète avec force et ferveur sa pensée, sa sensibilité, ses prises de position, son lyrisme, la lucidité, ses thèmes de prédilection … « Je sais que ma source est dans l'Envers et l'Endroit » précisait Camus en 1958...
Citations et extraits (129)
Voir plus
Ajouter une citation
Si ce soir, c'est l'image d'une certaine enfance qui revient vers moi, comment ne pas accueillir la leçon d'amour et de pauvreté que je puis en tirer? Puisque cette heure est comme un intervalle entre oui et non, je laisse pour d'autres heures l'espoir ou le dégoût de vivre. Oui, recueillir seulement la transparence et la simplicité des paradis perdus : dans une image. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas longtemps, dans une maison d'un vieux quartier, un fils est allé voir sa mère. Ils sont assis face à face, en silence. Mais leurs regards se rencontrent:
« Alors, maman.
-Alors, voilà.
-Tu t'ennuies? Je ne parle pas beaucoup?
-Oh, tu n'as jamais beaucoup parlé. »
Et un beau sourire sans lèvres se fond sur son visage. C'est vrai, il ne lui a jamais parlé. Mais quel besoin, en vérité? A se taire, la situation s'éclaircit. Il est son fils, elle est sa mère. Elle peut lui dire : « Tu sais. »
« Alors, maman.
-Alors, voilà.
-Tu t'ennuies? Je ne parle pas beaucoup?
-Oh, tu n'as jamais beaucoup parlé. »
Et un beau sourire sans lèvres se fond sur son visage. C'est vrai, il ne lui a jamais parlé. Mais quel besoin, en vérité? A se taire, la situation s'éclaircit. Il est son fils, elle est sa mère. Elle peut lui dire : « Tu sais. »
Amour de vivre
À Ibiza, j’allais tous les jours m’asseoir dans les cafés qui jalonnent le port. Vers cinq heures, les jeunes gens du pays se promènent sur deux rangs tout le long de la jetée. Là se font les mariages et la vie tout entière. On ne peut s’empêcher de penser qu’il y a une certaine grandeur à commencer ainsi sa vie devant le monde. Je m’asseyais, encore tout chancelant du soleil de la journée, plein d’églises blanches et de murs crayeux, de campagnes sèches et d’oliviers hirsutes. Je buvais un orgeat douceâtre. Je regardais la courbe des collines qui me faisaient face. Elles descendaient doucement vers la mer. [...] Dans ce court instant de crépuscule, régnait quelque chose de fugace et de mélancolique qui n’était pas sensible à un homme seulement, mais à un peuple tout entier. Pour moi, j’avais envie d’aimer comme on a envie de pleurer. Il me semblait que chaque heure de mon sommeil serait désormais volée à la vie... c’est-à-dire au temps du désir sans objet. Comme dans ces heures vibrantes du cabaret de Palma et du cloître de San Francisco, j’étais immobile et tendu, sans forces contre cet immense élan qui voulait mettre le monde entre mes mains.
À Ibiza, j’allais tous les jours m’asseoir dans les cafés qui jalonnent le port. Vers cinq heures, les jeunes gens du pays se promènent sur deux rangs tout le long de la jetée. Là se font les mariages et la vie tout entière. On ne peut s’empêcher de penser qu’il y a une certaine grandeur à commencer ainsi sa vie devant le monde. Je m’asseyais, encore tout chancelant du soleil de la journée, plein d’églises blanches et de murs crayeux, de campagnes sèches et d’oliviers hirsutes. Je buvais un orgeat douceâtre. Je regardais la courbe des collines qui me faisaient face. Elles descendaient doucement vers la mer. [...] Dans ce court instant de crépuscule, régnait quelque chose de fugace et de mélancolique qui n’était pas sensible à un homme seulement, mais à un peuple tout entier. Pour moi, j’avais envie d’aimer comme on a envie de pleurer. Il me semblait que chaque heure de mon sommeil serait désormais volée à la vie... c’est-à-dire au temps du désir sans objet. Comme dans ces heures vibrantes du cabaret de Palma et du cloître de San Francisco, j’étais immobile et tendu, sans forces contre cet immense élan qui voulait mettre le monde entre mes mains.
"L'envers et l'endroit" - recueil de cinq nouvelles (1937)
"L'ironie" : Trois vieillards : "trois destins semblables et pourtant différents. La mort pour tous, mais à chacun sa mort. Après tout, le soleil nous chauffe quand même les os".
"Entre oui et non" : Un jeune homme évoque avec pudeur son enfance, l'émouvante indifférence de sa mère et les liens que le silence tissait entre eux, dans un monde de pauvreté.
"La mort dans l'âme" : La découverte, au cours d'un voyage à Prague, de la solitude, du tête à tête angoissant avec soi-même que le dépaysement ménage, de l'évidence brutale de la mort. Et puis c'est l'Italie, où le narrateur retrouve "la force d'être courageux et conscient à la fois".
"Amour de vivre" : Un séjour aux îles Baléares entraîne une nouvelle réflexion : "il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre".
"L'envers et l'endroit" : Une vieille femme devant la mort. Un jeune homme devant sa vie.
(extrait de "Récits, pièces et essais" issu de "Albert Camus" de la collection "Génies et réalités" publiée aux éditions "Hachette" en 1964)
"L'ironie" : Trois vieillards : "trois destins semblables et pourtant différents. La mort pour tous, mais à chacun sa mort. Après tout, le soleil nous chauffe quand même les os".
"Entre oui et non" : Un jeune homme évoque avec pudeur son enfance, l'émouvante indifférence de sa mère et les liens que le silence tissait entre eux, dans un monde de pauvreté.
"La mort dans l'âme" : La découverte, au cours d'un voyage à Prague, de la solitude, du tête à tête angoissant avec soi-même que le dépaysement ménage, de l'évidence brutale de la mort. Et puis c'est l'Italie, où le narrateur retrouve "la force d'être courageux et conscient à la fois".
"Amour de vivre" : Un séjour aux îles Baléares entraîne une nouvelle réflexion : "il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre".
"L'envers et l'endroit" : Une vieille femme devant la mort. Un jeune homme devant sa vie.
(extrait de "Récits, pièces et essais" issu de "Albert Camus" de la collection "Génies et réalités" publiée aux éditions "Hachette" en 1964)
La vie est courte et c'est péché de perdre son temps. Je suis actif, dit-on. Mais être actif, c'est encore perdre son temps, dans la mesure où on se perd. Aujourd'hui est une halte et mon cœur s'en va à la rencontre de lui-même. Si une angoisse encore m'étreint, c'est de sentir cet impalpable instant glisser entre mes doigts comme les perles du mercure. Laissez donc ceux qui veulent tourner le dos au monde. Je ne me plains pas puisque je me regarde naître. À cette heure, tout mon royaume est de ce monde. Ce soleil et ces ombres, cette chaleur et ce froid qui vient du fond de l'air: vais-je me demander si quelque chose meurt et si les hommes souffrent puisque tout est écrit dans cette fenêtre où le ciel déverse sa plénitude à la rencontre de ma pitié.
Mais, après m'être interrogé, je puis témoigner que, parmi mes nombreuses faiblesses, n'a jamais figuré le défaut le plus répandu parmi nous, je veux dire l'envie, véritable cancer des sociétés et des doctrines.
Le mérite de cette heureuse immunité ne me revient pas. Je la dois aux miens, d'abord, qui manquaient de presque tout et n'enviaient à peu près rien. Par son seul silence, sa réserve, sa fierté naturelle et sobre, cette famille, qui ne savait même pas lire, m'a donné alors mes plus hautes leçons , qui durent toujours. Et puis j'étais moi-même trop occupé à sentir pour rêver d'autre chose.
Le mérite de cette heureuse immunité ne me revient pas. Je la dois aux miens, d'abord, qui manquaient de presque tout et n'enviaient à peu près rien. Par son seul silence, sa réserve, sa fierté naturelle et sobre, cette famille, qui ne savait même pas lire, m'a donné alors mes plus hautes leçons , qui durent toujours. Et puis j'étais moi-même trop occupé à sentir pour rêver d'autre chose.
Videos de Albert Camus (159)
Voir plusAjouter une vidéo
Rencontre avec Denis Salas autour de le déni du viol. Essai de justice narrative paru aux éditions Michalon.
-- avec l'Université Toulouse Capitole
Denis Salas, ancien juge, enseigne à l'École nationale de la magistrature et dirige la revue Les Cahiers de la Justice. Il préside l'Association française pour l'histoire de la justice. Il a publié aux éditions Michalon Albert Camus. La justice révolte, Kafka. le combat avec la loi et, avec Antoine Garapon, Imaginer la loi. le droit dans la littérature.
--
02/02/2024 - Réalisation et mise en ondes Radio Radio, RR+, Radio TER
-- avec l'Université Toulouse Capitole
Denis Salas, ancien juge, enseigne à l'École nationale de la magistrature et dirige la revue Les Cahiers de la Justice. Il préside l'Association française pour l'histoire de la justice. Il a publié aux éditions Michalon Albert Camus. La justice révolte, Kafka. le combat avec la loi et, avec Antoine Garapon, Imaginer la loi. le droit dans la littérature.
--
02/02/2024 - Réalisation et mise en ondes Radio Radio, RR+, Radio TER
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Albert Camus (102)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz sur l´Etranger par Albert Camus
L´Etranger s´ouvre sur cet incipit célèbre : "Aujourd´hui maman est morte...
Et je n´ai pas versé de larmes
Un testament sans héritage
Tant pis
Ou peut-être hier je ne sais pas
9 questions
4767 lecteurs ont répondu
Thème : L'étranger de
Albert CamusCréer un quiz sur ce livre4767 lecteurs ont répondu