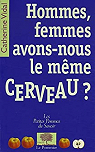Natacha Chetcuti
Michel Bozon (Préfacier, etc.)/5 11 notes
Michel Bozon (Préfacier, etc.)/5 11 notes
Résumé :
Comment les lesbiennes se disent-elles ? Comment aiment-elles ? Quels sont leurs modèles de couple ? Quelle est leur sexualité ? Comment sont-elles perçues par les femmes hétérosexuelles ?
Ce livre à la fois novateur, riche et subtil est le premier, en France comme à l'étranger, à s'attacher à l'intimité des femmes lesbiennes en s'appuyant sur des récits de vie. Il fait l'historique de cette « catégorie » apparue dans les années 1870, décrit les trois pa... >Voir plus
Ce livre à la fois novateur, riche et subtil est le premier, en France comme à l'étranger, à s'attacher à l'intimité des femmes lesbiennes en s'appuyant sur des récits de vie. Il fait l'historique de cette « catégorie » apparue dans les années 1870, décrit les trois pa... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Se dire lesbienne. Vie de couple, sexualité, représentation de soiVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Pendant toute la lecture de l'essai, il a fallu que je garde à l'esprit cette idée : que le lesbianisme ne se résume pas à une orientation sexuelle féminine ; au moins depuis les années 1970 et Monique Wittig, le lesbianisme est d'abord et surtout une posture politique de critique féministe de l'hétéronormativité, donc de la domination masculine. Dès lors, une dialectique est posée : d'une part le positionnement de chaque femme homosexuelle vis-à-vis de sa socialisation genrée, c'est-à-dire son acceptation, refus ou problématisation de sa propre féminité et des attendus sociaux afférents ; d'autre part sa volonté de s'inscrire ou non dans le militantisme lesbien, comme forme d'engagement (ou de lutte) féministe ayant ses propres attendus et ses lieux et formes spécifiques de socialisation. Une telle dialectique a l'air d'être parfaitement individuelle, mais en cela intervient la sociologie empirique et expérimentale : dans sa capacité à repérer des régularités, à déceler des lois grâce à ses méthodes de terrain, et notamment à l'échantillonnage et à l'entretien, éventuellement à établir des corrélations entre de telles régularités et des variables significatives (âge, parcours, classe sociale, circonstances de la sociabilité, événements biographiques marquants, etc.).
Dans cet essai, comme son titre l'indique, en amont de la manière dont l'homosexualité est vécue par les femmes lesbiennes interrogées, la question est posée de ce que le lesbianisme représente pour elles, des variables sociologiques qui vont être retenues, de la représentation de soi en termes identitaires mais aussi et d'abord d'autonomination de soi en tant que lesbienne (ou autrement). Seulement ensuite, à partir du chap. V, l'expérience lesbienne est analysée sous un prisme très marqué par la vie de couple et surtout par les modalités des sexualités (chap. VI). L'entrée en couple et les modalités de celui-ci s'avèrent en effet avoir une place tout à fait prépondérante dans la construction de soi comme lesbienne et même dans le « coming out », c'est-à-dire dans la construction sociale comme lesbienne. le dernier chap. utilise la notion de « script » sexuel ; dans sa grande longueur et surtout dans la profondeur des détails dans lequel il entre, il décline une à une toutes les pratiques du rapport sexuel lesbien : ainsi m'a-t-il paru indigeste et rébarbatif. Mais je concède ex post qu'il est également essentiel à la démonstration, dans la mesure où il permet de mettre en relation ces pratiques sexuelles avec le genre, et en particulier avec leurs connotations habituelles masculines/féminine, rôle actif/passif, dominant/dominée, voire de les mettre en regard avec les pratiques analogues ayant cours dans des rapports hétérosexuels. Ainsi l'autrice peut avancer sa thèse fondamentale qui est la suivante : le lesbianisme, à certaines conditions, permet la dissolution du genre, ou a minima celle de certains rôles associés au genre dans la sexualité, notamment par leur interchangeabilité entre personnes du même sexe.
Du point de vue méthodologique, cet essai possède le grand mérite d'introduire les concepts d'après le matériau des entretiens, de manière déductive donc, et en faisant un usage judicieux des verbatim. Une partie (au moins un annexe) sur les critères d'échantillonnage voire simplement sur le nombre et les données sociologiques des personnes interviewées aurait été la bienvenue, d'autant plus qu'il m'a été difficile de repérer et regrouper les cit. des femmes nommées et identifiées par leur âge et souvent leur nomination (parcours, situation de couple, etc.).
En conclusion, ce travail a une grande valeur explicative du lesbianisme comme forme d'identité individuelle, saisie dans le contexte de la recherche de terrain, mais aussi comme forme théorique de critique et de prise de distance des normes sociales, incarnée par le vécu de la sexualité.
Table [avec appel des cit.]
Préface. le lesbianisme, vu de la sexualité – (par Michel Bozon)
Introduction [cit. 1]
Chap. Ier. « La lesbienne », ou l'invention d'une catégorie :
« La lesbienne » : une construction historique
Butch-fem : une subversion des codes ?
La traversée du féminisme : sexe, genre et lesbianisme
Quelques questions de méthode : le principe de l'autonomination
Chap. II. Lieux de rencontres :
Quel terrain pour quel type de sociabilité ?
Convivialité, culture et politique
Des sociabilités homosexuelles
Territorialité et spatialité lesbiennes : des contre-espaces pour mieux se reconnaître
Chap. III. Devenir lesbienne et représentation de soi :
Le sentiment d'anormalité face à la contrainte hétérosexuelle [cit. 2]
« De toute façon, moi, je n'étais pas une fille comme les autres »
« Je préfère les femmes »
« J'ai perdu du côté féminin en apparence »
« J'aime une certaine image de la féminité » [cit. 3]
Se reconnaître lesbiennes, ou les inclassables du genre
L'androgynie ou le genre indécidable [cit. 4]
Chap. IV. Des manières de se dire :
Le couple comme modèle de visibilité et d'énonciation du lesbianisme
Se dire par l'autonomination lesbienne
L'épreuve du déni
Les lesbiennes ne sont pas des femmes ?
La présomption d'hétérosexualité dans le milieu professionnel
Le couple comme mode de visibilité
Évaluation du contexte social et modes de nomination de soi [cit. 5]
Chap. V. Désir et modalités de couple :
La fidélité sexuelle et affective : une exigence partagée [cit. 6]
Le vécu du désir : une manière de confirmer l'existence du couple
Le couple n'est pas une certitude en soi
Conciliation de l'autonomie sexuelle et de la sécurité du lien
Le multipartenariat contractualisé : script récréatif et vie de couple
Critique du couple monogame : la polyfidélité comme modèle politique
La fidélité multiple : un idéal relationnel ? [cit. 7]
De la monogamie sérielle au multipartenariat affectif : un modèle intériorisé ?
Se « pacser » : une légitimation du couple homosexuel ?
Chap. VI. Les scénarios de la sexualité : normes et transgressions [cit. 8] :
L'accès à l'orgasme : un « must » du moment sexuel
Un script non ordonnancé par la pénétration coïtale
Prise d'autonomie avec le script hétérosexuel et pratiques pénétratives
La pénétration anale : tabou, acte contre nature ou trop intime ?
Les pratiques bucco-génitales : un acte sexuel en soi
Les objets sexuels : une utilisation circonstancielle
Des actes et des gestes : une manière de connaître l'autre avec soi
Masturbation et autoérotisme : des pratiques pauvres ?
L'usage des mots et le sens donné à la relation sexuelle
La relation idéale : au-delà de la simple génitalité
Des situations difficiles
Absence de soi ou de l'autre : inadéquation, limitation
Genre et script sexuel [cit. 9]
Butch-fem : réalités ou mythes ?
Les pratiques sado-masochistes, entre répulsion et revendication
La norme sexuelle en question : représentation et désidentification de genre
Conclusion. de l'égalité à la dissolution du genre [cit. 10]
Petit glossaire de vocabulaire lesbien
[...]
Dans cet essai, comme son titre l'indique, en amont de la manière dont l'homosexualité est vécue par les femmes lesbiennes interrogées, la question est posée de ce que le lesbianisme représente pour elles, des variables sociologiques qui vont être retenues, de la représentation de soi en termes identitaires mais aussi et d'abord d'autonomination de soi en tant que lesbienne (ou autrement). Seulement ensuite, à partir du chap. V, l'expérience lesbienne est analysée sous un prisme très marqué par la vie de couple et surtout par les modalités des sexualités (chap. VI). L'entrée en couple et les modalités de celui-ci s'avèrent en effet avoir une place tout à fait prépondérante dans la construction de soi comme lesbienne et même dans le « coming out », c'est-à-dire dans la construction sociale comme lesbienne. le dernier chap. utilise la notion de « script » sexuel ; dans sa grande longueur et surtout dans la profondeur des détails dans lequel il entre, il décline une à une toutes les pratiques du rapport sexuel lesbien : ainsi m'a-t-il paru indigeste et rébarbatif. Mais je concède ex post qu'il est également essentiel à la démonstration, dans la mesure où il permet de mettre en relation ces pratiques sexuelles avec le genre, et en particulier avec leurs connotations habituelles masculines/féminine, rôle actif/passif, dominant/dominée, voire de les mettre en regard avec les pratiques analogues ayant cours dans des rapports hétérosexuels. Ainsi l'autrice peut avancer sa thèse fondamentale qui est la suivante : le lesbianisme, à certaines conditions, permet la dissolution du genre, ou a minima celle de certains rôles associés au genre dans la sexualité, notamment par leur interchangeabilité entre personnes du même sexe.
Du point de vue méthodologique, cet essai possède le grand mérite d'introduire les concepts d'après le matériau des entretiens, de manière déductive donc, et en faisant un usage judicieux des verbatim. Une partie (au moins un annexe) sur les critères d'échantillonnage voire simplement sur le nombre et les données sociologiques des personnes interviewées aurait été la bienvenue, d'autant plus qu'il m'a été difficile de repérer et regrouper les cit. des femmes nommées et identifiées par leur âge et souvent leur nomination (parcours, situation de couple, etc.).
En conclusion, ce travail a une grande valeur explicative du lesbianisme comme forme d'identité individuelle, saisie dans le contexte de la recherche de terrain, mais aussi comme forme théorique de critique et de prise de distance des normes sociales, incarnée par le vécu de la sexualité.
Table [avec appel des cit.]
Préface. le lesbianisme, vu de la sexualité – (par Michel Bozon)
Introduction [cit. 1]
Chap. Ier. « La lesbienne », ou l'invention d'une catégorie :
« La lesbienne » : une construction historique
Butch-fem : une subversion des codes ?
La traversée du féminisme : sexe, genre et lesbianisme
Quelques questions de méthode : le principe de l'autonomination
Chap. II. Lieux de rencontres :
Quel terrain pour quel type de sociabilité ?
Convivialité, culture et politique
Des sociabilités homosexuelles
Territorialité et spatialité lesbiennes : des contre-espaces pour mieux se reconnaître
Chap. III. Devenir lesbienne et représentation de soi :
Le sentiment d'anormalité face à la contrainte hétérosexuelle [cit. 2]
« De toute façon, moi, je n'étais pas une fille comme les autres »
« Je préfère les femmes »
« J'ai perdu du côté féminin en apparence »
« J'aime une certaine image de la féminité » [cit. 3]
Se reconnaître lesbiennes, ou les inclassables du genre
L'androgynie ou le genre indécidable [cit. 4]
Chap. IV. Des manières de se dire :
Le couple comme modèle de visibilité et d'énonciation du lesbianisme
Se dire par l'autonomination lesbienne
L'épreuve du déni
Les lesbiennes ne sont pas des femmes ?
La présomption d'hétérosexualité dans le milieu professionnel
Le couple comme mode de visibilité
Évaluation du contexte social et modes de nomination de soi [cit. 5]
Chap. V. Désir et modalités de couple :
La fidélité sexuelle et affective : une exigence partagée [cit. 6]
Le vécu du désir : une manière de confirmer l'existence du couple
Le couple n'est pas une certitude en soi
Conciliation de l'autonomie sexuelle et de la sécurité du lien
Le multipartenariat contractualisé : script récréatif et vie de couple
Critique du couple monogame : la polyfidélité comme modèle politique
La fidélité multiple : un idéal relationnel ? [cit. 7]
De la monogamie sérielle au multipartenariat affectif : un modèle intériorisé ?
Se « pacser » : une légitimation du couple homosexuel ?
Chap. VI. Les scénarios de la sexualité : normes et transgressions [cit. 8] :
L'accès à l'orgasme : un « must » du moment sexuel
Un script non ordonnancé par la pénétration coïtale
Prise d'autonomie avec le script hétérosexuel et pratiques pénétratives
La pénétration anale : tabou, acte contre nature ou trop intime ?
Les pratiques bucco-génitales : un acte sexuel en soi
Les objets sexuels : une utilisation circonstancielle
Des actes et des gestes : une manière de connaître l'autre avec soi
Masturbation et autoérotisme : des pratiques pauvres ?
L'usage des mots et le sens donné à la relation sexuelle
La relation idéale : au-delà de la simple génitalité
Des situations difficiles
Absence de soi ou de l'autre : inadéquation, limitation
Genre et script sexuel [cit. 9]
Butch-fem : réalités ou mythes ?
Les pratiques sado-masochistes, entre répulsion et revendication
La norme sexuelle en question : représentation et désidentification de genre
Conclusion. de l'égalité à la dissolution du genre [cit. 10]
Petit glossaire de vocabulaire lesbien
[...]
J'ai l'habitude de lire des romans et il ne m'est pas toujours facile de me lancer dans la lecture d'un essai, qu'il soit politique ou sociologique.
Chaque fois que je me trouve devant un essai, je me sens envahie par un mélange d'une forte envie et un peu d'angoisse. Depuis mes années de fac, j'ai intégré l'idée que cette écriture est forcément compliquée, peu accessible, qui demande beaucoup d'efforts et de concetrantion. Mais dans une librairie, devant le rayon, parfois mon envie prend le dessus et j'ose, tout en pensant aux gains que je tirerai de ces efforts.
Parfois, en me plongeant dedans, à ma grande surprise, je me dis que ce n'est pas si compliqué, que tout est clair et compréhensible et je me sens rassurée et peu à peu j' apprends à apprécier ces textes.
J'ai trouvé cet essai de Natacha Chetcuti simple et très clair. Simple quant à sa forme, au lexique et à la syntaxe utilisées et non pas par sa réflexion ou son manque de profondeur.
Comme le titre l'indique bien, c'est un essai qui nous parle de lesbiennes, de la représentation de soi en tant que telle, de différents modes de nomination de soi, de coming out, de désir, de modalités de couple et de la sexualité aux sein de ceux-ci.
C'est bondé de témoignages de personnes d'âges différents, de sexualités différentes qui n'ont pas eu peur de nous dévoiler leurs vécus, leurs expériences, leurs parcours et qui nous ont ouvert en grand la porte vers leur intimité.
C'était intéressant de voir qu'il y a autant de représentations, de nominations de soi et de pratiques, que de lesbiennes. Et ça m'a fait du bien, car parfois dans certains de ces témoignages, j'ai pu me retrouver, même si je ne me définis pas comme telle.
Chaque fois que je me trouve devant un essai, je me sens envahie par un mélange d'une forte envie et un peu d'angoisse. Depuis mes années de fac, j'ai intégré l'idée que cette écriture est forcément compliquée, peu accessible, qui demande beaucoup d'efforts et de concetrantion. Mais dans une librairie, devant le rayon, parfois mon envie prend le dessus et j'ose, tout en pensant aux gains que je tirerai de ces efforts.
Parfois, en me plongeant dedans, à ma grande surprise, je me dis que ce n'est pas si compliqué, que tout est clair et compréhensible et je me sens rassurée et peu à peu j' apprends à apprécier ces textes.
J'ai trouvé cet essai de Natacha Chetcuti simple et très clair. Simple quant à sa forme, au lexique et à la syntaxe utilisées et non pas par sa réflexion ou son manque de profondeur.
Comme le titre l'indique bien, c'est un essai qui nous parle de lesbiennes, de la représentation de soi en tant que telle, de différents modes de nomination de soi, de coming out, de désir, de modalités de couple et de la sexualité aux sein de ceux-ci.
C'est bondé de témoignages de personnes d'âges différents, de sexualités différentes qui n'ont pas eu peur de nous dévoiler leurs vécus, leurs expériences, leurs parcours et qui nous ont ouvert en grand la porte vers leur intimité.
C'était intéressant de voir qu'il y a autant de représentations, de nominations de soi et de pratiques, que de lesbiennes. Et ça m'a fait du bien, car parfois dans certains de ces témoignages, j'ai pu me retrouver, même si je ne me définis pas comme telle.
Pour cet essai, Natacha Chetcuti a interrogé des lesbiennes sur leur coming out, sur leurs premières relations, comment elles s'identifient (s'affirment-elles en tant que lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles…?), etc. de leur vie sociale à leur vie sexuelle, sans oublier leurs rapports professionnels, Chetcuti dresse des portraits de femmes homosexuelles ; ils forment un ensemble que l'autrice a étudié afin de partager avec nous ses recherches.
Cet essai est une relecture ; j'avais eu l'occasion de le découvrir à sa sortie (2010) mais il m'avait laissé peu de souvenirs. J'étais jeune et, si le sujet m'intéressait, je n'avais toutefois pas assez de bagage pour vraiment m'imprégner de toutes les données dont il est question dans le livre. Avec le temps, je comprends mieux pourquoi Chetcuti a ciblé des lesbiennes entre 30 et 50 ans : elles ont suffisamment d'expériences diverses et de recul pour pouvoir en parler sans filtre, pour pouvoir les comparer les unes aux autres.
Si l'on remarque que Se dire lesbienne date déjà un peu (par exemple, le mariage n'était pas autorisé pour les homosexuel.le.s lors de sa parution), les propos restent pertinents, notamment en ce qui concerne la sous-représentation des lesbiennes dans la société, et donc le manque de modèles. Toutefois, en faisant le parallèle avec mon vécu, avec le vécu de mes amies, je constate qu'il suffit d'une génération pour observer des points de vue bien différents sur certains sujets, sur lesquels il faut alors avoir un peu de recul. Cela dit, même si l'on ne s'y retrouve pas forcément, cela nous permet de nous interroger.
C'est donc un livre à lire, à partager, et dont il faut ensuite discuter ; il faut remettre les choses dans leur contexte. Il est très ciblé mais peut être lu autant par des lesbiennes que par hétérosexuel.le.s, et quiconque le souhaite.
Lien : https://malecturotheque.word..
Cet essai est une relecture ; j'avais eu l'occasion de le découvrir à sa sortie (2010) mais il m'avait laissé peu de souvenirs. J'étais jeune et, si le sujet m'intéressait, je n'avais toutefois pas assez de bagage pour vraiment m'imprégner de toutes les données dont il est question dans le livre. Avec le temps, je comprends mieux pourquoi Chetcuti a ciblé des lesbiennes entre 30 et 50 ans : elles ont suffisamment d'expériences diverses et de recul pour pouvoir en parler sans filtre, pour pouvoir les comparer les unes aux autres.
Si l'on remarque que Se dire lesbienne date déjà un peu (par exemple, le mariage n'était pas autorisé pour les homosexuel.le.s lors de sa parution), les propos restent pertinents, notamment en ce qui concerne la sous-représentation des lesbiennes dans la société, et donc le manque de modèles. Toutefois, en faisant le parallèle avec mon vécu, avec le vécu de mes amies, je constate qu'il suffit d'une génération pour observer des points de vue bien différents sur certains sujets, sur lesquels il faut alors avoir un peu de recul. Cela dit, même si l'on ne s'y retrouve pas forcément, cela nous permet de nous interroger.
C'est donc un livre à lire, à partager, et dont il faut ensuite discuter ; il faut remettre les choses dans leur contexte. Il est très ciblé mais peut être lu autant par des lesbiennes que par hétérosexuel.le.s, et quiconque le souhaite.
Lien : https://malecturotheque.word..
Citations et extraits (15)
Voir plus
Ajouter une citation
10. « Elles proposent une voie de 'dénaturalisation' de la sexualité hétéronormative qui renvoie à une indifférenciation des genres et s'incarne le plus souvent dans l'androgynie. Même l'intégration du registre 'butch-fem' dans la sexualité témoigne davantage de l'acquisition d'un code culturel lesbien exprimant une intentionnalité érotique que de pratiques sexuelles prescrites. Les femmes hétérosexuelles interrogées, au contraire, sont moins préoccupées d'annuler le marquage de genre que d'accéder à une égalité entre des partenaires de sexe différent.
La réévaluation des normes de genre, pour la totalité des lesbiennes interrogées, s'effectue par une mise à distance de la définition sociale de la féminité et de ses attributs dévalorisants : 1) par la revendication d'une certaine masculinité ; 2) par la critique du masculin et du féminin au sein du couple 'butch-fem' ; 3) par la redéfinition, le long d'un continuum de féminité, de la catégorie "femme" ; 4) par le rejet de la bicatégorisation du genre et le recours au modèle de l'androgyne. Il est plus valorisé chez les 30-50 ans. Chez les plus jeunes (15-35 ans), domine un modèle qui tend davantage à mettre en avant les normes de la féminité dans la présentation de soi en tant que lesbienne. Est-ce une manière de renforcer l'invisibilité de l'homosexualité féminine ? Ou, au contraire, n'aurait-on pas affaire à une mutation sociologique : déjouer la norme hétérosexuelle du côté des attendus du "féminin", tout en affirmant une position lesbienne ? » (pp. 278-279)
La réévaluation des normes de genre, pour la totalité des lesbiennes interrogées, s'effectue par une mise à distance de la définition sociale de la féminité et de ses attributs dévalorisants : 1) par la revendication d'une certaine masculinité ; 2) par la critique du masculin et du féminin au sein du couple 'butch-fem' ; 3) par la redéfinition, le long d'un continuum de féminité, de la catégorie "femme" ; 4) par le rejet de la bicatégorisation du genre et le recours au modèle de l'androgyne. Il est plus valorisé chez les 30-50 ans. Chez les plus jeunes (15-35 ans), domine un modèle qui tend davantage à mettre en avant les normes de la féminité dans la présentation de soi en tant que lesbienne. Est-ce une manière de renforcer l'invisibilité de l'homosexualité féminine ? Ou, au contraire, n'aurait-on pas affaire à une mutation sociologique : déjouer la norme hétérosexuelle du côté des attendus du "féminin", tout en affirmant une position lesbienne ? » (pp. 278-279)
3. « Pour les trois quarts des lesbiennes interrogées, le lesbianisme représente une rupture avec la féminité traditionnelle prenant la forme d'une certaine masculinité revendiquée ou d'un entre-deux du genre. Les autres pensent le lesbianisme comme un continuum de la catégorie "femme".
[…]
Cette conception du lesbianisme lui a permis [un cas d'adhésion à la conception du continuum est analysé en détail] d'acquérir une représentation de sa nouvelle identité sexuelle acceptable pour elle, sans lui faire perdre sa place dans le système de genre. Elle met davantage l'accent sur l'adhésion au sexe/genre que sur la critique du genre, ce qui lui permet de relativiser sa place en tant que femme par rapport aux hommes.
[…]
Aucune des lesbiennes interrogées ne se revendique "fem", peut-être parce qu'il est plus difficile de rejeter consciemment les catégorisations binaires de sexe en créant une nouvelle problématisation de la relation sexe/genre par une pratique fem.
À partir des témoignages recueillis, on constate que le corps "féminisé" n'est pas une valeur majoritairement reconnaissable pas les lesbiennes socialisées dans des groupes politiques ou culturels. Même si, avec la progression du "queer", le port de vêtements féminins n'est plus aussi marginalisant, il peut signifier, dans certains réseaux de socialisation lesbiens politiques de la génération des 30-50 ans, un faible niveau de critique de l'hétérosexualité. Utiliser ce mode de présentation genrée, sans marquer dans le discours une rupture théorique avec la féminité traditionnelle, peut rendre la personne suspecte d'alliance avec l'hétérosexualité et lui donner l'impression d'être marginalisée, non reconnue par ses paires, voire stigmatisée. » (pp. 81-84)
[…]
Cette conception du lesbianisme lui a permis [un cas d'adhésion à la conception du continuum est analysé en détail] d'acquérir une représentation de sa nouvelle identité sexuelle acceptable pour elle, sans lui faire perdre sa place dans le système de genre. Elle met davantage l'accent sur l'adhésion au sexe/genre que sur la critique du genre, ce qui lui permet de relativiser sa place en tant que femme par rapport aux hommes.
[…]
Aucune des lesbiennes interrogées ne se revendique "fem", peut-être parce qu'il est plus difficile de rejeter consciemment les catégorisations binaires de sexe en créant une nouvelle problématisation de la relation sexe/genre par une pratique fem.
À partir des témoignages recueillis, on constate que le corps "féminisé" n'est pas une valeur majoritairement reconnaissable pas les lesbiennes socialisées dans des groupes politiques ou culturels. Même si, avec la progression du "queer", le port de vêtements féminins n'est plus aussi marginalisant, il peut signifier, dans certains réseaux de socialisation lesbiens politiques de la génération des 30-50 ans, un faible niveau de critique de l'hétérosexualité. Utiliser ce mode de présentation genrée, sans marquer dans le discours une rupture théorique avec la féminité traditionnelle, peut rendre la personne suspecte d'alliance avec l'hétérosexualité et lui donner l'impression d'être marginalisée, non reconnue par ses paires, voire stigmatisée. » (pp. 81-84)
6. « Les raisons pour lesquelles les lesbiennes pratiquent la norme de l'exclusivité sexuelle sont en grande partie liées à un conditionnement de genre qui ne sépare pas sexualité, amour et conjugalité. Elles manifestent ici leur adhésion à la norme de genre et à l'idéologie de l'amour comme centre de l'expérience majoritairement valorisée pour les femmes. Dans la pratique, la pérennité du couple n'est jamais assurée, les relations les plus durables dans les couples interrogés tenant de huit à dix ans. L'ensemble des répondantes sont conscientes de la fragilité d'un couple qui dépend, en grande partie, de l'accomplissement du désir.
Il en résulte deux positions contraires. L'une donne la priorité au couple comme lieu privilégié de l'expérience individuelle sur le plan affectif et considère que l'amour/désir doit tenir une place importante dans la réalisation du soi lesbien. La seconde procède d'une analyse politique qui associe le couple à la perte d'autonomie de soi. Luttant contre la dépendance que crée la situation conjugale, certaines lesbiennes voudraient distinguer l'épanouissement du soi individuel de celui du soi conjugal. Certaines en viennent à remettre en cause l'idéologie de l'amour qui maintient une dépendance à l'autre.
Les pratiques de couple varient toutefois selon la place donnée à "l'identité" homosexuelle dans l'histoire du couple et du degré d'implication militante de la personne. » (p. 139)
Il en résulte deux positions contraires. L'une donne la priorité au couple comme lieu privilégié de l'expérience individuelle sur le plan affectif et considère que l'amour/désir doit tenir une place importante dans la réalisation du soi lesbien. La seconde procède d'une analyse politique qui associe le couple à la perte d'autonomie de soi. Luttant contre la dépendance que crée la situation conjugale, certaines lesbiennes voudraient distinguer l'épanouissement du soi individuel de celui du soi conjugal. Certaines en viennent à remettre en cause l'idéologie de l'amour qui maintient une dépendance à l'autre.
Les pratiques de couple varient toutefois selon la place donnée à "l'identité" homosexuelle dans l'histoire du couple et du degré d'implication militante de la personne. » (p. 139)
5. « La question fondamentale que révèlent les données présentées pourrait s'énoncer ainsi : "entre dire et laisser voir", quelles sont les marges de manœuvre d'un groupe minoritaire ? Les observations réalisées et l'analyse des entretiens ont montré que les processus du dire et du laisser voir s'insèrent dans des moments particuliers de la biographie (rencontre avec une partenaire se définissant comme lesbienne, mise en couple, fréquentation de groupes politiques), mais restent ancrés dans la mémoire comme des moments pénibles, dans la majeure partie des cas. De plus, les femmes interrogées, qu'elles soient dans un lesbianisme revendiqué ou non, ont dû faire face à des comportements agressifs (regards blessants, insultes).
[…]
Bien souvent, prendre la décision de se dire lesbienne (notamment dans l'espace professionnel) implique une reconnaissance de soi suffisamment positive pour répondre aux éventuelles attitudes ou propos dévalorisants. Selon le contexte dans lequel est parlé le lesbianisme, le dire ou le laisser voir dépend d'un ensemble de pratiques, de normes, de règles et de savoirs sociaux qui ont des conséquences réelles et très concrètes sur les individus touchés. » (pp. 134-135)
[…]
Bien souvent, prendre la décision de se dire lesbienne (notamment dans l'espace professionnel) implique une reconnaissance de soi suffisamment positive pour répondre aux éventuelles attitudes ou propos dévalorisants. Selon le contexte dans lequel est parlé le lesbianisme, le dire ou le laisser voir dépend d'un ensemble de pratiques, de normes, de règles et de savoirs sociaux qui ont des conséquences réelles et très concrètes sur les individus touchés. » (pp. 134-135)
1. « On finit par se dire lesbienne au terme de trois types de parcours que les récits de vie m'ont permis d'identifier.
Les 'parcours exclusifs' sont vécus par des femmes qui n'ont jamais eu de relations sexuelles avec des hommes. Ce sont les moins nombreuses. Elles ont le plus souvent connu leur première relation sexuelle avec une femme entre 20 et 24 ans.
[…]
Plus fréquents, les 'parcours […] simultanés' sont composés de femmes ayant vécu leur premier rapport sexuel entre 13 et 22 ans. Elles ont commencé leur vie sexuelle avec une femme ou un homme dans la même période, pour ensuite ne vivre que des relations avec des femmes. […]
Les 'parcours progressifs' sont largement majoritaires. Ils se distinguent des autres parcours par la durée de l'expérience hétérosexuelle, mais également par les types de relations engagées avec les hommes. L'orientation sexuelle à laquelle les interviewées se réfèrent dans ce cas est l'hétérosexualité exclusive ou bisexuelle, au moins dans le premier temps de leur cheminement sexuel. […] Après avoir vécu cinq à dix ans de conjugalités hétérosexuelles, elles s'engagent le plus souvent dans des relations avec des femmes de manière exclusive. » (pp. 19-21)
Les 'parcours exclusifs' sont vécus par des femmes qui n'ont jamais eu de relations sexuelles avec des hommes. Ce sont les moins nombreuses. Elles ont le plus souvent connu leur première relation sexuelle avec une femme entre 20 et 24 ans.
[…]
Plus fréquents, les 'parcours […] simultanés' sont composés de femmes ayant vécu leur premier rapport sexuel entre 13 et 22 ans. Elles ont commencé leur vie sexuelle avec une femme ou un homme dans la même période, pour ensuite ne vivre que des relations avec des femmes. […]
Les 'parcours progressifs' sont largement majoritaires. Ils se distinguent des autres parcours par la durée de l'expérience hétérosexuelle, mais également par les types de relations engagées avec les hommes. L'orientation sexuelle à laquelle les interviewées se réfèrent dans ce cas est l'hétérosexualité exclusive ou bisexuelle, au moins dans le premier temps de leur cheminement sexuel. […] Après avoir vécu cinq à dix ans de conjugalités hétérosexuelles, elles s'engagent le plus souvent dans des relations avec des femmes de manière exclusive. » (pp. 19-21)
autres livres classés : LesbiennesVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Natacha Chetcuti (3)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philosophes au cinéma
Ce film réalisé par Derek Jarman en 1993 retrace la vie d'un philosophe autrichien né à Vienne en 1889 et mort à Cambridge en 1951. Quel est son nom?
Ludwig Wittgenstein
Stephen Zweig
Martin Heidegger
8 questions
156 lecteurs ont répondu
Thèmes :
philosophie
, philosophes
, sociologie
, culture générale
, cinema
, adapté au cinéma
, adaptation
, littératureCréer un quiz sur ce livre156 lecteurs ont répondu