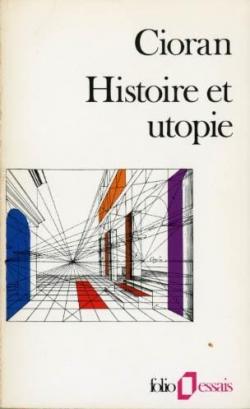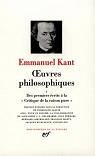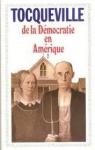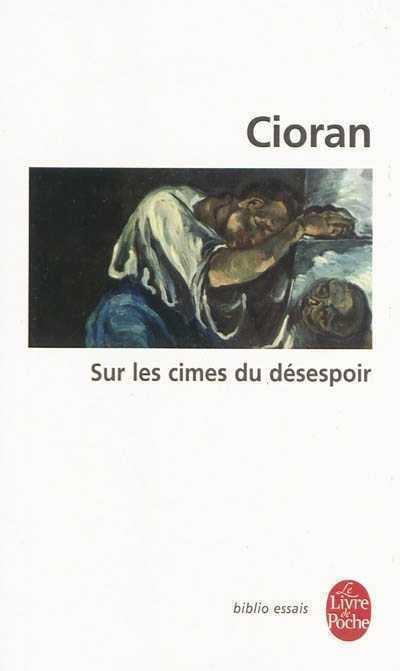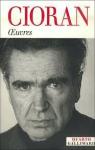Emil Cioran/5
72 notes
Résumé :
Seul un monstre peut se permettre le luxe de voir les choses telles qu'elles sont. Mais une collectivité ne subsiste que dans la mesure où elle se crée des fictions, les entretient et s'y attache. S'emploie-t-elle à cultiver la lucidité et le sarcasme, à considérer le vrai sans mélange, le réel à l'état pur ? Elle se désagrège, elle s'effondre. D'où pour elle ce besoin métaphysique de fraude, cette nécessité de concevoir, d'inventer, à l'intérieur du temps, une duré... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Histoire et utopieVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (10)
Voir plus
Ajouter une critique
Histoire et utopie ne décevra pas les amateurs de Cioran. Pessimiste, désabusement, mise en lumière de la laideur humaine, plus proche de la vérité que tous les bons sentiments, l'empathie, le pardon, la quête d'un âge d'or et d'une société idéale qui ne sont que les revers naïfs d'une médaille noire, rarement grise foncée... j'ai trouvé certaines de ses analyses d'une lucidité froide et d'un modernisme historique étonnant...je me suis noté de le relire pour approfondir certains passages.
Cioran n'aime pas du tout les utopies, qu'il considère comme stupides : la nature humaine étant ce qu'elle est, la société ne peut guère être autrement.
Le pessimisme de Cioran n'est manifestement pas surfait. Rien n'est sûr, grosso modo, à part la mort et le vice.
La principale caractéristique des utopies est de créer des êtres-marionnettes, incapables de la moindre réflexion et dépourvus du plus petit trait psychologique.
Cependant, le scepticisme de Cioran n'est pas intégral ; il accorde tout de même un léger avantage à la société capitaliste.
Le pessimisme de Cioran n'est manifestement pas surfait. Rien n'est sûr, grosso modo, à part la mort et le vice.
La principale caractéristique des utopies est de créer des êtres-marionnettes, incapables de la moindre réflexion et dépourvus du plus petit trait psychologique.
Cependant, le scepticisme de Cioran n'est pas intégral ; il accorde tout de même un léger avantage à la société capitaliste.
Alors que dans "La chute dans le temps", Cioran se recentrait sur l'individu, il se place ici au niveau du collectif, du temps historique. Pour cet ouvrage aussi, il s'agit de plusieurs feuillets rassemblés par l'éditeur, ce qui donne une succession de plusieurs textes centrés sur des thèmes particuliers. On commence par une comparaison entre la société capitaliste et communiste sous la forme d'une lettre adressée à un ami roumain pour en arriver à des réflexions sur le pouvoir et la marche de l'Histoire. L'Histoire, qui d'ailleurs, ne mène à rien et n'a aucun sens, selon Cioran. Pour résumer très grossièrement, c'est toujours le plus fort de la meute qui prend le pouvoir.
On retrouve toute la misanthropie de Cioran dans un style toujours très lyrique, mais précis. Cependant, j'ai eu parfois bien du mal à comprendre où il voulait en venir. Ses idées sont tellement contraires à la pensée dominante, qu'on reste souvent bouche bée, les yeux écarquillés devant ses assertions. C'est d'ailleurs ce qui me plait dans ses livres. Il n'hésite pas à dénigrer l'homme, l'humanité et lui-même, mais son nihilisme est parfois déroutant, presqu'inquiétant. Attention à ne pas se laisser submerger !
Pour amateurs éclairés.
On retrouve toute la misanthropie de Cioran dans un style toujours très lyrique, mais précis. Cependant, j'ai eu parfois bien du mal à comprendre où il voulait en venir. Ses idées sont tellement contraires à la pensée dominante, qu'on reste souvent bouche bée, les yeux écarquillés devant ses assertions. C'est d'ailleurs ce qui me plait dans ses livres. Il n'hésite pas à dénigrer l'homme, l'humanité et lui-même, mais son nihilisme est parfois déroutant, presqu'inquiétant. Attention à ne pas se laisser submerger !
Pour amateurs éclairés.
Publiés pour la première fois en 1960 par Gallimard, les six chapitres qui constituent "Histoire et utopie" sont à la fois un tour d'horizon des tyrannies, des démocraties, des utopies et des religions, une manière de nouveau "Le Prince" - en écho à celui de Machiavel- et enfin une vision implacable de l'individu social et de tous ses défauts. Court, bien écrit et pertinent cet ouvrage donne à penser et à réfléchir. Juste un bémol concernant l'évocation de l'URSS et de ses satellites qui est forcément datée, à l'inverse des considérations sur l'âme slave et sur les tyrans de l'Est.
Machiavel revu à l'aune de la psychologie individuelle des tyrans et collective des peuples dont l'acceptation docile de l'asservissement conduit au ravissement. Avec une analyse de la "cosmogonie" russe qui nous donne des clefs pour appréhender l'actualité
Un essai dérangeant qui déconstruit l'espérance en la démocratie, dévaste nos utopies, écharpe nos idéaux et nous abandonne au pessimisme structurel de Cioran.
Un essai dérangeant qui déconstruit l'espérance en la démocratie, dévaste nos utopies, écharpe nos idéaux et nous abandonne au pessimisme structurel de Cioran.
Citations et extraits (76)
Voir plus
Ajouter une citation
Chaque civilisation croit que son mode de vie est le seul bon et le seul concevable, qu'elle doit y convertir le monde ou le lui infliger. On ne fonde pas un empire seulement par caprice. On assujettit les autres pour qu'ils vous imitent, pour qu'ils se modèlent sur vous, sur vos croyances et vos habitudes ; vient ensuite l'impératif pervers d'en faire des esclaves pour contempler en eux l'ébauche flatteuse ou caricaturale de soi-même.
« Et le peuple ? » dira-t-on. Le penseur ou l'historien qui emploie ce mot sans ironie se disqualifie. Le « peuple », on sait trop bien à quoi il est destiné : subir les événements, et les fantaisies des gouvernants. Toute expérience politique, si « avancée » fût-elle, se déroule à ses dépens, se dirige contre lui : il porte les stigmates de l'esclavage par arrêt divin ou diabolique. Inutile de s'apitoyer sur lui : sa cause est sans ressource. Nations et empires se forment par sa complaisance aux iniquités dont il est l'objet. Point de chef d'État, ni de conquérant qui ne le méprise ; mais il accepte ce mépris, et en vit. [...] Tel qu'il est, il représente une invitation au despotisme. Il supporte ses épreuves, parfois il les sollicite, et ne se révolte contre elles que pour courir vers de nouvelles, plus atroces que les anciennes. La révolution étant son seul luxe, il s'y précipite, non pas tant pour en retirer quelques bénéfices ou améliorer son sort, que pour acquérir lui aussi le droit d'être insolent, avantage qui le console de ses déconvenues habituelles, mais qu'il perd aussitôt qu'on abolit les privilèges du désordre. Aucun régime n'assurant son salut, il s'accommode de tous et d'aucun. Et, depuis le Déluge jusqu'au Jugement, tout ce à quoi il peut prétendre, c'est de remplir honnêtement sa mission de vaincu.
Nous n'agissons que sous la fascination de l'impossible ; autant dire qu'une société incapable d'enfanter une utopie et de s'y vouer est menacée de sclérose et de ruine.
p.119.
Aujourd’hui, réconciliés avec le terrible, nous assistons à une contamination de l’utopie par l’apocalypse : la « nouvelle terre » qu’on nous annonce affecte de plus en plus la figure d’un nouvel enfer. Mais, cet enfer, nous l’attendons, nous nous faisons même un devoir d’en précipiter la venue. Les deux genres, l’utopique et l’apocalyptique, qui nous apparaissaient si dissemblables, s’interpénètrent, déteignent maintenant l’un sur l’autre, pour en former un troisième, merveilleusement apte à refléter la sorte de réalité qui nous menace et à laquelle nous dirons néanmoins oui, un oui correct et sans illusion. Ce sera notre manière d’être irrépprochables devant la fatalité.
Aujourd’hui, réconciliés avec le terrible, nous assistons à une contamination de l’utopie par l’apocalypse : la « nouvelle terre » qu’on nous annonce affecte de plus en plus la figure d’un nouvel enfer. Mais, cet enfer, nous l’attendons, nous nous faisons même un devoir d’en précipiter la venue. Les deux genres, l’utopique et l’apocalyptique, qui nous apparaissaient si dissemblables, s’interpénètrent, déteignent maintenant l’un sur l’autre, pour en former un troisième, merveilleusement apte à refléter la sorte de réalité qui nous menace et à laquelle nous dirons néanmoins oui, un oui correct et sans illusion. Ce sera notre manière d’être irrépprochables devant la fatalité.
La pitié en général, qu'est-elle sinon le vice de la bonté ? Tirant son efficace du principe mauvais qu'elle recèle, elle jubile aux épreuves des autres, s'en régale, en savoure le poison, se jette sur tous les maux qu'elle aperçoit ou pressent, rêve de l'enfer comme d'une terre promise, le postule, n'arrive guère à s'en passer, et, si elle n'est pas destructrice par elle-même, elle profite néanmoins de tout ce qui détruit. Extrême déviation de la bonté, elle finit par en être la négation, chez les saints encore plus que chez vous. Pour s'en convaincre, qu'on fréquente leurs Vies et que l'on y contemple la voracité avec laquelle ils se précipitent sur nos péchés, la nostalgie qu'ils éprouvent de la dégringolade fulgurante ou du remords interminable, leur exaspération devant la médiocrité de nos scélératesses et leur regret de n'avoir pas à se tourmenter davantage pour notre rachat.
Videos de Emil Cioran (34)
Voir plusAjouter une vidéo
CHAPITRES :
0:00 - Titre
C : 0:06 - CRÉATION - Paul Bourget 0:17 - CRÉATION DE L'HOMME - Jean Dutourd 0:28 - CROIRE - Comte de Las Cases
D : 0:38 - DÉBAUCHE - Restif de la Bretonne 0:51 - DÉCEPTION - Fréron 1:04 - DÉLUGE - Jean-François Ducis 1:15 - DÉMOCRATE - Georges Clemenceau 1:26 - DERRIÈRE - Montaigne 1:36 - DOCTRINE - Édouard Herriot 1:46 - DOULEUR - Honoré de Balzac 1:58 - DOUTE - Henri Poincaré
E : 2:11 - ÉCHAFAUD - Émile Pontich 2:23 - ÉCOUTER - Rohan-Chabot 2:33 - ÉGALITÉ - Ernest Jaubert 2:43 - ÉGOCENTRISME - René Bruyez 3:00 - ÉGOÏSME - Comte d'Houdetot 3:10 - ÉLECTION - Yves Mirande 3:21 - ENFANT - Remy de Gourmont 3:33 - ENNUI - Emil Cioran 3:41 - ENSEIGNER - Jacques Cazotte 3:53 - ENTENTE - Gilbert Cesbron 4:05 - ENTERREMENT - Jean-Jacques Rousseau 4:14 - ÉPOUSE - André Maurois 4:37 - ÉPOUSER UNE FEMME - Maurice Blondel 4:48 - ESPOIR - Paul Valéry 4:57 - ESPRIT - Vicomte de Freissinet de Valady 5:07 - EXPÉRIENCE - Barbey d'Aurevilly
F : 5:18 - FATALITÉ - Anne-Marie Swetchine 5:27 - FIDÉLITÉ - Rivarol
5:41 - Générique
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE : Jean Delacour, Tout l'esprit français, Paris, Albin Michel, 1974.
IMAGES D'ILLUSTRATION : Paul Bourget : https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Bourget#/media/File:Paul_Bourget_7.jpg Jean Dutourd : https://www.purepeople.com/media/jean-dutourd-est-mort-a-l-age-de-91_m544292 Comte de Las Cases : https://www.babelio.com/auteur/Emmanuel-de-Las-Cases/169833 Restif de la Bretonne : https://fr.wikiquote.org/wiki/Nicolas_Edme_Restif_de_La_Bretonne#/media/Fichier:NicolasRestifdeLaBretonne.jpg Fréron : https://www.musicologie.org/Biographies/f/freron_elie_catherine.html Jean-François Ducis : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-François_Ducis#/media/Fichier:Jean-François_Ducis_par_le_baron_Gérard.jpg Georges Clemenceau : https://www.lareorthe.fr/Georges-Clemenceau_a58.html Montaigne : https://www.walmart.ca/fr/ip/Michel-Eyquem-De-Montaigne-N-1533-1592-French-Essayist-And-Courtier-Line-Engraving-After-A-Painting-By-An-Unknown-16Th-Century-Artist-Poster-Print-18/1T9RWV8P5A9D Édouard Herriot : https://www.babelio.com/auteur/Edouard-Herriot/78775 Honoré de Balzac : https://www.hachettebnf.fr/sites/default/files/images/intervenants/000000000042_L_Honor%25E9_de_Balzac___%255Bphotographie_%255B...%255DAtelier_Nadar_btv1b53118945v.JPEG Henri Poincaré : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Henri_Poincaré_-_Dernières_pensées%2C_1920_%28page_16_crop%29.jpg René Bruyez : https://aaslan.com/english/gallery/sculpture/Bruyez.html Yves Mirande : https://www.abebooks.com/photographs/Yves-MIRANDE-auteur-superviseur-film-CHANCE/31267933297/bd#&gid=1&pid=1 Remy de Gourmont : https://www.editionsdelherne.com/publication/cahier-gourmont/ Emil Cioran : https://www.penguin.com.au/books/the-trouble-with
C : 0:06 - CRÉATION - Paul Bourget 0:17 - CRÉATION DE L'HOMME - Jean Dutourd 0:28 - CROIRE - Comte de Las Cases
D : 0:38 - DÉBAUCHE - Restif de la Bretonne 0:51 - DÉCEPTION - Fréron 1:04 - DÉLUGE - Jean-François Ducis 1:15 - DÉMOCRATE - Georges Clemenceau 1:26 - DERRIÈRE - Montaigne 1:36 - DOCTRINE - Édouard Herriot 1:46 - DOULEUR - Honoré de Balzac 1:58 - DOUTE - Henri Poincaré
E : 2:11 - ÉCHAFAUD - Émile Pontich 2:23 - ÉCOUTER - Rohan-Chabot 2:33 - ÉGALITÉ - Ernest Jaubert 2:43 - ÉGOCENTRISME - René Bruyez 3:00 - ÉGOÏSME - Comte d'Houdetot 3:10 - ÉLECTION - Yves Mirande 3:21 - ENFANT - Remy de Gourmont 3:33 - ENNUI - Emil Cioran 3:41 - ENSEIGNER - Jacques Cazotte 3:53 - ENTENTE - Gilbert Cesbron 4:05 - ENTERREMENT - Jean-Jacques Rousseau 4:14 - ÉPOUSE - André Maurois 4:37 - ÉPOUSER UNE FEMME - Maurice Blondel 4:48 - ESPOIR - Paul Valéry 4:57 - ESPRIT - Vicomte de Freissinet de Valady 5:07 - EXPÉRIENCE - Barbey d'Aurevilly
F : 5:18 - FATALITÉ - Anne-Marie Swetchine 5:27 - FIDÉLITÉ - Rivarol
5:41 - Générique
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE : Jean Delacour, Tout l'esprit français, Paris, Albin Michel, 1974.
IMAGES D'ILLUSTRATION : Paul Bourget : https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Bourget#/media/File:Paul_Bourget_7.jpg Jean Dutourd : https://www.purepeople.com/media/jean-dutourd-est-mort-a-l-age-de-91_m544292 Comte de Las Cases : https://www.babelio.com/auteur/Emmanuel-de-Las-Cases/169833 Restif de la Bretonne : https://fr.wikiquote.org/wiki/Nicolas_Edme_Restif_de_La_Bretonne#/media/Fichier:NicolasRestifdeLaBretonne.jpg Fréron : https://www.musicologie.org/Biographies/f/freron_elie_catherine.html Jean-François Ducis : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-François_Ducis#/media/Fichier:Jean-François_Ducis_par_le_baron_Gérard.jpg Georges Clemenceau : https://www.lareorthe.fr/Georges-Clemenceau_a58.html Montaigne : https://www.walmart.ca/fr/ip/Michel-Eyquem-De-Montaigne-N-1533-1592-French-Essayist-And-Courtier-Line-Engraving-After-A-Painting-By-An-Unknown-16Th-Century-Artist-Poster-Print-18/1T9RWV8P5A9D Édouard Herriot : https://www.babelio.com/auteur/Edouard-Herriot/78775 Honoré de Balzac : https://www.hachettebnf.fr/sites/default/files/images/intervenants/000000000042_L_Honor%25E9_de_Balzac___%255Bphotographie_%255B...%255DAtelier_Nadar_btv1b53118945v.JPEG Henri Poincaré : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Henri_Poincaré_-_Dernières_pensées%2C_1920_%28page_16_crop%29.jpg René Bruyez : https://aaslan.com/english/gallery/sculpture/Bruyez.html Yves Mirande : https://www.abebooks.com/photographs/Yves-MIRANDE-auteur-superviseur-film-CHANCE/31267933297/bd#&gid=1&pid=1 Remy de Gourmont : https://www.editionsdelherne.com/publication/cahier-gourmont/ Emil Cioran : https://www.penguin.com.au/books/the-trouble-with
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Types d'Etats et de gouvernementsVoir plus
>Sciences sociales>Science politique>Types d'Etats et de gouvernements (94)
autres livres classés : Civilisation occidentaleVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Emil Cioran (43)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
848 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre848 lecteurs ont répondu