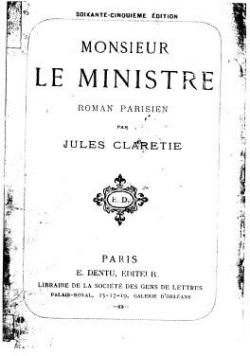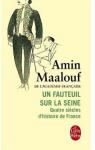La Commune de Paris : Analyse spectrale de l’Occident (1965 / France Culture). Diffusion sur France Culture le 12 juin 1965. Illustration : Une photo de la Barricade de la Chaussée Ménilmontant, Paris, 18 mars 1871 © Getty / Bettmann / Contributeur. Pierre Sipriot s'entretient avec Henri Guillemin (critique littéraire, historien, conférencier, polémiste, homme de radio et de télévision), Emmanuel Berl (journaliste, historien, essayiste), Adrien Dansette (historien, juriste), Pierre Descaves (écrivain, chroniqueur, homme de radio), Jacques Rougerie (historien spécialiste de la Commune de Paris), Philippe Vigier (historien contemporanéiste spécialiste de la Deuxième République), Henri Lefebvre (philosophe), et Georges Lefranc (historien spécialiste du socialisme et du syndicalisme). Dans les années 60, la Commune de Paris était encore "un objet chaud" qui divisait profondément les historiens. Comme en atteste ce débat diffusé pour la première fois sur les ondes de France Culture en juin 1965 et qui réunissait sept historiens, journalistes ou philosophes spécialistes du XIXe siècle. Textes d'Élémir Bourges, Jules Claretie, Lucien Descaves, Paul et Victor Margueritte, Jules Vallès et Émile Zola lus par Jean-Paul Moulinot, Robert Party et François Périer.
« La Commune, objet chaud, a longtemps divisé les historiens. Elle a eu sa légende noire, sitôt après l’événement : celle de la révolte sauvage des barbares et bandits. Elle a eu sa légende rouge : toutes les révolutions, les insurrections socialistes du XXe siècle se sont voulues filles de l’insurrection parisienne de 1871 ; et c’était à tout prendre, politiquement, leur droit. Historiquement, cette légende a pu se révéler redoutablement déformante. L’historiographie socialiste s’assignait pour tâche de démontrer "scientifiquement" que l’onde révolutionnaire qui parcourt le premier XXe siècle trouvait sa source vive dans une Commune dont elle se déclarait légitime héritière. On quêtait, par une analyse anachroniquement rétrospective, les preuves de cette filiation, oubliant le beau précepte que Lissagaray, communard, historien « immédiat » de l’événement avait placé en 1876 en exergue à son Histoire de la Commune. "Celui qui fait au peuple de fausses légendes révolutionnaires, celui qui l’amuse d’histoires chantantes est aussi criminel que le géographe qui dresserait des cartes menteuses pour les navigateurs." »
Jacques Rougerie (in "La Commune, 1871", PUF, 1988)
Source : France Culture

Jules Claretie
EAN : 978B0039S23W8
DENTU E. . (01/01/1882)
/5
2 notes
DENTU E. . (01/01/1882)
Résumé :
Pour modifier cette description, vous devez vous connecter
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Monsieur le ministreVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Bien qu'il soit aujourd'hui passablement oublié, sauf des plus érudits, Jules Claretie fut, durant la seconde moitié du XIXème siècle, l'un de nos plus prodigieux écrivains, et l'adjectif "prodigieux" n'est ici en rien excessif. Car ce petit homme au physique timide et au regard doux détient un palmarès dont ni Balzac ni Victor Hugo ne peuvent s'enorgueillir : 47 ans de carrière, une centaine d'ouvrages, tous d'un remarquable niveau, en s'étant essayé avec bonheur à absolument tous les genres littéraires, même les moins évidents. Débutant en 1860 dans un registre sentimental, Jules Claretie évolua rapidement vers le drame de moeurs, puis le roman judiciaire dans la veine d'Émile Gaboriau, avant de faire un étrange détour, plusieurs fois réitéré, vers le fantastique post-roman gothique, lequel le mena rapidement au roman-feuilleton, puis, dès la fin des années 70, vers une littérature réaliste ambitieuse, portraiturant les moeurs de la Belle-Époque, à laquelle il consacra sa plus belle plume, et dont « Monsieur le Ministre » (1881) est le premier roman majeur.
Tout cela fait déjà une oeuvre conséquente qui équivaut à la bibliographie de deux ou trois écrivains. Mais bien entendu, Jules Claretie ne s'arrêta pas là, et c'est ce qui contribue à sa dimension exceptionnelle. Historien de formation universitaire, on lui doit une dizaine d'études historiques aussi remarquablement documentées que lumineuses, dont une consignation en 5 volumes du Siège de Paris et de la Commune, publiée dès 1872, et qui ne fut pas pour rien dans la connaissance extrêmement précise que l'on conserve de cette période tourmentée de l'Histoire de France.
Comme si cette débauche de talents lui laissait encore du temps de libre, Jules Claretie s'intéressa longuement aussi aux talents des autres : il publia plusieurs biographies d'écrivains (Petrus Borel, Lamartine, Ludovic Halévy, La Fontaine, Victor Hugo), signa quantité de critiques littéraires et de critiques d'art, écrivit aussi par délassement et admiration pour Béranger (dont il signa aussi une biographie), des paroles de chanson, puis de fil en aiguille, un ouvrage historiographique sur la chanson française (le premier du genre), ce qui le mena au théâtre (où l'on chantait beaucoup), comme auteur, mais aussi comme adaptateur en pièces de romans à succès, puis enfin comme librettiste de deux opéras, dont « La Navarraise » de Jules Massenet.
Est-ce tout ? vous demanderez-vous. Presque, vous répondrai-je, car si toute l'immensité du talent de Jules Claretie est à présent résumée de manière quasi exhaustive, on ne cachera pas qu'en plus, il n'eut même pas à lutter pour que son oeuvre abondante fut reconnue et estimée : aucun honneur ne lui fut épargné. Élu à L Académie Française en 1888, à seulement 48 ans, président de la Société des Gens de Lettres, vice-président de la toujours vaillante SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), et enfin Administrateur Général de la Comédie Française (jusqu'à sa mort en 1913), Jules Claretie sut toute sa vie prouver qu'il pouvait joindre l'utile à l'agréable, et régner quasiment en maître – en maître discret et nullement tyrannique – sur le monde des lettres de la Belle-Époque.
Alors comment expliquer qu'un tel monument de la littérature française soit aussi incroyablement tombé dans l'oubli, après avoir publié avec succès en moyenne 3 à 4 livres par an pendant un demi-siècle ? Il ne me semble pas y avoir à cela une raison en particulier, mais plusieurs petites raisons qui se combinent mal.
D'abord Jules Claretie est mort quasiment en même temps que son époque : la Première Guerre Mondiale, par sa violence et sa brutalité, l'a renvoyé aux antiquités d'une Belle-Époque jugée naïve et confortable. Ensuite, même s'il fut célébré de son vivant, Jules Claretie n'a pas laissé un roman ou un essai emblématique que l'on désignerait unanimement comme son chef d'oeuvre, et auquel son nom serait associé pour toujours. Même ses plus féroces adversaires (et à vrai dire il y en eut peu) lui reconnaissaient quinze à vingt romans essentiels. Allez faire, dans tout cela, un choix initiatique, d'autant plus que, comme Zola, Jules Claretie avait besoin de place pour s'exprimer, et presque tous ses romans atteignent les 500 pages, et demandent donc un certain investissement.
Enfin, Jules Claretie avait un modèle, auquel il consacra d'ailleurs, en 1902, son ultime biographie : Victor Hugo, dont il emprunta la rigueur littéraire et le goût pour la diversité dans les créations littéraires.
Mais contrairement à Victor Hugo, Jules Claretie n'était pas un idéologue engagé. Fervent républicain mais sans excès, Jules Claretie incarnait une bourgeoisie érudite et sociable, ironique mais tolérante, qui connaissait trop bien L Histoire et ce qu'elle avait de cyclique pour s'égarer dans une ferveur politique promettant des lendemains qui chantent et des sociétés nouvelles. le peuple, hélas, ne s'enthousiasme guère pour les génies qui n'ont pas le sens du visionnaire, même si L Histoire leur donne souvent raison.
Quelle meilleure preuve d'ailleurs que ce « Monsieur le Ministre », le premier roman de Claretie publié chez le très éclectique Édouard Dentu, éditeur opportuniste qui aimait le scandale et les auteurs qui fâchent, de quelque bord qu'ils se tiennent, et dont le catalogue, qui s'étend de 1849 à 1895, est une mine de curiosités et d'audaces littéraires.
Présenté comme l'adaptation libre et romanesque de scènes véritables auxquelles Jules Claretie aurait assisté, « Monsieur le Ministre » conte le bref mandat de Sulpice Vaudrey, un parlementaire provincial, à peine sortie de sa campagne grenobloise et fraîchement débarqué à Paris, en compagnie de son épouse, afin d'y intégrer le nouveau gouvernement en qualité de Ministre de l'Intérieur.
Sous la IIIème République, le suffrage universel n'existe pas encore : la population élit ses maires et ses députés, mais la nomination du gouvernement et la désignation du Président de la République se font exclusivement en interne, à l'Assemblée Nationale et au Sénat, ce qui, selon Jules Claretie, autorise bien des corruptions et nécessite des complicités et des services d'une légalité douteuse. Quelque chose de la décadence figée du Second Empire et de l'Ancien Régime demeure encore dans cette République où chaque député, auréolé du prestige de la capitale auprès de son électorat provincial, est assuré de garder son siège durant des décennies, pour peu qu'il soit intrigant, habile, même dans le choix de ceux qui doivent lui être supérieurs.
Car si Sulpice Vaudrey a été appelé de sa lointaine province pour siéger au gouvernement, ce n'est pas, comme il se plaît à le croire, pour ses qualités de député récemment élu. C'est d'abord pour son immense popularité dans son département, mais surtout parce qu'on l'a jugé en haut lieu tel qu'il est : un bon gros naïf des campagnes, qu'il sera facile de griser de mondanités et d'étourdir avec les fastes de la vie nocturne parisienne, ceci afin d'obtenir de lui tous les avantages de son poste sans en partager le moindre risque de scandale ou de corruption.
Sulpice Vaudrey est en effet un politicien naïf et très enthousiaste, sincèrement désireux d'oeuvrer pour son pays, d'y appliquer des réformes nécessaires et charmé d'être si vite reconnu, croit-il, pour ses mérites et son désir de modernité. Mais très vite, il va déchanter : lui qui avait déjà en tête une liste de personnes de confiance dont il désire s'entourer, se retrouve plus ou moins sommé par son collègue, et néanmoins ami, Guy de Lissac, non seulement d'accepter des assistants qui sont aux ordres de la majorité, mais de prendre un chef de cabinet, Warcolier, intriguant ambitieux et hautain, qui lui est immédiatement antipathique, mais qu'il ne peut refuser, de peur que toutes ses propositions de lois ou de réformes soient repoussés par ses prétendus "amis" de corporation. Il s'inquiète d'ailleurs pour pas grand-chose : elles le seront, quoi qu'il advienne.
Car en réalité, entre le Palais Bourbon, le Sénat et l'Assemblée Nationale, un fonctionnement immuable verrouille d'avance toute initiative inhabituelle susceptible de gripper un système qui fonctionne parfaitement selon ceux qui l'entretiennent, c'est-à-dire un système qui maintient à leur place avantageuse des députés qui, en réalité, ne font rien pour la conserver. Peu à peu, Sulpice Vaudrey réalise que dans ce ministère à haute responsabilité, il n'en a quasiment aucune, sinon celle d'exécuter – ou plutôt de faire exécuter par le diligent Warcolier – ce que les amis de ce dernier ont décidé. Son travail effectif consiste essentiellement à répondre favorablement ou défavorablement aux innombrables sollicitations intéressées qu'un ministre reçoit quotidiennement : demandes de licences, de favoritisme, d'emplois pour un frère, une épouse, un fils qui traînasse au lycée…
Sulpice Vaudrey est rapidement gagné par une mélancolie qui s'est installée, sans qu'il s'en doute, dans son foyer, où Adrienne, sa femme, ne se fait pas à la vie parisienne, aux femmes des autres ministres qui la traînent dans des soirées mondaines ou des campagnes de charité. Elle ne se fait pas non plus aux absences prolongées de son mari, pris lui aussi dans le tourbillon des mondanités jusqu'à des heures indues. Mais il faut admettre que la tristesse de sa femme accentuant la sienne propre, Sulpice Vaudrey se complaît rapidement hors de son foyer, jusque dans les coulisses de l'Opéra où, selon des règles bien établies, les parlementaires et les ministres se rejoignent dans les coulisses pour chasser des ballerines fort jeunes, prêtes à rendre des services intimes à des messieurs arrivés susceptibles de leur ouvrir une position et de leur fournir une garçonnière.
En effet, pour un personnage public, les adultères avec des femmes mariées sont périlleux, et générateurs de scandales. le député qui a besoin de se "relaxer" est invité à éduquer une jeunesse dans le besoin. le système est tellement bien rodé qu'un prêteur sur gages, Salomon Molina, se charge de guider les parlementaires vers les quelques ballerines délurées en quête de protecteurs, ou sous l'emprise d'une mère décidée à faire leur bonheur malgré elles. Il propose également des prêts à taux fixe, histoire de financer une relation qui pourrait créer un vide un peu trop visible sur un compte bancaire.
Néanmoins, Sulpice Vaudrey n'a pas de goût pour la chair fraîche, ni même envie de tromper Adrienne, qui l'ennuie par sa neurasthénie, certes, mais dont il reste vaguement épris. Cependant, au cours d'une soirée mondaine, il fait la connaissance de Marianne Kayser, une intrigante de la pire espèce, femme jolie, sensuelle et à l'air innocent, dont il tombe fou amoureux.
Malgré les avertissements de Guy de Lissac, qui se révèle être un des anciens amants de la gourgandine, le Ministre de l'Intérieur dépose son coeur aux pieds de Marianne Kayser et son compte en banque à ceux de Salomon Molina. Ce double coup de folie signera sa perte...
En effet, Marianne Kayser est, depuis des années, la bonne amie de tous ceux qui veulent bien l'entretenir, mais elle vise en particulier le Duc de Rosas, un artiste-peintre espagnol fort épris d'elle, habitant usuellement Paris, mais qui fuit Marianne au point d'avoir quitté la France sans donner de nouvelles, quelques semaines auparavant. Mais voilà qu'en pleine romance avec Sulpice Vaudrey, auquel Marianne n'aurait pas accordé un regard s'il n'avait pas été Ministre de l'Intérieur, le Duc de Rosas rentre brusquement à Paris, plus amoureux que jamais, bien décidé à épouser Marianne, qu'il pense naïvement pure et quasiment vierge.
Pour la catin cynique et glaciale, qui voyait approcher avec angoisse la quarantaine et la chute de sa valeur marchande, cette perspective est un enchantement : elle, ancienne prostituée des quartiers mal famés de Pigalle, devenir duchesse en Espagne ! Quelle apothéose ! Bien entendu, elle accepte, mais sachant la droiture morale toute aristocrate de son nouveau mari, il lui faut se débarrasser d'urgence de Sulpice Vaudrey, et de ce qui peut encore témoigner, même à distance, du peu reluisant passé de la nouvelle duchesse. Et tant pis s'il faut briser des coeurs et des carrières, et ça lui est d'autant plus facile que l'un de ses amants les plus dévoués n'est autre que le préfet de police...
Dans cette débâcle, rapidement entachée de scandale public, et en seulement quelques heures, Sulpice Vaudrey perdra tout : d'abord Marianne Kayser dont il s'est sottement mais sincèrement épris; puis son poste de Ministre de l'Intérieur; puis son épouse, qui le quitte et rentre seule à Grenoble, ne lui pardonnant pas cette humiliation privée et publique; et même son avenir politique, puisque la section iséroise de son parti entendre parler de lui… La fable est ici terriblement féroce et d'un effrayant réalisme, malgré la plume pudique, teintée de symbolisme, d'un Jules Claretie qui sait bien de quoi il parle, et sait aussi qu'il prend en marche, brillamment, le train d'une nouvelle littérature qui ne s'embarrasse plus d'enjoliver la plus abjecte des réalités.
Le personnage de Marianne Kayser est d'une grande précision dans les détails, tant physiquement, que dans l'expression de sa duplicité de caractère. Si Sulpice Vaudrey n'est qu'un archétype de l'arriviste bêta, Marianne Kayser s'inspire très probablement d'une personne réelle. On notera son prénom français, semblable à celui de l'icône de la République, accolé à un nom de famille germanique qui signifie "empereur".
Pour son temps, et signé de la plume d'un auteur qui avait déjà vingt ans de carrière, « Monsieur le Ministre » était une oeuvre d'une étonnante modernité, et qui en dépit de quelques désuétudes (dont une image quelque peu idéalisée du journalisme intègre, incarné par l'impuissant et amer Denis Ramel), et d'un rythme narratif un peu monolithique, reste d'une insolence remarquable, et d'une grande pertinence documentaire. On ne s'imagine que trop bien que les choses ont un peu changé, mais pas tant que ça, et qu'avec quelques actualisations, un tel roman ferait encore sens aujourd'hui. Il choquerait même par ce réalisme finalement assez froid, assez naturaliste dans l'esprit faute de l'être dans le style.
Il n'y a pas ici de message ou de délation, pas plus que de populisme ou de militantisme : le lecteur y est livré à lui-même, découvrant avec Sulpice Vaudrey le malaise d'une parlementarisme figé et décadent, tantôt mondain et séduisant, tantôt perfide et égoïste, dont il n'est ni facile de se faire un jugement, ni d'imaginer de quelle autre façon cela pourrait fonctionner.
Sans l'odieux cliché antisémite du banquier véreux Salomon Molina, personnage abject mais dont l'abjection semble, selon Claretie qu'on n'attendait pas si médiocre sur ce sujet, être doublement imputable à son identité juive et à son origine marseillaise, « Monsieur le Ministre » gagnerait pleinement à être redécouvert, tant ce rare témoignage d'une corruption des élus induite par un système politique qui ne tolère aucune alternative, aucune évolution, est d'une très grande force, d'une merveilleuse intelligence, et ramène finalement toute cette intemporelle problématique à l'incorrigible nature humaine, qui fait se heurter en permanence des naïfs et des pervertis autour de la grande illusion du pouvoir, jusqu'à ce que les premiers deviennent les dignes successeurs des seconds.
Tout cela fait déjà une oeuvre conséquente qui équivaut à la bibliographie de deux ou trois écrivains. Mais bien entendu, Jules Claretie ne s'arrêta pas là, et c'est ce qui contribue à sa dimension exceptionnelle. Historien de formation universitaire, on lui doit une dizaine d'études historiques aussi remarquablement documentées que lumineuses, dont une consignation en 5 volumes du Siège de Paris et de la Commune, publiée dès 1872, et qui ne fut pas pour rien dans la connaissance extrêmement précise que l'on conserve de cette période tourmentée de l'Histoire de France.
Comme si cette débauche de talents lui laissait encore du temps de libre, Jules Claretie s'intéressa longuement aussi aux talents des autres : il publia plusieurs biographies d'écrivains (Petrus Borel, Lamartine, Ludovic Halévy, La Fontaine, Victor Hugo), signa quantité de critiques littéraires et de critiques d'art, écrivit aussi par délassement et admiration pour Béranger (dont il signa aussi une biographie), des paroles de chanson, puis de fil en aiguille, un ouvrage historiographique sur la chanson française (le premier du genre), ce qui le mena au théâtre (où l'on chantait beaucoup), comme auteur, mais aussi comme adaptateur en pièces de romans à succès, puis enfin comme librettiste de deux opéras, dont « La Navarraise » de Jules Massenet.
Est-ce tout ? vous demanderez-vous. Presque, vous répondrai-je, car si toute l'immensité du talent de Jules Claretie est à présent résumée de manière quasi exhaustive, on ne cachera pas qu'en plus, il n'eut même pas à lutter pour que son oeuvre abondante fut reconnue et estimée : aucun honneur ne lui fut épargné. Élu à L Académie Française en 1888, à seulement 48 ans, président de la Société des Gens de Lettres, vice-président de la toujours vaillante SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), et enfin Administrateur Général de la Comédie Française (jusqu'à sa mort en 1913), Jules Claretie sut toute sa vie prouver qu'il pouvait joindre l'utile à l'agréable, et régner quasiment en maître – en maître discret et nullement tyrannique – sur le monde des lettres de la Belle-Époque.
Alors comment expliquer qu'un tel monument de la littérature française soit aussi incroyablement tombé dans l'oubli, après avoir publié avec succès en moyenne 3 à 4 livres par an pendant un demi-siècle ? Il ne me semble pas y avoir à cela une raison en particulier, mais plusieurs petites raisons qui se combinent mal.
D'abord Jules Claretie est mort quasiment en même temps que son époque : la Première Guerre Mondiale, par sa violence et sa brutalité, l'a renvoyé aux antiquités d'une Belle-Époque jugée naïve et confortable. Ensuite, même s'il fut célébré de son vivant, Jules Claretie n'a pas laissé un roman ou un essai emblématique que l'on désignerait unanimement comme son chef d'oeuvre, et auquel son nom serait associé pour toujours. Même ses plus féroces adversaires (et à vrai dire il y en eut peu) lui reconnaissaient quinze à vingt romans essentiels. Allez faire, dans tout cela, un choix initiatique, d'autant plus que, comme Zola, Jules Claretie avait besoin de place pour s'exprimer, et presque tous ses romans atteignent les 500 pages, et demandent donc un certain investissement.
Enfin, Jules Claretie avait un modèle, auquel il consacra d'ailleurs, en 1902, son ultime biographie : Victor Hugo, dont il emprunta la rigueur littéraire et le goût pour la diversité dans les créations littéraires.
Mais contrairement à Victor Hugo, Jules Claretie n'était pas un idéologue engagé. Fervent républicain mais sans excès, Jules Claretie incarnait une bourgeoisie érudite et sociable, ironique mais tolérante, qui connaissait trop bien L Histoire et ce qu'elle avait de cyclique pour s'égarer dans une ferveur politique promettant des lendemains qui chantent et des sociétés nouvelles. le peuple, hélas, ne s'enthousiasme guère pour les génies qui n'ont pas le sens du visionnaire, même si L Histoire leur donne souvent raison.
Quelle meilleure preuve d'ailleurs que ce « Monsieur le Ministre », le premier roman de Claretie publié chez le très éclectique Édouard Dentu, éditeur opportuniste qui aimait le scandale et les auteurs qui fâchent, de quelque bord qu'ils se tiennent, et dont le catalogue, qui s'étend de 1849 à 1895, est une mine de curiosités et d'audaces littéraires.
Présenté comme l'adaptation libre et romanesque de scènes véritables auxquelles Jules Claretie aurait assisté, « Monsieur le Ministre » conte le bref mandat de Sulpice Vaudrey, un parlementaire provincial, à peine sortie de sa campagne grenobloise et fraîchement débarqué à Paris, en compagnie de son épouse, afin d'y intégrer le nouveau gouvernement en qualité de Ministre de l'Intérieur.
Sous la IIIème République, le suffrage universel n'existe pas encore : la population élit ses maires et ses députés, mais la nomination du gouvernement et la désignation du Président de la République se font exclusivement en interne, à l'Assemblée Nationale et au Sénat, ce qui, selon Jules Claretie, autorise bien des corruptions et nécessite des complicités et des services d'une légalité douteuse. Quelque chose de la décadence figée du Second Empire et de l'Ancien Régime demeure encore dans cette République où chaque député, auréolé du prestige de la capitale auprès de son électorat provincial, est assuré de garder son siège durant des décennies, pour peu qu'il soit intrigant, habile, même dans le choix de ceux qui doivent lui être supérieurs.
Car si Sulpice Vaudrey a été appelé de sa lointaine province pour siéger au gouvernement, ce n'est pas, comme il se plaît à le croire, pour ses qualités de député récemment élu. C'est d'abord pour son immense popularité dans son département, mais surtout parce qu'on l'a jugé en haut lieu tel qu'il est : un bon gros naïf des campagnes, qu'il sera facile de griser de mondanités et d'étourdir avec les fastes de la vie nocturne parisienne, ceci afin d'obtenir de lui tous les avantages de son poste sans en partager le moindre risque de scandale ou de corruption.
Sulpice Vaudrey est en effet un politicien naïf et très enthousiaste, sincèrement désireux d'oeuvrer pour son pays, d'y appliquer des réformes nécessaires et charmé d'être si vite reconnu, croit-il, pour ses mérites et son désir de modernité. Mais très vite, il va déchanter : lui qui avait déjà en tête une liste de personnes de confiance dont il désire s'entourer, se retrouve plus ou moins sommé par son collègue, et néanmoins ami, Guy de Lissac, non seulement d'accepter des assistants qui sont aux ordres de la majorité, mais de prendre un chef de cabinet, Warcolier, intriguant ambitieux et hautain, qui lui est immédiatement antipathique, mais qu'il ne peut refuser, de peur que toutes ses propositions de lois ou de réformes soient repoussés par ses prétendus "amis" de corporation. Il s'inquiète d'ailleurs pour pas grand-chose : elles le seront, quoi qu'il advienne.
Car en réalité, entre le Palais Bourbon, le Sénat et l'Assemblée Nationale, un fonctionnement immuable verrouille d'avance toute initiative inhabituelle susceptible de gripper un système qui fonctionne parfaitement selon ceux qui l'entretiennent, c'est-à-dire un système qui maintient à leur place avantageuse des députés qui, en réalité, ne font rien pour la conserver. Peu à peu, Sulpice Vaudrey réalise que dans ce ministère à haute responsabilité, il n'en a quasiment aucune, sinon celle d'exécuter – ou plutôt de faire exécuter par le diligent Warcolier – ce que les amis de ce dernier ont décidé. Son travail effectif consiste essentiellement à répondre favorablement ou défavorablement aux innombrables sollicitations intéressées qu'un ministre reçoit quotidiennement : demandes de licences, de favoritisme, d'emplois pour un frère, une épouse, un fils qui traînasse au lycée…
Sulpice Vaudrey est rapidement gagné par une mélancolie qui s'est installée, sans qu'il s'en doute, dans son foyer, où Adrienne, sa femme, ne se fait pas à la vie parisienne, aux femmes des autres ministres qui la traînent dans des soirées mondaines ou des campagnes de charité. Elle ne se fait pas non plus aux absences prolongées de son mari, pris lui aussi dans le tourbillon des mondanités jusqu'à des heures indues. Mais il faut admettre que la tristesse de sa femme accentuant la sienne propre, Sulpice Vaudrey se complaît rapidement hors de son foyer, jusque dans les coulisses de l'Opéra où, selon des règles bien établies, les parlementaires et les ministres se rejoignent dans les coulisses pour chasser des ballerines fort jeunes, prêtes à rendre des services intimes à des messieurs arrivés susceptibles de leur ouvrir une position et de leur fournir une garçonnière.
En effet, pour un personnage public, les adultères avec des femmes mariées sont périlleux, et générateurs de scandales. le député qui a besoin de se "relaxer" est invité à éduquer une jeunesse dans le besoin. le système est tellement bien rodé qu'un prêteur sur gages, Salomon Molina, se charge de guider les parlementaires vers les quelques ballerines délurées en quête de protecteurs, ou sous l'emprise d'une mère décidée à faire leur bonheur malgré elles. Il propose également des prêts à taux fixe, histoire de financer une relation qui pourrait créer un vide un peu trop visible sur un compte bancaire.
Néanmoins, Sulpice Vaudrey n'a pas de goût pour la chair fraîche, ni même envie de tromper Adrienne, qui l'ennuie par sa neurasthénie, certes, mais dont il reste vaguement épris. Cependant, au cours d'une soirée mondaine, il fait la connaissance de Marianne Kayser, une intrigante de la pire espèce, femme jolie, sensuelle et à l'air innocent, dont il tombe fou amoureux.
Malgré les avertissements de Guy de Lissac, qui se révèle être un des anciens amants de la gourgandine, le Ministre de l'Intérieur dépose son coeur aux pieds de Marianne Kayser et son compte en banque à ceux de Salomon Molina. Ce double coup de folie signera sa perte...
En effet, Marianne Kayser est, depuis des années, la bonne amie de tous ceux qui veulent bien l'entretenir, mais elle vise en particulier le Duc de Rosas, un artiste-peintre espagnol fort épris d'elle, habitant usuellement Paris, mais qui fuit Marianne au point d'avoir quitté la France sans donner de nouvelles, quelques semaines auparavant. Mais voilà qu'en pleine romance avec Sulpice Vaudrey, auquel Marianne n'aurait pas accordé un regard s'il n'avait pas été Ministre de l'Intérieur, le Duc de Rosas rentre brusquement à Paris, plus amoureux que jamais, bien décidé à épouser Marianne, qu'il pense naïvement pure et quasiment vierge.
Pour la catin cynique et glaciale, qui voyait approcher avec angoisse la quarantaine et la chute de sa valeur marchande, cette perspective est un enchantement : elle, ancienne prostituée des quartiers mal famés de Pigalle, devenir duchesse en Espagne ! Quelle apothéose ! Bien entendu, elle accepte, mais sachant la droiture morale toute aristocrate de son nouveau mari, il lui faut se débarrasser d'urgence de Sulpice Vaudrey, et de ce qui peut encore témoigner, même à distance, du peu reluisant passé de la nouvelle duchesse. Et tant pis s'il faut briser des coeurs et des carrières, et ça lui est d'autant plus facile que l'un de ses amants les plus dévoués n'est autre que le préfet de police...
Dans cette débâcle, rapidement entachée de scandale public, et en seulement quelques heures, Sulpice Vaudrey perdra tout : d'abord Marianne Kayser dont il s'est sottement mais sincèrement épris; puis son poste de Ministre de l'Intérieur; puis son épouse, qui le quitte et rentre seule à Grenoble, ne lui pardonnant pas cette humiliation privée et publique; et même son avenir politique, puisque la section iséroise de son parti entendre parler de lui… La fable est ici terriblement féroce et d'un effrayant réalisme, malgré la plume pudique, teintée de symbolisme, d'un Jules Claretie qui sait bien de quoi il parle, et sait aussi qu'il prend en marche, brillamment, le train d'une nouvelle littérature qui ne s'embarrasse plus d'enjoliver la plus abjecte des réalités.
Le personnage de Marianne Kayser est d'une grande précision dans les détails, tant physiquement, que dans l'expression de sa duplicité de caractère. Si Sulpice Vaudrey n'est qu'un archétype de l'arriviste bêta, Marianne Kayser s'inspire très probablement d'une personne réelle. On notera son prénom français, semblable à celui de l'icône de la République, accolé à un nom de famille germanique qui signifie "empereur".
Pour son temps, et signé de la plume d'un auteur qui avait déjà vingt ans de carrière, « Monsieur le Ministre » était une oeuvre d'une étonnante modernité, et qui en dépit de quelques désuétudes (dont une image quelque peu idéalisée du journalisme intègre, incarné par l'impuissant et amer Denis Ramel), et d'un rythme narratif un peu monolithique, reste d'une insolence remarquable, et d'une grande pertinence documentaire. On ne s'imagine que trop bien que les choses ont un peu changé, mais pas tant que ça, et qu'avec quelques actualisations, un tel roman ferait encore sens aujourd'hui. Il choquerait même par ce réalisme finalement assez froid, assez naturaliste dans l'esprit faute de l'être dans le style.
Il n'y a pas ici de message ou de délation, pas plus que de populisme ou de militantisme : le lecteur y est livré à lui-même, découvrant avec Sulpice Vaudrey le malaise d'une parlementarisme figé et décadent, tantôt mondain et séduisant, tantôt perfide et égoïste, dont il n'est ni facile de se faire un jugement, ni d'imaginer de quelle autre façon cela pourrait fonctionner.
Sans l'odieux cliché antisémite du banquier véreux Salomon Molina, personnage abject mais dont l'abjection semble, selon Claretie qu'on n'attendait pas si médiocre sur ce sujet, être doublement imputable à son identité juive et à son origine marseillaise, « Monsieur le Ministre » gagnerait pleinement à être redécouvert, tant ce rare témoignage d'une corruption des élus induite par un système politique qui ne tolère aucune alternative, aucune évolution, est d'une très grande force, d'une merveilleuse intelligence, et ramène finalement toute cette intemporelle problématique à l'incorrigible nature humaine, qui fait se heurter en permanence des naïfs et des pervertis autour de la grande illusion du pouvoir, jusqu'à ce que les premiers deviennent les dignes successeurs des seconds.
Citations et extraits (6)
Voir plus
Ajouter une citation
Elle pensait à frapper un grand coup. Jusqu'à présent, son aventure avec Sulpice avait flotté dans les sentimentalités de roman ou de romance. Le ministre se croyait aimé pour son amour même. Il ne voyait dans Marianne qu'une fille excentrique, affranchie de tout préjugé et de tout devoir, qui disposait de sa vie comme bon lui semblait, sans avoir à en rendre compte à un mari ou à un amant. Libre, elle faisait de sa liberté du plaisir ou de la passion à sa fantaisie. Les terribles questions pratiques, les nécessités quotidiennes, échappaient à cet homme, chargé de la question gouvernementale de la France. Encore une fois, il ne se demandait pas d'où provenait le luxe de Marianne. Il s'en affolait sans penser à rien analyser, à rien savoir, naïvement. Le premier mot de Mlle Kayser devait brusquement l'éveiller.
Elle savait que Vaudrey devait venir, et, brusquement, quittant le coin du feu, elle s'habilla pour lui d'un peignoir de satin noir, doublé de surrah rouge, à revers de velours ouvert sur des plissés de vieilles dentelles laissant voir les blancheurs du cou et de la poitrine. Les cheveux blonds tombaient sur le col de velours, et cette tête pâle, au-dessus de ce costume bizarre, prenait, sur le fond sombre du salon drapé de rouge, le charme inquiétant d'une apparition.
Sulpice, en la voyant, ne put s'empêcher de s'arrêter, en l'admirant, au milieu du salon où elle l'attendait, assise, rangeant des tas de paperasses dans une corbeille à pieds dorés, capitonnée de satin rose.
Elle lui tendit la main, une main pâle, tombante comme une main de morte, et languissamment lui demanda pourquoi il restait là, stupéfait, sans venir
à elle.
- Je regarde, dit le ministre.
- Vous êtes toujours le plus galant des hommes ! fit Marianne. Vous n'êtes donc pas déjà las de m'avoir contemplée ? Ordinairement, les caprices durent moins longtemps.
- L'affection que j'ai pour vous n'est pas un caprice.
- Qu'est-ce que c'est donc ? Je serais curieuse...
- C'est de la passion, Marianne, une passion absolue, profonde, folle...
- Oh ! Laissez ! Laissez ! dit Marianne. Je sais que vous parlez infiniment bien. Je vous ai entendu à la tribune. Une déclaration d'amour ne vous coûte pas plus qu'une déclaration ministérielle. Mais aujourd'hui, mon cher ministre, je ne suis pas disposée à en entendre, même de vous !
Il y avait, dans ces derniers mots, une certaine tendresse qui atténuait un peu le ton d'ennui ou de maussaderie dont Marianne parlait. Sulpice y vit comme une acceptation muette de son amour offert.
- Oui, fit brusquement Marianne; je suis très triste, horriblement triste.
- Sans cause ? demanda Vaudrey.
Elle haussa les épaules.
- Oh ! Moi, je ne suis pas de celles que leurs nerfs dominent. Quand je m'ennuie, il y a toujours une cause. Cela dit une fois pour toutes.
- Et cette cause ? Je serais heureux de la connaître, Marianne, car je vous jure que de vos ennuis et de vos peines, je voudrais avoir toujours la moitié.
- Merci !... Mais il est des peines assez vulgaires dans la vie qu'on ne pourrait confier qu'à ses amis les plus intimes.
- Vous n'avez pas d'ami plus dévoué que moi, dit Vaudrey d'un ton de conviction profonde.
Elle le savait bien. Elle lisait à nu dans cette âme.
- C'est quand on a rencontré des amis comme vous qu'on tient à les garder et à ne pas les attrister de ce qui est stupide !
- Mais enfin ? demanda Vaudrey en se rapprochant de Marianne. Qu'avez-vous ? Je vous en supplie, dites-le-moi !
Il la regardait dans le fond des yeux, cherchant en ces prunelles bleues un secret ou un aveu qui lui échappait et, instinctivement, ses deux mains avaient cherché les deux mains de Marianne qu'elle abandonnait, toutes froides. En se penchant vers elle pour la supplier de parler, il sentait la douceur de cette haleine, le parfum de cette fine peau de blonde, et le satin du peignoir dessinait, sous ses plis noirs, un corps aux courbures exquises. Sur son genou, le genou de Marianne se pressait doucement, tandis que les paupières lourdes tombaient comme des voiles sur les yeux de la jeune femme, où il semblait à Vaudrey qu'il apercevait des larmes.
- Marianne, je vous en prie, si vous avez un chagrin quelconque et que je puisse le soulager, je vous en conjure, dites-le-moi !
- Eh ! Si c'était un chagrin !.... dit-elle en retirant brusquement sa main gauche des étreintes chaudes de Sulpice. Mais c'est pis : c'est un tracas d'argent, oui, d'argent, dit-elle brusquement en voyant l'expression étonnée du visage de Vaudrey.
Elle prit, comme à poignée, les papiers jetés dans la corbeille à ouvrage et dit avec une sorte de colère pleine de dégoût :
- Ça, tenez, vous voyez bien ça ? Ce sont les notes de cet hôtel : notes de créanciers criards, tapissiers, serruriers, maçons, est-ce que je sais ?
- Comment ! Votre hôtel ?
- Vous pensiez que je l'avais payé ? Il est loué, mon hôtel, et rien de ce qui est dedans n'est soldé. Je dois tout cela, et à une meute.
Elle se mit à rire.
- Vous vous imaginez donc que la nièce au père Kayser pouvait mener cette vie de luxe où vous l'avez trouvée ? Je n'ai pas un sou et j'aurais à moi tout ce qui est ici ?... Non !... J'ai fait la folie de commander toutes ces choses, et maintenant je dois, et maintenant il faut payer ça, et maintenant on va me poursuivre. Voilà ! Vous aviez bien besoin de me pousser à vous avouer tout cela !... Ce sont mes tracas, ce ne sont pas les vôtres, je vous demande pardon, mon cher Vaudrey; voyons parlons d'autre chose. Eh bien, l'interpellation Fraynais, comment a-t-elle tourné ?... Qu'est-ce qu'il y a eu à la Chambre ?
- Ne parlons que de vous, Marianne, dit le ministre, en regardant la jeune femme avec une espèce de pitié naïve, comme un médecin ami regardant une malade.
Nerveusement elle faisait craquer ses doigts et battait, de ses pieds croisés, cette marche fébrile de tout à l'heure.
Lui, se rapprochait davantage, essayant de la calmer, d'obtenir d'elie des explications, des renseignements; et Marianne, comme si elle avait cédé, en livrant tout d'abord son secret à un mouvement irréfléchi, refusait à présent de compléter sa confidence. Elle répétait que rien de ce qui pouvait être ennuyeux ou bas ne devait attrister ses amis. D'ailleurs, on devait s'arrêter au secret même de sa vie. Elle avait bien le droit de se taire. Vaudrey en l'interrogeant ainsi, la faisait horriblement souffrir.
- Et vous, dit-il, vous, Marianne, vous me torturez bien plus encore en ne me répondant pas, à moi que le moindre détail de votre existence intéresse, à moi qui vous sais préoccupée, angoissée, et qui voudrais, je vous le jure, vous enlever toute tristesse.
Elle se tourna vers lui d'un mouvement brusque, et, ses yeux gris pailletés d'or jetant comme des étincelles, elle sembla obéir à un parti pris violent, soudain, presque involontaire, et dit à Sulpice :
- Alors vous voulez connaître la misère même de ma vie ? Soit. Mais je vous préviens que ce n'est pas gai. Aussi bien, fit-elle, après être restée muette un moment, - Sulpice frissonnant sous son regard -, mieux vaut jouer carte sur table, et si vous m'aimez comme vous le dites, me connaître tout à fait; vous verrez ensuite ce que vous aurez à faire ! Moi, je suis habituée aux déceptions.
Ah ! Quoi que cette femme fût prête à lui dire, Vaudrey sentait bien qu'une confidence ne pouvait qu'ajouter de l'amour à l'amour qu'il éprouvait. Elle s'était levée, les bras croisés sur sa robe noire où les velours rouges ressemblaient à des éclats de blessures, et ses yeux incendiés dans sa figure pâle, ses lèvres étrangement avivées, d'une sensualité bizarre appelant le baiser, tandis qu'une amertume colère enflait ses narines, elle se mit à conter à Vaudrey, assis devant elle et regardant d'en bas, - comme d'à-genoux -, une histoire attristée d'enfance mauvaise, d'adolescence ignorante, de jeunesse gâchée, des tristesses, des fautes, des élans de foi, des chutes, des ressauts d'amour, d'orgueil, de vertu, de rachat par le repentir, des espoirs flagellés, des confiances mortes : toute une existence déchirée de femme, laissant moins de la chair de son corps que de son cœur aux clous des calvaires, - quelque chose de banal et de déjà vu, de déjà entendu, mais de cruellement vrai, et qui allait droit au cœur de Sulpice, à ce cœur gonflé de pitié, à ce croyant attiré par tout ce qui lui semblait si douloureusement exquis et nouveau dans cette femme.
- Je vous ennuie peut-être ? dit-elle brusquement.
- Vous ! dit-il.
Il montrait ses yeux où montait une larme.
Elle savait que Vaudrey devait venir, et, brusquement, quittant le coin du feu, elle s'habilla pour lui d'un peignoir de satin noir, doublé de surrah rouge, à revers de velours ouvert sur des plissés de vieilles dentelles laissant voir les blancheurs du cou et de la poitrine. Les cheveux blonds tombaient sur le col de velours, et cette tête pâle, au-dessus de ce costume bizarre, prenait, sur le fond sombre du salon drapé de rouge, le charme inquiétant d'une apparition.
Sulpice, en la voyant, ne put s'empêcher de s'arrêter, en l'admirant, au milieu du salon où elle l'attendait, assise, rangeant des tas de paperasses dans une corbeille à pieds dorés, capitonnée de satin rose.
Elle lui tendit la main, une main pâle, tombante comme une main de morte, et languissamment lui demanda pourquoi il restait là, stupéfait, sans venir
à elle.
- Je regarde, dit le ministre.
- Vous êtes toujours le plus galant des hommes ! fit Marianne. Vous n'êtes donc pas déjà las de m'avoir contemplée ? Ordinairement, les caprices durent moins longtemps.
- L'affection que j'ai pour vous n'est pas un caprice.
- Qu'est-ce que c'est donc ? Je serais curieuse...
- C'est de la passion, Marianne, une passion absolue, profonde, folle...
- Oh ! Laissez ! Laissez ! dit Marianne. Je sais que vous parlez infiniment bien. Je vous ai entendu à la tribune. Une déclaration d'amour ne vous coûte pas plus qu'une déclaration ministérielle. Mais aujourd'hui, mon cher ministre, je ne suis pas disposée à en entendre, même de vous !
Il y avait, dans ces derniers mots, une certaine tendresse qui atténuait un peu le ton d'ennui ou de maussaderie dont Marianne parlait. Sulpice y vit comme une acceptation muette de son amour offert.
- Oui, fit brusquement Marianne; je suis très triste, horriblement triste.
- Sans cause ? demanda Vaudrey.
Elle haussa les épaules.
- Oh ! Moi, je ne suis pas de celles que leurs nerfs dominent. Quand je m'ennuie, il y a toujours une cause. Cela dit une fois pour toutes.
- Et cette cause ? Je serais heureux de la connaître, Marianne, car je vous jure que de vos ennuis et de vos peines, je voudrais avoir toujours la moitié.
- Merci !... Mais il est des peines assez vulgaires dans la vie qu'on ne pourrait confier qu'à ses amis les plus intimes.
- Vous n'avez pas d'ami plus dévoué que moi, dit Vaudrey d'un ton de conviction profonde.
Elle le savait bien. Elle lisait à nu dans cette âme.
- C'est quand on a rencontré des amis comme vous qu'on tient à les garder et à ne pas les attrister de ce qui est stupide !
- Mais enfin ? demanda Vaudrey en se rapprochant de Marianne. Qu'avez-vous ? Je vous en supplie, dites-le-moi !
Il la regardait dans le fond des yeux, cherchant en ces prunelles bleues un secret ou un aveu qui lui échappait et, instinctivement, ses deux mains avaient cherché les deux mains de Marianne qu'elle abandonnait, toutes froides. En se penchant vers elle pour la supplier de parler, il sentait la douceur de cette haleine, le parfum de cette fine peau de blonde, et le satin du peignoir dessinait, sous ses plis noirs, un corps aux courbures exquises. Sur son genou, le genou de Marianne se pressait doucement, tandis que les paupières lourdes tombaient comme des voiles sur les yeux de la jeune femme, où il semblait à Vaudrey qu'il apercevait des larmes.
- Marianne, je vous en prie, si vous avez un chagrin quelconque et que je puisse le soulager, je vous en conjure, dites-le-moi !
- Eh ! Si c'était un chagrin !.... dit-elle en retirant brusquement sa main gauche des étreintes chaudes de Sulpice. Mais c'est pis : c'est un tracas d'argent, oui, d'argent, dit-elle brusquement en voyant l'expression étonnée du visage de Vaudrey.
Elle prit, comme à poignée, les papiers jetés dans la corbeille à ouvrage et dit avec une sorte de colère pleine de dégoût :
- Ça, tenez, vous voyez bien ça ? Ce sont les notes de cet hôtel : notes de créanciers criards, tapissiers, serruriers, maçons, est-ce que je sais ?
- Comment ! Votre hôtel ?
- Vous pensiez que je l'avais payé ? Il est loué, mon hôtel, et rien de ce qui est dedans n'est soldé. Je dois tout cela, et à une meute.
Elle se mit à rire.
- Vous vous imaginez donc que la nièce au père Kayser pouvait mener cette vie de luxe où vous l'avez trouvée ? Je n'ai pas un sou et j'aurais à moi tout ce qui est ici ?... Non !... J'ai fait la folie de commander toutes ces choses, et maintenant je dois, et maintenant il faut payer ça, et maintenant on va me poursuivre. Voilà ! Vous aviez bien besoin de me pousser à vous avouer tout cela !... Ce sont mes tracas, ce ne sont pas les vôtres, je vous demande pardon, mon cher Vaudrey; voyons parlons d'autre chose. Eh bien, l'interpellation Fraynais, comment a-t-elle tourné ?... Qu'est-ce qu'il y a eu à la Chambre ?
- Ne parlons que de vous, Marianne, dit le ministre, en regardant la jeune femme avec une espèce de pitié naïve, comme un médecin ami regardant une malade.
Nerveusement elle faisait craquer ses doigts et battait, de ses pieds croisés, cette marche fébrile de tout à l'heure.
Lui, se rapprochait davantage, essayant de la calmer, d'obtenir d'elie des explications, des renseignements; et Marianne, comme si elle avait cédé, en livrant tout d'abord son secret à un mouvement irréfléchi, refusait à présent de compléter sa confidence. Elle répétait que rien de ce qui pouvait être ennuyeux ou bas ne devait attrister ses amis. D'ailleurs, on devait s'arrêter au secret même de sa vie. Elle avait bien le droit de se taire. Vaudrey en l'interrogeant ainsi, la faisait horriblement souffrir.
- Et vous, dit-il, vous, Marianne, vous me torturez bien plus encore en ne me répondant pas, à moi que le moindre détail de votre existence intéresse, à moi qui vous sais préoccupée, angoissée, et qui voudrais, je vous le jure, vous enlever toute tristesse.
Elle se tourna vers lui d'un mouvement brusque, et, ses yeux gris pailletés d'or jetant comme des étincelles, elle sembla obéir à un parti pris violent, soudain, presque involontaire, et dit à Sulpice :
- Alors vous voulez connaître la misère même de ma vie ? Soit. Mais je vous préviens que ce n'est pas gai. Aussi bien, fit-elle, après être restée muette un moment, - Sulpice frissonnant sous son regard -, mieux vaut jouer carte sur table, et si vous m'aimez comme vous le dites, me connaître tout à fait; vous verrez ensuite ce que vous aurez à faire ! Moi, je suis habituée aux déceptions.
Ah ! Quoi que cette femme fût prête à lui dire, Vaudrey sentait bien qu'une confidence ne pouvait qu'ajouter de l'amour à l'amour qu'il éprouvait. Elle s'était levée, les bras croisés sur sa robe noire où les velours rouges ressemblaient à des éclats de blessures, et ses yeux incendiés dans sa figure pâle, ses lèvres étrangement avivées, d'une sensualité bizarre appelant le baiser, tandis qu'une amertume colère enflait ses narines, elle se mit à conter à Vaudrey, assis devant elle et regardant d'en bas, - comme d'à-genoux -, une histoire attristée d'enfance mauvaise, d'adolescence ignorante, de jeunesse gâchée, des tristesses, des fautes, des élans de foi, des chutes, des ressauts d'amour, d'orgueil, de vertu, de rachat par le repentir, des espoirs flagellés, des confiances mortes : toute une existence déchirée de femme, laissant moins de la chair de son corps que de son cœur aux clous des calvaires, - quelque chose de banal et de déjà vu, de déjà entendu, mais de cruellement vrai, et qui allait droit au cœur de Sulpice, à ce cœur gonflé de pitié, à ce croyant attiré par tout ce qui lui semblait si douloureusement exquis et nouveau dans cette femme.
- Je vous ennuie peut-être ? dit-elle brusquement.
- Vous ! dit-il.
Il montrait ses yeux où montait une larme.
À tromper Vaudrey, elle n'avait pas grand mérite. Sulpice était aveuglé littéralement par cet amour. Il avait été, un moment, sur le qui-vive, lorsque Jouvenet lui avait conté que son secret ne lui appartenait plus. Pendant quelque temps, il semblait alors se détacher de Marianne; mais, après de nouvelles précautions prises, il revenait avec des frémissements ardents vers cet hôtel de Mlle Vanda, où l'attendaient les baisers, un peu las, de sa maîtresse.
Des mois passaient ainsi, tout l'été, les vacances de la Chambre, la saison morte de Paris. Adrienne partait, un moment, pour le Dauphiné où Vaudrey allait présider le Conseil Général, et elle retrouvait avec des joies d'enfant la vieille maison de Grenoble où elle avait autrefois vécu si heureuse ! Et même sous ce toit, entre ces murs témoins de ses amours honnêtes, surtout devant eux, Vaudrey pensait à Marianne, n'avait d'autre idée que de la revoir, de la tenir dans ses bras, et, chaque jour, il lui écrivait des lettres éperdues qu'elle parcourait à peine du regard en haussant les épaules, et qu'elle brûlait sans y attacher d'importance.
Lui, au fond de sa province, s'ennuyait, dans le continuel fracas de fêtes, de réceptions en son honneur, de discours à prononcer, de cérémonies à présider, de députations à recevoir, de statues à inaugurer. Des statues ! Toujours des statues ! Et on le traînait, dans les petites villes, à Allevard ou à Marestel, de la mairie à la grande place, entre des haies de pompiers, dans des cortèges bruyants, où les cuivres lui crevaient les oreilles, sous des tentes rayées de rose, tapissées de drapeaux tricolores, devant des défilés interminables de Sociétés de Gymnastique, d'orphéons, de corporations, d'associations, d'Amis de la Paix ou d'Amis de la Guerre ! Et c'était des harangues éperdues, des dévidages de lieux communs, des discours émaillés de latin de professeurs de rhétorique, des professions de foi politiques de conseillers municipaux éloquents, tout satisfaits de happer un ministre au passage. Ce que Vaudrey en entendait de ces harangues ! Plus qu'à la Chambre. Plus drues, plus serrées, plus implacables qu'à la Chambre. Et des avis et des considérations politiques et les remontrances qui se terminaient en demandes de places ! Des cantates qui sollicitaient des subventions ! Partout des demandes, demandes de subsides, demandes d'allocations, demandes de secours, demandes de croix ! C'était le harassement, l'énervement, la courbature, l'assourdissement. Ils voulaient le tuer en criant : "Vive Vaudrey !".
Le préfet et le général commandant la division, flanquaient éternellement Vaudrey, ce supplicié trainé entre ces deux habits brodés. Sulpice entendait, des lèvres du préfet, tomber la même harangue banale : le progrès, l'avenir, la fusion des partis et des intérêts, la grandeur du département, les cotonnades et les tanneries, la splendeur du ministre qui... du ministre que... de l'enfant glorieux du pays... de l'Aigle du Dauphiné ("Vive Vaudrey !","Vive Vaudrey !"). Le général du moins variait ses effets, grondait, serrait les poings, et Vaudrey, le jour de l'inauguration de la statue d'un certain M. Valbonnans, ancien député et notable fabricant de gants, - gloire du pays, lui aussi, - avait entendu le guerrier murmurer, du matin au soir, dans un mouvement de machoire qui faisait sauter sa barbiche : "J'aime le bronze !... J'aime le bronze !...", avec une persistance qui stupéfiait le ministre.
C'était peut-être le seul souvenir un peu gai des tournées de Vaudrey dans l'Isère. Ce couronnement éternel du général : "J'aime le bronze ! J'aime le bronze !" l'avait mis en éveil, et il se demandait gaiement quel diable d'appétit avait là ce militaire qui répétait son mot d'un ton goulu, assis à côté de lui sur l'estrade, tandis que les orphéons chantaient un hymne en l'honneur de feu M. Valbonnans composé pour la circonstance par un amateur de la ville :
"Chantons, oui, chantons M. Valbonnans,
Le meilleur fabricant de gants,
Élégants !"
Tandis que les fanfares reprenaient au refrain et que les pompiers découvraient, dans une immense acclamation, la statue de M. Valbonnans, portant ces mots sur son socle : "À l'inventeur, au patriote, au négociant"; tandis encore qu'à son oreille gauche le préfet reprenait son éternel discours : la ganterie, gloire de l'Isère, le progrès, les intérêts, la grandeur du département, le ministre qui... le ministre que... ("Vive Vaudrey !"), Sulpice entendait toujours, même au milieu des acclamations, le grondement de machine du général répétant, ressassant, remáchant :
- "J'aime le bronze ! J'aime le bronze !"
Le soir du banquet, le ministre avait enfin l'explication de cet amour farouche. Le général se levait, serrait son verre à le briser, et pendant que le parfait fondait dans les assiettes, il s'écriait, de sa grosse voix, comme sur le front de sa division :
- J'aime le bronze !... J'aime le bronze, parce qu'il sert à la fois à élever des statues et à fondre des canons ! J'aime le bronze dont la voix gagne les batailles, l'artillerie étant aujourd'hui l'arme supérieure, quoique la cavalerie soit la plus chevaleresque ! J'aime le bronze qui est l'image du cœur du soldat et je voudrais voir à notre pays une armée d'hommes de bronze qui... que...
Il s'embarrassait, s'embrouillait, roulait des yeux blancs dans une face pourprée et, pour en finir, brandissait son verre comme il l'eût fait de son bancal et, aux applaudissements frénétiques des convives, hurlait vaillamment :
- J'aime le bronze ! J'aime le bronze !
Vaudrey avait failli éclater d'un fou rire, malgré toute sa dignité ministérielle, et quand il était rentré à Grenoble, sa voiture pleine des fleurs qu'on lui avait lancées, il n'avait, à Adrienne lui demandant s'il avait bien parlé, si cela avait été beau, rien répondu, en jetant à terre ses bouquets, que :
- J'ai beaucoup ri ! Mais je suis écrasé, abruti ! Quelle migraine I...
C'était tout cela que Sulpice écrivait, racontait à Marianne, en Iui disant, le naif : "Ah ! toutes ces voix qui m'acclament ne valent pas une parole de la tienne ! Quand te reverrai-je, Marianne, chère âme ?".
- Le plus tard possible ! disait la chère âme.
Elle voyait même avec un ennui profond l'été finir, l'automne commencer et venir l'approche de la saison parlementaire qui ramènerait Vaudrey et lui infligerait la présence de son amant. Sulpice lui donnait largement ce qu'il fallait à ses appétits de luxe, et c'était bien pourquoi elle ne se décidait pas à rompre, quoique depuis longtemps cet homme fût sacrifié dans son esprit.
- "Ah ! quand je pourrai le balancer !" disait-elle avec son ton de fille.
Des mois passaient ainsi, tout l'été, les vacances de la Chambre, la saison morte de Paris. Adrienne partait, un moment, pour le Dauphiné où Vaudrey allait présider le Conseil Général, et elle retrouvait avec des joies d'enfant la vieille maison de Grenoble où elle avait autrefois vécu si heureuse ! Et même sous ce toit, entre ces murs témoins de ses amours honnêtes, surtout devant eux, Vaudrey pensait à Marianne, n'avait d'autre idée que de la revoir, de la tenir dans ses bras, et, chaque jour, il lui écrivait des lettres éperdues qu'elle parcourait à peine du regard en haussant les épaules, et qu'elle brûlait sans y attacher d'importance.
Lui, au fond de sa province, s'ennuyait, dans le continuel fracas de fêtes, de réceptions en son honneur, de discours à prononcer, de cérémonies à présider, de députations à recevoir, de statues à inaugurer. Des statues ! Toujours des statues ! Et on le traînait, dans les petites villes, à Allevard ou à Marestel, de la mairie à la grande place, entre des haies de pompiers, dans des cortèges bruyants, où les cuivres lui crevaient les oreilles, sous des tentes rayées de rose, tapissées de drapeaux tricolores, devant des défilés interminables de Sociétés de Gymnastique, d'orphéons, de corporations, d'associations, d'Amis de la Paix ou d'Amis de la Guerre ! Et c'était des harangues éperdues, des dévidages de lieux communs, des discours émaillés de latin de professeurs de rhétorique, des professions de foi politiques de conseillers municipaux éloquents, tout satisfaits de happer un ministre au passage. Ce que Vaudrey en entendait de ces harangues ! Plus qu'à la Chambre. Plus drues, plus serrées, plus implacables qu'à la Chambre. Et des avis et des considérations politiques et les remontrances qui se terminaient en demandes de places ! Des cantates qui sollicitaient des subventions ! Partout des demandes, demandes de subsides, demandes d'allocations, demandes de secours, demandes de croix ! C'était le harassement, l'énervement, la courbature, l'assourdissement. Ils voulaient le tuer en criant : "Vive Vaudrey !".
Le préfet et le général commandant la division, flanquaient éternellement Vaudrey, ce supplicié trainé entre ces deux habits brodés. Sulpice entendait, des lèvres du préfet, tomber la même harangue banale : le progrès, l'avenir, la fusion des partis et des intérêts, la grandeur du département, les cotonnades et les tanneries, la splendeur du ministre qui... du ministre que... de l'enfant glorieux du pays... de l'Aigle du Dauphiné ("Vive Vaudrey !","Vive Vaudrey !"). Le général du moins variait ses effets, grondait, serrait les poings, et Vaudrey, le jour de l'inauguration de la statue d'un certain M. Valbonnans, ancien député et notable fabricant de gants, - gloire du pays, lui aussi, - avait entendu le guerrier murmurer, du matin au soir, dans un mouvement de machoire qui faisait sauter sa barbiche : "J'aime le bronze !... J'aime le bronze !...", avec une persistance qui stupéfiait le ministre.
C'était peut-être le seul souvenir un peu gai des tournées de Vaudrey dans l'Isère. Ce couronnement éternel du général : "J'aime le bronze ! J'aime le bronze !" l'avait mis en éveil, et il se demandait gaiement quel diable d'appétit avait là ce militaire qui répétait son mot d'un ton goulu, assis à côté de lui sur l'estrade, tandis que les orphéons chantaient un hymne en l'honneur de feu M. Valbonnans composé pour la circonstance par un amateur de la ville :
"Chantons, oui, chantons M. Valbonnans,
Le meilleur fabricant de gants,
Élégants !"
Tandis que les fanfares reprenaient au refrain et que les pompiers découvraient, dans une immense acclamation, la statue de M. Valbonnans, portant ces mots sur son socle : "À l'inventeur, au patriote, au négociant"; tandis encore qu'à son oreille gauche le préfet reprenait son éternel discours : la ganterie, gloire de l'Isère, le progrès, les intérêts, la grandeur du département, le ministre qui... le ministre que... ("Vive Vaudrey !"), Sulpice entendait toujours, même au milieu des acclamations, le grondement de machine du général répétant, ressassant, remáchant :
- "J'aime le bronze ! J'aime le bronze !"
Le soir du banquet, le ministre avait enfin l'explication de cet amour farouche. Le général se levait, serrait son verre à le briser, et pendant que le parfait fondait dans les assiettes, il s'écriait, de sa grosse voix, comme sur le front de sa division :
- J'aime le bronze !... J'aime le bronze, parce qu'il sert à la fois à élever des statues et à fondre des canons ! J'aime le bronze dont la voix gagne les batailles, l'artillerie étant aujourd'hui l'arme supérieure, quoique la cavalerie soit la plus chevaleresque ! J'aime le bronze qui est l'image du cœur du soldat et je voudrais voir à notre pays une armée d'hommes de bronze qui... que...
Il s'embarrassait, s'embrouillait, roulait des yeux blancs dans une face pourprée et, pour en finir, brandissait son verre comme il l'eût fait de son bancal et, aux applaudissements frénétiques des convives, hurlait vaillamment :
- J'aime le bronze ! J'aime le bronze !
Vaudrey avait failli éclater d'un fou rire, malgré toute sa dignité ministérielle, et quand il était rentré à Grenoble, sa voiture pleine des fleurs qu'on lui avait lancées, il n'avait, à Adrienne lui demandant s'il avait bien parlé, si cela avait été beau, rien répondu, en jetant à terre ses bouquets, que :
- J'ai beaucoup ri ! Mais je suis écrasé, abruti ! Quelle migraine I...
C'était tout cela que Sulpice écrivait, racontait à Marianne, en Iui disant, le naif : "Ah ! toutes ces voix qui m'acclament ne valent pas une parole de la tienne ! Quand te reverrai-je, Marianne, chère âme ?".
- Le plus tard possible ! disait la chère âme.
Elle voyait même avec un ennui profond l'été finir, l'automne commencer et venir l'approche de la saison parlementaire qui ramènerait Vaudrey et lui infligerait la présence de son amant. Sulpice lui donnait largement ce qu'il fallait à ses appétits de luxe, et c'était bien pourquoi elle ne se décidait pas à rompre, quoique depuis longtemps cet homme fût sacrifié dans son esprit.
- "Ah ! quand je pourrai le balancer !" disait-elle avec son ton de fille.
Il lui fallait maintenant se contraindre pour s'intéresser à ce duel qui l'eût passionné, quelques mois auparavant. La lune de miel de son amour pour le pouvoir était passée. Il avait trop ressenti, un à un, les écœurements de cette situation qu'il enviait afin de faire le bien, de réformer, d'agir, et où il se heurtait, depuis les premières heures, à la Routine, aux vieilles idées, aux petites ambitions, à tous les intérêts, à tous les égoïsmes. Il avait rêvé une sorte de Chimère emportant le pays vers le Progrès sur ses ailes étendues : il s'était trouvé pris dans l'engrenage poudreux d'une machine usée, et sentant l'huile rance qui tralnait l'État comme l'eût fait quelque cheval poussif. Alors, peu à peu, la lassitude et le dégoût étaient entrés dans le cœur de ce croyant qui voulait vivre, s'affirmer, en finir avec tant d'abus, et à qui ses collègues, ses chefs de division, ses chefs de service, le chef de l'État lui-même, répétaient prudemment :
- "N'innovez pas ! Laissez aller ! Cela a marché ainsi pendant si longtemps ! Â quoi bon changer ? Cela marchera bien encore !"
Ah ! C'était à secouer le joug et à tenter l'impossible ! Vaudrey se trouvait placé entre ses rêves les plus chers et la plus écœurante des réalités. Ce n'était pas des réformes qu'on lui demandait, c'était des places. Ce n'était pas le progrès que poursuivaient ces hommes chargés du sort du pays, c'était leurs intérêts propres, leurs intérêts de boutique et de terroir. Il en avait comme la nausée. Il les prenait en mépris, ces députés qui assiégeaient son cabinet et emplissaient son antichambre pour demander, réclamer et quémander. Tous, étranglés eux-mêmes de sollicitations par leurs électeurs, sollicitaient quelque chose, Ils apparaissaient à Sulpice non comme les serviteurs, mais comme les domestiques du suffrage universel. Cet abaissement devant les manieurs de bulletins indignait Vaudrey. II sentait avec effroi que la France devenait peu à peu un vaste marché aux promesses, une nation où tout le monde demandait des places à quelques-uns qui, pour garder la leur, les promettaient toutes. Les ministres, cramponnés à leur situation, devenaient les domestiques des députés, domestiques eux-mêmes de leurs électeurs. Tout se tenait dans un vaste réseau de sollicitations et de marchandages. Et dans tout cela, la haine du talent vrai, l'âpre égoïsme, l'étroitesse navrante des idées !
Sous l'Empire, au temps où l'empereur, effaré, se sentant isolé, demandait, cherchait un homme, Vaudrey se rappelait qu'on lui avait conté l'histoire de cette sonnette des Tuileries spécialement destinée à avertir les chambellans de l'entrée au château d'un visage nouveau, de la visite d'un inconnu, afin que la camarilla, prévenue par ce timbre particulier, eût le temps de se mettre sur ses gardes et d'éconduire le nouveau venu qui pouvait devenir un appui pour le maître, mais un danger pour les serviteurs.
Eh bien, Sulpice ne l'entendait pas, cette sonnette invisible et sourde, mais il la devinait, il la devinait autour de lui, avertissant les intéressés, toujours prêts à chasser l'inconnu; il sentait que son fil secret était partout étabii autour des puissants, puissants de quatre jours ou d'un quart de siècle, et que, tant qu'il y aurait au monde un pouvoir, il aurait des courtisans, et que ces courtisans, âpres au morceau, empêcheraient l'inconnu, c'est-à-dire la vérité, d'arriver jusqu'à la lumière, de crainte qu'il ne se fit, cet inconnu, la part du lion, et ne chassât les mouches du gâteau de miel. Aussi comme il en avait, de ce pouvoir passager, inutilisé malgré lui, la nausée et le mépris ! Un pouvoir qui le mettait à la merci de la criaillerie d'un collègue, d'un ennemi, à la merci lui-même de ce maitre tout-puissant, et si facilement mécontent : Tout le monde.
Il avait vu de trop près les intrigues basses, les tripotages attristants, la triture de cette cuisine politique dont tant de gens, ce Warcolier, avec sa faconde rhétoricienne, ce Granet, avec son petit sourire de supériorité, étaient avides de tenir la queue de la casserole. Il se rappelait un mot que Denis Ramel lui avait souvent répété : "À quoi bon se démener pour avoir une place au soleil ? Les meilleures sont à l'ombre !".
Il lui prenait des colères contre ses propres ambitions, contre son manque d'énergie qui l'empêchait de balayer les obstacles - hommes et idées de routine, et il se rappelait avec une amertume navrée cette entrée aux affaires, dans une clarté d'apothéose, et ses rêves, ses pauvres beaux rêves ! : "Un grand ministre ! Je veux être un grand ministre !".
Ah ! Bien oui ! On est ministre, voilà tout ! Et c'est assez ! Et c'est souvent trop ! Nous verrons bien ce qu'il fera, lui, ce Granet, qui doit faire tant de choses !
Vaudrey riait nerveusement.
Ce qu'il fera ? Rien ! Rien ! Et rien ! C'est bien simple ! Pour faire quelque chose il faut être un grand homme et non un politicien tout étourdi de se trouver au sommet du pouvoir.
- "N'innovez pas ! Laissez aller ! Cela a marché ainsi pendant si longtemps ! Â quoi bon changer ? Cela marchera bien encore !"
Ah ! C'était à secouer le joug et à tenter l'impossible ! Vaudrey se trouvait placé entre ses rêves les plus chers et la plus écœurante des réalités. Ce n'était pas des réformes qu'on lui demandait, c'était des places. Ce n'était pas le progrès que poursuivaient ces hommes chargés du sort du pays, c'était leurs intérêts propres, leurs intérêts de boutique et de terroir. Il en avait comme la nausée. Il les prenait en mépris, ces députés qui assiégeaient son cabinet et emplissaient son antichambre pour demander, réclamer et quémander. Tous, étranglés eux-mêmes de sollicitations par leurs électeurs, sollicitaient quelque chose, Ils apparaissaient à Sulpice non comme les serviteurs, mais comme les domestiques du suffrage universel. Cet abaissement devant les manieurs de bulletins indignait Vaudrey. II sentait avec effroi que la France devenait peu à peu un vaste marché aux promesses, une nation où tout le monde demandait des places à quelques-uns qui, pour garder la leur, les promettaient toutes. Les ministres, cramponnés à leur situation, devenaient les domestiques des députés, domestiques eux-mêmes de leurs électeurs. Tout se tenait dans un vaste réseau de sollicitations et de marchandages. Et dans tout cela, la haine du talent vrai, l'âpre égoïsme, l'étroitesse navrante des idées !
Sous l'Empire, au temps où l'empereur, effaré, se sentant isolé, demandait, cherchait un homme, Vaudrey se rappelait qu'on lui avait conté l'histoire de cette sonnette des Tuileries spécialement destinée à avertir les chambellans de l'entrée au château d'un visage nouveau, de la visite d'un inconnu, afin que la camarilla, prévenue par ce timbre particulier, eût le temps de se mettre sur ses gardes et d'éconduire le nouveau venu qui pouvait devenir un appui pour le maître, mais un danger pour les serviteurs.
Eh bien, Sulpice ne l'entendait pas, cette sonnette invisible et sourde, mais il la devinait, il la devinait autour de lui, avertissant les intéressés, toujours prêts à chasser l'inconnu; il sentait que son fil secret était partout étabii autour des puissants, puissants de quatre jours ou d'un quart de siècle, et que, tant qu'il y aurait au monde un pouvoir, il aurait des courtisans, et que ces courtisans, âpres au morceau, empêcheraient l'inconnu, c'est-à-dire la vérité, d'arriver jusqu'à la lumière, de crainte qu'il ne se fit, cet inconnu, la part du lion, et ne chassât les mouches du gâteau de miel. Aussi comme il en avait, de ce pouvoir passager, inutilisé malgré lui, la nausée et le mépris ! Un pouvoir qui le mettait à la merci de la criaillerie d'un collègue, d'un ennemi, à la merci lui-même de ce maitre tout-puissant, et si facilement mécontent : Tout le monde.
Il avait vu de trop près les intrigues basses, les tripotages attristants, la triture de cette cuisine politique dont tant de gens, ce Warcolier, avec sa faconde rhétoricienne, ce Granet, avec son petit sourire de supériorité, étaient avides de tenir la queue de la casserole. Il se rappelait un mot que Denis Ramel lui avait souvent répété : "À quoi bon se démener pour avoir une place au soleil ? Les meilleures sont à l'ombre !".
Il lui prenait des colères contre ses propres ambitions, contre son manque d'énergie qui l'empêchait de balayer les obstacles - hommes et idées de routine, et il se rappelait avec une amertume navrée cette entrée aux affaires, dans une clarté d'apothéose, et ses rêves, ses pauvres beaux rêves ! : "Un grand ministre ! Je veux être un grand ministre !".
Ah ! Bien oui ! On est ministre, voilà tout ! Et c'est assez ! Et c'est souvent trop ! Nous verrons bien ce qu'il fera, lui, ce Granet, qui doit faire tant de choses !
Vaudrey riait nerveusement.
Ce qu'il fera ? Rien ! Rien ! Et rien ! C'est bien simple ! Pour faire quelque chose il faut être un grand homme et non un politicien tout étourdi de se trouver au sommet du pouvoir.
- Vous vous rappelez donc, chère Marianne, dit Guy, le temps où, sur des portraits-cartes, hardiment, vous écriviez à quelqu'un qui vous aimait beaucoup : « À celui que j'aime plus que tout au monde » ?
- Oui, dit Marianne, en jetant un peu de fumée au plafond. Ça ne s'oublie jamais, ces choses-là, si l'on est le moins du monde sincère quand on les écrit !
- Et vous étiez sincère ?
- Foi d'honnête homme ! dit-elle en riant.
- On m'a pourtant assuré depuis que vous aviez, avant celui-là, adoré quelqu'un.
- C'est possible, fit Marianne avec une amertume soudaine; mais, dans la vie que j'ai menée, on m'a si souvent achetée que j'ai bien pu prendre plus d'une fois pour de l'amour le plaisir que j'avais à me donner !
Elle avait laissé, dans ces paroles, lancées d'un ton bref, sifflant comme une cravache qui eût coupé l'air, percer une telle souffrance, une colère voilée, que Lissac en fut ému étrangement.
Ce Parisien de Guy éprouvait là un sentiment tout à fait curieux et très inattendu, et cette femme qui, la nuque appuyée au dossier du fauteuil, renversée, laissait monter, dans le frémissement de ses narines, la fumée sortie de ses lèvres, par bouffées, lui semblait une créature nouvelle, inconnue, qui venait là pour le tenter. Il suivait, dans le renversement de cette pose alanguie, et comme abandonnée, les contours de ce corps élégant, d'une jeunesse épanouie, les saillies du buste, les caresses des jupes collées à ces flancs exquis, et le retour inattendu de l'amie disparue, de la maitresse oubliée, prenait tout à coup pour lui le piquant d'un caprice et d'une aventure. Et puis cette note amère, au milieu de ces lestes propos parisiens, fouettait encore sa curiosité, réveillait tout ce qu'il y avait peut-être de latent encore dans une passion brusquement coupée en deux, autrefois.
Il s'était assis, sur un pouf, à côté de Marianne, cherchant du regard les yeux clairs de la jeune femme, sa main essayant de saisir une main blanche qui se dérobait lestement. Il mettait déjà, dans le geste commencé par ses bras, quelque chose comme la caresse d'un enlacement.
Tout à coup, Marianne le regarda bien en face, et, nettement, du ton railleur d'un passé qui refusait de rouvrir un compte à l'avenir :
- Oh ! Oh ! Mais c'est une cour, ça, mon ami ?
Lissac souriait.
- Allons ! fit-elle. Laissez donc ! C'est un roman que vous avez déjà terriblement feuilleté, celui-là !
- Le roman de ma vie ! dit Lissac à voix basse, approchant sa lèvre de l'oreille de Marianne.
- Raison de plus pour ne pas le relire. C'est vrai, Il est des livres qu'on ne lit qu'une fois. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne les oublie plus !
Elle se leva toute droite, brusquement, envoyant son bout de cigarette dans le feu de la cheminée et, plongeant droit la clarté de son regard dans les yeux étonnés de Lissac :
- Ah ! Le temps est loin, voyez-vous, de ce que vous appeliez, en riant - nous avons bien ri, je l'avoue ! - les « Caprices de Marianne » ! Savez-vous où j'en suis, mon cher Guy ? Oui, où en est la folle qui fut votre maîtresse autrefois ? À l'ennui noir, profond, incurable ! Je baille ma vie, mon cher, comme dit cet autre, et je la baille à me décrocher la mâchoire. Les journées me semblent ternes, les gens me semblent bêtes, les livres me paraissent fades, les sots me font l'effet d'idiots et les hommes d'esprit de niais. C'est une maladie noire, si vous voulez, ou plutôt non, c'est une maladie grise, la haine de l'incolore, la lassitude du banal, la soif de l'impossible. Une soif qu'on n'étanche pas, soit dit en passant. La source d'eau fraîche qui doit me désaltérer n'a pas encore jailli !
Elle parlait d'un ton sec, âpre, avec un sourire que de petits rires nerveux coupaient nettement, comme de légères quintes. De temps à autre, ayant repris une cigarette, nerveusement, elle lançait une bouffée de fumée échappée de ses lèvres, ou, du bout de l'ongle, touchant son papelito, elle faisait tomber sur le tapis une pincée de cendres.
Emu, intrigué, ne pensant plus à cette tentation de tout à l'heure, Guy la regardait en hochant la tête, comme un médecin qui trouverait un client plus malade que celui-ci ne voudrait bien l'avouer.
- Vous êtes très malheureuse, Marianne ! dit-il.
- Moi ? Allons donc ! Lassée, dégoûtée, ennuyée, oui ! Malheureuse, non ! Le malheur, ça a encore quelque chose de grand. Ça peut se braver. C'est le tonnerre. Mais la pluie, l'éternelle pluie, la pluie incessante, avec le délayage de la boue, cela ah ! Cela, pouah ! C'est assommant ! Et il pleut, il pleut, il pleut terriblement dans ma vie !
Elle étendait maintenant ses deux bras dans un baillement qui n'en finissait plus, laissant voir à Lissac l'accablement stupide d'une déception immense et d'une chute sans espoir.
- La vie ? Ma vie à moi ? Une meule tournée bêtement ! Un perpétuel recommencement d'amours sans joies et d'ivresses sans soif. Comprenez-vous ? La vie d'une fille menée par une vraie femme ! Une âme à moi, un esprit à moi, une intelligence à moi dans un corps que j'abandonne à d'autres... Que j'ai abandonné, Dieu merci ! Car je me suis ressaisie enfin et je n'ai plus d'amant, et je n'en veux plus ! Et je veux être ma maîtresse enfin et n'être plus la maîtresse de personne. Je n'ai qu'un plaisir, tenez...
- Lequel ? demanda Guy, que cette colère, ce jaillissement de souffrance, cette douleur involontairement criée, troublaient profondément, le ballottant du doute à la pitié.
- Mon plaisir, dit Marianne, est d'aller m'enfermer toute seule dans une petite chambre que j'ai louée au bout d'une ruelle perdue prés du Jardin des Plantes, et où j'ai fait transporter ce qui me reste d'épaves de ma vie passée : des livres, des bibelots, des portraits, est-ce que je sais ? Et ma volupté est de me dire que là on ne me connaît pas, on ignore mon nom, et d'où je viens, et où je vais, et ce que je pense, et ce que je hais, et qui j'ai aimé, et tout ! Je m'enferme. Je m'étends sur une chaise longue et je me dis que si, par hasard, - ça arrive -, un anévrisme, une congestion, je ne sais quoi, me foudroyait là, dans cette solitude, personne ne saurait qui je suis, personne, personne, et qu'on porterait à la Morgue ou à la fosse, peu m'importe, ce corps dont les petits toquets de loutre vous rappellent la ligne serpentine. Ah ! N'est-ce pas, ce n'est pas très gai, ces parties de plaisir-là ? Eh bien, mon cher, ce sont mes bons moments. Jugez des autres !...
Lissac, remué au vif, était décidément très intrigué. On venait à lui : donc on avait besoin de lui ! On ne tenait pas à retrouver le signet à l'endroit où l'on avait laissé le roman interrompu : donc on ne venait point pour renouer ce qui avait été d'ailleurs, non pas dénoué, mais coupé.
Mais alors qu'est-ce que cette créature, toujours charmante et capiteuse, et le cœur mordu, tordu de tristesse maintenant, venait donc faire là ? Et était-elle femme (Guy la connaissait si bien !) à revenir ainsi, rien que pour évoquer les souvenirs enfuis, livrer le secret de ses angoisses présentes et faire quelque peu respirer à Lissac un parfum envolé, plus fugitif que la fumée bleue de sa cigarette ?
- Oui, dit Marianne, en jetant un peu de fumée au plafond. Ça ne s'oublie jamais, ces choses-là, si l'on est le moins du monde sincère quand on les écrit !
- Et vous étiez sincère ?
- Foi d'honnête homme ! dit-elle en riant.
- On m'a pourtant assuré depuis que vous aviez, avant celui-là, adoré quelqu'un.
- C'est possible, fit Marianne avec une amertume soudaine; mais, dans la vie que j'ai menée, on m'a si souvent achetée que j'ai bien pu prendre plus d'une fois pour de l'amour le plaisir que j'avais à me donner !
Elle avait laissé, dans ces paroles, lancées d'un ton bref, sifflant comme une cravache qui eût coupé l'air, percer une telle souffrance, une colère voilée, que Lissac en fut ému étrangement.
Ce Parisien de Guy éprouvait là un sentiment tout à fait curieux et très inattendu, et cette femme qui, la nuque appuyée au dossier du fauteuil, renversée, laissait monter, dans le frémissement de ses narines, la fumée sortie de ses lèvres, par bouffées, lui semblait une créature nouvelle, inconnue, qui venait là pour le tenter. Il suivait, dans le renversement de cette pose alanguie, et comme abandonnée, les contours de ce corps élégant, d'une jeunesse épanouie, les saillies du buste, les caresses des jupes collées à ces flancs exquis, et le retour inattendu de l'amie disparue, de la maitresse oubliée, prenait tout à coup pour lui le piquant d'un caprice et d'une aventure. Et puis cette note amère, au milieu de ces lestes propos parisiens, fouettait encore sa curiosité, réveillait tout ce qu'il y avait peut-être de latent encore dans une passion brusquement coupée en deux, autrefois.
Il s'était assis, sur un pouf, à côté de Marianne, cherchant du regard les yeux clairs de la jeune femme, sa main essayant de saisir une main blanche qui se dérobait lestement. Il mettait déjà, dans le geste commencé par ses bras, quelque chose comme la caresse d'un enlacement.
Tout à coup, Marianne le regarda bien en face, et, nettement, du ton railleur d'un passé qui refusait de rouvrir un compte à l'avenir :
- Oh ! Oh ! Mais c'est une cour, ça, mon ami ?
Lissac souriait.
- Allons ! fit-elle. Laissez donc ! C'est un roman que vous avez déjà terriblement feuilleté, celui-là !
- Le roman de ma vie ! dit Lissac à voix basse, approchant sa lèvre de l'oreille de Marianne.
- Raison de plus pour ne pas le relire. C'est vrai, Il est des livres qu'on ne lit qu'une fois. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne les oublie plus !
Elle se leva toute droite, brusquement, envoyant son bout de cigarette dans le feu de la cheminée et, plongeant droit la clarté de son regard dans les yeux étonnés de Lissac :
- Ah ! Le temps est loin, voyez-vous, de ce que vous appeliez, en riant - nous avons bien ri, je l'avoue ! - les « Caprices de Marianne » ! Savez-vous où j'en suis, mon cher Guy ? Oui, où en est la folle qui fut votre maîtresse autrefois ? À l'ennui noir, profond, incurable ! Je baille ma vie, mon cher, comme dit cet autre, et je la baille à me décrocher la mâchoire. Les journées me semblent ternes, les gens me semblent bêtes, les livres me paraissent fades, les sots me font l'effet d'idiots et les hommes d'esprit de niais. C'est une maladie noire, si vous voulez, ou plutôt non, c'est une maladie grise, la haine de l'incolore, la lassitude du banal, la soif de l'impossible. Une soif qu'on n'étanche pas, soit dit en passant. La source d'eau fraîche qui doit me désaltérer n'a pas encore jailli !
Elle parlait d'un ton sec, âpre, avec un sourire que de petits rires nerveux coupaient nettement, comme de légères quintes. De temps à autre, ayant repris une cigarette, nerveusement, elle lançait une bouffée de fumée échappée de ses lèvres, ou, du bout de l'ongle, touchant son papelito, elle faisait tomber sur le tapis une pincée de cendres.
Emu, intrigué, ne pensant plus à cette tentation de tout à l'heure, Guy la regardait en hochant la tête, comme un médecin qui trouverait un client plus malade que celui-ci ne voudrait bien l'avouer.
- Vous êtes très malheureuse, Marianne ! dit-il.
- Moi ? Allons donc ! Lassée, dégoûtée, ennuyée, oui ! Malheureuse, non ! Le malheur, ça a encore quelque chose de grand. Ça peut se braver. C'est le tonnerre. Mais la pluie, l'éternelle pluie, la pluie incessante, avec le délayage de la boue, cela ah ! Cela, pouah ! C'est assommant ! Et il pleut, il pleut, il pleut terriblement dans ma vie !
Elle étendait maintenant ses deux bras dans un baillement qui n'en finissait plus, laissant voir à Lissac l'accablement stupide d'une déception immense et d'une chute sans espoir.
- La vie ? Ma vie à moi ? Une meule tournée bêtement ! Un perpétuel recommencement d'amours sans joies et d'ivresses sans soif. Comprenez-vous ? La vie d'une fille menée par une vraie femme ! Une âme à moi, un esprit à moi, une intelligence à moi dans un corps que j'abandonne à d'autres... Que j'ai abandonné, Dieu merci ! Car je me suis ressaisie enfin et je n'ai plus d'amant, et je n'en veux plus ! Et je veux être ma maîtresse enfin et n'être plus la maîtresse de personne. Je n'ai qu'un plaisir, tenez...
- Lequel ? demanda Guy, que cette colère, ce jaillissement de souffrance, cette douleur involontairement criée, troublaient profondément, le ballottant du doute à la pitié.
- Mon plaisir, dit Marianne, est d'aller m'enfermer toute seule dans une petite chambre que j'ai louée au bout d'une ruelle perdue prés du Jardin des Plantes, et où j'ai fait transporter ce qui me reste d'épaves de ma vie passée : des livres, des bibelots, des portraits, est-ce que je sais ? Et ma volupté est de me dire que là on ne me connaît pas, on ignore mon nom, et d'où je viens, et où je vais, et ce que je pense, et ce que je hais, et qui j'ai aimé, et tout ! Je m'enferme. Je m'étends sur une chaise longue et je me dis que si, par hasard, - ça arrive -, un anévrisme, une congestion, je ne sais quoi, me foudroyait là, dans cette solitude, personne ne saurait qui je suis, personne, personne, et qu'on porterait à la Morgue ou à la fosse, peu m'importe, ce corps dont les petits toquets de loutre vous rappellent la ligne serpentine. Ah ! N'est-ce pas, ce n'est pas très gai, ces parties de plaisir-là ? Eh bien, mon cher, ce sont mes bons moments. Jugez des autres !...
Lissac, remué au vif, était décidément très intrigué. On venait à lui : donc on avait besoin de lui ! On ne tenait pas à retrouver le signet à l'endroit où l'on avait laissé le roman interrompu : donc on ne venait point pour renouer ce qui avait été d'ailleurs, non pas dénoué, mais coupé.
Mais alors qu'est-ce que cette créature, toujours charmante et capiteuse, et le cœur mordu, tordu de tristesse maintenant, venait donc faire là ? Et était-elle femme (Guy la connaissait si bien !) à revenir ainsi, rien que pour évoquer les souvenirs enfuis, livrer le secret de ses angoisses présentes et faire quelque peu respirer à Lissac un parfum envolé, plus fugitif que la fumée bleue de sa cigarette ?
Salomon Molina entrait d'ailleurs dans le cabinet du ministre comme il entrait au foyer de l'Opéra, le torse élargi, le menton haut, le ventre en avant.
- Monsieur le Ministre, dit-il, la voix claire, en s'évasant dans le fauteuil que lui désignait Vaudrey, je vous préviens que vous avez la virginité de mes démarches !... C'est toujours une virginité ! Ma parole, voici la première fois que je mets le pied dans un ministère !...
Il mettait à affirmer son indépendance - née de sa colossale puissance - une affectation de satisfait et de parvenu. L'ancien marchand d'habits marseillais raccrochant, au passage, dans sa jeunesse, les matelots du port, les ouvriers maltais, les levantins, pour leur "couler" un paletot d'occasion ou un pantalon de hasard, comme les revendeuses du Temple harponnent le passant; Salomon Molina, qui avait promené, sur la Canebière, sa gueuserie et ses espérances, rêvant, du fond de sa boutique noire, les triomphes, les joies, les débauches, les indigestions que donne l'argent, avait d'ailleurs toujours conservé la rancœur de ces journées mauvaises et l'amertume de ces souvenirs.
Son premier mot en entrant dans le cabinet de Vaudrey, cette constatation de sa virginité en fait de sollicitations, décelait ses rancunes. Maintenant, triomphant, puissant, enchanté, choyé, obèse, il étalait sur Paris sa corpulence énorme, sa chair et son argent. Il remplissait de son ventre, soulevé par de gros rires, les avant-scénes des théâtres. Il épanouissait sa carrure dans la calèche qui le déposait, aux jours de Courses, à l'entrée de l'enceinte du pesage. Il tenait comme par le cou tout ce qui, dans la curée parisienne, jappe et bondit autour de l'argent et des sacs éventrés, les émissions, les mangeailles de la fortune publique : banquiers, coulissiers, tripoteurs d'affaires, journalistes de finance, de politique ou de chantage, hères en quête de cent sous, hommes d'état en passe de fortune, et il distribuait à ce petit monde, comme pâtée au chenil, les escomptes et les rognures de ses tripotages, en se donnant le malin plaisir, la jouissance insolente de parvenu heureux, de feindre, par exemple, aux heures d'émissions, des maladies qui n'existaient pas, pour avoir le droit de garder la chambre, d'entendre sonner à sa porte des gens portant des noms célèbres, et de faire faire antichambre, lui, le brocanteur et le chineur marseillais, à des puissants et à des illustres.
Alors, il savourait la joie de la toute-puissance, cette joie qui lui donnait jusqu'aux moelles des titillations de jouissance, et, après être resté, tout le jour, en proie à des névralgies de commande, il éprouvait le ravissement infini de la force humiliant l'esprit, du coup de poing écrasant une faiblesse, en apparaissant cravaté de blanc dans un salon, dans le foyer de la danse ou dans les coulisses d'une première, et en disant, avec le sourire railleur du triomphe gavé :
- J'étais malade aujourd'hui. J'avais ma névralgie ! Le Ministre des Finances est venu me voir !... Le baron Nathan est venu prendre de mes nouvelles !
De toutes les jouissances que cet homme avait éprouvées, ce n'était pas celle des virginités féminines, achetées parfois à prix d'or, c'était ces virginités d'âmes, d'honnêteté et de vertu qu'il parvenait souvent à humilier devant lui, à courber comme de l'osier, et à souffleter de son ironie, lorsque la misère jetait à sa merci de ces puritains qui avaient passé quelquefois, le front hautain, devant les millions de l'homme d'argent. Alors le marchand d'habits prenait hideusement ses revanches. Il n'y avait pas de pitié à attendre de ce gros homme rieur et bon enfant d'allures. Ses doigts gras vous étranglaient plus sürement que les maigres mains d'un usurier. Molina ne pardonnait pas. Ah ! S'il venait voir le ministre, celui-là, c'était assurément qu'il avait quelque chose à lui demander !
Mais quoi ? Chose extraordinaire, devant Vaudrey, Molina, qui cependant avait joué sous jambe bien des malins parmi les malins, se trouvait comme mal à l'aise. II y avait dans le regard franc de ce bêta, comme "Molina le Tombeur" l'avait appelé, un soir, en causant politique, une honnêteté si droite, que le banquier, habitué aux coquins et aux faiseurs, ne savait trop comment aborder la question. Il s'agissait pourtant d'une grosse affaire.
- Une fameuse poire ! songeait Molina.
Une affaire de chemins de fer. Une concession à obtenir. Une affaire d'intérêts privés dissimulée sous les grands mots d'intérêt public, de besoins nationaux. Des millions à gagner. Molina s'était chargé de tâter le Président du Conseil et le Ministre des Travaux Publics. Deux honnêtetés. Le truc, comme disait le "Tombeur", c'était de leur faire avaler la chose sous couleur de patriotisme. Chemin de fer stratégique. Moyen de locomotion rapide, en cas de mobilisation. Avec des mots bien sonnants, comme stratégie, frontières, sécurité, on enlèverait bien des choses...
- Monsieur le Ministre, dit-il, la voix claire, en s'évasant dans le fauteuil que lui désignait Vaudrey, je vous préviens que vous avez la virginité de mes démarches !... C'est toujours une virginité ! Ma parole, voici la première fois que je mets le pied dans un ministère !...
Il mettait à affirmer son indépendance - née de sa colossale puissance - une affectation de satisfait et de parvenu. L'ancien marchand d'habits marseillais raccrochant, au passage, dans sa jeunesse, les matelots du port, les ouvriers maltais, les levantins, pour leur "couler" un paletot d'occasion ou un pantalon de hasard, comme les revendeuses du Temple harponnent le passant; Salomon Molina, qui avait promené, sur la Canebière, sa gueuserie et ses espérances, rêvant, du fond de sa boutique noire, les triomphes, les joies, les débauches, les indigestions que donne l'argent, avait d'ailleurs toujours conservé la rancœur de ces journées mauvaises et l'amertume de ces souvenirs.
Son premier mot en entrant dans le cabinet de Vaudrey, cette constatation de sa virginité en fait de sollicitations, décelait ses rancunes. Maintenant, triomphant, puissant, enchanté, choyé, obèse, il étalait sur Paris sa corpulence énorme, sa chair et son argent. Il remplissait de son ventre, soulevé par de gros rires, les avant-scénes des théâtres. Il épanouissait sa carrure dans la calèche qui le déposait, aux jours de Courses, à l'entrée de l'enceinte du pesage. Il tenait comme par le cou tout ce qui, dans la curée parisienne, jappe et bondit autour de l'argent et des sacs éventrés, les émissions, les mangeailles de la fortune publique : banquiers, coulissiers, tripoteurs d'affaires, journalistes de finance, de politique ou de chantage, hères en quête de cent sous, hommes d'état en passe de fortune, et il distribuait à ce petit monde, comme pâtée au chenil, les escomptes et les rognures de ses tripotages, en se donnant le malin plaisir, la jouissance insolente de parvenu heureux, de feindre, par exemple, aux heures d'émissions, des maladies qui n'existaient pas, pour avoir le droit de garder la chambre, d'entendre sonner à sa porte des gens portant des noms célèbres, et de faire faire antichambre, lui, le brocanteur et le chineur marseillais, à des puissants et à des illustres.
Alors, il savourait la joie de la toute-puissance, cette joie qui lui donnait jusqu'aux moelles des titillations de jouissance, et, après être resté, tout le jour, en proie à des névralgies de commande, il éprouvait le ravissement infini de la force humiliant l'esprit, du coup de poing écrasant une faiblesse, en apparaissant cravaté de blanc dans un salon, dans le foyer de la danse ou dans les coulisses d'une première, et en disant, avec le sourire railleur du triomphe gavé :
- J'étais malade aujourd'hui. J'avais ma névralgie ! Le Ministre des Finances est venu me voir !... Le baron Nathan est venu prendre de mes nouvelles !
De toutes les jouissances que cet homme avait éprouvées, ce n'était pas celle des virginités féminines, achetées parfois à prix d'or, c'était ces virginités d'âmes, d'honnêteté et de vertu qu'il parvenait souvent à humilier devant lui, à courber comme de l'osier, et à souffleter de son ironie, lorsque la misère jetait à sa merci de ces puritains qui avaient passé quelquefois, le front hautain, devant les millions de l'homme d'argent. Alors le marchand d'habits prenait hideusement ses revanches. Il n'y avait pas de pitié à attendre de ce gros homme rieur et bon enfant d'allures. Ses doigts gras vous étranglaient plus sürement que les maigres mains d'un usurier. Molina ne pardonnait pas. Ah ! S'il venait voir le ministre, celui-là, c'était assurément qu'il avait quelque chose à lui demander !
Mais quoi ? Chose extraordinaire, devant Vaudrey, Molina, qui cependant avait joué sous jambe bien des malins parmi les malins, se trouvait comme mal à l'aise. II y avait dans le regard franc de ce bêta, comme "Molina le Tombeur" l'avait appelé, un soir, en causant politique, une honnêteté si droite, que le banquier, habitué aux coquins et aux faiseurs, ne savait trop comment aborder la question. Il s'agissait pourtant d'une grosse affaire.
- Une fameuse poire ! songeait Molina.
Une affaire de chemins de fer. Une concession à obtenir. Une affaire d'intérêts privés dissimulée sous les grands mots d'intérêt public, de besoins nationaux. Des millions à gagner. Molina s'était chargé de tâter le Président du Conseil et le Ministre des Travaux Publics. Deux honnêtetés. Le truc, comme disait le "Tombeur", c'était de leur faire avaler la chose sous couleur de patriotisme. Chemin de fer stratégique. Moyen de locomotion rapide, en cas de mobilisation. Avec des mots bien sonnants, comme stratégie, frontières, sécurité, on enlèverait bien des choses...
Video de Jules Claretie (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jules Claretie (68)
Voir plus
Quiz
Voir plus
1 classique = 1 auteur (XIX° siècle)
La Chartreuse de Parme
Stendhal
Alfred de Vigny
Honoré de Balzac
21 questions
566 lecteurs ont répondu
Thèmes :
classique
, classique 19ème siècle
, 19ème siècleCréer un quiz sur ce livre566 lecteurs ont répondu