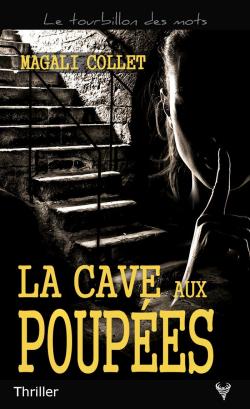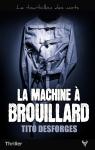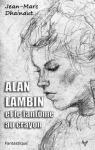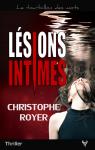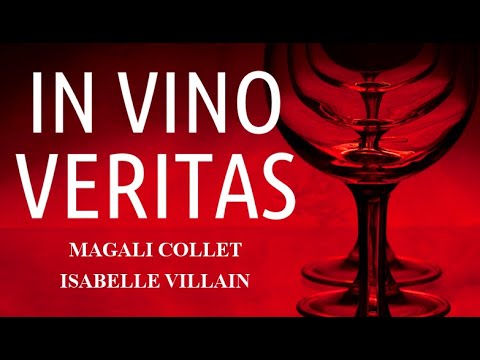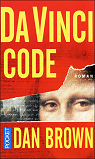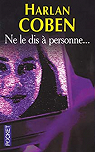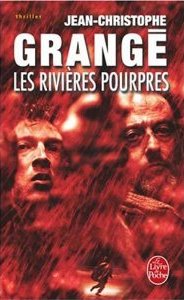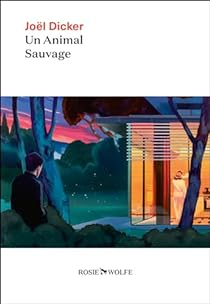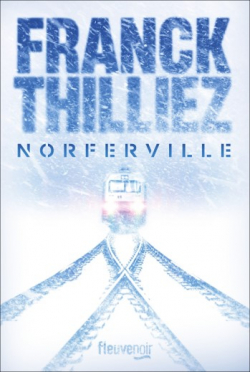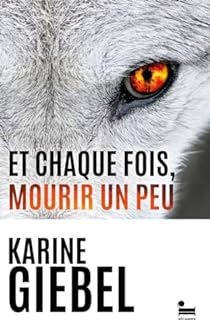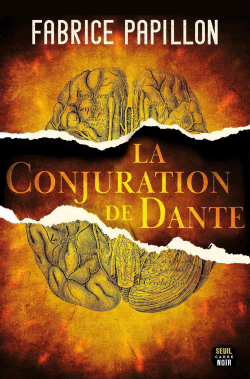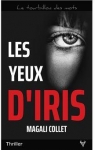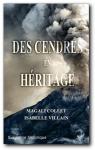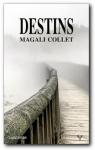Magali Collet
EAN : 9782372580663
Taurnada Éditions (19/03/2019)
/5
405 notesTaurnada Éditions (19/03/2019)
Résumé :
Manon n’est pas une fille comme les autres, ça, elle le sait depuis son plus jeune âge. En effet, une fille normale ne passe pas ses journées à regarder la vraie vie à la télé. Une fille normale ne compte pas les jours qui la séparent de la prochaine raclée monumentale… Mais, par-dessus tout, une fille normale n’aide pas son père à garder une adolescente prisonnière dans la cave de la maison.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Cave aux poupéesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (189)
Voir plus
Ajouter une critique
Le Père, il avait vingt-neuf ans quand il a rencontré maman, qui en avait treize.
Elle s'est enfui avec lui dans sa maison, loin de tout.
Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, j'ai vu ça à la télévision.
Tu peux aimer des personnes qui ont vingt ans de plus que toi, ou vingt ans de moins.
C'est comme ça que ça marche les sentiments.
Moins de deux ans plus tard maman était enceinte et je suis arrivée.
Je m'appelle Manon.
J'ai grandi dans cette demeure isolée. Le Père partait travailler pendant que maman faisait la cuisine, et toutes les autres tâches ménagères.
C'est le rôle des femmes de prendre soin de leur mari et de s'occuper des corvées.
Maman a essayé de m'apprendre à lire et à écrire mais je n'y suis jamais arrivé. Peut-être que je suis trop bête. Elle me racontait des histoires aussi. Elle m'aimait fort.
Parfois le Père la frappait mais elle m'expliquait que c'était normal, son travail était stressant et il fallait bien qu'il se défoule sur quelqu'un.
Je savais que ma famille était un peu différente mais c'était tout ce que je connaissais.
Quand j'ai grandi, le Père a commencé à me regarder autrement. A vouloir me toucher. Ca n'a pas plu du tout à Maman.
Je devais avoir neuf ans quand il m'a monté pour la première fois. Maman s'en est rendu compte et elle lui a hurlé dessus.
Pour la faire taire et lui apprendre la politesse, il l'a encore frappé, quarante-sept fois.
Je ne sais pas lire mais j'aime compter.
Je crois qu'à vingt-deux ans maman était devenue trop vieille pour plaire encore au père.
Cette nuit-là j'ai dormi avec elle pour essayer de réchauffer son corps froid.
Le Père, il l'a enterrée le lendemain.
C'est moi qui suis devenu la femme de la maison à partir de ce moment là. J'ai fait les corvées, je me suis faite monter à chaque fois que le Père il en avait envie. Et quand je faisais quelque chose de mal ou que j'oubliais les règles de la maison je prenais de sacrées raclées.
Mais il me reste quand même quelques dents bien accrochées.
A quatorze ans j'ai accouché d'un petit garçon. Mais pour le Père pas question de le garder alors il a du s'en débarrasser. Ca m'a rendu très triste.
"Il avait tué le bébé parce que dans la vraie vie , on doit pas faire des gosses avec son père. C'est pas humain."
De toute façon je commençais à être un peu trop grande pour le Père, qui préférais monter des pré-adolescentes. Des gamines de douze ans qui de préférence font un peu moins que leur âge, et n'ont pas encore atteint la puberté.
Jamais des garçons par contre.
"Le Père, il n'aimait pas les garçons, même les jeunes. C'était contre nature, qu'il disait."
Il a aménagé deux chambres pour elles dans la cave.
Et quand l'une d'elle se laisse mourir de désespoir, il l'enterre sous le Tilleul et revient peu de temps après avec une nouvelle fille.
C'est moi qui doit leur donner à manger et aussi les laver au début. Avant qu'elles comprennent que c'est dans leur intérêt.
Le père aime qu'elles soient propres, épilées, coiffées et qu'elles sentent bons.
"Est-ce que j'étais un monstre comme ceux dont on parlait des fois à la télé ?"
Et j'avais interdiction de nouer un dialogue avec elles, sinon le Père il se mettait en colère.
Ces filles, c'étaient que des objets de toute façon.
"T'es rien de plus qu'une merde sous ma chaussure."
"Le Père, il disait toujours que j'étais moche et bonne à rien."
J'avais donc plutôt intérêt à obéir si je ne voulais pas prendre de nouveaux coups.
Aujourd'hui j'ai vingt-deux ans. le Père me laisse tranquille puisqu'il a souvent deux filles à sa disposition au sous-sol, qui se laissent faire.
Il aime beaucoup quand même quand elles crient parce qu'elles ont mal.
Maintenant il ne me monte plus que quand elles saignent et sont en âge d'avoir un bébé.
A l'instant où commence mon histoire, il n'y a plus qu'une prisonnière.
La seconde a justement accouché. le Père il a pas encore eu le temps de reboucher les trous près du Tilleul. Alors ça attire les mouches.
* * *
Vous l'aurez compris, La cave aux poupées est un court roman qui n'a rien de très sain, avec lequel on n'a pas le visage qui se fend d'un large sourire à chaque page à moins d'être particulièrement sadique.
Ce n'est pourtant pas non plus un roman glauque qui prend aux tripes et qui cherche à nous écoeurer.
Pas de longues descriptions de torture, pas de détails inutiles.
Ce qu'on ressent avant tout, c'est la peine et la douleur.
Tout est histoire de perspective.
Dans une enquête policière ou avec un narrateur omniscient, beaucoup de lecteurs auraient peut être pensé que Magali Collet allait beaucoup trop loin dans l'horreur et la turpitude, ne cherchant qu'à repousser les limites d'un scénario très similaire avec celui de Cicatrices de Claire Favan, dans lequel un violeur surnommé Twice retient toujours deux victimes à la fois dans sa ferme.
Mais racontée par Manon, la fille de ce "Père" monstrueux dont le prénom ne sera cité qu'une fois comme pour mieux lui enlever toute humanité, le macabre récit de la cave aux poupées prend une toute autre envergure.
Manon est un monstre complice des atrocités commises par un père violeur, pédophile, incestueux et tueur en série.
Mais elle est aussi une victime et cette ambiguïté rend le personnage particulièrement fascinant.
Torturée aussi bien physiquement que psychologiquement depuis son plus jeune âge.
Et malgré ses actes il est impossible de la juger avec sévérité, uniquement avec énormément d'empathie.
C'est encore une enfant mentalement, qui aimerait probablement mieux jouer aux poupées, mais une gamine coincée dans un corps de femme qui n'a jamais eu la possibilité de grandir.
D'apprendre les notions de bien et de mal.
Elle connaît la souffrance, elle se souvient encore de l'amour maternel, mais elle a été privée toute sa vie de repères.
"Le rire, c'est indécent ici."
Elle doit respecter l'autorité et les règles du Père.
Elle ne sait pas que le rôle des femmes dans la société ne consiste pas uniquement à coucher, se faire cogner et faire à manger.
"La bonniche de la maison c'est toi à ce qu'il paraît."
L'auteure a visiblement énormément travaillé sur le vocabulaire avec lequel s'exprime Manon.
Elle n'a certes pas une maîtrise absolue du Bescherelle, elle qui n'a jamais pu être scolarisée.
"Je suis peut-être jamais sortie d'ici mais je connais la vraie vie à la télé."
Mais par les mots qu'elle emploie, par les raisonnements curieux qu'elle peut avoir, Magali Collet nous permet de nous mettre dans sa peau et de penser comme elle.
De la comprendre.
Par exemple le Père ne baise pas, ne viole pas, il monte toujours ses victimes. A l'image d'un étalon montant une jument pour une saillie.
Ce qui minimise le crime tout en donnant au boucher autant d'humanité que les morceaux de viande sur son étal.
Dans chacune de ses paroles on constate qu'elle est formatée, qu'elle fonctionne à l'instinct, à la peur des coups.
Que son sort est scellé. Qu'il n'y a aucun moyen et surtout aucune raison de chercher à fuir.
"Quand on vit dans la merde on finit par lui ressembler quoi qu'on fasse."
Et elle a des failles malgré tout derrière cette carapace quasi bestiale.
Comme son besoin d'amitié, son envie de dialoguer, son désir de maternité.
La cave aux poupées avait tout pour être un livre malsain et dérangeant de plus.
Et il l'est. A ne pas mettre en toutes les mains et âmes sensibles s'abstenir, tout ça tout ça.
Mais je vais aussi en retenir toute la douceur, toute la chaleur.
Ce portrait de Manon qui est conditionnée depuis sa naissance à n'être qu'une victime et un monstre, nous révèle progressivement d'attendrissants vestiges d'humanité.
Qui ont échappé au massacre de sa personnalité.
Et je pense avoir rarement lu un roman aussi noir qui arrive pourtant à emmener tout au long de ses pages un véritable rayon d'espoir.
Mon seul bémol serait lié à mon regard de lecteur policier.
Aussi isolée que soit la maison, il y a forcément une enquête suite aux disparitions répétées de très jeunes adolescentes dans la région, aux profils similaires.
S'il y en a une, le livre ne l'évoque pas. Ca n'est pas son sujet.
Malgré tout, le lecteur sait que le Père part travailler tous les jours de la semaine. C'est donc qu'il a probablement un emploi stable et une adresse connue.
Et de nos jours il peut paraître surprenant qu'un endroit avec de l'électricité soit assez anonyme pour passer entre les mailles des filets du facteur, de l'administration, ou de l'employé d'Enedis qui veut vous forcer à poser un compteur Linky.
Et qui aurait alors aperçu une jeune femme pas tout à fait comme les autres et entendu des hurlements et des appels à l'aide en provenance de la cave.
Ce qui aurait écourté bien trop vite ce roman aussi ignoble que lumineux.
Premier livre de l'auteure Magali Collet, il a eu le « malheur » de sortir en plein confinement. Comme je vous l'ai annoncé dans un précédent article, je souhaiterais mettre en lumière, à ma petite échelle, ces livres qui ont fait preuve d'une énorme malchance. Car oui il était toujours possible de le commander en ebook mais il faut garder à l'esprit que tout le monde ne dispose pas de liseuse et que certains lecteurs conservent leur préférence pour la version papier.
Vu l'amélioration de la situation, je me suis dit que c'était enfin la bonne période pour m'y plonger et vous en parler.
Manon est une jeune fille de 22 ans qui n'a pas eu une enfance rêvée. Ayant perdu sa mère dès son plus jeune âge, c'est son père qui l'a élevée. Vous me direz que c'est le cas de milliers d'enfants et que cela se passe bien. Effectivement cela peut être le cas, sauf quand votre père est un dangereux tueur et violeur en série de jeunes filles. Manon a toujours grandi éloignée de la civilisation, ne s'évadant que par son poste de télévision. Mais alors qu'elle se lie d'amitié avec une des captives de son père, les choses pourraient peut-être changer.
Si je n'avais pas lu sur la quatrième de couverture qu'il s'agissait du premier livre de Magali Collet, je ne m'en serais pas doutée. En effet, son style d'écriture est très plaisant, fluide et déjà bien travaillé. Elle manie parfaitement les codes du suspens, le dosant savamment au fil des pages et faisant que le lecteur ne peut se détacher du bouquin.
Écrit à la première du singulier, cela nous plonge plus fortement dans le récit de cette Manon, personnage désoeuvré qui ne tombe pas dans le cliché non plus. Cette sobriété qu'a Magali Collet de traiter son huit-clos est bien pensée. Malgré l'horreur de la situation, on s'attache à cette « gamine » asservie et pourtant si forte.
Magali Collet est donc un nom que nous, amateurs de thrillers, devons retenir car sa plume fera partie intégrante de la scène du la littérature noire française dans le futur. C'est indéniable.
Je remercie les éditions Taurnada pour leur confiance.
Lien : https://www.musemaniasbooks...
Vu l'amélioration de la situation, je me suis dit que c'était enfin la bonne période pour m'y plonger et vous en parler.
Manon est une jeune fille de 22 ans qui n'a pas eu une enfance rêvée. Ayant perdu sa mère dès son plus jeune âge, c'est son père qui l'a élevée. Vous me direz que c'est le cas de milliers d'enfants et que cela se passe bien. Effectivement cela peut être le cas, sauf quand votre père est un dangereux tueur et violeur en série de jeunes filles. Manon a toujours grandi éloignée de la civilisation, ne s'évadant que par son poste de télévision. Mais alors qu'elle se lie d'amitié avec une des captives de son père, les choses pourraient peut-être changer.
Si je n'avais pas lu sur la quatrième de couverture qu'il s'agissait du premier livre de Magali Collet, je ne m'en serais pas doutée. En effet, son style d'écriture est très plaisant, fluide et déjà bien travaillé. Elle manie parfaitement les codes du suspens, le dosant savamment au fil des pages et faisant que le lecteur ne peut se détacher du bouquin.
Écrit à la première du singulier, cela nous plonge plus fortement dans le récit de cette Manon, personnage désoeuvré qui ne tombe pas dans le cliché non plus. Cette sobriété qu'a Magali Collet de traiter son huit-clos est bien pensée. Malgré l'horreur de la situation, on s'attache à cette « gamine » asservie et pourtant si forte.
Magali Collet est donc un nom que nous, amateurs de thrillers, devons retenir car sa plume fera partie intégrante de la scène du la littérature noire française dans le futur. C'est indéniable.
Je remercie les éditions Taurnada pour leur confiance.
Lien : https://www.musemaniasbooks...
« Comme à chaque fois qu'il dépassait les bornes, il s'occupa de moi. Sans tendresse, sans amour, comme on soigne un animal qui nous est utile. »
Non, Manon n'est vraiment pas une fille comme les autres.
Depuis toujours, elle vit coupée du monde, dans une maison isolée, seule avec son père, « le Père ». Seule ? Pas tout à fait…
Son unique lien avec le monde extérieur lui vient de la télévision. Mais la vie des gens qui la fait rêver dans le poste n'a pas grand-chose à voir avec sa propre existence. de plus, dans la cave de la maison, dans une cellule comparable à celles d'une prison, une adolescente est retenue prisonnière, séquestrée, violentée et régulièrement violée par « le Père ».
Manon n'a jamais connu autre chose que ce semblant de vie-là, dans l'antre d'un monstre. Un monstre engendre-t-il forcément un monstre ?...
Waow ! Juste Waow. Voilà ce que je me suis dit en refermant ce livre. Sans courses poursuites ni rebondissements à chaque page, Magali Collet construit un redoutable thriller psychologique impossible à lâcher, un thriller d'une brillante noirceur !
Une histoire terrible qui fait froid dans le dos, servie par des personnages crédibles et surtout par une langue qui sonne juste, un ton qui sent le parler vrai. En immersion avec les personnages, on est abasourdi par l'abjection du « Père » qui nous laisse sur le carreau presque sonné par une telle inhumanité.
Magali Collet vous invite à faire un aller-retour en enfer dans La Cave aux poupées, il serait vraiment dommage de passer votre tour…
Lien : https://bouquins-de-poches-e..
Non, Manon n'est vraiment pas une fille comme les autres.
Depuis toujours, elle vit coupée du monde, dans une maison isolée, seule avec son père, « le Père ». Seule ? Pas tout à fait…
Son unique lien avec le monde extérieur lui vient de la télévision. Mais la vie des gens qui la fait rêver dans le poste n'a pas grand-chose à voir avec sa propre existence. de plus, dans la cave de la maison, dans une cellule comparable à celles d'une prison, une adolescente est retenue prisonnière, séquestrée, violentée et régulièrement violée par « le Père ».
Manon n'a jamais connu autre chose que ce semblant de vie-là, dans l'antre d'un monstre. Un monstre engendre-t-il forcément un monstre ?...
Waow ! Juste Waow. Voilà ce que je me suis dit en refermant ce livre. Sans courses poursuites ni rebondissements à chaque page, Magali Collet construit un redoutable thriller psychologique impossible à lâcher, un thriller d'une brillante noirceur !
Une histoire terrible qui fait froid dans le dos, servie par des personnages crédibles et surtout par une langue qui sonne juste, un ton qui sent le parler vrai. En immersion avec les personnages, on est abasourdi par l'abjection du « Père » qui nous laisse sur le carreau presque sonné par une telle inhumanité.
Magali Collet vous invite à faire un aller-retour en enfer dans La Cave aux poupées, il serait vraiment dommage de passer votre tour…
Lien : https://bouquins-de-poches-e..
Voici mon retour de lecture sur La cave aux poupées de Magali Collet.
Manon n'est pas une fille comme les autres, ça, elle le sait depuis son plus jeune âge.
En effet, une fille normale ne passe pas ses journées à regarder la vraie vie à la télé.
Une fille normale ne compte pas les jours qui la séparent de la prochaine raclée monumentale..
Mais, par-dessus tout, une fille normale n'aide pas son père à garder une adolescente prisonnière dans la cave de la maison..
La cave aux poupées est un thriller époustouflant qui a réussi à me scotcher de la première à la dernière page.
Décidemment, j'apprécie de plus en plus la plume de Magali Collet ! Elle est hyper vivante, j'avais vraiment l'impression par moment d'être dans la tête de Manon, c'est hyper troublant.
J'ai commencé ce roman un soir au moment du coucher et j'ai été incapable de le lâcher pendant une heure trente ; je voulais savoir comment tout ça allait se terminer ; il fallait que les pages se tournent c'était indispensable :)
Ce roman est hyper fort, d'une violence inouïe que ce soit d'un point de vue psychologique ou physique.
Toutefois, l'autrice reste soft sur certains détails, certes ce qu'elle décrit est glaçant mais elle arrive à ne pas aller trop loin, dans le sordide.
La voix de Manon est comme celle d'une enfant bien que ce soit une jeune adulte. Elle réussit à décrire tout ça comme si c'était "normal". Une normalité bien loin de la vraie vie, évidemment !
Mais comme nous sommes dans les pensées d'une gamine sous l'emprise de son père ; plus nous découvrons le Père et plus l'effroi est là.
Manon est un personnage dérangeant, je ne pensais pas du tout m'attacher à elle et pourtant, à un moment, je me suis rendue compte qu'elle me touchait en plein coeur.
Je ne peux pas dire que je l'apprécie mais je ne la déteste pas non plus.
En fait, elle est surtout à plaindre, pauvre gamine !
La cave aux poupées est un thriller époustouflant que je vous recommande (attention toutefois : âmes très sensibles s'abstenir) et note cinq étoiles :)
Manon n'est pas une fille comme les autres, ça, elle le sait depuis son plus jeune âge.
En effet, une fille normale ne passe pas ses journées à regarder la vraie vie à la télé.
Une fille normale ne compte pas les jours qui la séparent de la prochaine raclée monumentale..
Mais, par-dessus tout, une fille normale n'aide pas son père à garder une adolescente prisonnière dans la cave de la maison..
La cave aux poupées est un thriller époustouflant qui a réussi à me scotcher de la première à la dernière page.
Décidemment, j'apprécie de plus en plus la plume de Magali Collet ! Elle est hyper vivante, j'avais vraiment l'impression par moment d'être dans la tête de Manon, c'est hyper troublant.
J'ai commencé ce roman un soir au moment du coucher et j'ai été incapable de le lâcher pendant une heure trente ; je voulais savoir comment tout ça allait se terminer ; il fallait que les pages se tournent c'était indispensable :)
Ce roman est hyper fort, d'une violence inouïe que ce soit d'un point de vue psychologique ou physique.
Toutefois, l'autrice reste soft sur certains détails, certes ce qu'elle décrit est glaçant mais elle arrive à ne pas aller trop loin, dans le sordide.
La voix de Manon est comme celle d'une enfant bien que ce soit une jeune adulte. Elle réussit à décrire tout ça comme si c'était "normal". Une normalité bien loin de la vraie vie, évidemment !
Mais comme nous sommes dans les pensées d'une gamine sous l'emprise de son père ; plus nous découvrons le Père et plus l'effroi est là.
Manon est un personnage dérangeant, je ne pensais pas du tout m'attacher à elle et pourtant, à un moment, je me suis rendue compte qu'elle me touchait en plein coeur.
Je ne peux pas dire que je l'apprécie mais je ne la déteste pas non plus.
En fait, elle est surtout à plaindre, pauvre gamine !
La cave aux poupées est un thriller époustouflant que je vous recommande (attention toutefois : âmes très sensibles s'abstenir) et note cinq étoiles :)
Pfiouh ! Quelle claque ! Un roman noir, très noir, qu'il est difficile de lâcher tant il est singulier par son côté glauque et oppressant.
" Quand on vit dans la merde, on finit par lui ressembler quoi qu'on fasse" répète Manon, comme un mantra. On peut dire qu'elle sait de quoi elle parle en tournant les pages de ce récit qui relate une partie de sa vie.
Enfermée depuis sa plus tendre enfance dans une maison perdue dans les montagnes, Manon, jeune fille d'une vingtaine d'années, passe ses journées à travailler chez elle selon un planning bien précis : ménage, lessive, repas à faire pour son père, avec qui elle vit seule depuis une dizaine d'années, et une mission bien plus sordide : faire la toilette et apporter les soins nécessaires aux jeunes filles que son père a enlevées pour assouvir ses pulsions malsaines. Ces dernières sont enfermées dans des cachots situés dans le sous-sol de la maison.
« C'était à moi de la laver aussi, ce que je faisais à l'aide d'une bassine que je remplissais directement à la douche de la cellule. Pendant ce temps-là, elle gardait les yeux fermés et je préférais ça. le Père, ça lui allait de monter un fantôme et il continuait à le faire au même rythme qu'avant. »
Manon ne pose pas de question : au moindre faux pas, elle est rouée de coups…
Elle n'a aucune conscience de ce qu'est une vie que l'on peut qualifier de « normale ». Ses seuls repères sont ceux diffusés à la télé… Sa conception de la vie de famille est tellement faussée !
En tant que lecteur, on a envie d'aider Manon à ouvrir les yeux même si l'on sait très bien que nos conceptions sont tellement différentes des siennes. Cette jeune femme, outre les violences physiques innommables qu'elle subit depuis des années, est complètement brisée au niveau psychologique.
Pour un premier roman, Magali Collet frappe vraiment très fort ! Son style sert parfaitement son intrigue. Pas de pathos, ni de psychologie à deux balles. Elle raconte à travers la voix de Manon, ses observations factuelles, ses pauvres capacités de réflexion, ses pauvres petits rêves…
Un conseil : jetez-vous sur cette pépite !!! Moi, j'attends le prochain avec impatience !
" Quand on vit dans la merde, on finit par lui ressembler quoi qu'on fasse" répète Manon, comme un mantra. On peut dire qu'elle sait de quoi elle parle en tournant les pages de ce récit qui relate une partie de sa vie.
Enfermée depuis sa plus tendre enfance dans une maison perdue dans les montagnes, Manon, jeune fille d'une vingtaine d'années, passe ses journées à travailler chez elle selon un planning bien précis : ménage, lessive, repas à faire pour son père, avec qui elle vit seule depuis une dizaine d'années, et une mission bien plus sordide : faire la toilette et apporter les soins nécessaires aux jeunes filles que son père a enlevées pour assouvir ses pulsions malsaines. Ces dernières sont enfermées dans des cachots situés dans le sous-sol de la maison.
« C'était à moi de la laver aussi, ce que je faisais à l'aide d'une bassine que je remplissais directement à la douche de la cellule. Pendant ce temps-là, elle gardait les yeux fermés et je préférais ça. le Père, ça lui allait de monter un fantôme et il continuait à le faire au même rythme qu'avant. »
Manon ne pose pas de question : au moindre faux pas, elle est rouée de coups…
Elle n'a aucune conscience de ce qu'est une vie que l'on peut qualifier de « normale ». Ses seuls repères sont ceux diffusés à la télé… Sa conception de la vie de famille est tellement faussée !
En tant que lecteur, on a envie d'aider Manon à ouvrir les yeux même si l'on sait très bien que nos conceptions sont tellement différentes des siennes. Cette jeune femme, outre les violences physiques innommables qu'elle subit depuis des années, est complètement brisée au niveau psychologique.
Pour un premier roman, Magali Collet frappe vraiment très fort ! Son style sert parfaitement son intrigue. Pas de pathos, ni de psychologie à deux balles. Elle raconte à travers la voix de Manon, ses observations factuelles, ses pauvres capacités de réflexion, ses pauvres petits rêves…
Un conseil : jetez-vous sur cette pépite !!! Moi, j'attends le prochain avec impatience !
Citations et extraits (14)
Voir plus
Ajouter une citation
D’ordinaire, il y avait une fille par cellule. Les filles, elles étaient choyées : elles avaient une chemise de nuit que je changeais tous les deux jours et une culotte quotidienne. Je leur brossais les cheveux au début et puis après, je leur laissais une brosse sur le lavabo, à côté du dentifrice. Sur la table de chevet, il y avait aussi la télécommande pour la télé qui se trouvait dans le couloir, accrochée au plafond près du mur. Le Père, il l’avait placée de telle façon qu’elles pouvaient la voir de leur lit. Il aimait que les filles puissent regarder la télé surtout au début quand elles arrivaient. Elles guettaient la moindre info qui parlait d’elles et elles voyaient que, plus les jours passaient, moins elles y étaient présentes… Ça suffisait à les adoucir. Une fois par semaine, je m’occupais de leurs poils. Les bras, les jambes et tout le corps. Le Père, il achetait des bombes « Spécial Épilation ». Y avait juste à vaporiser, à attendre que le boulot se fasse pis à rincer à la douche. Au début, j’étais obligée de les attacher pour le faire parce qu’elles se débattaient comme des diablesses, mais après quelques jours elles se laissaient faire sans broncher. Quand elles étaient sèches, je leur mettais de la crème, celle qui sent bon, qu’on met pour les bébés. J’aimais cette odeur… Le Père, lui, il aimait juste que les filles soient propres.
Mais moi, j'avais pas peur. Je savais bien qu'il allait me rosser ou essayer de m'étrangler une fois de plus, mais ça ne m'effrayait pas. Je lui avais dit que j'avais l'habitude et que j'arrivais à sortir de mon corps pour pas avoir trop mal, il suffirait que je le fasse encore une fois.
Cette nuit j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que toutes les portes et les grilles de la maison étaient ouverts, que tu en avais les clefs et que nous partions toutes les deux. On allait au bord de la mer, là où il y a du vent, comme en Bretagne, chez ma grand-mère. Tu n'as jamais senti l'iode, hein ? Ça ne ressemble à rien de ce que tu connais, ça te requinque en moins de deux et tu es pleine d'énergie pour le reste de la journée. Tu aimerais ça, je crois. On irait ramasser des coquillages à la marée basse, un seau plein et on rentrerait les cuire dans la maison de ma grand-mère. Ensuite on irait au jardin ramasser les légumes et on ferait une jardinière. J'ai jamais aimé manger les légumes mais je donnerais tout pour pouvoir manger à nouveau ceux de ma grand-mère. Elle doit avoir 76 ans maintenant. Elle te plairait, je crois. Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Thriller écrit à la première personne qui donne le ton dès le premier chapitre. Un récit d'une jeune fille, Manon, très spécial qui vous glace le sang, nous entraîne dans une spirale glauque qui nous met forcément mal à l'aise. Un monologue aux pensées ambiguës et ambivalents.
Thriller psychologique dérangeant où diverses émotions bouillonnent dans cette histoire et on s'y laisse prendre. Je me suis attachée malgré moi à manon, plus une victime qu'autre chose dans ce huis clos troublant. Quelque part Manon fait preuve d'une certaine naïveté dans son absurde labeur, elle reste un être humain mais une jeune femme avant tout, avec ses défauts et ses qualités, avec ses subtilités et son raisonnement... ce qui fait la subtilité de Manon.
J'ai apprécié la lecture de ce thriller bien construit ainsi que bien écrit, une plume fluide et agréable qui se laisse lire. Certains passages sont choquants mais d'autres prêtes à sourire par les "maladresses" de Manon. Malgré l'horreur de la forme de cette histoire, le fond reste humain. Je n'en dirais pas plus de peur de spoiler l'histoire. A vous de la découvrir.
Bonne lecture à vous.
Thriller psychologique dérangeant où diverses émotions bouillonnent dans cette histoire et on s'y laisse prendre. Je me suis attachée malgré moi à manon, plus une victime qu'autre chose dans ce huis clos troublant. Quelque part Manon fait preuve d'une certaine naïveté dans son absurde labeur, elle reste un être humain mais une jeune femme avant tout, avec ses défauts et ses qualités, avec ses subtilités et son raisonnement... ce qui fait la subtilité de Manon.
J'ai apprécié la lecture de ce thriller bien construit ainsi que bien écrit, une plume fluide et agréable qui se laisse lire. Certains passages sont choquants mais d'autres prêtes à sourire par les "maladresses" de Manon. Malgré l'horreur de la forme de cette histoire, le fond reste humain. Je n'en dirais pas plus de peur de spoiler l'histoire. A vous de la découvrir.
Bonne lecture à vous.
Connaitre son prénom ne devrait rien changer, d’ailleurs j’avais intérêt à l’oublier vite fait. Camille, c’était qu’un mot comme « assiette » ou « canapé ». Si je ne voulais pas d’ennuis, il vaudrait mieux pour moi qu’elle redevienne qu’un meuble, comme les autres filles. C’était aussi la meilleure chose que je puisse faire pour elle jusqu’à ce qu’elle crève avec son bâtard : lui enlever tout espoir. Elle devait comprendre qu’il y avait bien plus d’humanité dans un rat mort que dans tous les habitants de cette putain de maison. Ah ça oui !
Videos de Magali Collet (4)
Voir plusAjouter une vidéo
« In vino veritas », le booktrailer. Un roman de Magali Collet & Isabelle Villain.
Lors d'un vernissage, une galeriste est assassinée. Secrets, mensonges et trahisons vont secouer la quiétude d'une petite commune en plein coeur du vignoble bordelais. Et lorsque deux frères se retrouvent après des années de séparation, la liberté de l'un va dépendre de la détermination de l'autre.
Un thriller psychologique délicieusement machiavélique.
Roman disponible le 11 mai 2023 (papier & numérique).
Infos & précommande ici https://www.taurnada.fr/ivvmciv/
Lors d'un vernissage, une galeriste est assassinée. Secrets, mensonges et trahisons vont secouer la quiétude d'une petite commune en plein coeur du vignoble bordelais. Et lorsque deux frères se retrouvent après des années de séparation, la liberté de l'un va dépendre de la détermination de l'autre.
Un thriller psychologique délicieusement machiavélique.
Roman disponible le 11 mai 2023 (papier & numérique).
Infos & précommande ici https://www.taurnada.fr/ivvmciv/
Les plus populaires : Polar et thriller
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Magali Collet (5)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (6 - polars et thrillers )
Roger-Jon Ellory : " **** le silence"
seul
profond
terrible
intense
20 questions
2859 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, thriller
, romans policiers et polarsCréer un quiz sur ce livre2859 lecteurs ont répondu