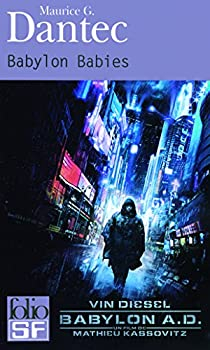>
Dès que l’on ouvre ce troisième roman, force est de noter que l’auteur n’a pas renoncé à sa détestable habitude d’étaler ses références bibliographiques (voir Les racines du Mal). Au moins cette fois nous en épargne-t-il la liste détaillée pour nous asséner, suprême habileté, de longs remerciements adressés à de nombreuses personnalités du monde littéraire et philosophique tels P. K. Dick et P. Deleuze.
Pourtant, malgré ce prélude calamiteux, il est incontestable que Dantec a gagné en expérience et en professionnalisme (à moins que l’éditeur ne se soit enfin décidé à faire son travail de correcteur). Le style, mieux maîtrisé, si l’on excepte quelques passages enflés dont l’auteur s’est fait une spécialité, s’en trouve nettement amélioré.
Nous renouons dans cette troisième œuvre avec le personnage de Hugo Toorop, le héros de La Sirène rouge. Bien du temps a passé : l’homme d’action idéaliste, fringant et sûr de lui, n’est plus qu’un mercenaire fatigué qui s’accroche encore, sans grand espoir, à son système de valeurs. Finies les puissantes voitures qui vous permettaient de filer entre les doigts de l’adversaire, finies les cartes de crédit illimité généreusement distribuées par une énigmatique brigade internationale : Toorop, meurtri, ne peut plus compter que sur lui-même et pour survivre, il dépouille les ennemis qu’il vient d’abattre. Cette dégringolade sociale et morale, voire idéologique, nous rend le personnage plus proche, plus humain, moins sentencieux et en somme plus sympathique. L’effet « looser » reste un bon ingrédient littéraire.
Autre belle réussite du roman : la toile de fond politique et sociale dans un monde postmoderne. Guerre civile en Chine, magouilles en tous genres, sectes et apprentis sorciers, ignobles tractations orchestrées par la mafia se mêlent pour composer un décor aux sordides imbrications, vraisemblable, cohérent, angoissant, à la mesure de l’amertume du personnage principal.
L’intérêt du récit tient également à sa remarquable galerie de personnages secondaires. Du colonel russe corrompu qui use de ses pouvoirs pour soutenir les trafics les plus illicites, au mafieux sibérien qui commandite les plus sombres machinations, en passant par les hommes et femmes de main de tout bord dont les alliances précaires ne cessent de se faire et de se défaire, c’est tout une faune hétéroclite, lamentable, désespérément humaine que l’auteur anime avec brio en l’insérant parfaitement dans le décor grâce à quelques procédés efficaces déjà utilisés dès La Sirène Rouge.
On distingue, en gros, deux parties dans le roman.
La première peut être assimilée à une longue scène d’exposition chargée de promesses d’orages. Marie Zorn, une jeune femme au passé trouble, doit être convoyée au Canada sous haute protection. Pourquoi ? Cela, même le colonel russe qui coordonne l’opération l’ignore. La mafia paye bien, trop bien même, et elle ne tolère aucune question. Toorop accepte la mission avec deux autres mercenaires (un tueur orangiste et une ancienne de Tsahal) placés sous ses ordres. Armés jusqu’aux dents, ils se claquemurent avec leur protégée dans un appartement de Montréal. Le jeu est risqué : la mafia surveille l’opération, le colonel cherche à doubler son « allié » mafieux avec la complicité de Toorop, et d’autres forces que l’on devine tout aussi redoutables œuvrent en coulisse. La mission qui dérape rapidement hors du schéma prévu peut être interrompue d’un moment à l’autre et, dans ce cas, Marie Zorn devra être exécutée. Des affrontements sanglants se dessinent et le lecteur se surprend à imaginer les déchaînements à venir. Malgré quelques longueurs et incohérences psychologiques, cette mise en place sur l’échiquier est un succès.
La deuxième partie est malheureusement beaucoup moins brillante. Renonçant à exploiter ses effets d’annonce (affrontements pressentis entre la mafia, les Russes et l’équipe de Toorop), l’auteur bifurque, et l’intrigue perd soudain sa cohérence. Les nouveaux personnages se multiplient, tous dotés, même les plus mineurs, d’une biographie détaillée où le propos du récit s’englue. De la scène épique longuement préparée pour relancer l’action, l’auteur (pourtant orfèvre en la matière) ne nous livre, à force de prises de reculs, d’affèteries narratives et de procédés d’éclatement du discours, que des images fragmentaires, incomplètes et pour tout dire frustrantes. Comme la bataille oppose, de plus, des factions que l’on n’a pratiquement pas vues jusque-là et que les personnages principaux n’y participent pas, l’intérêt du lecteur est vite émoussé. On retrouve là les limites de Dantec qui révèle, une fois de plus, son incapacité à maîtriser une intrigue complexe. Le scénario, de plus en plus décousu, cède la place au pittoresque, voire aux effets racoleurs, et l’intrigue délayée brinquebale tant bien que mal vers une issue prophétique à la Dantec, puisqu’il en faut une. Ce n’est d’ailleurs pas tant l’utilisation de la théorie de Deleuze sur les schizophrènes qui lasse (le sujet s’intègre très bien dans un roman de science-fiction) que le style pesant et sentencieux exhumé pour l’occasion. L’auteur a retrouvé tous ses défauts de jeunesse, et c’est dans un interminable dialogue de gourous entre Toorop, Darquandier (le héros des Racines du Mal) et Dantec lui-même, sous le nom de Boris Dantzic (!), que nous est infligée la révélation des arcanes du récit. Suit, pour ceux qui seront arrivés jusque-là, un pâle épilogue censé injecter une dose d’optimisme dans toute cette noirceur.
Critique de Gataparda
Dès que l’on ouvre ce troisième roman, force est de noter que l’auteur n’a pas renoncé à sa détestable habitude d’étaler ses références bibliographiques (voir Les racines du Mal). Au moins cette fois nous en épargne-t-il la liste détaillée pour nous asséner, suprême habileté, de longs remerciements adressés à de nombreuses personnalités du monde littéraire et philosophique tels P. K. Dick et P. Deleuze.
Pourtant, malgré ce prélude calamiteux, il est incontestable que Dantec a gagné en expérience et en professionnalisme (à moins que l’éditeur ne se soit enfin décidé à faire son travail de correcteur). Le style, mieux maîtrisé, si l’on excepte quelques passages enflés dont l’auteur s’est fait une spécialité, s’en trouve nettement amélioré.
Nous renouons dans cette troisième œuvre avec le personnage de Hugo Toorop, le héros de La Sirène rouge. Bien du temps a passé : l’homme d’action idéaliste, fringant et sûr de lui, n’est plus qu’un mercenaire fatigué qui s’accroche encore, sans grand espoir, à son système de valeurs. Finies les puissantes voitures qui vous permettaient de filer entre les doigts de l’adversaire, finies les cartes de crédit illimité généreusement distribuées par une énigmatique brigade internationale : Toorop, meurtri, ne peut plus compter que sur lui-même et pour survivre, il dépouille les ennemis qu’il vient d’abattre. Cette dégringolade sociale et morale, voire idéologique, nous rend le personnage plus proche, plus humain, moins sentencieux et en somme plus sympathique. L’effet « looser » reste un bon ingrédient littéraire.
Autre belle réussite du roman : la toile de fond politique et sociale dans un monde postmoderne. Guerre civile en Chine, magouilles en tous genres, sectes et apprentis sorciers, ignobles tractations orchestrées par la mafia se mêlent pour composer un décor aux sordides imbrications, vraisemblable, cohérent, angoissant, à la mesure de l’amertume du personnage principal.
L’intérêt du récit tient également à sa remarquable galerie de personnages secondaires. Du colonel russe corrompu qui use de ses pouvoirs pour soutenir les trafics les plus illicites, au mafieux sibérien qui commandite les plus sombres machinations, en passant par les hommes et femmes de main de tout bord dont les alliances précaires ne cessent de se faire et de se défaire, c’est tout une faune hétéroclite, lamentable, désespérément humaine que l’auteur anime avec brio en l’insérant parfaitement dans le décor grâce à quelques procédés efficaces déjà utilisés dès La Sirène Rouge.
On distingue, en gros, deux parties dans le roman.
La première peut être assimilée à une longue scène d’exposition chargée de promesses d’orages. Marie Zorn, une jeune femme au passé trouble, doit être convoyée au Canada sous haute protection. Pourquoi ? Cela, même le colonel russe qui coordonne l’opération l’ignore. La mafia paye bien, trop bien même, et elle ne tolère aucune question. Toorop accepte la mission avec deux autres mercenaires (un tueur orangiste et une ancienne de Tsahal) placés sous ses ordres. Armés jusqu’aux dents, ils se claquemurent avec leur protégée dans un appartement de Montréal. Le jeu est risqué : la mafia surveille l’opération, le colonel cherche à doubler son « allié » mafieux avec la complicité de Toorop, et d’autres forces que l’on devine tout aussi redoutables œuvrent en coulisse. La mission qui dérape rapidement hors du schéma prévu peut être interrompue d’un moment à l’autre et, dans ce cas, Marie Zorn devra être exécutée. Des affrontements sanglants se dessinent et le lecteur se surprend à imaginer les déchaînements à venir. Malgré quelques longueurs et incohérences psychologiques, cette mise en place sur l’échiquier est un succès.
La deuxième partie est malheureusement beaucoup moins brillante. Renonçant à exploiter ses effets d’annonce (affrontements pressentis entre la mafia, les Russes et l’équipe de Toorop), l’auteur bifurque, et l’intrigue perd soudain sa cohérence. Les nouveaux personnages se multiplient, tous dotés, même les plus mineurs, d’une biographie détaillée où le propos du récit s’englue. De la scène épique longuement préparée pour relancer l’action, l’auteur (pourtant orfèvre en la matière) ne nous livre, à force de prises de reculs, d’affèteries narratives et de procédés d’éclatement du discours, que des images fragmentaires, incomplètes et pour tout dire frustrantes. Comme la bataille oppose, de plus, des factions que l’on n’a pratiquement pas vues jusque-là et que les personnages principaux n’y participent pas, l’intérêt du lecteur est vite émoussé. On retrouve là les limites de Dantec qui révèle, une fois de plus, son incapacité à maîtriser une intrigue complexe. Le scénario, de plus en plus décousu, cède la place au pittoresque, voire aux effets racoleurs, et l’intrigue délayée brinquebale tant bien que mal vers une issue prophétique à la Dantec, puisqu’il en faut une. Ce n’est d’ailleurs pas tant l’utilisation de la théorie de Deleuze sur les schizophrènes qui lasse (le sujet s’intègre très bien dans un roman de science-fiction) que le style pesant et sentencieux exhumé pour l’occasion. L’auteur a retrouvé tous ses défauts de jeunesse, et c’est dans un interminable dialogue de gourous entre Toorop, Darquandier (le héros des Racines du Mal) et Dantec lui-même, sous le nom de Boris Dantzic (!), que nous est infligée la révélation des arcanes du récit. Suit, pour ceux qui seront arrivés jusque-là, un pâle épilogue censé injecter une dose d’optimisme dans toute cette noirceur.