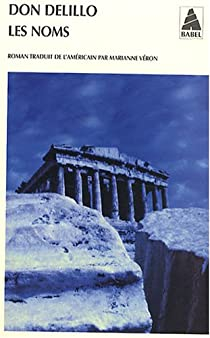Si vous lisez Les Noms de Don DeLillo ,surtout ne faites pas comme moi, ne le lisez pas avec des interruptions trop longues car ce roman est labyrinthique ! Et je me suis souvent égarée dans ce récit tortueux à souhait, je devrais plutôt dire dans la lecture de deux récits parallèles dont on n'est pas convaincu qu'il s'éclaire l'un l'autre. Bien au contraire car ils sont truffés de ruptures narratives dont on ne perçoit pas toujours la logique...
L'intrigue repose sur un premier récit, celui d'un groupe d'expatriés, hommes d'affaires américains, dont Jim, le narrateur fait partie car il est analyste de risques géopolitiques. Nous suivons leurs tribulations dans les années 1979/83, l'époque du néolibéralisme triomphant mais aussi période de grandes tensions internationales. L'auteur nous offre une belle galerie de portraits de ces hommes d'affaires toujours entre deux avions et qui vivent ce déracinement perpétuel en se shootant au goût du risque et du pouvoir sans oublier l'alcool dont ils font un usage immodéré lors de soirées bien arrosées dans l'entre-soi bien sûr du petit monde des expats ! le Moyen et le Proche Orient sont déjà à l'époque une pétaudière et derrière ce monde des affaires "de l'argent délicat" rôde la CIA...
Inerfère avec ce premier récit un autre qui ne démarre que tardivement dans le roman. le narrateur se rend régulièrement sur une île proche d'Athènes qui est son QG professionnel pour retrouver son fils TAP et sa femme Kathryn dont il est séparé. Cette dernière est archéologue et travaille sous la direction d'Owen Brademas qui se passionne lui pour les lettres des écrits anciens et surtout leur graphisme car il y voit une source de mystère et de signification ésotérique beaucoup plus passionnante que le contenu qu'elle véhiculent. C'est pourquoi il va s'intéresser à une mystérieuse secte qui va commettre un meurtre sur l'île où il se trouve avant d'en perpétrer d'autres en Jordanie et en Syrie. Pourquoi Owen va-t-il se mettre à jouer les détectives et poursuivre les membres de cette secte jusqu'en Inde ? Eh bien c'est parce qu'il a remarqué de troublantes concordances entre les meurtres commis et les lettres de l'alphabet... Il y a donc dans ce deuxième récit pseudo policier une quête initiatique qui repose sur le sens profond du langage et d'ailleurs l'une des dernières phrases du roman est : "Notre offrande est le langage"
Pour moi le fil rouge qui court dans ces deux récits est celui du langage. Fil rouge souterrain certes mais c'est le seul lien que je perçois entre ces deux récits qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Tous les personnages sont en effet de redoutables débatteurs et les dialogues qui émaillent le roman sont éblouissants de virtuosité. C'est aussi le langage cette fois-ci liée à la plume de l'auteur qui nous permet de nous immerger dans les ambiances, les paysages des pays traversés, qu'il s'agisse d'un petit village grec "où la lumière, l'immensité, la profondeur sont partout" ou du grouillement de vie et du cosmopolitisme propres aux villes de Proche et Moyen Orient.
La plume de DeLillo fait aussi mouche dans le sarcasme lorsqu'il s'en donne à coeur joie pour se livrer à une critique acerbe de l'American way of life ou lorsqu'il fustige via un personnage de banquier, la soi-disant générosité du "grand frère américain" !
Je suis donc à la fois ravie et agacée par la lecture de ce roman. Ravie par la plume de l'auteur mais agacée par la construction labyrinthique du roman qui m'a paru inutilement complexe, comme si l'auteur prenait un malin plaisir à jouer au chat et à la souris avec son lecteur !
L'intrigue repose sur un premier récit, celui d'un groupe d'expatriés, hommes d'affaires américains, dont Jim, le narrateur fait partie car il est analyste de risques géopolitiques. Nous suivons leurs tribulations dans les années 1979/83, l'époque du néolibéralisme triomphant mais aussi période de grandes tensions internationales. L'auteur nous offre une belle galerie de portraits de ces hommes d'affaires toujours entre deux avions et qui vivent ce déracinement perpétuel en se shootant au goût du risque et du pouvoir sans oublier l'alcool dont ils font un usage immodéré lors de soirées bien arrosées dans l'entre-soi bien sûr du petit monde des expats ! le Moyen et le Proche Orient sont déjà à l'époque une pétaudière et derrière ce monde des affaires "de l'argent délicat" rôde la CIA...
Inerfère avec ce premier récit un autre qui ne démarre que tardivement dans le roman. le narrateur se rend régulièrement sur une île proche d'Athènes qui est son QG professionnel pour retrouver son fils TAP et sa femme Kathryn dont il est séparé. Cette dernière est archéologue et travaille sous la direction d'Owen Brademas qui se passionne lui pour les lettres des écrits anciens et surtout leur graphisme car il y voit une source de mystère et de signification ésotérique beaucoup plus passionnante que le contenu qu'elle véhiculent. C'est pourquoi il va s'intéresser à une mystérieuse secte qui va commettre un meurtre sur l'île où il se trouve avant d'en perpétrer d'autres en Jordanie et en Syrie. Pourquoi Owen va-t-il se mettre à jouer les détectives et poursuivre les membres de cette secte jusqu'en Inde ? Eh bien c'est parce qu'il a remarqué de troublantes concordances entre les meurtres commis et les lettres de l'alphabet... Il y a donc dans ce deuxième récit pseudo policier une quête initiatique qui repose sur le sens profond du langage et d'ailleurs l'une des dernières phrases du roman est : "Notre offrande est le langage"
Pour moi le fil rouge qui court dans ces deux récits est celui du langage. Fil rouge souterrain certes mais c'est le seul lien que je perçois entre ces deux récits qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Tous les personnages sont en effet de redoutables débatteurs et les dialogues qui émaillent le roman sont éblouissants de virtuosité. C'est aussi le langage cette fois-ci liée à la plume de l'auteur qui nous permet de nous immerger dans les ambiances, les paysages des pays traversés, qu'il s'agisse d'un petit village grec "où la lumière, l'immensité, la profondeur sont partout" ou du grouillement de vie et du cosmopolitisme propres aux villes de Proche et Moyen Orient.
La plume de DeLillo fait aussi mouche dans le sarcasme lorsqu'il s'en donne à coeur joie pour se livrer à une critique acerbe de l'American way of life ou lorsqu'il fustige via un personnage de banquier, la soi-disant générosité du "grand frère américain" !
Je suis donc à la fois ravie et agacée par la lecture de ce roman. Ravie par la plume de l'auteur mais agacée par la construction labyrinthique du roman qui m'a paru inutilement complexe, comme si l'auteur prenait un malin plaisir à jouer au chat et à la souris avec son lecteur !
On pourrait dire, en paraphrasant «Papa» Ernest, que l'atmosphère dépeinte par Don DeLillo au sein de ce groupe d'expatriés américains installés à Athènes, à l'aube de années 1980, n'a rien à proprement parler d'une «fête»… «Les Américains avaient l'habitude de venir dans des endroits comme celui-ci pour écrire, peindre et étudier, pour trouver des textures plus profondes. Maintenant, nous faisons des affaires.»
Cadres de filiales de multinationales de l'assurance ou de la finance pour le Proche-Orient et l'Inde, basés à Athènes, travaillant à la sauvegarde des intérêts économiques et géopolitiques américains, et notamment à l'évaluation des risques et à la sécurisation matérielle des citoyens et des sites industriels américains dans les zones les plus sensibles de la planète, ce groupe d'expatriés, selon James Axton, personnage central et narrateur du roman, était emblématique d'«une sous-culture d'hommes d'affaires en transit, vieillissant dans les avions et les aéroports», se retrouvant sporadiquement à Athènes, autour d'une table au restaurant, entre deux missions en Afghanistan ou en Inde, ou bien chez les uns ou chez les autres, lors de soirées bien arrosées durant lesquelles «nous nous disions où il fallait signer un document pour boire un verre, où l'on ne pouvait pas manger de viande le mercredi ou le jeudi, où il fallait esquiver un homme accompagné d'un cobra en sortant de l'hôtel, où s'appliquait la loi martiale, où se pratiquait la fouille corporelle, la torture systématique, le tir groupé en l'air, à la mitraillette à l'occasion des mariages, l'enlèvement contre rançon des représentants des sociétés industrielles». James Axton en devient ainsi un témoin privilégié, à la fois sujet et chroniqueur du caractère compartimenté et des codes particuliers régissant le fonctionnement en vase clos de ces «étrangers en terre étrangère», programmés «pour jouer au squash et travailler les week-ends», purs produits de la nouvelle vision du monde version 80's ; Axton incarnant en même temps l'écho de cette voix subjective qui s'interroge, face à l'image en miroir renvoyée par son environnement et son époque, sur le sens et l'orientation qu'on voudrait donner à sa vie («Ma vie passe et je n'arrive pas à la maîtriser»).
Avant de se retrouver analyste des risques pour une multinationale des assurances à Athènes, notre homme menait pourtant une vie paisible avec sa femme et son enfant «dans une vielle maison à pignons entre les Montagnes Vertes et les Adirondacks», une existence simple, «se satisfaisant de peu». Rédacteur free-lance, touche-à-tout («brochures, livrets, tracts, cochonneries de toutes sortes pour des industries ou le gouvernement»), il lui arrivait aussi, à l'occasion, de faire le nègre. Un écrivain donc, écrivant cependant pour les autres. Suite à la séparation du couple, sa femme, Kathryn, part s'installer en Grèce, à l'île de Kouros, où elle avait réussi à décrocher un job sur un site archéologique, et emmène avec elle leur enfant, «Tap» (autre écrivain, en herbe cette fois-ci, âgé de 9 ans et nourrissant déjà le projet d'écrire «un roman»…). Grâce au hasard d'une rencontre dans le cadre de ses activités de rédacteur free-lance, Axton s'était vu quelque temps auparavant proposer un poste à Athènes, qu'il finirait donc par accepter pour pouvoir par la suite se rapprocher de sa famille.
A partir de cette trame initiale, assez «lisible», Don DeLillo construit une narration virtuose, à plusieurs étages, ne cessant de se ramifier dans d'autres histoires, récits d'événements parallèles s'ouvrant à leur tour à d'autres niveaux plus complexes de lecture (et par moment assez exigeants aussi vis-à-vis de ses lecteurs), mettant en scène des personnages énigmatiques, habités par d'étranges desseins : des membres d'une mystérieuse secte commettant des meurtres rituels à travers le monde, dictés par des rapprochements entre les noms des victimes et la toponymie des sites où ils sont perpétrés ; Owen Brademas, archéologue passionnée d'épigraphie, parcourant le Proche-Orient , cherchant dans les inscriptions en langues anciennes, gravées sur les pierres provenant de sites et de ruines antiques, à «déchiffrer, découvrir des secrets et relever la géographie du langage, en quelque sorte», ou encore Frank Volterra, cinéaste renommé, amitié de jeunesse d'Axton et de son ex-femme, qui abandonnera un tournage en cours pour suivre les traces de la secte mystérieuse dans les régions montagneuses du Péloponnèse, afin d'en faire un documentaire…
Roman radicalement métonymique et elliptique, où le sens ne cesse de glisser sans jamais se laisser totalement apprivoiser, par certains aspects prémonitoire (sur l'ampleur, par exemple, que les campagnes d'attaque organisées et systématiques contre «l'Empire du Mal» devaient prendre dans les années à venir), dans LES NOMS, Don DeLillo semble avoir en quelque sorte voulu mettre en parallèle les pistes balisées par la mythologie d'une nouvelle puissance américaine globalisée, véhiculée notamment par la doctrine reaganienne, avec cette autre, incarnée ici par les paysages arides de la Grèce et les contrées désertiques du Proche-Orient, cette puissance archétypique et indomptable, indéchiffrable qui continue, malgré tout le soin mis par le nouvel ordre néo-libéral à tenter de la circonscrire et, dans certains cas, de la chiffrer, à y survivre, prête à refaire surface à tout moment, se refusant à toute emprise purement rationnelle, à toute reconnaissance «soumise au [seul] scrutin conscient». L'auteur ne ménagera pas les effets de sidération et de folie qui résulteront d'une telle confrontation chez certains de ses personnages, et son lecteur non plus: DeLillo, lui, n'écrit pas pour les autres, il ne s'adresse pas en tout cas à notre besoin viscéral de certitudes, à cette part hargneuse en nous qui réclame son dû aux conteurs à qui elle prête oreille: des noms, des révélations, des conclusions! Il s'adresse avant tout à notre soif de contemplation subjective du monde et de ses mystères, à notre intelligence intime la plus précieuse et la plus fragile, celle qui s'applique à réfléchir à une forme possible d'habiter la réalité de manière unique et individuée (sans devenir pour autant purement individualiste comme semble nous y inviter notre époque) ; à cette part d'imaginaire, enfin, qui nous évitera, dans le meilleur des cas, de nous conformer, au-delà du strictement nécessaire, aux faux-semblants et aux critères tendus par l'urgence du présent. L'écrivain, nous dit Don DeLillo par la bouche de l'un de ses personnages, «en ce siècle, entretient une conversation avec la folie», le conduisant à procéder à «une distillation finale du soi, à une mise au point définitive» et à «l'extinction des voix fausses». LES NOMS semble justement constituer une métaphore de cette dissolution du sens qui marque notre modernité -ou faudrait-il plutôt dire, notre postmodernité?
«Postmodernité» : voilà une notion répandue dans différents domaines (politique, sociétal, économique, artistique, philosophique, architectural, dans la mode, etc..) et s'appliquant à caractériser notre époque. Elle semble également avoir été intégrée dans le langage courant -plutôt branché («oh-là-là, j'adooore ton look postmoderne !»), si bien qu'on peut légitimement se demander si elle ne se serait pas quelque peu galvaudée, à être utilisée ainsi à tous bouts de champs, de manière aussi vague et aléatoire… A l'origine, pourtant, cette expression avait été créée pour qualifier des phénomènes précis, à savoir la désagrégation progressive des modes de régulation sociale et économique, ou encore la déconstruction de certains courants de pensées et systèmes de valeurs emblématiques de la modernité forgée par le XXème siècle. Ainsi, en devenant postmodernes, ne serions-nous pas, pour autant, devenus encore-plus-modernes-que-les-modernes , ni plus novateurs que ne le fut le XXème siècle (ce dernier terme à ne pas confondre, bien sûr, avec le grand nombre d'innovations technologiques proposées à la pelle de nos jours). Les critères de la «modernité» n'étant plus opérants pour appréhender et/ou transformer le monde contemporain, la condition de postmodernité semblerait dès lors correspondre davantage à quelque chose de subi, qu'à une véritable révolution, celle-ci fleurerait, pour ainsi dire, davantage la décomposition que la fraicheur d'un nouveau parfum, marquerait moins l'avènement de nouvelles certitudes ou la promesse d'un bonheur inouï, qu'une perte de repères progressive et, d'ailleurs, à mesure que les années avancent, soit dit au passage, de plus en plus anxiogène. La postmodernité déconstruirait davantage qu'elle ne construit; plutôt que de créer du nouveau, elle fragmenterait, empilerait, superposerait et remixerait; le rétro-futurisme, l'afro-celtique, le cyber-gothique ou le trash-musette, par exemple, en seraient, parmi de tonnes d'autres courants et modes dits «postmodernes», de coquettes illustrations de ce manque cruel de véritables et solides perspectives nouvelles… !
La critique de la postmodernité, en tout cas depuis cet angle de vision, semble occuper une place centrale dans l'oeuvre de Don DeLillo. Echec des utopies collectives, fragmentation des identités, instrumentalisation des savoirs, repli sur soi et individualisme prononcé, ravages divers, individuels et collectifs, provoqués par le néo-libéralisme économique, en sont quelques-uns de ses ingrédients principaux, présents dès son coup de génie inaugural, «Americana», premier roman explosif de l'auteur, publié en 1972. DeLillo s'est depuis inscrit en digne héritier de cette célèbre lignée d'écrivains américains ayant aspiré à faire une radioscopie panoramique de la culture américaine, de ses grands fantasmes et ses pires démons, afin de réaliser ce qu'on a pris l'habitude de nommer le «grand roman américain» d'une époque.
LES NOMS ne semble pas, néanmoins, une lecture qui pourrait plaire facilement ou de manière consensuelle une majorité de lecteurs. du fait du développement non-linéaire et fragmenté de son intrigue, en raison du choix volontaire de l'auteur de ne pas donner des réponses fermes et unilatérales aux questions qu'elle soulève, ou de l'enfermer dans un dénouement à sens unique, ou enfin de ses différentes strates et niveaux de lecture, susceptibles d'égarer par moments les lecteurs les plus aguerris, il devient quasiment impossible d'embrasser d'un seul coup, d'un seul et unique regard toute la richesse d'évocation de ce roman et toutes les subtilités de sa construction (de surcroît, une traduction, certes pas simple à la base, mais qui en l'occurrence ne semble pas tout le temps à la hauteur, n'est pas là pour faciliter la tâche au lecteur…). Une oeuvre malgré tout fascinante. Un grand roman de mon point de vue, sans l'ombre d'un doute, qu'on savourera et appréciera peut-être mieux et davantage après lecture, quand l'on aura refermé et dépassé une certaine frustration de ne pas avoir eu toutes les réponses aux énigmes surprenantes qu'il nous avait assénées au départ; un peu d'ailleurs comme son personnage central, James Axton, quand, le temps ayant passé et la parenthèse grecque étant définitivement close, ce dernier, évoquant le souvenir des compatriotes qu'il avait côtoyés à Athènes, déclarera : «Ils font partie des gens que j'ai essayé de connaître deux fois, la seconde fois par la mémoire et le langage. Et à travers eux, moi-même. Ils sont ce que je suis devenu, par des chemins que je ne comprends pas mais qui, à mon avis, aboutiront à une vérité circulaire, une seconde vie pour moi aussi bien que pour eux».
Cadres de filiales de multinationales de l'assurance ou de la finance pour le Proche-Orient et l'Inde, basés à Athènes, travaillant à la sauvegarde des intérêts économiques et géopolitiques américains, et notamment à l'évaluation des risques et à la sécurisation matérielle des citoyens et des sites industriels américains dans les zones les plus sensibles de la planète, ce groupe d'expatriés, selon James Axton, personnage central et narrateur du roman, était emblématique d'«une sous-culture d'hommes d'affaires en transit, vieillissant dans les avions et les aéroports», se retrouvant sporadiquement à Athènes, autour d'une table au restaurant, entre deux missions en Afghanistan ou en Inde, ou bien chez les uns ou chez les autres, lors de soirées bien arrosées durant lesquelles «nous nous disions où il fallait signer un document pour boire un verre, où l'on ne pouvait pas manger de viande le mercredi ou le jeudi, où il fallait esquiver un homme accompagné d'un cobra en sortant de l'hôtel, où s'appliquait la loi martiale, où se pratiquait la fouille corporelle, la torture systématique, le tir groupé en l'air, à la mitraillette à l'occasion des mariages, l'enlèvement contre rançon des représentants des sociétés industrielles». James Axton en devient ainsi un témoin privilégié, à la fois sujet et chroniqueur du caractère compartimenté et des codes particuliers régissant le fonctionnement en vase clos de ces «étrangers en terre étrangère», programmés «pour jouer au squash et travailler les week-ends», purs produits de la nouvelle vision du monde version 80's ; Axton incarnant en même temps l'écho de cette voix subjective qui s'interroge, face à l'image en miroir renvoyée par son environnement et son époque, sur le sens et l'orientation qu'on voudrait donner à sa vie («Ma vie passe et je n'arrive pas à la maîtriser»).
Avant de se retrouver analyste des risques pour une multinationale des assurances à Athènes, notre homme menait pourtant une vie paisible avec sa femme et son enfant «dans une vielle maison à pignons entre les Montagnes Vertes et les Adirondacks», une existence simple, «se satisfaisant de peu». Rédacteur free-lance, touche-à-tout («brochures, livrets, tracts, cochonneries de toutes sortes pour des industries ou le gouvernement»), il lui arrivait aussi, à l'occasion, de faire le nègre. Un écrivain donc, écrivant cependant pour les autres. Suite à la séparation du couple, sa femme, Kathryn, part s'installer en Grèce, à l'île de Kouros, où elle avait réussi à décrocher un job sur un site archéologique, et emmène avec elle leur enfant, «Tap» (autre écrivain, en herbe cette fois-ci, âgé de 9 ans et nourrissant déjà le projet d'écrire «un roman»…). Grâce au hasard d'une rencontre dans le cadre de ses activités de rédacteur free-lance, Axton s'était vu quelque temps auparavant proposer un poste à Athènes, qu'il finirait donc par accepter pour pouvoir par la suite se rapprocher de sa famille.
A partir de cette trame initiale, assez «lisible», Don DeLillo construit une narration virtuose, à plusieurs étages, ne cessant de se ramifier dans d'autres histoires, récits d'événements parallèles s'ouvrant à leur tour à d'autres niveaux plus complexes de lecture (et par moment assez exigeants aussi vis-à-vis de ses lecteurs), mettant en scène des personnages énigmatiques, habités par d'étranges desseins : des membres d'une mystérieuse secte commettant des meurtres rituels à travers le monde, dictés par des rapprochements entre les noms des victimes et la toponymie des sites où ils sont perpétrés ; Owen Brademas, archéologue passionnée d'épigraphie, parcourant le Proche-Orient , cherchant dans les inscriptions en langues anciennes, gravées sur les pierres provenant de sites et de ruines antiques, à «déchiffrer, découvrir des secrets et relever la géographie du langage, en quelque sorte», ou encore Frank Volterra, cinéaste renommé, amitié de jeunesse d'Axton et de son ex-femme, qui abandonnera un tournage en cours pour suivre les traces de la secte mystérieuse dans les régions montagneuses du Péloponnèse, afin d'en faire un documentaire…
Roman radicalement métonymique et elliptique, où le sens ne cesse de glisser sans jamais se laisser totalement apprivoiser, par certains aspects prémonitoire (sur l'ampleur, par exemple, que les campagnes d'attaque organisées et systématiques contre «l'Empire du Mal» devaient prendre dans les années à venir), dans LES NOMS, Don DeLillo semble avoir en quelque sorte voulu mettre en parallèle les pistes balisées par la mythologie d'une nouvelle puissance américaine globalisée, véhiculée notamment par la doctrine reaganienne, avec cette autre, incarnée ici par les paysages arides de la Grèce et les contrées désertiques du Proche-Orient, cette puissance archétypique et indomptable, indéchiffrable qui continue, malgré tout le soin mis par le nouvel ordre néo-libéral à tenter de la circonscrire et, dans certains cas, de la chiffrer, à y survivre, prête à refaire surface à tout moment, se refusant à toute emprise purement rationnelle, à toute reconnaissance «soumise au [seul] scrutin conscient». L'auteur ne ménagera pas les effets de sidération et de folie qui résulteront d'une telle confrontation chez certains de ses personnages, et son lecteur non plus: DeLillo, lui, n'écrit pas pour les autres, il ne s'adresse pas en tout cas à notre besoin viscéral de certitudes, à cette part hargneuse en nous qui réclame son dû aux conteurs à qui elle prête oreille: des noms, des révélations, des conclusions! Il s'adresse avant tout à notre soif de contemplation subjective du monde et de ses mystères, à notre intelligence intime la plus précieuse et la plus fragile, celle qui s'applique à réfléchir à une forme possible d'habiter la réalité de manière unique et individuée (sans devenir pour autant purement individualiste comme semble nous y inviter notre époque) ; à cette part d'imaginaire, enfin, qui nous évitera, dans le meilleur des cas, de nous conformer, au-delà du strictement nécessaire, aux faux-semblants et aux critères tendus par l'urgence du présent. L'écrivain, nous dit Don DeLillo par la bouche de l'un de ses personnages, «en ce siècle, entretient une conversation avec la folie», le conduisant à procéder à «une distillation finale du soi, à une mise au point définitive» et à «l'extinction des voix fausses». LES NOMS semble justement constituer une métaphore de cette dissolution du sens qui marque notre modernité -ou faudrait-il plutôt dire, notre postmodernité?
«Postmodernité» : voilà une notion répandue dans différents domaines (politique, sociétal, économique, artistique, philosophique, architectural, dans la mode, etc..) et s'appliquant à caractériser notre époque. Elle semble également avoir été intégrée dans le langage courant -plutôt branché («oh-là-là, j'adooore ton look postmoderne !»), si bien qu'on peut légitimement se demander si elle ne se serait pas quelque peu galvaudée, à être utilisée ainsi à tous bouts de champs, de manière aussi vague et aléatoire… A l'origine, pourtant, cette expression avait été créée pour qualifier des phénomènes précis, à savoir la désagrégation progressive des modes de régulation sociale et économique, ou encore la déconstruction de certains courants de pensées et systèmes de valeurs emblématiques de la modernité forgée par le XXème siècle. Ainsi, en devenant postmodernes, ne serions-nous pas, pour autant, devenus encore-plus-modernes-que-les-modernes , ni plus novateurs que ne le fut le XXème siècle (ce dernier terme à ne pas confondre, bien sûr, avec le grand nombre d'innovations technologiques proposées à la pelle de nos jours). Les critères de la «modernité» n'étant plus opérants pour appréhender et/ou transformer le monde contemporain, la condition de postmodernité semblerait dès lors correspondre davantage à quelque chose de subi, qu'à une véritable révolution, celle-ci fleurerait, pour ainsi dire, davantage la décomposition que la fraicheur d'un nouveau parfum, marquerait moins l'avènement de nouvelles certitudes ou la promesse d'un bonheur inouï, qu'une perte de repères progressive et, d'ailleurs, à mesure que les années avancent, soit dit au passage, de plus en plus anxiogène. La postmodernité déconstruirait davantage qu'elle ne construit; plutôt que de créer du nouveau, elle fragmenterait, empilerait, superposerait et remixerait; le rétro-futurisme, l'afro-celtique, le cyber-gothique ou le trash-musette, par exemple, en seraient, parmi de tonnes d'autres courants et modes dits «postmodernes», de coquettes illustrations de ce manque cruel de véritables et solides perspectives nouvelles… !
La critique de la postmodernité, en tout cas depuis cet angle de vision, semble occuper une place centrale dans l'oeuvre de Don DeLillo. Echec des utopies collectives, fragmentation des identités, instrumentalisation des savoirs, repli sur soi et individualisme prononcé, ravages divers, individuels et collectifs, provoqués par le néo-libéralisme économique, en sont quelques-uns de ses ingrédients principaux, présents dès son coup de génie inaugural, «Americana», premier roman explosif de l'auteur, publié en 1972. DeLillo s'est depuis inscrit en digne héritier de cette célèbre lignée d'écrivains américains ayant aspiré à faire une radioscopie panoramique de la culture américaine, de ses grands fantasmes et ses pires démons, afin de réaliser ce qu'on a pris l'habitude de nommer le «grand roman américain» d'une époque.
LES NOMS ne semble pas, néanmoins, une lecture qui pourrait plaire facilement ou de manière consensuelle une majorité de lecteurs. du fait du développement non-linéaire et fragmenté de son intrigue, en raison du choix volontaire de l'auteur de ne pas donner des réponses fermes et unilatérales aux questions qu'elle soulève, ou de l'enfermer dans un dénouement à sens unique, ou enfin de ses différentes strates et niveaux de lecture, susceptibles d'égarer par moments les lecteurs les plus aguerris, il devient quasiment impossible d'embrasser d'un seul coup, d'un seul et unique regard toute la richesse d'évocation de ce roman et toutes les subtilités de sa construction (de surcroît, une traduction, certes pas simple à la base, mais qui en l'occurrence ne semble pas tout le temps à la hauteur, n'est pas là pour faciliter la tâche au lecteur…). Une oeuvre malgré tout fascinante. Un grand roman de mon point de vue, sans l'ombre d'un doute, qu'on savourera et appréciera peut-être mieux et davantage après lecture, quand l'on aura refermé et dépassé une certaine frustration de ne pas avoir eu toutes les réponses aux énigmes surprenantes qu'il nous avait assénées au départ; un peu d'ailleurs comme son personnage central, James Axton, quand, le temps ayant passé et la parenthèse grecque étant définitivement close, ce dernier, évoquant le souvenir des compatriotes qu'il avait côtoyés à Athènes, déclarera : «Ils font partie des gens que j'ai essayé de connaître deux fois, la seconde fois par la mémoire et le langage. Et à travers eux, moi-même. Ils sont ce que je suis devenu, par des chemins que je ne comprends pas mais qui, à mon avis, aboutiront à une vérité circulaire, une seconde vie pour moi aussi bien que pour eux».
Il n'est pas indifférent au lecteur « honorable » (il me parait bon de préciser que de mon temps la méthode globale n'était pas encore en vigueur pour l'apprentissage de la lecture), de souligner que le narrateur du roman :
1* commence par dire :
« Je suis longtemps resté à l'écart de l'Acropole. Elle m'intimidait cette roche sombre. Je préférais errer dans la ville moderne, imparfaite, assourdissante. »
2* Enfonce le clou en précisant :
« Que d'ambiguïtés dans les choses exaltées. Nous les méprisons un peu. »
A mon sens, la clé du roman se trouve essentiellement (existentiellement ?) dans ces cinq phrases. On pourrait presque en terminer la lecture et se contenter d'évaluer sa propre conception de la civilisation, de ce que nous ont apporté nos prédécesseurs et de ce que nous apportons, de ce que nous apporterons, nous, héritiers improbables de ceux qui ont construit l'Acropole et aussi d'une certaine façon, notre mode de pensée.
Leur faisons-nous honneur d'être venus au monde ? Je ne répondrais pas.
Pour cette raison, « Les noms », traduction littérale de « The names », mérite toute notre attention.
Certes, on peut aussi s'esbaudir sur la fatuité, la vacuité et la vulgarité de ce groupe « d'expats » made in USA, retranchés « sur les bas versants du Lycabette », à la limite de l'obésité, obsédé(e)s à l'idée de se taper un ou une collègue, incollables comme un Baedeker rouge (en fait le Baedeker est bleu je crois) question transport, hôtel, restaurant, sécurité de l'étranger et bonnes affaires.....
Le narrateur, James, sort de cette fausse quiétude, un paradis artificiel financé à coup de somptueux per-diem, et retrouve sa femme et son fils à Kouros. (Vous savez cette île des Cyclades dont Yves Saint Laurent a piqué le nom pour le donner à un de ses parfums.)
Katryn et Tap, vivent dans un monde minéral, un monde de réalité immédiate, avec Owen, le nouveau compagnon de Katryn, la femme que James a quitté ou par laquelle il s'est fait larguer.
A nouveau il est question de noms, de caractères (au sens typographique) , de langage. Nous nous demandons alors :
3° Une langue qui sert à décrire un horaire de compagnie aérienne, à lire le tarif d'un restaurant, est-elle véritablement la langue de la civilisation ? Je ne répondrais pas non plus !
Tap, le jeune garçon, fils de James, écrit des romans d'aventures, apprends le Grec, s'exprime en langue ob, (en ob, bonne nuit se dit bobnne nobuit), une langue inventée par sa mère et ses soeurs alors qu'elles étaient enfants.
Katryn est devenue archéologue par choix, après sa séparation :
« Elle était saisie de la pure lumière d'une vision de grand saint. Elle allait tamiser de la terre sur une île de la mer Egée. » dit James de façon perfide et peu loyale.
Elle répond plus loin (page 105) :
«Personne ne se limite à creuser.»
Elle trouve-là le moyen de s'opposer à son mari dont elle a dressé par écrit la liste « des 27 perversités » avant de se décider à divorcer.
D'Owen Brademas, le nouveau compagnon de Katryn, James dit :
« Peut-être prenions-nous cette effrayante vie intérieure pour une forme d'honnêteté dévastatrice, quelque chose d'unique et courageux, un état auquel nous avions la chance d'avoir échappé. »
Rendons justice à James, s'il est à l'aise avec ses compagnons de travail, il leur en remontre question tarifs de restos, heures de vols, jogging, dragage de collègues et tutti quanti, mais il cherche à se mettre volontairement en danger, il se place délibérément du côté du doute en revoyant sa femme son fils et Owen.
Il cherche, il cherche mais il ne sait quoi ni quand et comment il va le trouver. Il regarde ce monde et depuis sa place confortable il l'expertise, l'évalue.
Entre Katryn et James les différences sont abyssales (au propre comme au figuré) :
Katryn «fouille la terre», pour ressusciter des civilisations anciennes, James fait «des mises à jour de politiques comme on dit.», croisant des statistiques improbables sur des pays à conquérir ou à faire rentrer dans le giron des USA (nombre de prisonniers, % d'étrangers, salaires des généraux de l'armée, sommes d'argent versées au clergé etc....- page 51)
Katryn fait sortir de terre ce que les civilisations plus récentes ont enfouies, James veut enterrer les derniers vestiges des civilisations et faire entrer leurs descendants dans les délices sucrés et ouatés du rêve américain.
A y regarder de plus près, on dépasse la logique de confrontation apparente dans laquelle Katryn, Owen Brademas et James, sont enfermés. Au fond, ils font oeuvre de civilisation, chacun à leur manière, utilisent des méthodologies comparables, des outils identiques, mais leurs objectifs ne sont pas les mêmes.
«Déchiffrer, découvrir des secrets, relever la géographie du langage........ce que disent les pierres, après tout, c'est bien souvent de la routine.», dit Owen.
«...il semblerait nettement (avoue-t-il encore) que les premiers écrits aient été motivés par le désir de tenir des comptes.»
Cette quête nous renvoie à celle que nous menons innocemment (?) inconsciemment (?) lorsque nous nous déplaçons dans des contrées reculées pour retrouver le dénuement, l'extrême, l'extase, afin de mieux supporter les contraintes de la civilisation connectée et déshumanisée dans laquelle nous vivons.
Les expats de Don de Lillo font de même. Ils ont de ces lubies comme en ont les touristes lâchés à l'étranger, se baigner nus ou habillés selon..., boire à s'en rendre malades, montrer de la sympathie aux autochtones en laissant des pourboires royaux et prononcer des phrases pleine de compassion mais inutiles, le plus souvent en baragouinant la langue du pays avec un sourire niais sous leurs yeux complaisamment admiratifs.
« Je commençais à me voir comme un éternel touriste. Cela avait quelque chose d'agréable. Etre un touriste, c'est échapper aux responsabilités. Les erreurs et les échecs ne vous collent pas à la peau comme il feraient normalement.»
«Ma vie était pleine de surprises routinières.»
4° Et l'Acropole resurgit comme le cauchemar athénien de James, son ami Georges l'interroge (Page 73) :
Qu'est-ce-qu'il y a donc là haut que je doive absolument voir ?
Tu vas bien à Naples pour voir des peinture cochonnes.
Je vais le sauter, dit-il. Rien d'intéressant.
James regarde sa communauté de l'extérieur, ils sont comme des pièces rapportées, usant leur salive à répéter «inlassablement les mêmes histoires, avec les mêmes gestes et les mêmes intonations.». Dick Borden «passait la majeure partie de son temps dans le Golfe.». Dot, son épouse, «toujours prête à organiser des expéditions pour se procurer des produits de marque américaine.»
La première partie du roman décrit la vie de James en Grèce, tiraillée entre :
la communauté des expatriés, (Athènes) sa volonté de s'en extirper (mais au fond c'est cette capacité à comprendre les Grecs qui le rend attractif aux yeux des autres américains)
la famille (Sur l'île de Kouros) dont il s'est séparé et avec laquelle il veut conserver des liens, s'ils ne sont affectifs, au moins de raison,
son envie de découvrir la Grèce, d'apprendre la langue, de réaliser un voyage seul face au pays, sa langue, sa culture, ses traditions.
Il nous livre quelque confidence qui nous montre combien il est différent, spécifique, ailleurs :
Il regrette que son père «n'ait pas connu «cette cave à Athènes où il va quelquefois avec David Keller.» (page 48)
«Je crois que le plaisir est plus dans l'instant que dans la chose» (page 82)
«A mon avis les Américains ne voient les autres qu'en temps de crise.» (page 84)
Il voit Athènes, qu'il ne veut pas réduire à l'Acropole, grandir et sortir de son histoire ancienne :
«A mesure que la ville s'agrandissait, elle allait engloutir l'amertume de l'histoire qui l'entourait jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien d'autres que des rues grises., des immeubles de six étages avec leur lessive claquant du haut du toit. Puis je me rendis compte que la ville même était une invention des gens de ces endroits perdus, des gens recasés de force, fuyant la guerre et les massacres et se fuyant les uns les autres, affamés, en quête de travail. Ils étaient exilés chez eux, à Athènes qui s'étendait vers la mer et les collines jusque dans la plaine de l'Attique, cherchant sa voie. Une rose des vents de la mémoire.» (Pages 146 et 147)
Lors de son séjour à Kouros, Owen lui a parlé d'étrangers occupant des grottes dans une partie isolée de l'île, avec lesquels il a échangé à propos de ses recherches sur la langue grecque, les inscriptions sur les murs des vestiges et les signes de l'alphabet.
«La conversation est la vie, le langage est ce qu'il y a de plus profond dans l'être.»
« Il existe une étroite chaleur de proximité dans les noms et les images.»
James voit dans ces gens la quintessence de sa recherche, et de celle d'Owen et Katryn, ils ont tout abandonné pour vivre une vie dénudée de toutes apparences, une vie à l'état «primal», sans aucunes justifications de nature sociale, économique, familiale ou politique.
Ce qui rapproche Katryn, Tap, Owen et James est leur proximité d'une institution, culturelle, scientifique non lucrative pour les premiers, économique, politique et tournée vers le profit pour le second.
les habitants de la grotte (appelons-les comme cela pour l'instant) sont unis par une promiscuité qui leur fait partager le quotidien dans ses aspects les plus triviaux, et le langage qu'ils utilisent pour communiquer.
Qui sont-ils ? James les redoute, mais ils l'attirent. L'accusation de secte lui vient aussitôt à l'esprit, quand il en parle avec Owen. Réaction primaire lorsque l'on ne comprend pas le comportement de ses semblables.
Parleriez-vous de culte, à leur sujet ?
Ils partagent un intérêt ésotérique.
Ou de secte ?
Vous avez peut-être raison. J'ai eu l'impression qu'ils faisaient partie d'un groupe plus vaste, mais j'ignore si leurs idées, ou leurs coutume sont issues d'un corpus philosophique plus ample.
Et ensuite ? demandai-je.
Un premier crime est commis dans l'île, dans des conditions atroces ; et de façon insidieuse, l'existence de ce groupe est reliée à ce crime. (page 113)
Je pense qu'ils sont sur le continent. Dit Owen
Ils ont dit quelque chose sur le Péloponnèse.
Est-ce une chose dont il faudrait avertir la Police ?
Je ne sais pas, qu'en pensez-vous ?
Désormais l'intérêt de James pour ce groupe et pour les crimes que ses membres sont censés avoir commis va constituer sa principale préoccupation.
D'autres que lui éprouvent le même intérêt pour ces gens, Owen Brademas bien sûr, mais aussi un ancien ami commun à lui et Kathryn, Frank Volterra.
Désormais, il ne sera plus seul dans sa quête pour comprendre ces gens, mettre à jour leur identité, comprendre leur philosophie, identifier leur objectif, décoder les motivations des crimes qu'ils commettent, pour autant qu'ils en soient les auteurs.
Cette quête sans aboutissement répondra-t-elle à ses questions, difficile de répondre à cette question. James lui-même revient à Athènes avec plus de questions qu'il n'a de réponses.
Comme dans ses autres romans, Don de Lillo nous éloigne de l'image onirique des USA, notre rêve d'Européen, et nous plonge dans une réalité plus grise et plus réelle de ce pays. Pour autant il ne s'agit pas d'une littérature pessimiste ou du déclin. Il mesure simplement l'écart existant entre les hommes d'une nation riche et puissante et le reste de l'humanité, puissance contre impuissance, incapacité à lire le malheur des autres contre révolte, propension à renvoyer le reste de l'humanité à sa propre responsabilité contre empathie et compassion.
Cette lutte à l'échelle planétaire se retrouve souvent chez Don de Lillo dans l'intime de ses personnages.
A lire même si parfois cette lecture s'apparente à une épreuve parce qu'elle nous tend le miroir à peine déformant de notre propre incapacité à trouver un sens à la vie.
Je laisse la conclusion à James :
«Boire et manger, tel était le noyau de presque tous les contacts humains que j'avais en Grèce et dans la région.»
«Ta Onómata »
« Ils font partie des gens que j'ai essayé de connaître deux fois, la seconde fois par la mémoire et le langage. Et à travers eux, moi-même. Ils sont ce que je suis devenu, par des chemins que je ne comprends pas mais qui, à mon avis, aboutiront à une vérité circulaire, une seconde vie aussi bien pour moi que pour eux.»
A lire et à relire à tout prix
1* commence par dire :
« Je suis longtemps resté à l'écart de l'Acropole. Elle m'intimidait cette roche sombre. Je préférais errer dans la ville moderne, imparfaite, assourdissante. »
2* Enfonce le clou en précisant :
« Que d'ambiguïtés dans les choses exaltées. Nous les méprisons un peu. »
A mon sens, la clé du roman se trouve essentiellement (existentiellement ?) dans ces cinq phrases. On pourrait presque en terminer la lecture et se contenter d'évaluer sa propre conception de la civilisation, de ce que nous ont apporté nos prédécesseurs et de ce que nous apportons, de ce que nous apporterons, nous, héritiers improbables de ceux qui ont construit l'Acropole et aussi d'une certaine façon, notre mode de pensée.
Leur faisons-nous honneur d'être venus au monde ? Je ne répondrais pas.
Pour cette raison, « Les noms », traduction littérale de « The names », mérite toute notre attention.
Certes, on peut aussi s'esbaudir sur la fatuité, la vacuité et la vulgarité de ce groupe « d'expats » made in USA, retranchés « sur les bas versants du Lycabette », à la limite de l'obésité, obsédé(e)s à l'idée de se taper un ou une collègue, incollables comme un Baedeker rouge (en fait le Baedeker est bleu je crois) question transport, hôtel, restaurant, sécurité de l'étranger et bonnes affaires.....
Le narrateur, James, sort de cette fausse quiétude, un paradis artificiel financé à coup de somptueux per-diem, et retrouve sa femme et son fils à Kouros. (Vous savez cette île des Cyclades dont Yves Saint Laurent a piqué le nom pour le donner à un de ses parfums.)
Katryn et Tap, vivent dans un monde minéral, un monde de réalité immédiate, avec Owen, le nouveau compagnon de Katryn, la femme que James a quitté ou par laquelle il s'est fait larguer.
A nouveau il est question de noms, de caractères (au sens typographique) , de langage. Nous nous demandons alors :
3° Une langue qui sert à décrire un horaire de compagnie aérienne, à lire le tarif d'un restaurant, est-elle véritablement la langue de la civilisation ? Je ne répondrais pas non plus !
Tap, le jeune garçon, fils de James, écrit des romans d'aventures, apprends le Grec, s'exprime en langue ob, (en ob, bonne nuit se dit bobnne nobuit), une langue inventée par sa mère et ses soeurs alors qu'elles étaient enfants.
Katryn est devenue archéologue par choix, après sa séparation :
« Elle était saisie de la pure lumière d'une vision de grand saint. Elle allait tamiser de la terre sur une île de la mer Egée. » dit James de façon perfide et peu loyale.
Elle répond plus loin (page 105) :
«Personne ne se limite à creuser.»
Elle trouve-là le moyen de s'opposer à son mari dont elle a dressé par écrit la liste « des 27 perversités » avant de se décider à divorcer.
D'Owen Brademas, le nouveau compagnon de Katryn, James dit :
« Peut-être prenions-nous cette effrayante vie intérieure pour une forme d'honnêteté dévastatrice, quelque chose d'unique et courageux, un état auquel nous avions la chance d'avoir échappé. »
Rendons justice à James, s'il est à l'aise avec ses compagnons de travail, il leur en remontre question tarifs de restos, heures de vols, jogging, dragage de collègues et tutti quanti, mais il cherche à se mettre volontairement en danger, il se place délibérément du côté du doute en revoyant sa femme son fils et Owen.
Il cherche, il cherche mais il ne sait quoi ni quand et comment il va le trouver. Il regarde ce monde et depuis sa place confortable il l'expertise, l'évalue.
Entre Katryn et James les différences sont abyssales (au propre comme au figuré) :
Katryn «fouille la terre», pour ressusciter des civilisations anciennes, James fait «des mises à jour de politiques comme on dit.», croisant des statistiques improbables sur des pays à conquérir ou à faire rentrer dans le giron des USA (nombre de prisonniers, % d'étrangers, salaires des généraux de l'armée, sommes d'argent versées au clergé etc....- page 51)
Katryn fait sortir de terre ce que les civilisations plus récentes ont enfouies, James veut enterrer les derniers vestiges des civilisations et faire entrer leurs descendants dans les délices sucrés et ouatés du rêve américain.
A y regarder de plus près, on dépasse la logique de confrontation apparente dans laquelle Katryn, Owen Brademas et James, sont enfermés. Au fond, ils font oeuvre de civilisation, chacun à leur manière, utilisent des méthodologies comparables, des outils identiques, mais leurs objectifs ne sont pas les mêmes.
«Déchiffrer, découvrir des secrets, relever la géographie du langage........ce que disent les pierres, après tout, c'est bien souvent de la routine.», dit Owen.
«...il semblerait nettement (avoue-t-il encore) que les premiers écrits aient été motivés par le désir de tenir des comptes.»
Cette quête nous renvoie à celle que nous menons innocemment (?) inconsciemment (?) lorsque nous nous déplaçons dans des contrées reculées pour retrouver le dénuement, l'extrême, l'extase, afin de mieux supporter les contraintes de la civilisation connectée et déshumanisée dans laquelle nous vivons.
Les expats de Don de Lillo font de même. Ils ont de ces lubies comme en ont les touristes lâchés à l'étranger, se baigner nus ou habillés selon..., boire à s'en rendre malades, montrer de la sympathie aux autochtones en laissant des pourboires royaux et prononcer des phrases pleine de compassion mais inutiles, le plus souvent en baragouinant la langue du pays avec un sourire niais sous leurs yeux complaisamment admiratifs.
« Je commençais à me voir comme un éternel touriste. Cela avait quelque chose d'agréable. Etre un touriste, c'est échapper aux responsabilités. Les erreurs et les échecs ne vous collent pas à la peau comme il feraient normalement.»
«Ma vie était pleine de surprises routinières.»
4° Et l'Acropole resurgit comme le cauchemar athénien de James, son ami Georges l'interroge (Page 73) :
Qu'est-ce-qu'il y a donc là haut que je doive absolument voir ?
Tu vas bien à Naples pour voir des peinture cochonnes.
Je vais le sauter, dit-il. Rien d'intéressant.
James regarde sa communauté de l'extérieur, ils sont comme des pièces rapportées, usant leur salive à répéter «inlassablement les mêmes histoires, avec les mêmes gestes et les mêmes intonations.». Dick Borden «passait la majeure partie de son temps dans le Golfe.». Dot, son épouse, «toujours prête à organiser des expéditions pour se procurer des produits de marque américaine.»
La première partie du roman décrit la vie de James en Grèce, tiraillée entre :
la communauté des expatriés, (Athènes) sa volonté de s'en extirper (mais au fond c'est cette capacité à comprendre les Grecs qui le rend attractif aux yeux des autres américains)
la famille (Sur l'île de Kouros) dont il s'est séparé et avec laquelle il veut conserver des liens, s'ils ne sont affectifs, au moins de raison,
son envie de découvrir la Grèce, d'apprendre la langue, de réaliser un voyage seul face au pays, sa langue, sa culture, ses traditions.
Il nous livre quelque confidence qui nous montre combien il est différent, spécifique, ailleurs :
Il regrette que son père «n'ait pas connu «cette cave à Athènes où il va quelquefois avec David Keller.» (page 48)
«Je crois que le plaisir est plus dans l'instant que dans la chose» (page 82)
«A mon avis les Américains ne voient les autres qu'en temps de crise.» (page 84)
Il voit Athènes, qu'il ne veut pas réduire à l'Acropole, grandir et sortir de son histoire ancienne :
«A mesure que la ville s'agrandissait, elle allait engloutir l'amertume de l'histoire qui l'entourait jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien d'autres que des rues grises., des immeubles de six étages avec leur lessive claquant du haut du toit. Puis je me rendis compte que la ville même était une invention des gens de ces endroits perdus, des gens recasés de force, fuyant la guerre et les massacres et se fuyant les uns les autres, affamés, en quête de travail. Ils étaient exilés chez eux, à Athènes qui s'étendait vers la mer et les collines jusque dans la plaine de l'Attique, cherchant sa voie. Une rose des vents de la mémoire.» (Pages 146 et 147)
Lors de son séjour à Kouros, Owen lui a parlé d'étrangers occupant des grottes dans une partie isolée de l'île, avec lesquels il a échangé à propos de ses recherches sur la langue grecque, les inscriptions sur les murs des vestiges et les signes de l'alphabet.
«La conversation est la vie, le langage est ce qu'il y a de plus profond dans l'être.»
« Il existe une étroite chaleur de proximité dans les noms et les images.»
James voit dans ces gens la quintessence de sa recherche, et de celle d'Owen et Katryn, ils ont tout abandonné pour vivre une vie dénudée de toutes apparences, une vie à l'état «primal», sans aucunes justifications de nature sociale, économique, familiale ou politique.
Ce qui rapproche Katryn, Tap, Owen et James est leur proximité d'une institution, culturelle, scientifique non lucrative pour les premiers, économique, politique et tournée vers le profit pour le second.
les habitants de la grotte (appelons-les comme cela pour l'instant) sont unis par une promiscuité qui leur fait partager le quotidien dans ses aspects les plus triviaux, et le langage qu'ils utilisent pour communiquer.
Qui sont-ils ? James les redoute, mais ils l'attirent. L'accusation de secte lui vient aussitôt à l'esprit, quand il en parle avec Owen. Réaction primaire lorsque l'on ne comprend pas le comportement de ses semblables.
Parleriez-vous de culte, à leur sujet ?
Ils partagent un intérêt ésotérique.
Ou de secte ?
Vous avez peut-être raison. J'ai eu l'impression qu'ils faisaient partie d'un groupe plus vaste, mais j'ignore si leurs idées, ou leurs coutume sont issues d'un corpus philosophique plus ample.
Et ensuite ? demandai-je.
Un premier crime est commis dans l'île, dans des conditions atroces ; et de façon insidieuse, l'existence de ce groupe est reliée à ce crime. (page 113)
Je pense qu'ils sont sur le continent. Dit Owen
Ils ont dit quelque chose sur le Péloponnèse.
Est-ce une chose dont il faudrait avertir la Police ?
Je ne sais pas, qu'en pensez-vous ?
Désormais l'intérêt de James pour ce groupe et pour les crimes que ses membres sont censés avoir commis va constituer sa principale préoccupation.
D'autres que lui éprouvent le même intérêt pour ces gens, Owen Brademas bien sûr, mais aussi un ancien ami commun à lui et Kathryn, Frank Volterra.
Désormais, il ne sera plus seul dans sa quête pour comprendre ces gens, mettre à jour leur identité, comprendre leur philosophie, identifier leur objectif, décoder les motivations des crimes qu'ils commettent, pour autant qu'ils en soient les auteurs.
Cette quête sans aboutissement répondra-t-elle à ses questions, difficile de répondre à cette question. James lui-même revient à Athènes avec plus de questions qu'il n'a de réponses.
Comme dans ses autres romans, Don de Lillo nous éloigne de l'image onirique des USA, notre rêve d'Européen, et nous plonge dans une réalité plus grise et plus réelle de ce pays. Pour autant il ne s'agit pas d'une littérature pessimiste ou du déclin. Il mesure simplement l'écart existant entre les hommes d'une nation riche et puissante et le reste de l'humanité, puissance contre impuissance, incapacité à lire le malheur des autres contre révolte, propension à renvoyer le reste de l'humanité à sa propre responsabilité contre empathie et compassion.
Cette lutte à l'échelle planétaire se retrouve souvent chez Don de Lillo dans l'intime de ses personnages.
A lire même si parfois cette lecture s'apparente à une épreuve parce qu'elle nous tend le miroir à peine déformant de notre propre incapacité à trouver un sens à la vie.
Je laisse la conclusion à James :
«Boire et manger, tel était le noyau de presque tous les contacts humains que j'avais en Grèce et dans la région.»
«Ta Onómata »
« Ils font partie des gens que j'ai essayé de connaître deux fois, la seconde fois par la mémoire et le langage. Et à travers eux, moi-même. Ils sont ce que je suis devenu, par des chemins que je ne comprends pas mais qui, à mon avis, aboutiront à une vérité circulaire, une seconde vie aussi bien pour moi que pour eux.»
A lire et à relire à tout prix
C'est un petit ovni ce livre du Grand Don, il y a plusieurs personnages dont un couple de new-yorkais moderne comme l'on pouvait l'être dans les années 70, on suit leurs pérégrinations, celle du mari qui flirte avec le terrorisme, sa femme en vacances bien méritées dans le Maine avec un couple d'amis homosexuels.
Leurs histoires qui les feront dévier de leur quotidien (boire des verres le soir, zapper, parler de tout est de rien) les feront rentrer dans une ère nouvelle, la fin des années 70 pleines d'illusions et d'espérances dans le cynisme des années 80.
Ici l'histoire n'a que peu d'importance, les dialogues sont le grand attrait de ce roman, tantôt poétiques voire oniriques, complètement loufoques et plein de non-sens.
Encore une fois Don prouve qu'il sait tout faire et tout écrire
Leurs histoires qui les feront dévier de leur quotidien (boire des verres le soir, zapper, parler de tout est de rien) les feront rentrer dans une ère nouvelle, la fin des années 70 pleines d'illusions et d'espérances dans le cynisme des années 80.
Ici l'histoire n'a que peu d'importance, les dialogues sont le grand attrait de ce roman, tantôt poétiques voire oniriques, complètement loufoques et plein de non-sens.
Encore une fois Don prouve qu'il sait tout faire et tout écrire
Il est des livres comme ça où on ne comprend pas grand chose, où on se perd dans les personnages, les époques, les lieux, toutes les strates possibles, et où l'écriture souvent brillante nous perd, nous aveugle, peut-être. Des livres épais, dans tous les sens du terme. Alors, je ne sais pas, sans doute, comme un Au-dessous du Volcan de Lowry ou certaines des oeuvres de Virginia Woolf ou de Joyce peut-être, il faut se les laisser mûrir, mûrir soi, pour mieux saisir l'énorme masse pleine de vie, de folie et de sens que ce livre recèle.
Lecteurs non courageux, abandonnez tout de suite, les autres armez-vous de tout ce que vous pourrez.
Moi, en tout cas, je dis wooohw et si je ne mets pas cinq étoiles c'est parce que je ne suis pas encore assez cap'.
Lecteurs non courageux, abandonnez tout de suite, les autres armez-vous de tout ce que vous pourrez.
Moi, en tout cas, je dis wooohw et si je ne mets pas cinq étoiles c'est parce que je ne suis pas encore assez cap'.
Les noms est le premier et le dernier livre de Don Delillo que je lis ! J'avais entendu parler de cet auteur américain dont le genre de littérature était des romans géopolitiques et mystérieux, parfois même fantastiques et apocalyptiques. J'ai donc naturellement été tenté. Et bien mal m'en a prit ! Car lire ce bouquin a été un calvaire indicible pour moi, et le finir un vrai supplice ! C'est l'histoire d'un homme, un Américain, qui s'en va retrouver sa femme et son fils en Grèce, durant ce passage où il sera amené à mener une enquête sur un meurtre commis par une tribu indigène et mystérieuse. C'est la trame principale de l'histoire, mais une histoire qui va vite devenir chaotique et incompréhensible, à cause de la non maîtrise de la narration de l'auteur ! Et pourtant Don Delillo semble être un écrivain dont le talent est particulierement reconnu dans la sphère littéraire... Mais est-ce pour autant que je ne dois pas le critiquer ou remettre en question un aspect de son talent ? Et bien je me permets de critiquer cet auteur, et de le critiquer négativement ! Parce que son livre, ici Les noms, que j'ai lu l'année dernière, m'a démontré plusieurs choses accablantes concernant cet auteur italo-américain : la première et la principale, c'est que l'auteur fait preuve effectivement d'un manque de maîtrise flagrant de la narration, où il s'en va nous raconter plusieurs choses à la fois, passant d'une histoire à une autre, et d'un lieu à un autre, accumulant des hors sujets à n'en plus finir ! Alors que son idée de départ (l'enquête sur un meurtre par une tribu indigène et l'apparition d'un rituel mystérieux entourant ce meurtre) était pourtant originale et suscitait la curiosité. Mais l'auteur n'a pas su raconter son histoire ! Il s'est mêlé les pinceaux comme à la manière d'un mauvais peintre, créant alors un récit en forme de bouillie inmangeable et sujet à la répulsion ! Les noms devient un récit incompréhensible, où le lecteur se perd dans des chemins divers comme s'il se perdait dans un labyrinthe ! Impossible de retrouver le fil d'Ariane ! C'est l'incompréhension totale. Et la lecture de ce livre donne la migraine tant le lecteur sent sa tête sur le point d'exploser à force de réfléchir pour essayer de comprendre de quoi parle le livre... Il faut une sacrée dose de courage et de volonté pour terminer la lecture de cette bouillie inextricable et sans saveur. Même en le relisant, je doute fortement que le lecteur finisse par comprendre quelque chose... En vérité, Don Delillo s'est lui même perdu en chemin en écrivant ce livre ! C'est uniquement parce qu'il s'agissait de mon premier livre de Don Delillo que je suis allé jusqu'au bout, mais en y allant tout de même avec des béquilles, pour finir sur un fauteuil roulant ! Un livre sans aucune maîtrise de l'écriture et de la narration de son auteur ! A éviter à tout prix.
Loin de leur base filiale, des travailleurs américains gravitant entre la Méditerrané, le Proche et le Moyen Orient se retrouvent à Athènes pour échanger. Mais quel est le lien entre ces personnages? Quelles sont leurs véritables activités? Avançant à tâtons sous un soleil aveuglant, l'intrigue s'étire et revêt une opacité inquiétante.
Le passé du personnage principal est trouble et ses préoccupations sont peu avouables. Il a une femme qui a voulu le tuer et qu'il trompe, un enfant écrivain qui a déjà pris la place du père. Et puis il y a cette organisation secrète que le narrateur cherche à sonder et qui repose sur des principes ambigus, à la fois archaïques et complexes. Elle se fonde sur les sacrifices humains et entend se développer en usant du pouvoir du langage.
Si les américains sont aujourd'hui en danger dans certains pays étrangers, c'est parce qu'ils incarnent une matérialité exubérante qui s'oppose à la spiritualité orientale ou européenne. Autant je n'avais pas décelé le côté «prophétique» du roman Soumission de Houellebecq, autant ici on ne peut qu'admirer l'auteur pour son observation fine et avisée des intérêts géopolitiques dans ces régions instables du monde.
Associé à son style dépouillé, un brin décousu mais qui témoigne d'une grande profondeur, Delillo n'atteint pas ici le sommet d'Outremonde mais propose quand même une oeuvre puissante et singulière.
Le passé du personnage principal est trouble et ses préoccupations sont peu avouables. Il a une femme qui a voulu le tuer et qu'il trompe, un enfant écrivain qui a déjà pris la place du père. Et puis il y a cette organisation secrète que le narrateur cherche à sonder et qui repose sur des principes ambigus, à la fois archaïques et complexes. Elle se fonde sur les sacrifices humains et entend se développer en usant du pouvoir du langage.
Si les américains sont aujourd'hui en danger dans certains pays étrangers, c'est parce qu'ils incarnent une matérialité exubérante qui s'oppose à la spiritualité orientale ou européenne. Autant je n'avais pas décelé le côté «prophétique» du roman Soumission de Houellebecq, autant ici on ne peut qu'admirer l'auteur pour son observation fine et avisée des intérêts géopolitiques dans ces régions instables du monde.
Associé à son style dépouillé, un brin décousu mais qui témoigne d'une grande profondeur, Delillo n'atteint pas ici le sommet d'Outremonde mais propose quand même une oeuvre puissante et singulière.
L'écrivain américain Don DeLillo nous a habitué depuis longtemps à ses gros livres touffus qui mêlent les époques et brassent les idées. Se plonger dans l'un de ses pavés s'est s'immerger dans sa vision du monde, sous forme de métaphores où s'enchevêtrent aujourd'hui et hier pour mieux nous parler de demain.
Avec ce roman, Les noms, paru en 1982 aux Etats-Unis mais traduit en 1990 pour la France, l'auteur nous livre sa version de la place de l'Amérique dans le monde. « L'Amérique est le mythe vivant du monde ». le monde vu par l'Amérique, l'Amérique vue par le monde à travers cinq cents pages d'un roman politique et méandreux, complexe à appréhender.
Le livre se déroule autour de la Méditerranée et au Moyen-Orient comme dans les romans d'espionnage, car la zone est riche en Histoire, conflits larvés ou actifs, peuples divers, nomades ou sédentarisés. Régions des débuts et peut-être de la fin pour l'Homme, terres des langues ancestrales et millénaires. Des employés Américains de grandes multinationales naviguent entre ces différents pays, rédigeant des rapports et des analyses sur la situation géopolitique pour anticiper les évènements qui pourraient perturber les cours des matières premières et énergétiques. A Beyrouth ou Athènes, ils ont leurs habitudes, leurs points de chute. L'un d'eux va se laisser entraîner dans une enquête suite à un meurtre rituel qui va le mettre sur la piste d'une secte qui a le culte des mots. le nom de votre ennemi est inscrit sur une poterie, on brise la poterie, plus de nom donc plus d'existence. « Voilà ce que nous apportons au temple, non pas des prières ou des incantations ou des béliers sacrifiés. Notre offrande est le langage ».
Un livre dense, pas facile à lire. Difficile de suivre les protagonistes, la chronologie des évènements et les idées. Néanmoins un roman fascinant pour ceux qui acceptent de se laisser entraîner par le rythme des mots, quitte à perdre pied durant plus phrases avant de refaire surface à la page suivante. Personnellement je n'ai que moyennement adhéré à la narration et ce n'est pas mon bouquin de Don DeLillo que je préfère, mais il faudrait le relire au moins une fois de plus pour donner un avis sensé.
Avec ce roman, Les noms, paru en 1982 aux Etats-Unis mais traduit en 1990 pour la France, l'auteur nous livre sa version de la place de l'Amérique dans le monde. « L'Amérique est le mythe vivant du monde ». le monde vu par l'Amérique, l'Amérique vue par le monde à travers cinq cents pages d'un roman politique et méandreux, complexe à appréhender.
Le livre se déroule autour de la Méditerranée et au Moyen-Orient comme dans les romans d'espionnage, car la zone est riche en Histoire, conflits larvés ou actifs, peuples divers, nomades ou sédentarisés. Régions des débuts et peut-être de la fin pour l'Homme, terres des langues ancestrales et millénaires. Des employés Américains de grandes multinationales naviguent entre ces différents pays, rédigeant des rapports et des analyses sur la situation géopolitique pour anticiper les évènements qui pourraient perturber les cours des matières premières et énergétiques. A Beyrouth ou Athènes, ils ont leurs habitudes, leurs points de chute. L'un d'eux va se laisser entraîner dans une enquête suite à un meurtre rituel qui va le mettre sur la piste d'une secte qui a le culte des mots. le nom de votre ennemi est inscrit sur une poterie, on brise la poterie, plus de nom donc plus d'existence. « Voilà ce que nous apportons au temple, non pas des prières ou des incantations ou des béliers sacrifiés. Notre offrande est le langage ».
Un livre dense, pas facile à lire. Difficile de suivre les protagonistes, la chronologie des évènements et les idées. Néanmoins un roman fascinant pour ceux qui acceptent de se laisser entraîner par le rythme des mots, quitte à perdre pied durant plus phrases avant de refaire surface à la page suivante. Personnellement je n'ai que moyennement adhéré à la narration et ce n'est pas mon bouquin de Don DeLillo que je préfère, mais il faudrait le relire au moins une fois de plus pour donner un avis sensé.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Don DeLillo (23)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Dead or Alive ?
Harlan Coben
Alive (vivant)
Dead (mort)
20 questions
1818 lecteurs ont répondu
Thèmes :
auteur américain
, littérature américaine
, états-unisCréer un quiz sur ce livre1818 lecteurs ont répondu