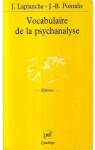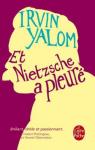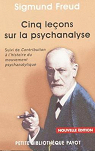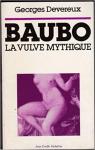Georges Devereux
Robert Neuburger (Préfacier, etc.)/5 7 notes
Certains éprouvent le besoin, pour se protéger, de masquer leur identité, ou pire : de renoncer à toute identité. Comment y parviennent-ils ?
S'agit-il d'une pathologie ? Qu'est-ce qui, venant des autres, peut bien les menacer à ce point ?
Robert Neuburger (Préfacier, etc.)/5 7 notes
Résumé :
Certains éprouvent le besoin, pour se protéger, de masquer leur identité, ou pire : de renoncer à toute identité. Comment y parviennent-ils ?
S'agit-il d'une pathologie ? Qu'est-ce qui, venant des autres, peut bien les menacer à ce point ?
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La renonciationà l'identité : Défense contre l'anéantissementVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Le titre et sous-titre sont proprement foudroyants : « La renonciation à l'identité – défense contre l'anéantissement » ; ils m'ont immédiatement fait songer à des périodes obscures de notre Histoire – je savais que Georges Devereux était un Juif converti au catholicisme au début des années 30. J'ai appris par l'excellente préface de Robert Neuburger que son nom d'origine était György Dobó et que son patronyme francisé, prononcé par un Hongrois, signifie « le Juif »...
L'incipit est aussi, pour ainsi dire, flamboyant : « L'objet de cette étude est le fantasme que la possession d'une identité est une véritable outrecuidance qui, automatiquement, incite les autres à anéantir non seulement cette identité, mais l'existence même du présomptueux – en général par un acte de cannibalisme, ce qui transforme le sujet en objet. Les patients les plus gravement atteints cherchent à se protéger contre ce risque, en renonçant à toute véritable identité ; ceux qui sont moins atteints se constituent une fausse identité. »
Cependant, cet essai (de 1967) issu d'une communication adressée par l'impétrant déjà presque sexagénaire à la Société psychanalytique de Paris, qui ne lui accordera jamais le rang de membre titulaire (!), est beaucoup moins ambitieuse que ces indices initiaux ne l'auraient laissé augurer. Et d'abord en sont exclues toutes les considérations politiques ou de sciences sociales – alors que le pionnier de l'ethnopsychiatrie a notoirement reconnu la société à la fois comme cause de certaines psychopathologies – inadaptations de « l'homme normal » dans une société pathologique – et comme pourvoyeuse d'un nombre limité de symptômes « normalement anormaux » « qui permet[tent aux inadaptés] d'exprimer leur souffrance sans risquer de dévoiler une identité fragilisée » (dixit Neuburger), nombre réduit essentiellement à trois, dans notre Occident contemporain : dépression, syndrome bipolaire, schizophrénie.
Ici au contraire, il est question uniquement de redéfinir la résistance dans la thérapie psychanalytique.
Par ailleurs, l'identité, qui se confond progressivement avec l'individualité – malgré une précaution terminologique initiale (p. 26) [pour preuve de la confusion, cf. l'incipit ci-dessus avec la cit. pp. 65-66, infra], s'entend circonscrite à l'intégrité du psychisme individuel dans l'espace (le corps) et dans le temps (la vie) ; les failles identitaires à l'âge adulte sont reconduites à la (mauvaise) éducation des enfants par certains parents « cannibales » ; en même temps que la résistance au thérapeute consiste dans la protection de l'identité contre soi-même et contre lui : conception freudienne très classique, mais appliquée à l'identité tout entière plutôt qu'aux seuls symptômes.
L'exposé se compose d'une partie théorique, nettement plus intéressante – car elle contient de nombreux renvois et des présages de développements ultérieurs – et d'un cas clinique, étudié sur une vingtaine de pages. Les plus grosses lacunes, regrettées par l'auteur lui-même, concernent le cannibalisme comme punition de « l'outrecuidance identitaire », et la renonciation comme mécanisme de défense de l'identité. Les ancrages mythologiques de ces deux points ne sont que deux, venant de l'Odyssée : le passage de Ménélas essayant d'obtenir un oracle de Protée, et le fameux passage où Odysseus échappe au cannibalisme du cyclope Polyphème en prétendant s'appeler « Personne [au sens de Nobody] ». Rares sont aussi les références ethnologiques, ce qui est déconcertant. Je trouve aussi que le parallèle entre développement de l'identité-individualité et développement de la sexualité aurait dû à être étudié au lieu d'être simplement énoncé – et enfin pourquoi diantre le nom serait-il seulement le pénis et non le vagin ?!
L'incipit est aussi, pour ainsi dire, flamboyant : « L'objet de cette étude est le fantasme que la possession d'une identité est une véritable outrecuidance qui, automatiquement, incite les autres à anéantir non seulement cette identité, mais l'existence même du présomptueux – en général par un acte de cannibalisme, ce qui transforme le sujet en objet. Les patients les plus gravement atteints cherchent à se protéger contre ce risque, en renonçant à toute véritable identité ; ceux qui sont moins atteints se constituent une fausse identité. »
Cependant, cet essai (de 1967) issu d'une communication adressée par l'impétrant déjà presque sexagénaire à la Société psychanalytique de Paris, qui ne lui accordera jamais le rang de membre titulaire (!), est beaucoup moins ambitieuse que ces indices initiaux ne l'auraient laissé augurer. Et d'abord en sont exclues toutes les considérations politiques ou de sciences sociales – alors que le pionnier de l'ethnopsychiatrie a notoirement reconnu la société à la fois comme cause de certaines psychopathologies – inadaptations de « l'homme normal » dans une société pathologique – et comme pourvoyeuse d'un nombre limité de symptômes « normalement anormaux » « qui permet[tent aux inadaptés] d'exprimer leur souffrance sans risquer de dévoiler une identité fragilisée » (dixit Neuburger), nombre réduit essentiellement à trois, dans notre Occident contemporain : dépression, syndrome bipolaire, schizophrénie.
Ici au contraire, il est question uniquement de redéfinir la résistance dans la thérapie psychanalytique.
Par ailleurs, l'identité, qui se confond progressivement avec l'individualité – malgré une précaution terminologique initiale (p. 26) [pour preuve de la confusion, cf. l'incipit ci-dessus avec la cit. pp. 65-66, infra], s'entend circonscrite à l'intégrité du psychisme individuel dans l'espace (le corps) et dans le temps (la vie) ; les failles identitaires à l'âge adulte sont reconduites à la (mauvaise) éducation des enfants par certains parents « cannibales » ; en même temps que la résistance au thérapeute consiste dans la protection de l'identité contre soi-même et contre lui : conception freudienne très classique, mais appliquée à l'identité tout entière plutôt qu'aux seuls symptômes.
L'exposé se compose d'une partie théorique, nettement plus intéressante – car elle contient de nombreux renvois et des présages de développements ultérieurs – et d'un cas clinique, étudié sur une vingtaine de pages. Les plus grosses lacunes, regrettées par l'auteur lui-même, concernent le cannibalisme comme punition de « l'outrecuidance identitaire », et la renonciation comme mécanisme de défense de l'identité. Les ancrages mythologiques de ces deux points ne sont que deux, venant de l'Odyssée : le passage de Ménélas essayant d'obtenir un oracle de Protée, et le fameux passage où Odysseus échappe au cannibalisme du cyclope Polyphème en prétendant s'appeler « Personne [au sens de Nobody] ». Rares sont aussi les références ethnologiques, ce qui est déconcertant. Je trouve aussi que le parallèle entre développement de l'identité-individualité et développement de la sexualité aurait dû à être étudié au lieu d'être simplement énoncé – et enfin pourquoi diantre le nom serait-il seulement le pénis et non le vagin ?!
Le titre interpelle. La 4ème de couverture finit de vous convaincre.
Comme ce texte s'adresse d'abord à des " spécialistes"(. Il s'agit de la reprise d'une conférence qu'il a donnée le 17 novembre 1964, dans le cadre don admission à la Société psychanalytique de Paris.) la lecture de la préface de Robert Neuburger, n'est pas à bouder ; bien au contraire. Elle ne fait pas que lever le voile sur l'enjeu du livre, elle permet de " prendre la température " avant de plonger dans le grand bain. Je le reconnais aux premiers abords certaines lignes sont parfois difficiles, pourtant ce livre restera une référence pour moi
Georges Devereux part d'une interrogation : quel est le rôle de la résistance dans la cure psychanalytique?
Avant de pouvoir démonter les raisons d'un tel mécanisme et en tirer les conclusions qui s'imposent dans sa pratique thérapeutique vis à vis de ses patients, Georges Devereux va d'abord s'employer à rappeler certaines évidences : "Dès que nous comprenons une chose ou un être dès que nous en établissons l'identité, dès que nous pouvons prévoir son comportement nous avons une emprise sur lui, nous sommes en mesure d'intervenir dans sa vie , tant pour le bien que pour le mal. " (page 38) .
Mais ce qu'il écrit quelques pages plus loin, dépasse le cadre strictement thérapeutique.
En lisant ce livre, on comprend à quel point la formation de l'identité est un processus complexe, fragile et d'une certaine manière aléatoire, qui dépend en grande partie de l'éducation reçue, et quels sont les mécanismes de défense mis alors en place pour pouvoir survivre et vivre...
Comme ce texte s'adresse d'abord à des " spécialistes"(. Il s'agit de la reprise d'une conférence qu'il a donnée le 17 novembre 1964, dans le cadre don admission à la Société psychanalytique de Paris.) la lecture de la préface de Robert Neuburger, n'est pas à bouder ; bien au contraire. Elle ne fait pas que lever le voile sur l'enjeu du livre, elle permet de " prendre la température " avant de plonger dans le grand bain. Je le reconnais aux premiers abords certaines lignes sont parfois difficiles, pourtant ce livre restera une référence pour moi
Georges Devereux part d'une interrogation : quel est le rôle de la résistance dans la cure psychanalytique?
Avant de pouvoir démonter les raisons d'un tel mécanisme et en tirer les conclusions qui s'imposent dans sa pratique thérapeutique vis à vis de ses patients, Georges Devereux va d'abord s'employer à rappeler certaines évidences : "Dès que nous comprenons une chose ou un être dès que nous en établissons l'identité, dès que nous pouvons prévoir son comportement nous avons une emprise sur lui, nous sommes en mesure d'intervenir dans sa vie , tant pour le bien que pour le mal. " (page 38) .
Mais ce qu'il écrit quelques pages plus loin, dépasse le cadre strictement thérapeutique.
En lisant ce livre, on comprend à quel point la formation de l'identité est un processus complexe, fragile et d'une certaine manière aléatoire, qui dépend en grande partie de l'éducation reçue, et quels sont les mécanismes de défense mis alors en place pour pouvoir survivre et vivre...
Perplexe en début de lecture, après réflexion je peux entrevoir des mécanismes, décortiqués par l'auteur, autant chez moi que dans mon entourage.
Citations et extraits (8)
Voir plus
Ajouter une citation
De nos jours, le but inavoué des pseudo-démocraties hypocrites est de se constituer en une population d' enfants intelligents, tandis que les totalitarismes cherchent à se constituer en une population d'adultes stupides. [...] Cette tendance de « régularisation par amoindrissement » est particulièrement frappante dans l'éducation des enfants. J'ai dit naguère, et je ne cesse d'insister , que nous apprenons à nos enfants tant et si bien l'art « d'être enfants » qu'ils ont toute la peine du monde à devenir adultes.
La conclusion s'impose qu'étant donné la tendance de certains parents à punir toute manifestation d'individualité de leurs enfants, nos patients finissent par croire que le fait même de vouloir posséder une individualité sera considéré par des être tout-puissants comme une outrecuidance, punissable par la destruction de l'identité et même de la simple existence du coupable. (page 66)
« Ces faits expliquent, à mon avis, pourquoi le surmoi tend à conserver les attributs d'un matériel nettement hétéropsychique [particulièrement provenant de quelque divinité], et pourquoi il représente un conglomérat fortuit, plutôt qu'une véritable structure ; bref, pourquoi le surmoi est essentiellement composé de tout ce qui n'a pu être ni compris, ni maîtrisé, ni transformé en matériel autopsychique au moment où les événements, dont le précipité constitue le surmoi, se sont produits. » (pp. 61-62)
« [… L']identité n'est pas une première donnée. Elle résulte d'un assemblage à la fois planifié et fortuit, dont les possibilités et la portée sont limitées tant par la nature du "projet" que par le matériel dont il dispose, et dont il exploite les possibilités avec plus ou moins de succès. En même temps, divers secteurs de son "projet" peuvent se faire une concurrence pour le même matériel. » (p. 49)
Dès que nous comprenons une chose ou un être dès que nous en établissons l'identité, dès que nous pouvons prévoir son comportement nous avons une emprise sur lui, nous sommes en mesure d'intervenir dans sa vie , tant pour le bien que pour le mal.
Video de Georges Devereux (1)
Voir plusAjouter une vidéo
JIMMY P : Psychothérapie d'un Indien des Plaines (2013), film français réalisé par Arnaud Desplechin, avec Benicio del Toro, Mathieu Amalric. Bande Annonce
autres livres classés : psychanalyseVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Georges Devereux (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Freud et les autres...
Combien y a-t-il de leçons sur la psychanalyse selon Freud ?
3
4
5
6
10 questions
433 lecteurs ont répondu
Thèmes :
psychologie
, psychanalyse
, sciences humainesCréer un quiz sur ce livre433 lecteurs ont répondu