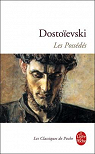Fichtre, voilà un roman torturé mais passionnant ! C'est en quelque sorte la voix refoulée d'un clandestin de la vie, d'un homme en souffrance, prisonnier de sa soif de reconnaissance et de son amour propre qui ne semble pouvoir exister que par et pour la souffrance. Il s'est créé un monde intérieur, un monde en quête du beau et du sublime que la littérature lui procure, mais un monde qui se heurte au monde extérieur.
Je me suis lancée dans cette lecture d'abord parce que le livre est très court, ce qui n'est pas si fréquent parmi les romans de Dostoïevski et ensuite, parce que j'ai lu quelque part, ou entendu, que c'était un condensé des grands thèmes qu'il développera ensuite dans Crime et châtiment, L'Idiot, Les Possédés, Les Frères Karamazov. Il parait aussi qu'il a inspiré Freud, et même Nietzsche. Je vous laisse imaginer ce que cela peut donner sur un livre de 180 pages.
Il s'ouvre avec ces lignes : « Je suis un homme malade…Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir, voilà ce que je suis. »
Tout un programme…
Notre « méchant » homme, le narrateur, est terré dans son sous-sol depuis vingt ans quand il décide de mettre par écrit ses pensées. Dans la première partie (il y en a deux), il s'adresse à une assemblée imaginaire (le lecteur ? lui-même ?), qui ne lui répond pas mais dont il imagine les répliques. C'est un monologue quasi fantasmagorique, une logorrhée, vive et alerte, parsemée d'envolées lyriques, sur sa vision du monde, des hommes et de lui-même. Il y crache son mépris, sa rage, débat sur le beau et le sublime, sur la jouissance de la souffrance, sur les lois de la raison et de la conscience, sur le galvaudage du bonheur et tout un tas de trucs …
« D'où vient que vous êtes si fermement, si triomphalement persuadés que seul le positif et le normal – bref, en un mot, le bien-être – sont dans les intérêts des hommes ? Votre raison ne se trompe-t-elle pas dans ses conclusions ? Et si les hommes n'aimaient pas seulement le bien-être ? Et s'ils aimaient la souffrance exactement autant ? Si la souffrance les intéressait tout autant que le bien-être ? Les hommes l'aiment quelquefois, la souffrance, d'une façon terrible, passionnée, ça aussi, c'est un fait. Ce n'est même plus la peine de se rapporter à l'histoire du monde ; posez-vous la question vous-même si seulement vous êtes un homme et si vous avez un tant soit peu vécu. »
La deuxième partie illustre concrètement ses propos. Elle semble plus mesurée car le narrateur raconte et revient sur les événements qui l'ont conduit dans ce sous-sol. Mais l'est-elle vraiment ? Deux scènes sont particulièrement édifiantes : celle de la prostituée, et peut être plus encore, celle de l'officier. Elle est proprement hallucinante et nous fait passer d'une phrase à l'autre par des émotions contradictoires. Et c'est sans doute le plus frappant dans ce livre : Il nous fait passer sans ménagements de l'antipathie à l'empathie, de la compassion à la révulsion, au malaise etc…
Vraiment, un livre à découvrir. C'est pessimiste mais fascinant et troublant. Il repose sur le psychisme du narrateur et ses contradictions et nous entraine dans la spirale infernale du masochisme moral.
Je me suis lancée dans cette lecture d'abord parce que le livre est très court, ce qui n'est pas si fréquent parmi les romans de Dostoïevski et ensuite, parce que j'ai lu quelque part, ou entendu, que c'était un condensé des grands thèmes qu'il développera ensuite dans Crime et châtiment, L'Idiot, Les Possédés, Les Frères Karamazov. Il parait aussi qu'il a inspiré Freud, et même Nietzsche. Je vous laisse imaginer ce que cela peut donner sur un livre de 180 pages.
Il s'ouvre avec ces lignes : « Je suis un homme malade…Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir, voilà ce que je suis. »
Tout un programme…
Notre « méchant » homme, le narrateur, est terré dans son sous-sol depuis vingt ans quand il décide de mettre par écrit ses pensées. Dans la première partie (il y en a deux), il s'adresse à une assemblée imaginaire (le lecteur ? lui-même ?), qui ne lui répond pas mais dont il imagine les répliques. C'est un monologue quasi fantasmagorique, une logorrhée, vive et alerte, parsemée d'envolées lyriques, sur sa vision du monde, des hommes et de lui-même. Il y crache son mépris, sa rage, débat sur le beau et le sublime, sur la jouissance de la souffrance, sur les lois de la raison et de la conscience, sur le galvaudage du bonheur et tout un tas de trucs …
« D'où vient que vous êtes si fermement, si triomphalement persuadés que seul le positif et le normal – bref, en un mot, le bien-être – sont dans les intérêts des hommes ? Votre raison ne se trompe-t-elle pas dans ses conclusions ? Et si les hommes n'aimaient pas seulement le bien-être ? Et s'ils aimaient la souffrance exactement autant ? Si la souffrance les intéressait tout autant que le bien-être ? Les hommes l'aiment quelquefois, la souffrance, d'une façon terrible, passionnée, ça aussi, c'est un fait. Ce n'est même plus la peine de se rapporter à l'histoire du monde ; posez-vous la question vous-même si seulement vous êtes un homme et si vous avez un tant soit peu vécu. »
La deuxième partie illustre concrètement ses propos. Elle semble plus mesurée car le narrateur raconte et revient sur les événements qui l'ont conduit dans ce sous-sol. Mais l'est-elle vraiment ? Deux scènes sont particulièrement édifiantes : celle de la prostituée, et peut être plus encore, celle de l'officier. Elle est proprement hallucinante et nous fait passer d'une phrase à l'autre par des émotions contradictoires. Et c'est sans doute le plus frappant dans ce livre : Il nous fait passer sans ménagements de l'antipathie à l'empathie, de la compassion à la révulsion, au malaise etc…
Vraiment, un livre à découvrir. C'est pessimiste mais fascinant et troublant. Il repose sur le psychisme du narrateur et ses contradictions et nous entraine dans la spirale infernale du masochisme moral.
J'ai emmené Notes d'un souterrain de Dostoïevski lors de mon voyage à Saint-Pétersbourg pour mieux apprécier le décor dans lequel, le héros abject qu'il a concocté se mêle au monde d'en haut lorsqu'il ne le commente pas d'en bas ...Une perspective plutôt réussi que celle de cette part d'humanité montrée dans ses aspects les plus cyniques, les plus vils et repoussants.
Sous-sol, sous-terrain, la notion de "bas" est omniprésente dans l'arrière-plan de ce roman monologue (ou dialogue avec le lecteur). Un homme original, en marge de la société détruit toute les idées reçues, les conventions admises; un homme pessimiste que rien n'attire dans cette vie; un anti-héros détesté de tous et se veut détestable. Il s'accuse dès le début du roman (certaines phrases nous rappellent des passages de Lautréamont dans ses "Chants"). Habitant dans un sous-sol, haïssant les bassesses humaines, lui même d'une condition basse et mettant au plus bas toutes les impulsions humaines. Ce personnage est la première version qui deviendra Raskolnikov, (il nous rappelle aussi le héros de "La Faim" d'Hamsun, et d'autres personnages de Kafka). Ce court roman- qui va ouvrir la voie à d'autres écrivains- est un vrai chef-d'oeuvre. Un roman (comme les aimait Kafka) qui secoue, qui remue les marécages de l'esprit et qui tombe comme un coup de marteau sur la tête.
DE PROFUNDIS CLAMAVI
Quelle est donc cette voix qui nous parle du fond de la nuit ?
Elle nous semble si familière que nous hésitons à croire qu'elle n'est pas sortie de notre propre bouche fiévreuse, un soir de cauchemar, le petit matin suintant lentement dans notre conscience, chargé des paroles terribles.
Il parle, il parle, il parle, nous dit Dostoïevski de son personnage, enfermé dans une cave pendant quarante années et, lorsqu'il en sort, pour quelque virée nocturne avec des soudards qui se terminera auprès d'une jeune prostituée qu'il souillera dans sa touchante pureté, c'est encore précédé des ténèbres de l'humiliation volontaire, de la soif de l'abaissement (1), de mille paroles bruissantes et rampantes, comme si l'homme du souterrain avait donné un coup de pied dans un nid de vipères dont il ne pouvait plus se débarrasser.
Pour Pietro Citati, cette ivresse de la haine et du mépris qu'un homme peut retourner contre lui-même bien plus que contre les autres est une des caractéristiques du Mal absolu sur lequel Francis Marmande, auteur d'une postface sans intérêt (pour la collection Babel) citant Guibert, Bataille, Leiris et même Duras, n'écrit pas un seul mot. Inexistence de ces pré et postfaciers qui semblent ne point savoir lire.
C'est encore Pietro Citati qui écrit que le héros, ou plutôt l'anti-héros absolu peint par Dostoïevski est un exemple, le premier sans doute, d'homme creux. L'image est facile et en partie fausse. C'est peut-être, en effet, ne pas tenir compte d'un certain nombre d'indices allant contre l'opinion de Citati, indices pour le moins insistants, le premier d'entre eux étant que Dostoïevski n'a pas voulu imaginer un homme qui fut complètement médiocre. le bavard des Carnets du sous-sol n'est certainement pas le minable Peredonov de Sologoub, un personnage absolument grotesque qui semble, décidément, hors de portée du plus puissant des bons samaritains, comme s'il se tenait, ainsi que Monsieur Ouine, hors de toute atteinte. Ne se révolte-t-il pas, même, contre le cartésianisme qui, à ses yeux, paraît avoir aplani le monde ?
L'homme médiocre est plat. Il refuse le risque de la profondeur, celle de l'amour ou celle du Mal volontaire.
Le médiocre est l'homme qui ne veut point du secours des autres hommes. Il est l'idiot, au sens étymologique du terme, celui qui ne veut point être relié à la communauté des vivants, l'îlot de perdition.
Notre médiocre, lui, même s'il appartient peut-être à cette catégorie, plus maudite que celle des «âmes perverties», des «âmes habituées» selon Charles Péguy, est tiraillé par la pureté, qu'il flaire d'ailleurs, comme un démon véritable, dans le coeur de la jeune prostituée venant chez lui après leur première rencontre, avec laquelle il couchera et qu'il humiliera en lui glissant un billet dans la main au moment de sa fuite, entièrement provoquée par les lamentables propos qu'il tient contre elle. Ne pouvant accomplir le bien, il lui reste à devenir vil. Comprenant que cette femme pourrait le sauver dans son infernale misère, le personnage de Dostoïevski tentera par tous les moyens de la blesser, de salir la petite flamme claire qui danse dans son coeur. Cette haine de la lumière n'est que la forme extrême de la conscience de sa propre misère, lorsque l'angoisse est la conséquence d'une certitude aussi douloureuse qu'aveuglante, ramassée en peu de mots par le grand Pascal lorsqu'il écrivit misère de l'homme : «Je sentais quelque chose qui refusait de mourir au fond de moi, dans le fond de mon coeur, de ma conscience, qui s'obstinait à ne pas mourir, qui se traduisait en angoisse brûlante» (p. 139).
Comme un véritable démon écrivais-je, car lui seul, comprenant que le bien qu'il ne peut toucher et qui brûle son regard est l'unique réalité, n'a de cesse de s'enfoncer dans le désespoir qu'il creuse, par l'action de sa propre volonté. En clair, il se dévore : «Plus je prenais conscience du bien, de tout ce «beau» et ce «sublime», écrit ainsi Dostoïevski, plus je m'engluais dans mon marais, et plus j'étais capable de m'y noyer complètement» (2).
C'est que l'homme creux tel que nous le peint l'écrivain russe n'est pas, à proprement parler, un médiocre ou alors il s'agit d'un médiocre d'un type particulier, parfaitement moderne, fruit de «notre époque négative» (p. 31), au savoir purement livresque et qui joue la comédie, devant les autres, en récitant les grandes phrases qu'il a lues et qui remplissent sa boursouflure d'un mauvais rêve éternellement bavard : «Que je vous explique : cette jouissance-là provient d'une conscience trop claire de votre abaissement; du fait que vous sentez vous-même que vous en êtes au dernier stade; et que c'est moche, et qu'il n'y a pas moyen de se sentir mieux; qu'il ne vous reste aucune issue, que plus jamais vous ne serez un autre; que, même s'il vous restait du temps et de la foi pour devenir quelque chose d'autre, vous ne voudriez plus vous-même, sans doute, vous transformer; et que, si vous vouliez, vous ne pourriez rien faire de toute façon, parce qu'il est vrai, peut-être, que vous n'avez plus rien en quoi vous transformer» (pp. 16-7).
Notre homme du souterrain tourne en rond, sa volonté porte à vide, n'a plus de poids, n'a plus la moindre importance dans un monde qui se moque des vieilles grandeurs antagonistes que sont le bien et le mal : «Parce que je suis coupable, enfin du fait que même si j'étais doué d'une quelconque grandeur d'âme, je n'en éprouverais qu'une douleur plus grande à la conscience de son inutilité» (p. 18).
L'homme creux, ce surgeon maléfique né dans la littérature du XIXe siècle et qui ne cessera de réapparaître au travers de centaines de masques (Folantin, Monsieur du Paur, Roquentin, Monsieur Ouine, etc.), veut faire le bien mais ne comprend guère quel hypothétique intérêt il va pouvoir en tirer. Faire le mal, alors, ne sera pas tant le résultat d'une décision mûrement réfléchie que la pente suivie d'une torturante facilité.
Le médiocre se laisse aller, comme on dit.
Tel un démon écrivais-je, ce qui signifie encore que le diable n'existe pas réellement dans Les Carnets du sous-sol en tant que personnage, mais bel et bien en tant que volonté maligne, de la part de l'écrivain, de conduire jusqu'à ses ultimes limites la conscience d'un homme qui ne s'aime pas. Peut-être est-ce ainsi que nous pouvons comprendre le jugement de Charles du Bos qui écrit : «Pour ma part, je n'éprouve son action [celle de Satan] sans cesse présente que dans l'oeuvre de Dostoïevsky (sic). Son action comme facteur, car nous vivons ici un phénomène qui se situe en une zone autrement profonde que celle d'où relève l'apparition ou au moins l'abstention d'un personnage. Ce n'est pas parce que Dostoïevski fait intervenir le diable dans ses romans, mais bien à cause de l'espèce fuligineuse de son génie, des procédés de son art d'une casuistique d'autant plus retorse que fallacieusement ingénue, de certains traits de la nature de l'homme […] que je le tiens pour démoniaque; — et, si je le tiens pour démoniaque, il va de soi que c'est parce que je me rallie de tous points à cette vue de Gide le concernant : «Je crois que nous atteignons avec [les Notes d'un souterrain] le sommet de la carrière de Dostoïevski. Je considère ce livre (et je ne suis pas le seul) comme la clef de voûte de son oeuvre entière». Or, [cette oeuvre] figure, à mon gré, le chef-d'oeuvre du démon dans l'ordre littéraire. Il le figure non seulement en fonction de «la rumination du cerveau», mais davantage encore pour le caractère du cheminement, tout ensemble par le labeur de la sape et par le dédale des boyaux. le démon est avant tout souterrain […]» (3).
Souterrain et incroyablement bavard, aussi, l'anti-héros de l'écrivain russe étant finalement le père, dont l'esprit est accablé de lectures (4), des personnages de Camus (le Jean-Baptiste Clamence de la Chute) et de Louis-René des Forêts (dans le Bavard) : «[…] je ne suis qu'un bavard inoffensif, rien qu'un bavard inoffensif et contrariant, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je peux faire quand la fonction unique et évidente de tout homme intelligent reste le bavardage, c'est-à-dire d'agiter les bras pour faire du vent ?» (p. 29).
Ainsi, parce qu'il s'est réfugié dans un anti-monde qui a de moins en moins de liens avec le monde véritable et la vie réelle, la bouche d'ombre du souterrain est décrite par Dostoïevski comme une espèce de chimère, la création véritablement malade d'une époque ayant perdu, pour employer une expression de Kierkegaard, le sens de la verte primitivité, une civilisation dont l'unique but, semble-t-il, est d'accroître une sensibilité privée d'objet (5), tout entière dévorée par une intelligence qui est condamnée à un monologue perpétuel, un ressassement infini : «Car raconter, par exemple, de longs récits sur la façon dont j'ai gâché ma vie dans mon trou, la désagrégation morale, l'absence de milieu, la perte du vivant et ma méchanceté vaniteuse dans mon sous-sol, je vous jure, cela n'a pas d'intérêt; le roman a besoin d'un héros et là, exprès, sont réunies toutes les caractéristiques d'un anti-héros et puis, surtout, cela fera une impression des plus désagréables, parce que nous avons tous perdu l'habitude de la vie, nous sommes tous plus ou moins boiteux. Nous en avons tellement perdu l'habitude, même, qu'il nous arrive parfois de ressentir une sorte de répulsion envers la «vie vivante», et c'est pourquoi nous ne pouvons pas supporter qu'on nous rappelle qu'elle existe. Car où en sommes-nous arrivés ?» (p. 164).
Nous en sommes arrivés à un monde qui, comme s'il s'agissait d'une réunion de sabbat, hurle autour du feu en ravageant la création et en brûlant les pauvres, dont les cendres alimentent l'immense machine dont le rêve ultime est de prendre notre place et puis, peut-être, de s'élancer dans les gouffres de l'espace pour y retrouver son créateur, dont elle gardera la très lointaine nostalgie.
«Nous sommes tous morts-nés, conclut Dostoïevski, et depuis bien longtemps, les pères qui nous engendrent, ils sont des morts eux-mêmes, et tout cela nous plaît de plus en plus. On y prend goût. Bientôt nous inventerons un moyen pour naître d'une idée» (p. 165).
En attendant ce jour qui, à vrai dire, est déjà le nôtre, annonçant le long monologue de l'homme ayant trébuché ou plutôt chuté comme l'imaginera Albert Camus, faux-pas et chute qui lui apprendront qu'il n'est plus rien de vivant puisqu'il a failli à sa tâche, Dostoïevski aura tendu à notre apocalypse festive et légère un miroir où grimace sa face de démon, son plus fidèle portrait sans doute (6).
L'enregistrement aussi, effrayant dans sa monotonie, d'une voix d'outre-tombe, la voix de la nuit évoquée par Marcel Beyer.
Notes
(1) «Oui, est-ce possible, enfin, est-ce possible que l'on s'estime encore un tant soit peu si l'on a essayé de chercher du plaisir même dans la sensation de son propre abaissement ?» (Fédor Dostoïevski, Les carnets du sous-sol [1864], Éditions Actes Sud, coll. Babel, traduction d'André Markowicz, lecture de Francis Marmande, 1993), p. 26.
(2) Op. cit., p. 16.
(3) Charles du Bos, Qu'est-ce que la littérature ? (Plon, coll. Présences, 1946), pp. 308-9.
(4) «[…] et une idylle, encore, de poudre aux yeux, livresque, inventée […]» (p. 141).
(5) «Qu'est-ce donc qu'elle adoucit en nous, la civilisation ? Tout ce que fait la civilisation, c'est qu'elle amène à une plus grande complexité de sensations… absolument rien d'autre» (p. 35).
(6) «Car s'il est une conviction chez Dostoïevski, c'est bien l'irrémissible rupture, à partir des Lumières, que provoque l'autodéification de l'homme, fêlure ontologique qui excède le cours des révolutions et par laquelle l'homme, singeant l'Absent, se fuit, précipite sa perte et rencontre l'échec en affirmant une impossible liberté, d'abord tragi-comique, puis proprement infernale. Loin de réécrire les mythes anciens du vol solaire ou du feu dérobé, c'est à une descente dans les basses-fosses de la modernité, là où s'élabore la fiction du sujet autonome, qu'il s'emploie», in Jean-François Colosimo, L'Apocalypse russe. Dieu au pays de Dostoïevski (Fayard, 2008), p. 177.
Cette très acérée chronique fut - lamentablement - captée, et illico reproduite ici par votre humble chroniqueur (paresseux), sur le blog de Juan Asensio qu'il a intitulé Stalker (en référence au célèbre film de Tarkovski).
Le lien pour ceux qui chercheraient à en savoir plus sur cette plume très accrocheuse, c'est ici : http://www.juanasensio.com/archive/2010/09/20/les-carnets-du-sous-sol-dostoievski-zapiski-iz-podpolia.html
Un autre point de vue sur ce texte incroyable du grand romancier russe, avec un angle d'attaque vraiment intéressant, se trouve ici : http://revuepostures.com/fr/articles/leguerrier-18
Quelle est donc cette voix qui nous parle du fond de la nuit ?
Elle nous semble si familière que nous hésitons à croire qu'elle n'est pas sortie de notre propre bouche fiévreuse, un soir de cauchemar, le petit matin suintant lentement dans notre conscience, chargé des paroles terribles.
Il parle, il parle, il parle, nous dit Dostoïevski de son personnage, enfermé dans une cave pendant quarante années et, lorsqu'il en sort, pour quelque virée nocturne avec des soudards qui se terminera auprès d'une jeune prostituée qu'il souillera dans sa touchante pureté, c'est encore précédé des ténèbres de l'humiliation volontaire, de la soif de l'abaissement (1), de mille paroles bruissantes et rampantes, comme si l'homme du souterrain avait donné un coup de pied dans un nid de vipères dont il ne pouvait plus se débarrasser.
Pour Pietro Citati, cette ivresse de la haine et du mépris qu'un homme peut retourner contre lui-même bien plus que contre les autres est une des caractéristiques du Mal absolu sur lequel Francis Marmande, auteur d'une postface sans intérêt (pour la collection Babel) citant Guibert, Bataille, Leiris et même Duras, n'écrit pas un seul mot. Inexistence de ces pré et postfaciers qui semblent ne point savoir lire.
C'est encore Pietro Citati qui écrit que le héros, ou plutôt l'anti-héros absolu peint par Dostoïevski est un exemple, le premier sans doute, d'homme creux. L'image est facile et en partie fausse. C'est peut-être, en effet, ne pas tenir compte d'un certain nombre d'indices allant contre l'opinion de Citati, indices pour le moins insistants, le premier d'entre eux étant que Dostoïevski n'a pas voulu imaginer un homme qui fut complètement médiocre. le bavard des Carnets du sous-sol n'est certainement pas le minable Peredonov de Sologoub, un personnage absolument grotesque qui semble, décidément, hors de portée du plus puissant des bons samaritains, comme s'il se tenait, ainsi que Monsieur Ouine, hors de toute atteinte. Ne se révolte-t-il pas, même, contre le cartésianisme qui, à ses yeux, paraît avoir aplani le monde ?
L'homme médiocre est plat. Il refuse le risque de la profondeur, celle de l'amour ou celle du Mal volontaire.
Le médiocre est l'homme qui ne veut point du secours des autres hommes. Il est l'idiot, au sens étymologique du terme, celui qui ne veut point être relié à la communauté des vivants, l'îlot de perdition.
Notre médiocre, lui, même s'il appartient peut-être à cette catégorie, plus maudite que celle des «âmes perverties», des «âmes habituées» selon Charles Péguy, est tiraillé par la pureté, qu'il flaire d'ailleurs, comme un démon véritable, dans le coeur de la jeune prostituée venant chez lui après leur première rencontre, avec laquelle il couchera et qu'il humiliera en lui glissant un billet dans la main au moment de sa fuite, entièrement provoquée par les lamentables propos qu'il tient contre elle. Ne pouvant accomplir le bien, il lui reste à devenir vil. Comprenant que cette femme pourrait le sauver dans son infernale misère, le personnage de Dostoïevski tentera par tous les moyens de la blesser, de salir la petite flamme claire qui danse dans son coeur. Cette haine de la lumière n'est que la forme extrême de la conscience de sa propre misère, lorsque l'angoisse est la conséquence d'une certitude aussi douloureuse qu'aveuglante, ramassée en peu de mots par le grand Pascal lorsqu'il écrivit misère de l'homme : «Je sentais quelque chose qui refusait de mourir au fond de moi, dans le fond de mon coeur, de ma conscience, qui s'obstinait à ne pas mourir, qui se traduisait en angoisse brûlante» (p. 139).
Comme un véritable démon écrivais-je, car lui seul, comprenant que le bien qu'il ne peut toucher et qui brûle son regard est l'unique réalité, n'a de cesse de s'enfoncer dans le désespoir qu'il creuse, par l'action de sa propre volonté. En clair, il se dévore : «Plus je prenais conscience du bien, de tout ce «beau» et ce «sublime», écrit ainsi Dostoïevski, plus je m'engluais dans mon marais, et plus j'étais capable de m'y noyer complètement» (2).
C'est que l'homme creux tel que nous le peint l'écrivain russe n'est pas, à proprement parler, un médiocre ou alors il s'agit d'un médiocre d'un type particulier, parfaitement moderne, fruit de «notre époque négative» (p. 31), au savoir purement livresque et qui joue la comédie, devant les autres, en récitant les grandes phrases qu'il a lues et qui remplissent sa boursouflure d'un mauvais rêve éternellement bavard : «Que je vous explique : cette jouissance-là provient d'une conscience trop claire de votre abaissement; du fait que vous sentez vous-même que vous en êtes au dernier stade; et que c'est moche, et qu'il n'y a pas moyen de se sentir mieux; qu'il ne vous reste aucune issue, que plus jamais vous ne serez un autre; que, même s'il vous restait du temps et de la foi pour devenir quelque chose d'autre, vous ne voudriez plus vous-même, sans doute, vous transformer; et que, si vous vouliez, vous ne pourriez rien faire de toute façon, parce qu'il est vrai, peut-être, que vous n'avez plus rien en quoi vous transformer» (pp. 16-7).
Notre homme du souterrain tourne en rond, sa volonté porte à vide, n'a plus de poids, n'a plus la moindre importance dans un monde qui se moque des vieilles grandeurs antagonistes que sont le bien et le mal : «Parce que je suis coupable, enfin du fait que même si j'étais doué d'une quelconque grandeur d'âme, je n'en éprouverais qu'une douleur plus grande à la conscience de son inutilité» (p. 18).
L'homme creux, ce surgeon maléfique né dans la littérature du XIXe siècle et qui ne cessera de réapparaître au travers de centaines de masques (Folantin, Monsieur du Paur, Roquentin, Monsieur Ouine, etc.), veut faire le bien mais ne comprend guère quel hypothétique intérêt il va pouvoir en tirer. Faire le mal, alors, ne sera pas tant le résultat d'une décision mûrement réfléchie que la pente suivie d'une torturante facilité.
Le médiocre se laisse aller, comme on dit.
Tel un démon écrivais-je, ce qui signifie encore que le diable n'existe pas réellement dans Les Carnets du sous-sol en tant que personnage, mais bel et bien en tant que volonté maligne, de la part de l'écrivain, de conduire jusqu'à ses ultimes limites la conscience d'un homme qui ne s'aime pas. Peut-être est-ce ainsi que nous pouvons comprendre le jugement de Charles du Bos qui écrit : «Pour ma part, je n'éprouve son action [celle de Satan] sans cesse présente que dans l'oeuvre de Dostoïevsky (sic). Son action comme facteur, car nous vivons ici un phénomène qui se situe en une zone autrement profonde que celle d'où relève l'apparition ou au moins l'abstention d'un personnage. Ce n'est pas parce que Dostoïevski fait intervenir le diable dans ses romans, mais bien à cause de l'espèce fuligineuse de son génie, des procédés de son art d'une casuistique d'autant plus retorse que fallacieusement ingénue, de certains traits de la nature de l'homme […] que je le tiens pour démoniaque; — et, si je le tiens pour démoniaque, il va de soi que c'est parce que je me rallie de tous points à cette vue de Gide le concernant : «Je crois que nous atteignons avec [les Notes d'un souterrain] le sommet de la carrière de Dostoïevski. Je considère ce livre (et je ne suis pas le seul) comme la clef de voûte de son oeuvre entière». Or, [cette oeuvre] figure, à mon gré, le chef-d'oeuvre du démon dans l'ordre littéraire. Il le figure non seulement en fonction de «la rumination du cerveau», mais davantage encore pour le caractère du cheminement, tout ensemble par le labeur de la sape et par le dédale des boyaux. le démon est avant tout souterrain […]» (3).
Souterrain et incroyablement bavard, aussi, l'anti-héros de l'écrivain russe étant finalement le père, dont l'esprit est accablé de lectures (4), des personnages de Camus (le Jean-Baptiste Clamence de la Chute) et de Louis-René des Forêts (dans le Bavard) : «[…] je ne suis qu'un bavard inoffensif, rien qu'un bavard inoffensif et contrariant, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je peux faire quand la fonction unique et évidente de tout homme intelligent reste le bavardage, c'est-à-dire d'agiter les bras pour faire du vent ?» (p. 29).
Ainsi, parce qu'il s'est réfugié dans un anti-monde qui a de moins en moins de liens avec le monde véritable et la vie réelle, la bouche d'ombre du souterrain est décrite par Dostoïevski comme une espèce de chimère, la création véritablement malade d'une époque ayant perdu, pour employer une expression de Kierkegaard, le sens de la verte primitivité, une civilisation dont l'unique but, semble-t-il, est d'accroître une sensibilité privée d'objet (5), tout entière dévorée par une intelligence qui est condamnée à un monologue perpétuel, un ressassement infini : «Car raconter, par exemple, de longs récits sur la façon dont j'ai gâché ma vie dans mon trou, la désagrégation morale, l'absence de milieu, la perte du vivant et ma méchanceté vaniteuse dans mon sous-sol, je vous jure, cela n'a pas d'intérêt; le roman a besoin d'un héros et là, exprès, sont réunies toutes les caractéristiques d'un anti-héros et puis, surtout, cela fera une impression des plus désagréables, parce que nous avons tous perdu l'habitude de la vie, nous sommes tous plus ou moins boiteux. Nous en avons tellement perdu l'habitude, même, qu'il nous arrive parfois de ressentir une sorte de répulsion envers la «vie vivante», et c'est pourquoi nous ne pouvons pas supporter qu'on nous rappelle qu'elle existe. Car où en sommes-nous arrivés ?» (p. 164).
Nous en sommes arrivés à un monde qui, comme s'il s'agissait d'une réunion de sabbat, hurle autour du feu en ravageant la création et en brûlant les pauvres, dont les cendres alimentent l'immense machine dont le rêve ultime est de prendre notre place et puis, peut-être, de s'élancer dans les gouffres de l'espace pour y retrouver son créateur, dont elle gardera la très lointaine nostalgie.
«Nous sommes tous morts-nés, conclut Dostoïevski, et depuis bien longtemps, les pères qui nous engendrent, ils sont des morts eux-mêmes, et tout cela nous plaît de plus en plus. On y prend goût. Bientôt nous inventerons un moyen pour naître d'une idée» (p. 165).
En attendant ce jour qui, à vrai dire, est déjà le nôtre, annonçant le long monologue de l'homme ayant trébuché ou plutôt chuté comme l'imaginera Albert Camus, faux-pas et chute qui lui apprendront qu'il n'est plus rien de vivant puisqu'il a failli à sa tâche, Dostoïevski aura tendu à notre apocalypse festive et légère un miroir où grimace sa face de démon, son plus fidèle portrait sans doute (6).
L'enregistrement aussi, effrayant dans sa monotonie, d'une voix d'outre-tombe, la voix de la nuit évoquée par Marcel Beyer.
Notes
(1) «Oui, est-ce possible, enfin, est-ce possible que l'on s'estime encore un tant soit peu si l'on a essayé de chercher du plaisir même dans la sensation de son propre abaissement ?» (Fédor Dostoïevski, Les carnets du sous-sol [1864], Éditions Actes Sud, coll. Babel, traduction d'André Markowicz, lecture de Francis Marmande, 1993), p. 26.
(2) Op. cit., p. 16.
(3) Charles du Bos, Qu'est-ce que la littérature ? (Plon, coll. Présences, 1946), pp. 308-9.
(4) «[…] et une idylle, encore, de poudre aux yeux, livresque, inventée […]» (p. 141).
(5) «Qu'est-ce donc qu'elle adoucit en nous, la civilisation ? Tout ce que fait la civilisation, c'est qu'elle amène à une plus grande complexité de sensations… absolument rien d'autre» (p. 35).
(6) «Car s'il est une conviction chez Dostoïevski, c'est bien l'irrémissible rupture, à partir des Lumières, que provoque l'autodéification de l'homme, fêlure ontologique qui excède le cours des révolutions et par laquelle l'homme, singeant l'Absent, se fuit, précipite sa perte et rencontre l'échec en affirmant une impossible liberté, d'abord tragi-comique, puis proprement infernale. Loin de réécrire les mythes anciens du vol solaire ou du feu dérobé, c'est à une descente dans les basses-fosses de la modernité, là où s'élabore la fiction du sujet autonome, qu'il s'emploie», in Jean-François Colosimo, L'Apocalypse russe. Dieu au pays de Dostoïevski (Fayard, 2008), p. 177.
Cette très acérée chronique fut - lamentablement - captée, et illico reproduite ici par votre humble chroniqueur (paresseux), sur le blog de Juan Asensio qu'il a intitulé Stalker (en référence au célèbre film de Tarkovski).
Le lien pour ceux qui chercheraient à en savoir plus sur cette plume très accrocheuse, c'est ici : http://www.juanasensio.com/archive/2010/09/20/les-carnets-du-sous-sol-dostoievski-zapiski-iz-podpolia.html
Un autre point de vue sur ce texte incroyable du grand romancier russe, avec un angle d'attaque vraiment intéressant, se trouve ici : http://revuepostures.com/fr/articles/leguerrier-18
Un jour qui devait être particulièrement sombre, Dostoïevski décida de dépeindre l'homme le plus abject qu'il puisse imaginer.
Voila comment on pourrait résumer le Sous-sol. L'homme que Dostoïevski imagina n'est pas un assassin, ni même un petit criminel. C'est un être infect et méprisable en tout point. Un anonyme, à qui personne ne s'est jamais intéressé et ne s'intéressera jamais. Totalement insignifiant. Sa seule façon d'exister, c'est d'enquiquiner les autres. Il ne conçoit pas l'existence autrement.
Pour lui, le fait d'avoir mal aux dents est une jouissance : cela lui donne une bonne raison de se plaindre, de gémir et d'empêcher les autres de dormir. L'amitié ou l'amour, pour lui cela n'a qu'une seule signification, et il le revendique fièrement : c'est accepter d'être torturé moralement par l'autre. On l'évite comme on évite une crotte de chien sur le trottoir. Et même cela lui procure une forme de jouissance.
Forcément, il y a une prostituée avec un visage un visage un peu enfantin. On est dans Dostoïevski. Et la façon dont il va se comporter avec elle est… Plus basse encore que ce qu'on est en droit d'attendre.
Dostoïevski a-t-il eu besoin de creuser profondément dans l'âme humaine pour composer son personnage ? Non. En fait il a plutôt tout enlevé. Et simplement laissé un égoïste dans la solitude au milieu des hommes.
Et pourtant même cet homme-là peut espérer son rachat, nous dit la fin. S'il se repend au plus profond de lui-même. Et si on accepte cette interprétation, alors ce livre représente probablement l'apogée de ce courant étrange et torturé que fut l'existentialisme chrétien...
Voila comment on pourrait résumer le Sous-sol. L'homme que Dostoïevski imagina n'est pas un assassin, ni même un petit criminel. C'est un être infect et méprisable en tout point. Un anonyme, à qui personne ne s'est jamais intéressé et ne s'intéressera jamais. Totalement insignifiant. Sa seule façon d'exister, c'est d'enquiquiner les autres. Il ne conçoit pas l'existence autrement.
Pour lui, le fait d'avoir mal aux dents est une jouissance : cela lui donne une bonne raison de se plaindre, de gémir et d'empêcher les autres de dormir. L'amitié ou l'amour, pour lui cela n'a qu'une seule signification, et il le revendique fièrement : c'est accepter d'être torturé moralement par l'autre. On l'évite comme on évite une crotte de chien sur le trottoir. Et même cela lui procure une forme de jouissance.
Forcément, il y a une prostituée avec un visage un visage un peu enfantin. On est dans Dostoïevski. Et la façon dont il va se comporter avec elle est… Plus basse encore que ce qu'on est en droit d'attendre.
Dostoïevski a-t-il eu besoin de creuser profondément dans l'âme humaine pour composer son personnage ? Non. En fait il a plutôt tout enlevé. Et simplement laissé un égoïste dans la solitude au milieu des hommes.
Et pourtant même cet homme-là peut espérer son rachat, nous dit la fin. S'il se repend au plus profond de lui-même. Et si on accepte cette interprétation, alors ce livre représente probablement l'apogée de ce courant étrange et torturé que fut l'existentialisme chrétien...
À Saint-Pétersbourg, l'auteur anonyme des Carnets (journal intime? essai rousseauiste? «peine de redressement»?), après avoir touché six mille roubles d'un de ses lointains parents, démissionnait de son poste de fonctionnaire pour se mettre, à l'aube de ses 40 ans, diablement et irrémédiablement à l'écart de tout commerce avec ses congénères. «Ma chambre est moche, elle est sale, elle est au bout de la ville». Terré dans son «trou», il s'attelle désormais à traduire sur le papier «certaines de [ses] aventures » de jeunesse, dont il aurait essayé jusque-là «de contourner avec une inquiétude bien réelle» le souvenir honteux. S'il le fait tout en ayant l'air de «s'adresser à des lecteurs», il jure pourtant ses grands dieux n'écrire que pour lui. S'il s'imagine un public, c'est, affirme-t-il, juste pour se donner une contenance, pour se «tenir un peu plus décemment». Il se ment, il nous ment, il ment, n'est-ce pas, comme tout un chacun, c'est dire...!
Dostoïevski par contre n'aura peut-être jamais cerné d'aussi près, de manière aussi épurée et condensée, ce fameux «locataire d'une maison en feu» qui lui avait apparemment dicté l'essentiel de son oeuvre . Il n'aura probablement jamais inspecté aussi directement, «sans temps à perdre et devant aller à l'essentiel», la crasse d'un sous-sol animique en danger de combustion. Aussi, plus que jamais, n'aura-t-il peut-être scruté comme il le fera ici, avec une telle liberté de ton, envoyant «au diable tous les systèmes et toutes les théories», la détermination aveugle qui amène son occupant, au-delà du bon sens, parfois contre son intérêt propre, à vouloir systématiquement soumettre l'aménagement des lieux, ainsi que ses invités de passage, à l'emprise de sa volonté souveraine, «indépendante, quel que soit le prix de cette indépendance, et quelles que soient ses conséquences», à la tyrannie absolue de son «caprice individuel, fût-il le plus farouche», ou encore à son besoin mesquin d'agrandir à l'occasion les lieux aux dépens de ses voisins… Jamais il ne l'aura peut-être montré aussi nu et paradoxal, sans bail à devoir honorer, dépourvu en même temps de toute couverture standard tissée par les conventions sociales en vigueur. Aucune draperie sublime non plus pour recouvrir ici les traces moches qu'auront laissées les minables saletés, les «débauchettes» et «torturettes intérieures», ces taches auréolées de sauce «jouissance du désespoir» qui s'incrustaient avec le temps sur son mobilier. Enfin, plus que jamais le génie de l'auteur ne s'était appliqué de la sorte à vouloir évacuer d'une fois pour toutes des locaux l'Autre qui, agitant ses breloquets sentimentaux, risque parfois de devenir un hôte embarrassant, source potentielle de compassion ou de remords de conscience…
Un demi-siècle avant, et encore plus radicalement peut-être qu'un Kafka («Je vous le dis avec solennité : j'ai voulu devenir un insecte à de nombreuses reprises. Et même là, je n'ai pas eu l'honneur») ou qu'un Pessoa («Je me moque de moi-même et je me console avec cette certitude aussi bilieuse qu'inutile : un homme intelligent ne peut rien devenir – il n'y a que les imbéciles qui deviennent»), Dostoïevski s'apprête, dès le milieu du XIXe siècle, à donner son préavis à tout locataire moderne s'imaginant, grâce à l'essor d'une nouvelle raison positiviste et aux avancées remarquables des sciences, pouvoir se débarrasser enfin de sa condition primitive de «bipède nuisible et ingrat», ainsi que du joug ancestral de la barbarie qui semble s'être de tout temps abattu sur les efforts humains civilisateurs, pacifistes et solidaires.
Et comment, dites-moi, s'aménager une «persona» présentable à une réunion de copropriété universelle après les révolutions copernicienne, darwinienne et freudienne ? (Même si cette dernière n'était pas encore initiée au moment de la rédaction de ces Carnets, qu'il fut, là encore, visionnaire ce Fédor par rapport à l'homo psychologicus du XXe siècle, quand il écrivait ceci: «Si, par exemple, un jour on me prouve que si j'ai dit «merde» à quelqu'un, c'était évidemment parce que je ne pouvais pas ne pas le dire, et que je devais le dire avec exactement l'intonation qui fut la mienne, alors qu'est-ce qu'il me restera de libre en moi, surtout si je suis instruit, et que j'ai un diplôme?). Désormais donc «sans dieu ni maître», esclave de sa propre réflexivité qui ne sert à plus rien, dans la mesure même où il s'avère n'être plus du tout au centre de quoi que ce soit, la conscience de l'homme moderne ne peut que s'éloigner inexorablement du «vivant» et se gaver de mots creux. Ou comme le scanderait par la suite l'espiègle Jacques Prévert : «La conscience d'aujourd'hui est la science des cons instruits».
Le paradoxe, donc, de la « conscience accrue » : notre locataire, après avoir vidé les lieux, s'ennuie à mort et risque alors sérieusement de songer à nouveau à Cléopâtre, «qui aimait enfoncer des épingles dorées dans les seins de ses servantes et trouvait une jouissance dans leurs tortillements et dans leurs cris…»
Au sous-sol alors : refuge au confort certes assez strict, mais qui permet à notre locataire au moins de «se tenir au sec» ; espace individuel («virtuel», pourrions-nous rajouter de nos jours..) préservé contre toute promiscuité dangereuse, où un «honnête homme peut enfin ne parler que de ce qui lui fait le plus plaisir, c'est-à-dire de lui-même» ; tour à tour Paradis privé, d'un Moi autarcique -principe et fin en soi-même - procédant au délicieux sacrifice imaginaire de l'Autre, et Hadès personnel où ses demi-dieux primitifs négligés, à qui plus aucun culte n'est rendu, se consumant à petit feu, condamneraient le sujet au supplice du manque et du ressentiment. «Soit un héros, soit une ordure».
Au-delà du « masochisme moral » de son personnage, mis en évidence à juste titre par de nombreux commentateurs de ce texte, au-delà de cette sorte d'extase à l'envers («Que vaut-il mieux : un bonheur bon marché ou une souffrance qui coûte cher ?») qu'il recherche obstinément, en évoquant avec force détail et une indissimulable jouissance les humiliations qu'il a subies ou infligées, l'auteur «imaginaire» de ces Carnets pourrait à mon sens incarner aussi à merveille le drame de la conscience moderne.
Un Antoine Roquentin avant la lettre ? S'il avoue comme le célèbre personnage sartrien éprouver de la «nausée» face à l'existence, je dirais (en risquant d'être à contre-courant de tous ceux qui s'empressent de cataloguer Dostoïevski comme un précurseur de « l'existentialisme » - tant pis, j'y vais «bavard et contrariant comme un autre» !! ) que même si à la base un même constat serait fait par les deux personnages, l'auteur des Carnets se situerait néanmoins tout à fait l'opposé du (anti)héros sartrien: à la «nausée», le premier s'est parfaitement habitué et a accepté volontairement de la supporter. «Toute forme de conscience est une maladie », nous dit-il, et « un homme d'action (au secours Sartre!!), une créature essentiellement limitée ».
Roman philosophique sur les limites du cogito («Je m'exerce à penser ; par conséquent, chez moi, toute cause première en fait surgir une autre, plus première encore, et ainsi de suite à l'infini. Telle est l'essence de toute conscience et de toute pensée »), sur les systèmes fermés d'idées finissant par engendrer «des espèces d'hommes globaux fantasmatiques» , et sur la quête d'un sens à donner à la vie, à laquelle aucune idéologie utopiste ne saurait apporter de réponse satisfaisante sans préempter au passage la liberté essentielle à l'homme, ces Carnets ne font pourtant retentir, à aucun moment me semble-t-il, de notes nihilistes.
Sceptique ? Oui. Pessimiste ? Oui. Mais pas nihiliste pour un sou !! Accroché au désir tout aussi « paradoxal » de pouvoir effleurer le coeur battant de la vie, de revenir à ce que Dostoïevski appellerait la «véritable vie vivante», ou encore d'inventer un moyen possible d'éviter à l'homme «de naître d'une idée», ce qui extraordinaire chez lui - au-delà de la cruelle lucidité avec laquelle il expose à notre vue les sombres sous-sols de l'âme humaine-, c'est cette sorte de mystique profane, complexe, pas évidente à circonscrire par le seul «bavardage qui agite les bras pour faire du vent», naturelle, ou en tout cas hors tout support purement rationnel, et à laquelle en fin de compte on ne peut accéder la plupart du temps qu'après un séjour plus ou moins long dans le désert…
C'est ainsi également que, tout en nous informant à la fin des Carnets que l'homme souterrain n'ayant plus eu envie de continuer à «écrire du fond de son sous-sol », il avait abandonné en l'état leur rédaction, inachevée, l'écrivain rajoute que ce n'est pourtant pas là que tout s'était terminé. «C'était plus fort que lui, il a continué.»
Dostoïevski par contre n'aura peut-être jamais cerné d'aussi près, de manière aussi épurée et condensée, ce fameux «locataire d'une maison en feu» qui lui avait apparemment dicté l'essentiel de son oeuvre . Il n'aura probablement jamais inspecté aussi directement, «sans temps à perdre et devant aller à l'essentiel», la crasse d'un sous-sol animique en danger de combustion. Aussi, plus que jamais, n'aura-t-il peut-être scruté comme il le fera ici, avec une telle liberté de ton, envoyant «au diable tous les systèmes et toutes les théories», la détermination aveugle qui amène son occupant, au-delà du bon sens, parfois contre son intérêt propre, à vouloir systématiquement soumettre l'aménagement des lieux, ainsi que ses invités de passage, à l'emprise de sa volonté souveraine, «indépendante, quel que soit le prix de cette indépendance, et quelles que soient ses conséquences», à la tyrannie absolue de son «caprice individuel, fût-il le plus farouche», ou encore à son besoin mesquin d'agrandir à l'occasion les lieux aux dépens de ses voisins… Jamais il ne l'aura peut-être montré aussi nu et paradoxal, sans bail à devoir honorer, dépourvu en même temps de toute couverture standard tissée par les conventions sociales en vigueur. Aucune draperie sublime non plus pour recouvrir ici les traces moches qu'auront laissées les minables saletés, les «débauchettes» et «torturettes intérieures», ces taches auréolées de sauce «jouissance du désespoir» qui s'incrustaient avec le temps sur son mobilier. Enfin, plus que jamais le génie de l'auteur ne s'était appliqué de la sorte à vouloir évacuer d'une fois pour toutes des locaux l'Autre qui, agitant ses breloquets sentimentaux, risque parfois de devenir un hôte embarrassant, source potentielle de compassion ou de remords de conscience…
Un demi-siècle avant, et encore plus radicalement peut-être qu'un Kafka («Je vous le dis avec solennité : j'ai voulu devenir un insecte à de nombreuses reprises. Et même là, je n'ai pas eu l'honneur») ou qu'un Pessoa («Je me moque de moi-même et je me console avec cette certitude aussi bilieuse qu'inutile : un homme intelligent ne peut rien devenir – il n'y a que les imbéciles qui deviennent»), Dostoïevski s'apprête, dès le milieu du XIXe siècle, à donner son préavis à tout locataire moderne s'imaginant, grâce à l'essor d'une nouvelle raison positiviste et aux avancées remarquables des sciences, pouvoir se débarrasser enfin de sa condition primitive de «bipède nuisible et ingrat», ainsi que du joug ancestral de la barbarie qui semble s'être de tout temps abattu sur les efforts humains civilisateurs, pacifistes et solidaires.
Et comment, dites-moi, s'aménager une «persona» présentable à une réunion de copropriété universelle après les révolutions copernicienne, darwinienne et freudienne ? (Même si cette dernière n'était pas encore initiée au moment de la rédaction de ces Carnets, qu'il fut, là encore, visionnaire ce Fédor par rapport à l'homo psychologicus du XXe siècle, quand il écrivait ceci: «Si, par exemple, un jour on me prouve que si j'ai dit «merde» à quelqu'un, c'était évidemment parce que je ne pouvais pas ne pas le dire, et que je devais le dire avec exactement l'intonation qui fut la mienne, alors qu'est-ce qu'il me restera de libre en moi, surtout si je suis instruit, et que j'ai un diplôme?). Désormais donc «sans dieu ni maître», esclave de sa propre réflexivité qui ne sert à plus rien, dans la mesure même où il s'avère n'être plus du tout au centre de quoi que ce soit, la conscience de l'homme moderne ne peut que s'éloigner inexorablement du «vivant» et se gaver de mots creux. Ou comme le scanderait par la suite l'espiègle Jacques Prévert : «La conscience d'aujourd'hui est la science des cons instruits».
Le paradoxe, donc, de la « conscience accrue » : notre locataire, après avoir vidé les lieux, s'ennuie à mort et risque alors sérieusement de songer à nouveau à Cléopâtre, «qui aimait enfoncer des épingles dorées dans les seins de ses servantes et trouvait une jouissance dans leurs tortillements et dans leurs cris…»
Au sous-sol alors : refuge au confort certes assez strict, mais qui permet à notre locataire au moins de «se tenir au sec» ; espace individuel («virtuel», pourrions-nous rajouter de nos jours..) préservé contre toute promiscuité dangereuse, où un «honnête homme peut enfin ne parler que de ce qui lui fait le plus plaisir, c'est-à-dire de lui-même» ; tour à tour Paradis privé, d'un Moi autarcique -principe et fin en soi-même - procédant au délicieux sacrifice imaginaire de l'Autre, et Hadès personnel où ses demi-dieux primitifs négligés, à qui plus aucun culte n'est rendu, se consumant à petit feu, condamneraient le sujet au supplice du manque et du ressentiment. «Soit un héros, soit une ordure».
Au-delà du « masochisme moral » de son personnage, mis en évidence à juste titre par de nombreux commentateurs de ce texte, au-delà de cette sorte d'extase à l'envers («Que vaut-il mieux : un bonheur bon marché ou une souffrance qui coûte cher ?») qu'il recherche obstinément, en évoquant avec force détail et une indissimulable jouissance les humiliations qu'il a subies ou infligées, l'auteur «imaginaire» de ces Carnets pourrait à mon sens incarner aussi à merveille le drame de la conscience moderne.
Un Antoine Roquentin avant la lettre ? S'il avoue comme le célèbre personnage sartrien éprouver de la «nausée» face à l'existence, je dirais (en risquant d'être à contre-courant de tous ceux qui s'empressent de cataloguer Dostoïevski comme un précurseur de « l'existentialisme » - tant pis, j'y vais «bavard et contrariant comme un autre» !! ) que même si à la base un même constat serait fait par les deux personnages, l'auteur des Carnets se situerait néanmoins tout à fait l'opposé du (anti)héros sartrien: à la «nausée», le premier s'est parfaitement habitué et a accepté volontairement de la supporter. «Toute forme de conscience est une maladie », nous dit-il, et « un homme d'action (au secours Sartre!!), une créature essentiellement limitée ».
Roman philosophique sur les limites du cogito («Je m'exerce à penser ; par conséquent, chez moi, toute cause première en fait surgir une autre, plus première encore, et ainsi de suite à l'infini. Telle est l'essence de toute conscience et de toute pensée »), sur les systèmes fermés d'idées finissant par engendrer «des espèces d'hommes globaux fantasmatiques» , et sur la quête d'un sens à donner à la vie, à laquelle aucune idéologie utopiste ne saurait apporter de réponse satisfaisante sans préempter au passage la liberté essentielle à l'homme, ces Carnets ne font pourtant retentir, à aucun moment me semble-t-il, de notes nihilistes.
Sceptique ? Oui. Pessimiste ? Oui. Mais pas nihiliste pour un sou !! Accroché au désir tout aussi « paradoxal » de pouvoir effleurer le coeur battant de la vie, de revenir à ce que Dostoïevski appellerait la «véritable vie vivante», ou encore d'inventer un moyen possible d'éviter à l'homme «de naître d'une idée», ce qui extraordinaire chez lui - au-delà de la cruelle lucidité avec laquelle il expose à notre vue les sombres sous-sols de l'âme humaine-, c'est cette sorte de mystique profane, complexe, pas évidente à circonscrire par le seul «bavardage qui agite les bras pour faire du vent», naturelle, ou en tout cas hors tout support purement rationnel, et à laquelle en fin de compte on ne peut accéder la plupart du temps qu'après un séjour plus ou moins long dans le désert…
C'est ainsi également que, tout en nous informant à la fin des Carnets que l'homme souterrain n'ayant plus eu envie de continuer à «écrire du fond de son sous-sol », il avait abandonné en l'état leur rédaction, inachevée, l'écrivain rajoute que ce n'est pourtant pas là que tout s'était terminé. «C'était plus fort que lui, il a continué.»
Le livre brosse le portrait, à la première personne, d'un personnage détestable sous de multiples aspects:
- un homme qui vit seul, cradement, dans son "sous-sol".
- un homme qui, lorsqu'il sort dudit sous-sol, se complaît dans une antipathie qu'il provoque et entretient.
- un homme geignard, qui trouve en lui-même mille motifs de détestation (avec un motif de plainte privilégié: son intelligence = son fardeau).
- un homme retors, qui dira une chose puis son contraire et laissera au lecteur le soin de démêler le vrai du faux (ex: "Mais oui je plaisante, Messieurs..." P.46).
Justement, quant à ce dernier point. On voit peu dans l'esprit du narrateur de ces rassurantes séparations vrai/faux. Il est d'abord pétri de paradoxes. Il pense une chose et son contraire, successivement, voire simultanément. Il ne cesse de remettre en cause la position qu'il vient d'avancer - et son flot de paroles est à la mesure de son incertitude fondamentale.
Son rapport à lui-même est particulièrement ambivalent. Par exemple il s'adore et il se déteste. Il s'adore parce qu'il se déteste (->il est singulier), il se déteste parce qu'il s'adore (->péché d'orgueil). L'intelligence ne lui amène pas la clarté en démêlant les fils, elle en rajoute à l'écheveau.
Quant à cette question de l'intelligence, j'avais senti en lisant Les Frères Karamazov une forte défiance de Dostoïevski pour l'intelligence athée, matérialiste, torturée d'Ivan Karamazov, en comparaison de la sagesse apaisée d'Aliocha (-> celui qui ne calcule pas, fonde sa confiance et sa connaissance sur sa foi). L'oeil lucide VS l'oeil bon.
De manière très nette, le narrateur tient son intelligence pour pernicieuse. À tel point qu'il se préférerait "insecte", car: "avoir une conscience trop développée, c'est une maladie, une maladie dans le plein sens du terme" (P.15). Une maladie à plusieurs niveaux:
- Maladie comportementale: l'intelligence bloque l'action par le regard critique porté sur elle. La conscience accrue entraîne l'inertie.
- Maladie sociale: elle marginalise en induisant un regard négatif, dépréciateur sur l'entourage.
- Maladie morale: elle provoque un vil plaisir d'autosatisfaction.
Le narrateur apparaît en effet méprisant, hautain, rempli du sentiment de sa supériorité intellectuelle. Il jouit de se faire détester pour de "bonnes raisons". Avoir raison et seul contre tous, quitte à casser l'ambiance à table en opposant aux rires imbéciles des vérités crasses, voilà bien un motif de réjouissance.
Voir le plaisir que le narrateur éprouve à se sentir centre de l'attention, lors de ses rares apparitions au soleil. À table avec ses camarades, il se réjouit des impressions désastreuses que son comportement suscite. La majeure partie du temps, il se morfond dans son trou. Lorsqu'il en sort, c'est pour faire valoir, par la provocation et la méchanceté, son ego esseulé en manque de reconnaissance.
Ci-dessous une analyse entendue chez Gilles Deleuze, dont j'ai retrouvé dans le livre une illustration directe.
Deleuze: "Chez Dostoïevski, les personnages sont perpétuellement pris dans des urgences, et en même temps qu'ils sont pris dans des urgences, qui sont des questions de vie ou de mort, ils savent qu'il y a une question encore plus urgente, et ils ne savent pas laquelle. Et c'est ça qui les arrête."
(Conférence "Qu'est-ce que l'acte de création?", 16:30: https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw)
P.34: "[...] est-ce qu'il n'existe pas un intérêt qui est le plus intéressant [...], un intérêt primordial, plus intéressant que tous les autres intérêts et au nom duquel, si cela s'avère nécessaire, les hommes sont prêts à braver toutes les lois - parfaitement, à se dresser contre le bon sens, l'honneur, le calme, le bien-être - bref, à se dresser contre tout ce qui est utile et beau, dans le seul but d'atteindre cet intérêt premier, cet intérêt le plus intéressant et qui leur est plus cher que tout?"
Parmi d'autres questions soulevées:
- n'y a-t-il pas quelque part plus de plaisir dans la souffrance que dans le bien-être? Ou, quelle serait cette souffrance, quel serait ce bien-être?
- n'y a-t-il pas plus de plaisir à espérer dans la démarche que dans l'accomplissement? etc.
Une proposition, posée frontalement par Dostoïevski: l'homme (supérieur?) souhaite avant tout disposer de sa volonté en toute indépendance. Une pleine liberté, voilà le souverain bien! Être libre, si l'envie lui venait, de se rouler éventuellement dans la fange.
Une conséquence directe: cet homme est ingrat. Si on le comble de bienfaits, il préfère qu'on l'en dispense, pour n'être l'obligé de personne.
Cet homme marginal cherche son plaisir dans la liberté dont il dispose, mais ne trouve à la fin qu'un plaisir sale, source de culpabilité. En ce sens, sa liberté est un poison, mais lui reste mille fois préférable à toutes formes de contraintes. La souffrance libre peut encore être source de plaisir, à la différence de la souffrance contrainte. La liberté lui serait la dernière chose encore désirable à la fin.
Mais qu'en est-il, si cette liberté ne sait être correctement gérée par l'esprit humain? A voir les tourments du narrateur, combien son "droit à exécrer en paix" est une impasse, on ressent toute l'ambiguïté du propos de Dostoïevski. le dialogue interne des voix, tel qu'il se constitue dans cet esprit torturé, ne trouve nul compromis, uniquement des clivages irrémédiables, et l'emprise dominatrice des affects. le retranchement du corps social n'est pas pour lui la liberté intérieure. A moins d'une révolution intérieure (spirituelle, christique?), sa pensée bouillonnante n'a aucune chance de connaître la paix.
D'où la quasi-irrésolution du récit, à l'image de ses nombreuses problématiques, difficilement solubles dans la complexité humaine. Dostoïevski pousse les paradoxes à un haut point d'incandescence, en tant que chez certains, ils sont à la fois obligés et sources de conflits intérieurs insoutenables. Par son narrateur des sous-sols, l'inénarrable en l'homme a trouvé un visage éventuel, un possible support de compréhension.
Voilà, en résumé, quelques commentaires sur un livre qui demanderait des pages et des pages de traitement. Mais comme le dit le rapporteur des Carnets, "c'est ici que l'on peut s'arrêter".
NB: le sous-sol n'est jamais décrit que par des qualificatifs sensoriels, olfactifs, il est "sale", il empeste, etc., tel un souterrain nauséabond dont on ne saurait (grammaticalement) distinguer les murs. le narrateur rampe laborieusement dans les ténèbres de son esprit, comme emprisonné sous le plancher des vaches.
- un homme qui vit seul, cradement, dans son "sous-sol".
- un homme qui, lorsqu'il sort dudit sous-sol, se complaît dans une antipathie qu'il provoque et entretient.
- un homme geignard, qui trouve en lui-même mille motifs de détestation (avec un motif de plainte privilégié: son intelligence = son fardeau).
- un homme retors, qui dira une chose puis son contraire et laissera au lecteur le soin de démêler le vrai du faux (ex: "Mais oui je plaisante, Messieurs..." P.46).
Justement, quant à ce dernier point. On voit peu dans l'esprit du narrateur de ces rassurantes séparations vrai/faux. Il est d'abord pétri de paradoxes. Il pense une chose et son contraire, successivement, voire simultanément. Il ne cesse de remettre en cause la position qu'il vient d'avancer - et son flot de paroles est à la mesure de son incertitude fondamentale.
Son rapport à lui-même est particulièrement ambivalent. Par exemple il s'adore et il se déteste. Il s'adore parce qu'il se déteste (->il est singulier), il se déteste parce qu'il s'adore (->péché d'orgueil). L'intelligence ne lui amène pas la clarté en démêlant les fils, elle en rajoute à l'écheveau.
Quant à cette question de l'intelligence, j'avais senti en lisant Les Frères Karamazov une forte défiance de Dostoïevski pour l'intelligence athée, matérialiste, torturée d'Ivan Karamazov, en comparaison de la sagesse apaisée d'Aliocha (-> celui qui ne calcule pas, fonde sa confiance et sa connaissance sur sa foi). L'oeil lucide VS l'oeil bon.
De manière très nette, le narrateur tient son intelligence pour pernicieuse. À tel point qu'il se préférerait "insecte", car: "avoir une conscience trop développée, c'est une maladie, une maladie dans le plein sens du terme" (P.15). Une maladie à plusieurs niveaux:
- Maladie comportementale: l'intelligence bloque l'action par le regard critique porté sur elle. La conscience accrue entraîne l'inertie.
- Maladie sociale: elle marginalise en induisant un regard négatif, dépréciateur sur l'entourage.
- Maladie morale: elle provoque un vil plaisir d'autosatisfaction.
Le narrateur apparaît en effet méprisant, hautain, rempli du sentiment de sa supériorité intellectuelle. Il jouit de se faire détester pour de "bonnes raisons". Avoir raison et seul contre tous, quitte à casser l'ambiance à table en opposant aux rires imbéciles des vérités crasses, voilà bien un motif de réjouissance.
Voir le plaisir que le narrateur éprouve à se sentir centre de l'attention, lors de ses rares apparitions au soleil. À table avec ses camarades, il se réjouit des impressions désastreuses que son comportement suscite. La majeure partie du temps, il se morfond dans son trou. Lorsqu'il en sort, c'est pour faire valoir, par la provocation et la méchanceté, son ego esseulé en manque de reconnaissance.
Ci-dessous une analyse entendue chez Gilles Deleuze, dont j'ai retrouvé dans le livre une illustration directe.
Deleuze: "Chez Dostoïevski, les personnages sont perpétuellement pris dans des urgences, et en même temps qu'ils sont pris dans des urgences, qui sont des questions de vie ou de mort, ils savent qu'il y a une question encore plus urgente, et ils ne savent pas laquelle. Et c'est ça qui les arrête."
(Conférence "Qu'est-ce que l'acte de création?", 16:30: https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw)
P.34: "[...] est-ce qu'il n'existe pas un intérêt qui est le plus intéressant [...], un intérêt primordial, plus intéressant que tous les autres intérêts et au nom duquel, si cela s'avère nécessaire, les hommes sont prêts à braver toutes les lois - parfaitement, à se dresser contre le bon sens, l'honneur, le calme, le bien-être - bref, à se dresser contre tout ce qui est utile et beau, dans le seul but d'atteindre cet intérêt premier, cet intérêt le plus intéressant et qui leur est plus cher que tout?"
Parmi d'autres questions soulevées:
- n'y a-t-il pas quelque part plus de plaisir dans la souffrance que dans le bien-être? Ou, quelle serait cette souffrance, quel serait ce bien-être?
- n'y a-t-il pas plus de plaisir à espérer dans la démarche que dans l'accomplissement? etc.
Une proposition, posée frontalement par Dostoïevski: l'homme (supérieur?) souhaite avant tout disposer de sa volonté en toute indépendance. Une pleine liberté, voilà le souverain bien! Être libre, si l'envie lui venait, de se rouler éventuellement dans la fange.
Une conséquence directe: cet homme est ingrat. Si on le comble de bienfaits, il préfère qu'on l'en dispense, pour n'être l'obligé de personne.
Cet homme marginal cherche son plaisir dans la liberté dont il dispose, mais ne trouve à la fin qu'un plaisir sale, source de culpabilité. En ce sens, sa liberté est un poison, mais lui reste mille fois préférable à toutes formes de contraintes. La souffrance libre peut encore être source de plaisir, à la différence de la souffrance contrainte. La liberté lui serait la dernière chose encore désirable à la fin.
Mais qu'en est-il, si cette liberté ne sait être correctement gérée par l'esprit humain? A voir les tourments du narrateur, combien son "droit à exécrer en paix" est une impasse, on ressent toute l'ambiguïté du propos de Dostoïevski. le dialogue interne des voix, tel qu'il se constitue dans cet esprit torturé, ne trouve nul compromis, uniquement des clivages irrémédiables, et l'emprise dominatrice des affects. le retranchement du corps social n'est pas pour lui la liberté intérieure. A moins d'une révolution intérieure (spirituelle, christique?), sa pensée bouillonnante n'a aucune chance de connaître la paix.
D'où la quasi-irrésolution du récit, à l'image de ses nombreuses problématiques, difficilement solubles dans la complexité humaine. Dostoïevski pousse les paradoxes à un haut point d'incandescence, en tant que chez certains, ils sont à la fois obligés et sources de conflits intérieurs insoutenables. Par son narrateur des sous-sols, l'inénarrable en l'homme a trouvé un visage éventuel, un possible support de compréhension.
Voilà, en résumé, quelques commentaires sur un livre qui demanderait des pages et des pages de traitement. Mais comme le dit le rapporteur des Carnets, "c'est ici que l'on peut s'arrêter".
NB: le sous-sol n'est jamais décrit que par des qualificatifs sensoriels, olfactifs, il est "sale", il empeste, etc., tel un souterrain nauséabond dont on ne saurait (grammaticalement) distinguer les murs. le narrateur rampe laborieusement dans les ténèbres de son esprit, comme emprisonné sous le plancher des vaches.
Les contradictions internes, les angoisses et les obsessions rythment l'oeuvre, format court, de Fiodor Dostoïevski dans Les carnets du sous-sol.
C'est écrit sous forme d'un monologue intérieur pour plonger dans l'esprit du narrateur, tourmenté et aliéné.
Il se présente comme un anti-héros, rejetant les normes sociales et se complaisant dans son propre malheur.
Le récit est divisé en deux parties : dans la première, le narrateur relate ses pensées et ses sentiments sur sa propre existence, son ressentiment envers la société et sa méfiance envers la raison. Dans la deuxième partie, il raconte une rencontre qu'il a eue avec d'anciens camarades de classe et exprime sa frustration et sa colère face à cette interaction sociale.
Les carnets de sous-sol font partie de ces livres qui dénoncent la société et de la rationalité moderne et qui ont influencé, ici, de nombreux philosophes et écrivains existentialistes. L'auteur donne à ces carnets une profondeur psychologique, et son style d'écriture puissant, une capacité à révéler les méandres sombres et tourmentés de l'âme humaine.
Le roman aborde des thèmes existentiels tels que l'aliénation, l'isolement, le libre arbitre, la nature humaine, et le sens de la vie.
Le narrateur se complait toutefois dans son propre malheur.
Il faut donc apprécier, mais avec le recul nécessaire, les émotions négatives que sa lecture suscite, et le pessimisme inhérent à de tels thèmes.
C'est sombre.
Mais captivant.
.
C'est écrit sous forme d'un monologue intérieur pour plonger dans l'esprit du narrateur, tourmenté et aliéné.
Il se présente comme un anti-héros, rejetant les normes sociales et se complaisant dans son propre malheur.
Le récit est divisé en deux parties : dans la première, le narrateur relate ses pensées et ses sentiments sur sa propre existence, son ressentiment envers la société et sa méfiance envers la raison. Dans la deuxième partie, il raconte une rencontre qu'il a eue avec d'anciens camarades de classe et exprime sa frustration et sa colère face à cette interaction sociale.
Les carnets de sous-sol font partie de ces livres qui dénoncent la société et de la rationalité moderne et qui ont influencé, ici, de nombreux philosophes et écrivains existentialistes. L'auteur donne à ces carnets une profondeur psychologique, et son style d'écriture puissant, une capacité à révéler les méandres sombres et tourmentés de l'âme humaine.
Le roman aborde des thèmes existentiels tels que l'aliénation, l'isolement, le libre arbitre, la nature humaine, et le sens de la vie.
Le narrateur se complait toutefois dans son propre malheur.
Il faut donc apprécier, mais avec le recul nécessaire, les émotions négatives que sa lecture suscite, et le pessimisme inhérent à de tels thèmes.
C'est sombre.
Mais captivant.
.
Un homme solitaire et isolé écrit ses pensées et ses souvenirs. Dans un premier temps, il expose des raisonnements philosophiques qui m'ont émerveillé par leur portée et leur pertinence. Il disserte notamment sur le libre arbitre, sujet encore loin d'être élucidé de nos jours. Ensuite, il raconte des épisodes pénibles de sa vie, avec toute la force de cette écriture viscérale que l'on connaît au véritable auteur de ce texte. Son personnage perçoit tout le pathétique de ses actions mais ne peut agir autrement. Ce trait de caractère magnifié à l'extrême chez lui illustre bien, je trouve, ce que plusieurs doivent vivre à des degrés moindres. On le voit, c'est un être tourmenté qui a écrit ces lignes. Il rappelle le personnage du ''Rêve d'un homme ridicule'', mais le présent livre est venu me chercher davantage.
Le premier grand écrit de dostoievski qui rompt avec ses anciennes amours. Dostoieski a certe ouvert la porte à des grands écrivains, à des grands philosophes. Ce livre se lit comme un traité philosophique où D. par le biais de l'homme du sousol critique les idéologies (l'homme de nature de rousseau, le beau/sublime de schiller et kant, le déterminisme ) le seul écrit de D. où l'espoir s'est enfui, la prostitué aurait bien pu jouer le role de redemptrice comme lisa pour Raskolnikov... pourtant il n'en est rien... il y a un moment pour croire et d'autres...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Fiodor Dostoïevski (139)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Crime et Châtiment
Qui est le meurtrier ?
Raskolnikov
Raspoutine
Raton-Laveur
Razoumikhine
9 questions
194 lecteurs ont répondu
Thème : Crime et Châtiment de
Fiodor DostoïevskiCréer un quiz sur ce livre194 lecteurs ont répondu