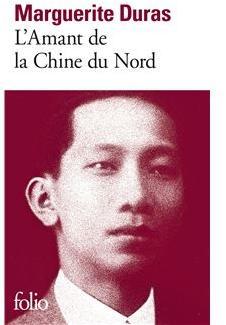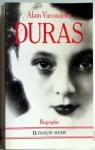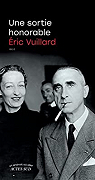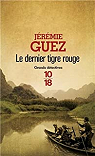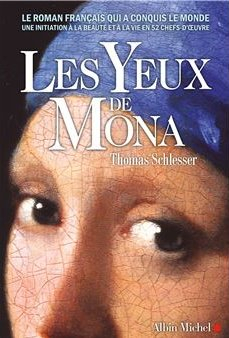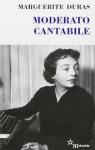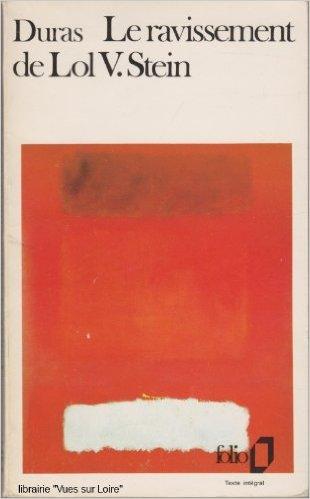Marguerite Duras/5
702 notes
Résumé :
Marguerite Duras
L'Amant de la Chine du Nord.
" J'ai appris qu'il était mort depuis des années. C'était en mai 90 (...). Je n'avais jamais pensé à sa mort. On m'a dit aussi qu'il était enterré à Sadec, que la maison bleue était toujours là, habitée par sa famille et des enfants. Qu'il avait été aimé à Sadec pour sa bonté, sa simplicité et qu'aussi il était devenu très religieux à la fin de sa vie. J'ai abandonné le travail que j'étais en train de faire... >Voir plus
L'Amant de la Chine du Nord.
" J'ai appris qu'il était mort depuis des années. C'était en mai 90 (...). Je n'avais jamais pensé à sa mort. On m'a dit aussi qu'il était enterré à Sadec, que la maison bleue était toujours là, habitée par sa famille et des enfants. Qu'il avait été aimé à Sadec pour sa bonté, sa simplicité et qu'aussi il était devenu très religieux à la fin de sa vie. J'ai abandonné le travail que j'étais en train de faire... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'Amant de la Chine du NordVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (64)
Voir plus
Ajouter une critique
Marguerite Duras a l'écriture courante, « pressée d'attraper les choses » car quand on écrit, on oublie, disait-elle. Et c'est vrai. On atterrit pas avec ce livre. Jamais on se plonge. C'est ça qui rend magnétique, hypnotique son écriture. Elle écrit comme elle parle. Avec ce débit-là. On l'entend lire dans la tête.
Le style de Duras me fait penser aux propos de Roland Barthes dans le Plaisir du Texte. Il compare la littérature classique au roman moderne. Dans la littérature classique nous sommes distraits parfois, les descriptions, le décor prenant une place telle que nous avons une lecture pressée d'ôter les vêtements du texte pour arriver à la « satisfaction romanesque », alors que dans le roman moderne on ne peut pas faire l'économie de cette lecture totale du texte, autrement nous n'y trouvons pas le plaisir.
Chez Duras il n'y a que la moelle.
Les phrases sont courtes, se répètent, le propos tantôt est définitif (péremptoire pourraient dire quelques critiques), tantôt très incertain, comme la mémoire qui trahit son doute, qui réécrit sans cesse, qui invente pour combler les trous de gruyère des souvenirs d'Asie.
Le monologue intérieur, nous dit à nouveau Roland Barthes, est en dehors de la phrase, il est comme un bruit de fond dans un café, jamais il ne fera phrase, c'est ainsi pour Duras qui confessait : « des mots d'abord » et la phrase s'attache aux mots « comme elle le peut ».
Sa syntaxe même est impayable, plusieurs fois on se prend à relire une phrase : « ce n'est pas français » se dit-on.
Elle joue avec le sens, se contredit, fait sienne la langue, c'est en cela qu'elle est une (grande) écrivaine.
L'histoire de l'Amant de la Mandchourie est une réécriture « en cas de film » de l'Amant, prix Goncourt 7 ans plus tôt, en réaction à l'adaptation cinématographique que l'auteure jugea insatisfaisante.
C'est une oeuvre scénaristique autant que littéraire. Les descriptions sont sommaires et la place est toute faite à l'image et au dialogue. On sait plus bien si c'est le jour ou la nuit, s'il lui a dit cela ou si c'est elle qui l'a dit. Parce que peu importe. C'est ça qui importe. Il y a tout un jeu entre la certitude et l'incertitude qui déstabilise opportunément le lecteur.
« Je ne suis pas allée au Lycée aujourd'hui. Je préfère rester avec toi. Hier non plus je n'y suis pas allée. Je préfère rester avec toi pour parler ensemble. » Ça commence en Indochine française, avec l'enfant au chapeau d'homme, le bac sur le Mékong, la Léon Bollée avec chauffeur.
C'est une oeuvre initiatique, la première fois. Elle rit de ça ; de ce scandale-là. Ce rire est comme un exutoire, un anticyclone, après la mousson des pleurs et des piastres et avant un autre scandale, familial. Duras aborde son entrée dans l'adolescence sous l'empire des sens.
C'était les corps communicants. Les « mains miraculeuses » du chinois. Hélène Lagonelle. Les frères. Sadec. La garçonnière. Ce sera la jouissance. Pas d'hédonisme joyeux. Une jouissance qui nait sur un sol moite et infertile, un cri dans la nuit. Duras raconte « le désespoir du bonheur de la chair. »
Le style de Duras me fait penser aux propos de Roland Barthes dans le Plaisir du Texte. Il compare la littérature classique au roman moderne. Dans la littérature classique nous sommes distraits parfois, les descriptions, le décor prenant une place telle que nous avons une lecture pressée d'ôter les vêtements du texte pour arriver à la « satisfaction romanesque », alors que dans le roman moderne on ne peut pas faire l'économie de cette lecture totale du texte, autrement nous n'y trouvons pas le plaisir.
Chez Duras il n'y a que la moelle.
Les phrases sont courtes, se répètent, le propos tantôt est définitif (péremptoire pourraient dire quelques critiques), tantôt très incertain, comme la mémoire qui trahit son doute, qui réécrit sans cesse, qui invente pour combler les trous de gruyère des souvenirs d'Asie.
Le monologue intérieur, nous dit à nouveau Roland Barthes, est en dehors de la phrase, il est comme un bruit de fond dans un café, jamais il ne fera phrase, c'est ainsi pour Duras qui confessait : « des mots d'abord » et la phrase s'attache aux mots « comme elle le peut ».
Sa syntaxe même est impayable, plusieurs fois on se prend à relire une phrase : « ce n'est pas français » se dit-on.
Elle joue avec le sens, se contredit, fait sienne la langue, c'est en cela qu'elle est une (grande) écrivaine.
L'histoire de l'Amant de la Mandchourie est une réécriture « en cas de film » de l'Amant, prix Goncourt 7 ans plus tôt, en réaction à l'adaptation cinématographique que l'auteure jugea insatisfaisante.
C'est une oeuvre scénaristique autant que littéraire. Les descriptions sont sommaires et la place est toute faite à l'image et au dialogue. On sait plus bien si c'est le jour ou la nuit, s'il lui a dit cela ou si c'est elle qui l'a dit. Parce que peu importe. C'est ça qui importe. Il y a tout un jeu entre la certitude et l'incertitude qui déstabilise opportunément le lecteur.
« Je ne suis pas allée au Lycée aujourd'hui. Je préfère rester avec toi. Hier non plus je n'y suis pas allée. Je préfère rester avec toi pour parler ensemble. » Ça commence en Indochine française, avec l'enfant au chapeau d'homme, le bac sur le Mékong, la Léon Bollée avec chauffeur.
C'est une oeuvre initiatique, la première fois. Elle rit de ça ; de ce scandale-là. Ce rire est comme un exutoire, un anticyclone, après la mousson des pleurs et des piastres et avant un autre scandale, familial. Duras aborde son entrée dans l'adolescence sous l'empire des sens.
C'était les corps communicants. Les « mains miraculeuses » du chinois. Hélène Lagonelle. Les frères. Sadec. La garçonnière. Ce sera la jouissance. Pas d'hédonisme joyeux. Une jouissance qui nait sur un sol moite et infertile, un cri dans la nuit. Duras raconte « le désespoir du bonheur de la chair. »
Ahhh, la Léon Bollée !
1930. Une gamine de 15 ans, sur le bac du Mékong, tombe amoureuse d'un Chinois de Mandchourie assis à l'arrière d'une Léon Bollée.
.
Dans un style très fluide, très plaisant, très émouvant, à la fois plein de douceur, mais aussi de larmes et de cris, Marguerite Duras raconte la "drague" ( terme tellement mal choisi, inconvenant, vulgaire ), puis l'amour entre un riche Chinois de 27 ans et une très jeune fille de 15 ans.
-- Et si la police nous trouvait ?
-- Je serais arrêté deux ou trois nuits peut être. Mon père paierait, ce ne serait pas grave.
;
Ce Chinois a marqué l'auteure, c'est l'amour de sa vie, et pour lui aussi, mais à la fin du livre, ils se rendent compte que cette passion est impossible, ils pleurent.
Marguerite, marquée, fera deux romans sur lui, à la fin de sa vie :
L'amant en 1984 ;
L'amant de la Chine du nord en 1991.
1930. Une gamine de 15 ans, sur le bac du Mékong, tombe amoureuse d'un Chinois de Mandchourie assis à l'arrière d'une Léon Bollée.
.
Dans un style très fluide, très plaisant, très émouvant, à la fois plein de douceur, mais aussi de larmes et de cris, Marguerite Duras raconte la "drague" ( terme tellement mal choisi, inconvenant, vulgaire ), puis l'amour entre un riche Chinois de 27 ans et une très jeune fille de 15 ans.
-- Et si la police nous trouvait ?
-- Je serais arrêté deux ou trois nuits peut être. Mon père paierait, ce ne serait pas grave.
;
Ce Chinois a marqué l'auteure, c'est l'amour de sa vie, et pour lui aussi, mais à la fin du livre, ils se rendent compte que cette passion est impossible, ils pleurent.
Marguerite, marquée, fera deux romans sur lui, à la fin de sa vie :
L'amant en 1984 ;
L'amant de la Chine du nord en 1991.
Bien qu'il faille se garder de chercher dans la vie d'une écrivaine, ou d'un écrivain, la source de son oeuvre romanesque (Proust l'écrit si bien dans son Contre Sainte-Beuve), il est parfois utile de comprendre les circonstances de son écriture.
C'est le cas, me semble-t-il, ici. Marguerite Duras, après avoir connu, en 1984, avec l'Amant, le succès, la reconnaissance, certes tardive, par le Prix Goncourt, n'a pas pu suivre, en raison d'une maladie grave, l'adaptation cinématographique du livre faite par Jean-Jacques Annaud. Elle n'appréciera pas celle-ci (il est vrai qu'Annaud n'est pas un cinéaste connu pour sa finesse psychologique), et réécrira fiévreusement l'histoire en 1991 (poussée aussi par la nouvelle de la mort de son amant chinois en 1990), dans un style propre à une adaptation cinématographique, avec des notes en ce sens et même à la fin du livre, une trame pour un scénario.
J'ai lu L'Amant il y a longtemps et je ne peux pas, il faudrait que je le relise, comparer en toute objectivité ce dernier avec L'Amant de la Chine du Nord.
Celui-ci m'est apparu comme une remémoration bouleversante d'une première passion, dans sa crudité et aussi son ambiguïté, j'y reviendrai.
Duras, avec une écriture simple, une abondance de dialogues et de détails, m'a donné l'impression de vouloir revivre ce moment unique de son existence, pour que tout ne soit pas perdu, de nous faire ressentir le coup de foudre entre cette adolescente de 15 ans et ce chinois de 27 ans, le déchirement du jeune chinois contraint aux règles de sa société, de sa famille très riche qui a d'avance programmé avec qui et quand il va se marier.
L'éveil de la sensualité débordante de « l'enfant » ( c'est ainsi que se nomme Marguerite Duras), qui s'exprime surtout avec son amant si délicat et sensible, mais aussi avec son amie Hélène, le serviteur Thanh, et même son frère Paulo, est décrit par ces petites touches si spécifiques du style durassien, mais avec tant de sincérité parfois crue qui peut déconcerter, Duras ne juge pas.
Et puis il y a cette famille, la mère désemparée devant ces enfants, surtout l'ainé, Pierre, violent et opiomane, qu'elle se résout à éloigner de son autre fils Paul dit Paulo, la mère ruinée par l'escroquerie de l'achat de terres incultivables, mais qui lutte avec énergie. La mère qui voudrait que sa fille épouse un homme riche pour soulager la charge de sa famille, et Duras nous laisse dans l'incertitude de savoir si la liaison de « l'enfant » avec le jeune Chinois très riche, n'est pas, au départ, intéressée. Cette ambiguïté des sentiments touche d'ailleurs beaucoup de protagonistes de l'histoire, le chinois, la mère.
C'est un récit magique, très visuel, centré sur les personnages, leurs sentiments, dans une atmosphère de chaleur et de mousson, mais peu de description des lieux.
Ce sont l'éveil des sens et la passion, avec ses rires et ses pleurs, qui l'animent de bout en bout, et c'est magnifique.
.
C'est le cas, me semble-t-il, ici. Marguerite Duras, après avoir connu, en 1984, avec l'Amant, le succès, la reconnaissance, certes tardive, par le Prix Goncourt, n'a pas pu suivre, en raison d'une maladie grave, l'adaptation cinématographique du livre faite par Jean-Jacques Annaud. Elle n'appréciera pas celle-ci (il est vrai qu'Annaud n'est pas un cinéaste connu pour sa finesse psychologique), et réécrira fiévreusement l'histoire en 1991 (poussée aussi par la nouvelle de la mort de son amant chinois en 1990), dans un style propre à une adaptation cinématographique, avec des notes en ce sens et même à la fin du livre, une trame pour un scénario.
J'ai lu L'Amant il y a longtemps et je ne peux pas, il faudrait que je le relise, comparer en toute objectivité ce dernier avec L'Amant de la Chine du Nord.
Celui-ci m'est apparu comme une remémoration bouleversante d'une première passion, dans sa crudité et aussi son ambiguïté, j'y reviendrai.
Duras, avec une écriture simple, une abondance de dialogues et de détails, m'a donné l'impression de vouloir revivre ce moment unique de son existence, pour que tout ne soit pas perdu, de nous faire ressentir le coup de foudre entre cette adolescente de 15 ans et ce chinois de 27 ans, le déchirement du jeune chinois contraint aux règles de sa société, de sa famille très riche qui a d'avance programmé avec qui et quand il va se marier.
L'éveil de la sensualité débordante de « l'enfant » ( c'est ainsi que se nomme Marguerite Duras), qui s'exprime surtout avec son amant si délicat et sensible, mais aussi avec son amie Hélène, le serviteur Thanh, et même son frère Paulo, est décrit par ces petites touches si spécifiques du style durassien, mais avec tant de sincérité parfois crue qui peut déconcerter, Duras ne juge pas.
Et puis il y a cette famille, la mère désemparée devant ces enfants, surtout l'ainé, Pierre, violent et opiomane, qu'elle se résout à éloigner de son autre fils Paul dit Paulo, la mère ruinée par l'escroquerie de l'achat de terres incultivables, mais qui lutte avec énergie. La mère qui voudrait que sa fille épouse un homme riche pour soulager la charge de sa famille, et Duras nous laisse dans l'incertitude de savoir si la liaison de « l'enfant » avec le jeune Chinois très riche, n'est pas, au départ, intéressée. Cette ambiguïté des sentiments touche d'ailleurs beaucoup de protagonistes de l'histoire, le chinois, la mère.
C'est un récit magique, très visuel, centré sur les personnages, leurs sentiments, dans une atmosphère de chaleur et de mousson, mais peu de description des lieux.
Ce sont l'éveil des sens et la passion, avec ses rires et ses pleurs, qui l'animent de bout en bout, et c'est magnifique.
.
A tous ceux qui ont aimés « un barrage contre le Pacifique » ( 1950) et « l'Amant » (1984), je n'ai qu'un mot à dire LISEZ ce dernier opus paru en 1991, cinq ans avant le décès de son auteure.
Quel livre émouvant, le plus beau pour moi, épuré, allant à l'essentiel de cet amour qui a marqué à jamais Marguerite Duras. Quelle émotion de la lire, celle qui au soeuil de sa vie nous livre sa vision presque cinématographique , faisant référence au fait que l'enfant sait déjà qu'elle écrira cette histoire, car « même après la mort, il y aura des livres pour raconter, car ce n'est pas possible autrement ».
On sent dans ce denier ouvrage, la réconciliation avec la mère, si éprouvée, ruinée par les gens du cadastre, qui lui ont vendus un terrain entre « montagne et mer » qui sera sa perte. L'enfant comprend tout d'elle, son combat perdu et la souffrance d'avoir entraîné ses enfants dans ce désastre. On ressent l'amour trouble pour le petit frère, pour Thanh et Hélène Lagonelle son amie de la pension Lyautey. On revoit les lieux, la maison de la mère, le lycée à Saigon, la garçonnière de l'amant chinois et sa Léon Bollée noire.
Et surtout on est pris d'émotion par cette écriture épurée, qui va à l'essentiel , pour nous décrire, ce lien si particulier et si fort entre le chinois et l'enfant.
« Ils se regardent, se regardent jusqu‘aux larmes. Et pour la première fois de sa vie elle dit les mots convenus pour le dire -les mots des livres, du cinéma, de la vie, de tous les amants.
-Je vous aime.
Le chinois se cache le visage, foudroyé par la souveraine banalité des mots dits par l‘enfant. Il dit que oui, que c‘est vrai. Il ferme les yeux. Il dit tout bas : je crois que c‘est ça qui nous sera arrivé.».
A emporter sur mon île déserte.
Quel livre émouvant, le plus beau pour moi, épuré, allant à l'essentiel de cet amour qui a marqué à jamais Marguerite Duras. Quelle émotion de la lire, celle qui au soeuil de sa vie nous livre sa vision presque cinématographique , faisant référence au fait que l'enfant sait déjà qu'elle écrira cette histoire, car « même après la mort, il y aura des livres pour raconter, car ce n'est pas possible autrement ».
On sent dans ce denier ouvrage, la réconciliation avec la mère, si éprouvée, ruinée par les gens du cadastre, qui lui ont vendus un terrain entre « montagne et mer » qui sera sa perte. L'enfant comprend tout d'elle, son combat perdu et la souffrance d'avoir entraîné ses enfants dans ce désastre. On ressent l'amour trouble pour le petit frère, pour Thanh et Hélène Lagonelle son amie de la pension Lyautey. On revoit les lieux, la maison de la mère, le lycée à Saigon, la garçonnière de l'amant chinois et sa Léon Bollée noire.
Et surtout on est pris d'émotion par cette écriture épurée, qui va à l'essentiel , pour nous décrire, ce lien si particulier et si fort entre le chinois et l'enfant.
« Ils se regardent, se regardent jusqu‘aux larmes. Et pour la première fois de sa vie elle dit les mots convenus pour le dire -les mots des livres, du cinéma, de la vie, de tous les amants.
-Je vous aime.
Le chinois se cache le visage, foudroyé par la souveraine banalité des mots dits par l‘enfant. Il dit que oui, que c‘est vrai. Il ferme les yeux. Il dit tout bas : je crois que c‘est ça qui nous sera arrivé.».
A emporter sur mon île déserte.
Pour ceux qui me connaissent un peu et qui ont pu notamment lu mes dernières critiques, ils savent que je suis très sensible aux affaires de sexe et pourtant, dans ce livre, il n'est pratiquement question que de ça mais cela est dit sans crudité, d'une manière tellement belle que l'on ne peut pas considérer que le sexe est l'unique centre d'intérêt de cet ouvrage. En effet, derrière cette façade, il y a beaucoup plus et le sentiment le plus puissant qui est exprimé avec brio ici est celui de l'Amour ; l'amour d'une jeune fille de quinze ans pour un jeune chinois, qui, lui en a 27 mais aussi l'amour de cette même jeune fille pour son petit frère Paulo.
L'histoire se déroule en 1930 dans le sud de l'Indochine où l'enfant (l'héroïne de ce roman qui n'est jamais nommée et est toujours désignée par cette appellation) vit avec sa mère, son frère aîné Pierre, son jeune frère Paulo et Than, un homme qui leur sert de chauffeur et que la mère a recueilli chez elle alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon.
C'est alors que l'enfant va faire la connaissance de ce chinois originaire de Mandchourie et qu'entre eux va se nouer une relation extrêmement forte bien que ce dernier ait déjà connu de nombreuses femmes dans sa vie, la preuve étant qu'il l'emmène régulièrement dans sa garçonnière. Cependant, étant le fils d'un homme extrêmement riche, il est, depuis plusieurs années déjà promis à une jeune chinoise qui est elle aussi issue d'une famille très aisée et en Chine à l'époque, il y avait certaines traditions que l'on ne pouvait pas briser.
Un roman construit sur des discours chaotiques, saccadées (c'est voulu et c'est d'ailleurs ce qui fait son charme), léger, agréable à lire et basé sur une valeur qui est pour moi la plus belle au monde, celle de l'Amour.
Je n'avais jamais lu cet ouvrage auparavant de peur d'être choquée par les descriptions d'inceste et autres mais je me rends compte à présent que j'avais totalement tord car il n'en n'est rien. A lire !
L'histoire se déroule en 1930 dans le sud de l'Indochine où l'enfant (l'héroïne de ce roman qui n'est jamais nommée et est toujours désignée par cette appellation) vit avec sa mère, son frère aîné Pierre, son jeune frère Paulo et Than, un homme qui leur sert de chauffeur et que la mère a recueilli chez elle alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon.
C'est alors que l'enfant va faire la connaissance de ce chinois originaire de Mandchourie et qu'entre eux va se nouer une relation extrêmement forte bien que ce dernier ait déjà connu de nombreuses femmes dans sa vie, la preuve étant qu'il l'emmène régulièrement dans sa garçonnière. Cependant, étant le fils d'un homme extrêmement riche, il est, depuis plusieurs années déjà promis à une jeune chinoise qui est elle aussi issue d'une famille très aisée et en Chine à l'époque, il y avait certaines traditions que l'on ne pouvait pas briser.
Un roman construit sur des discours chaotiques, saccadées (c'est voulu et c'est d'ailleurs ce qui fait son charme), léger, agréable à lire et basé sur une valeur qui est pour moi la plus belle au monde, celle de l'Amour.
Je n'avais jamais lu cet ouvrage auparavant de peur d'être choquée par les descriptions d'inceste et autres mais je me rends compte à présent que j'avais totalement tord car il n'en n'est rien. A lire !
Citations et extraits (102)
Voir plus
Ajouter une citation
Elle disait se souvenir de la peur. Comme elle se souvenait de la peau, de sa douceur. De celle-ci, à son tour, épouvantée.
Les yeux fermés elle touchait cette douceur, elle touchait la couleur dorée, la voix, le coeur qui avait peur, tout le corps retenu au-dessus du sien, prêt au meurtre de l'ignorance d'elle devenue son enfant. L'enfant de lui, l'homme de la Chine qui se tait et qui pleure et qui le fait dans un amour effrayant qui lui arrache des larmes.
La douleur arrive dans le corps de l'enfant. Elle est d'abord vive. Puis terrible. Puis contradictoire. Comme rien d'autre. Rien: c'est alors en effet que cette douleur devient intenable qu'elle commence à s'éloigner. Qu'elle change, qu'elle devient bonne à en gémir, à en crier, qu'elle prend tout le corps, la tête, toute la force du corps, de la tête, et celle de la pensée, terrassée.
La souffrance quitte le corps maigre, elle quitte la tête. Le corps reste ouvert sur le dehors. Il a été franchi, il saigne, il ne souffre plus. Ca ne s'appelle plus de la douleur, ça s'appelle peut-être mourir.
Et puis cette souffrance quitte le corps, quitte la tête, elle quitte insensiblement toute la surface du corps et se perd dans un bonheur encore inconnu d'aimer sans savoir.
Les yeux fermés elle touchait cette douceur, elle touchait la couleur dorée, la voix, le coeur qui avait peur, tout le corps retenu au-dessus du sien, prêt au meurtre de l'ignorance d'elle devenue son enfant. L'enfant de lui, l'homme de la Chine qui se tait et qui pleure et qui le fait dans un amour effrayant qui lui arrache des larmes.
La douleur arrive dans le corps de l'enfant. Elle est d'abord vive. Puis terrible. Puis contradictoire. Comme rien d'autre. Rien: c'est alors en effet que cette douleur devient intenable qu'elle commence à s'éloigner. Qu'elle change, qu'elle devient bonne à en gémir, à en crier, qu'elle prend tout le corps, la tête, toute la force du corps, de la tête, et celle de la pensée, terrassée.
La souffrance quitte le corps maigre, elle quitte la tête. Le corps reste ouvert sur le dehors. Il a été franchi, il saigne, il ne souffre plus. Ca ne s'appelle plus de la douleur, ça s'appelle peut-être mourir.
Et puis cette souffrance quitte le corps, quitte la tête, elle quitte insensiblement toute la surface du corps et se perd dans un bonheur encore inconnu d'aimer sans savoir.
Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit: je voulais seulement entendre votre voix. Elle avait dit: c'est moi, bonjour. Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres, il l'avait su par la mère qu'il avait revue à Saigon. Et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.
-- Mais il y a plus grave. Les mères d'élèves ont prévenu la directrice de Lyautey que vous ne rentriez pas tous les soirs à la pension -- légère colère du censeur -- comment l'ont-elles su ... mystère... Vous êtes cernée par le réseau policier des mères d'élèves -- il sourit -- de Saigon. Elles veulent que leurs filles restent entre elles. Elles disent -- tenez-vous bien -- "Pourquoi court-elle après le baccalauréat, cette petite grue ? Le Primaire c'est fait pour ces gens-là"...
NDL : ahem... Les mères d'élèves, elles parlent de Marguerite Duras... Oui, quand même !
NDL : ahem... Les mères d'élèves, elles parlent de Marguerite Duras... Oui, quand même !
"C'est drôle le bonheur, ça vient d'un seul coup, comme la colère."
La nuit est venue. C'est le même décor. La mère est encore là où était la "fête" de l'après-midi. Les lieux ont été remis en ordre. Les meubles sont à leur place.
La mère n'attend rien. Elle est au centre de son royaume : cette famille-là, ici entrevue.
La mère n'empêche plus rien. Elle n'empêchera plus rien.
Elle laissera se faire ce qui doit arriver.
Cela tout au long de l'histoire ici racontée.
C'est une mère découragée.
C'est le frère aîné qui regarde la mère. Il lui sourit. La mère ne le voit pas.
La mère n'attend rien. Elle est au centre de son royaume : cette famille-là, ici entrevue.
La mère n'empêche plus rien. Elle n'empêchera plus rien.
Elle laissera se faire ce qui doit arriver.
Cela tout au long de l'histoire ici racontée.
C'est une mère découragée.
C'est le frère aîné qui regarde la mère. Il lui sourit. La mère ne le voit pas.
Videos de Marguerite Duras (249)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

LA CHINE
elisabeth99
54 livres

Livre audio mon amour
Floccus
23 livres
Autres livres de Marguerite Duras (95)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Marguerite DURAS
Quel est le bon titre de sa bibliographie ?
L'Homme assis dans le corridor
L'Homme assis dans le couloir
L'Homme assis dans le boudoir
L'Homme assis dans le fumoir
20 questions
190 lecteurs ont répondu
Thème :
Marguerite DurasCréer un quiz sur ce livre190 lecteurs ont répondu