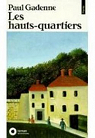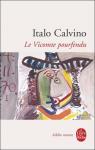Carlo Emilio Gadda
Louis Bonalumi (Traducteur)François Wahl (Éditeur scientifique)/5 37 notes
Dans une grande villa au Maradagàl, limitrophe du Parapagàl, deux États imaginaires situés quelque part en Amérique latine, non loin de la Cordillère des Andes, vit Gonzalo Pirobutirro d’Eltino, ingénieur neurasthénique qui nourrit des projets littéraires. Cet alter ego de l’auteur vit avec sa mère, dans une solitude rageuse et désespérée, exacerbée par la haine des petits-bourgeois et autres paysans pauvres et incultes qui l’entourent. La bienveillance et... >Voir plus
Louis Bonalumi (Traducteur)François Wahl (Éditeur scientifique)/5 37 notes
Résumé :
Dans une grande villa au Maradagàl, limitrophe du Parapagàl, deux États imaginaires situés quelque part en Amérique latine, non loin de la Cordillère des Andes, vit Gonzalo Pirobutirro d’Eltino, ingénieur neurasthénique qui nourrit des projets littéraires. Cet alter ego de l’auteur vit avec sa mère, dans une solitude rageuse et désespérée, exacerbée par la haine des petits-bourgeois et autres paysans pauvres et incultes qui l’entourent. La bienveillance et... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Connaissance de la douleurVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (6)
Voir plus
Ajouter une critique
C'est une lecture éprouvante que celle de la connaissance de la douleur. Comme la traversée d'un désert baroque que peuplent des mots dignes d'un trésor de la langue française et que hante une histoire de souffrance intime. Roman ou autofiction : le genre lui-même pose problème. Carlo Emilio Gadda l'a écrit à partir de 1938, peu de temps après la mort de sa mère. Son héros, Gonzalo Pirobutirro est une sorte de double littéraire de Gadda : perte du frère pendant la guerre, remords profond lié à cette mort, même origine sociale, et même environnement géographique, puisque le Maradagal décrit, Etat imaginaire sud-américain, rappelle fortement la Briance du nord de l'Italie.
Tandis que la première partie du roman s'attache à décrire le Maradagal et les us et coutumes qui y sont pratiquées, la deuxième et la troisième ressemblent davantage à un long portrait de cette figure torturée de Pirobutirro. Aristocrate désargenté, il vit avec sa mère et exècre absolument la tendance de cette dernière à mêler à sa vie les humbles, qui pourtant les soutiennent. Intellectuel que le bruit du monde effraie et repousse, Pirobutirro est l'un de ces héros littéraires que l'on imagine dégingandé, qui traversent le monde et le temps dans une furie dictée par les passions intérieures.
Le roman – adoptons une fois pour toutes ce terme – est truffé de références tantôt imaginaires, tantôt mythologiques et, surtout, issues de la littérature italienne des 18ème et 19ème siècles. Les notes de l'éditeur et celles de l'auteur sont donc bienvenues pour ne pas perdre le fil d'une lecture déjà rendue ardue par les trouvailles lexicales et les constructions syntaxiques complexes. L'effort intellectuel, toutefois, est récompensé par l'esprit cynique, mordant même, qui ponctue le texte. Cela ne suffit pas, cependant, à rendre de la vie au texte, qui s'englue dans des tournures qui laissent peu de répit au lecteur peu attentionné. le style, en un mot, l'emporte sur le fond, rendant, malheureusement, le roman peu accessible.
Tandis que la première partie du roman s'attache à décrire le Maradagal et les us et coutumes qui y sont pratiquées, la deuxième et la troisième ressemblent davantage à un long portrait de cette figure torturée de Pirobutirro. Aristocrate désargenté, il vit avec sa mère et exècre absolument la tendance de cette dernière à mêler à sa vie les humbles, qui pourtant les soutiennent. Intellectuel que le bruit du monde effraie et repousse, Pirobutirro est l'un de ces héros littéraires que l'on imagine dégingandé, qui traversent le monde et le temps dans une furie dictée par les passions intérieures.
Le roman – adoptons une fois pour toutes ce terme – est truffé de références tantôt imaginaires, tantôt mythologiques et, surtout, issues de la littérature italienne des 18ème et 19ème siècles. Les notes de l'éditeur et celles de l'auteur sont donc bienvenues pour ne pas perdre le fil d'une lecture déjà rendue ardue par les trouvailles lexicales et les constructions syntaxiques complexes. L'effort intellectuel, toutefois, est récompensé par l'esprit cynique, mordant même, qui ponctue le texte. Cela ne suffit pas, cependant, à rendre de la vie au texte, qui s'englue dans des tournures qui laissent peu de répit au lecteur peu attentionné. le style, en un mot, l'emporte sur le fond, rendant, malheureusement, le roman peu accessible.
Ce livre, je répugne presque à parler de roman, tant il est difficile à définir, est impossible à résumer. Les personnages se meuvent dans un pays imaginaire de l'Amérique du Sud, le Madragal. Au centre de la narration se trouve Gonzalo Pirobutirro d'Eltino,une sorte de Don Quichotte, mais sans l'idéalisme et la poésie de ce dernier. Il vit avec sa mère dans une villa, dans une sorte de misère décente, et semble d'après le propos général, sombrer progressivement dans la folie.
Le livre se contente en fait de brosser des portraits de personnages à différents moments, éventuellement à raconter des anecdotes isolées, difficile de parler d'une intrigue continue. Mais le livre est resté inachevé, même s'il semble qu'il ne manquait pas beaucoup de pages pour qu'il soit fini, et il se clôt sur un meurtre, qui reste du coup inexpliqué, même si une hypothèse vraisemblable traverse forcement l'esprit de tout lecteur.
Il semblerait que Gadda ait mis beaucoup de lui-même dans le personnage de Gonzalo: comme lui il est ingénieur, alors qu'il aurait préféré se consacrer à la philosophie, son frère aîné et préféré de sa mère est mort à la guerre, il y a aussi cette villa à laquelle la mère est très attachée, elle a consenti de gros sacrifices pour la garder, alors que le fils l'exècre. La relation mère fils est à mon sens le sujet principal du livre, une sorte de lien très pathogène, source de souffrances et d'égarements, bâtie dès le départ sur une totale incompréhension de l'autre, comme s'il s'agissait de deux représentants d'espèces différentes, vivants dans des mondes totalement coupés l'un de l'autre.
Mais au delà des thèmes abordés dans le livre, ce qui est le plus essentiel, le plus original, le plus fort, c'est l'écriture de Gadda. Une écriture baroque, on pourrait presque dire que cet adjectif n'a jamais été aussi justement employé que pour définir cette écriture-là, mais aussi grotesque et grinçante. Une écriture pétrie de culture et de références, littéraires, philosophiques, concernant aussi la mythologie étrusque, truffée de mots précieux et rares. Une sorte de poussée de lave impossible à arrêter, qui semble surgir et se répandre dans tous les sens.
Pour résumer, il s'agit d'une expérience de lecture forte, rappelant pour moi, les impressions que j'ai pu ressentir à lire Ulysse de Joyce, ou peut être encore plus L'homme sans qualités de Musil, mais une expérience exigeante, qui demande de l'attention et une très concentration, à l'opposé d'une distraction facile et agréable.
Le livre se contente en fait de brosser des portraits de personnages à différents moments, éventuellement à raconter des anecdotes isolées, difficile de parler d'une intrigue continue. Mais le livre est resté inachevé, même s'il semble qu'il ne manquait pas beaucoup de pages pour qu'il soit fini, et il se clôt sur un meurtre, qui reste du coup inexpliqué, même si une hypothèse vraisemblable traverse forcement l'esprit de tout lecteur.
Il semblerait que Gadda ait mis beaucoup de lui-même dans le personnage de Gonzalo: comme lui il est ingénieur, alors qu'il aurait préféré se consacrer à la philosophie, son frère aîné et préféré de sa mère est mort à la guerre, il y a aussi cette villa à laquelle la mère est très attachée, elle a consenti de gros sacrifices pour la garder, alors que le fils l'exècre. La relation mère fils est à mon sens le sujet principal du livre, une sorte de lien très pathogène, source de souffrances et d'égarements, bâtie dès le départ sur une totale incompréhension de l'autre, comme s'il s'agissait de deux représentants d'espèces différentes, vivants dans des mondes totalement coupés l'un de l'autre.
Mais au delà des thèmes abordés dans le livre, ce qui est le plus essentiel, le plus original, le plus fort, c'est l'écriture de Gadda. Une écriture baroque, on pourrait presque dire que cet adjectif n'a jamais été aussi justement employé que pour définir cette écriture-là, mais aussi grotesque et grinçante. Une écriture pétrie de culture et de références, littéraires, philosophiques, concernant aussi la mythologie étrusque, truffée de mots précieux et rares. Une sorte de poussée de lave impossible à arrêter, qui semble surgir et se répandre dans tous les sens.
Pour résumer, il s'agit d'une expérience de lecture forte, rappelant pour moi, les impressions que j'ai pu ressentir à lire Ulysse de Joyce, ou peut être encore plus L'homme sans qualités de Musil, mais une expérience exigeante, qui demande de l'attention et une très concentration, à l'opposé d'une distraction facile et agréable.
Roman célèbre, que j'avais commencé à lire il y a... trente ans ? sans parvenir à l'achever (mon temps était alors mité par le métier), et que sous un prétexte fallacieux (je suis à la recherche d'un roman dont il ne me reste qu'une brève note dans l'un de mes carnets, dont la seule chose que je sais est qu'un personnage se nomme Efisio ; or, le chat de Geppetto m'a affirmé que ce roman est La Connaissance de la douleur : ce qui est faux), je viens enfin de lire dans son intégralité.
C'est un roman inachevé, de peu, (il ne lui manquerait qu'une dizaine de pages), et d'ailleurs inachevable, selon François Wahl, l'un des deux traducteurs : comment le personnage principal, Gonzalo Pirobiturro d'Eltino, qui a beaucoup de traits communs avec l'auteur, pourrait-il être coupable de l'action abominable que le roman tend à lui prêter ? Mais, par ailleurs, comment le coupable pourrait-il être un autre que lui ? Qu'on me pardonne ces formules contournées, qui visent à ne rien divulguer de l'intrigue... Nous sommes donc dans un pays imaginaire, au pied de la Cordillère des Andes, le Maradagàl (qui a toutes les apparences de la Brianza, la région de piémont au nord de Milan où la famille Gadda avait une villa, minutieusement décrite dans le roman), au début des années 30, au sortir d'une guerre victorieuse contre le Paradagàl (Mara contre Para : guerre de la mère contre le père ?). le héros, si l'on peut le qualifier ainsi, souffre des séquelles psychologiques de cette guerre, au cours de laquelle il a perdu un frère (comme Gadda lui-même), et aussi d'une humeur atrabilaire qui lui rend insupportable la fréquentation de ses semblables, qu'ils soient de la bourgeoisie ou du petit peuple de péons et de lavandières qui s'insinue chez lui avec la complicité de sa mère.
Mais l'intrigue, que Gadda conduit avec une grande désinvolture, importe assez peu. C'est un livre qui ne tient que par la langue. Elle est d'une extraordinaire invention, foisonnante, labyrinthique, mêlant tous les registres, tour à tour savante et triviale, claire et obscure, saturée d'allusions littéraires, historiques et personnelles, dont François Wahl, dans sa belle postface, nous donne quelques clefs. Je me suis souvent plaint de la piètre qualité des traductions de romans. Celle-ci, due à Louis Bonalumi et François Wahl, est admirable : somptueuse, d'une extrême richesse, et même d'une folle invention, créant des néologismes dans notre langue pour remplacer ceux, très nombreux, de l'original italien, ajoutant même à l'occasion, sans déparer aucunement, quelques réjouissantes « notes du traducteur » en bas de page, dans le ton de l'auteur. Presque tout le plaisir de la lecture réside dans la langue de Gadda – le seul, peut-être, des écrivains modernes à avoir su donner vie au vieux rêve de Faubert.
C'est aussi la limite de ce roman, ce qui fait que Gadda est inférieur aux grands écrivains du siècle, Claude Simon ou Faulkner par exemple. Car les tourments du personnage principal et sa dureté dans ses rapports avec sa mère ne suffisent pas à créer un monde. Mais c'est une expérience de lecture qu'il faut avoir faite, ou plutôt vécue, une fois dans sa vie.
C'est un roman inachevé, de peu, (il ne lui manquerait qu'une dizaine de pages), et d'ailleurs inachevable, selon François Wahl, l'un des deux traducteurs : comment le personnage principal, Gonzalo Pirobiturro d'Eltino, qui a beaucoup de traits communs avec l'auteur, pourrait-il être coupable de l'action abominable que le roman tend à lui prêter ? Mais, par ailleurs, comment le coupable pourrait-il être un autre que lui ? Qu'on me pardonne ces formules contournées, qui visent à ne rien divulguer de l'intrigue... Nous sommes donc dans un pays imaginaire, au pied de la Cordillère des Andes, le Maradagàl (qui a toutes les apparences de la Brianza, la région de piémont au nord de Milan où la famille Gadda avait une villa, minutieusement décrite dans le roman), au début des années 30, au sortir d'une guerre victorieuse contre le Paradagàl (Mara contre Para : guerre de la mère contre le père ?). le héros, si l'on peut le qualifier ainsi, souffre des séquelles psychologiques de cette guerre, au cours de laquelle il a perdu un frère (comme Gadda lui-même), et aussi d'une humeur atrabilaire qui lui rend insupportable la fréquentation de ses semblables, qu'ils soient de la bourgeoisie ou du petit peuple de péons et de lavandières qui s'insinue chez lui avec la complicité de sa mère.
Mais l'intrigue, que Gadda conduit avec une grande désinvolture, importe assez peu. C'est un livre qui ne tient que par la langue. Elle est d'une extraordinaire invention, foisonnante, labyrinthique, mêlant tous les registres, tour à tour savante et triviale, claire et obscure, saturée d'allusions littéraires, historiques et personnelles, dont François Wahl, dans sa belle postface, nous donne quelques clefs. Je me suis souvent plaint de la piètre qualité des traductions de romans. Celle-ci, due à Louis Bonalumi et François Wahl, est admirable : somptueuse, d'une extrême richesse, et même d'une folle invention, créant des néologismes dans notre langue pour remplacer ceux, très nombreux, de l'original italien, ajoutant même à l'occasion, sans déparer aucunement, quelques réjouissantes « notes du traducteur » en bas de page, dans le ton de l'auteur. Presque tout le plaisir de la lecture réside dans la langue de Gadda – le seul, peut-être, des écrivains modernes à avoir su donner vie au vieux rêve de Faubert.
C'est aussi la limite de ce roman, ce qui fait que Gadda est inférieur aux grands écrivains du siècle, Claude Simon ou Faulkner par exemple. Car les tourments du personnage principal et sa dureté dans ses rapports avec sa mère ne suffisent pas à créer un monde. Mais c'est une expérience de lecture qu'il faut avoir faite, ou plutôt vécue, une fois dans sa vie.
La Connaissance de la douleur a paru en 1963 chez Einaudi et a été traduit en français en 1974, et de façon tout à fait remarquable, par Louis Bonalumi et François Wahl, qui du reste propose une intéressante lecture de ce roman en postface de l'édition du Seuil (1). Ce roman aussi magnifique que complexe et difficile, sobrescrito, surécrit comme eût dit Borges, puisant à une multitude de sources évidentes (comme Les Fiancées de Manzoni, Platon, la littérature latine, Dante) ou beaucoup plus discrètes (Joyce et, via ce dernier, Sterne), a en fait été rédigé entre 1938 et 1941, juste après que Carlo Emilio Gadda, en 1936, procède à la vente de la villa dans laquelle il vivait avec sa mère, décédée cette même année. Ce roman pourrait, à bien des égards, être compris comme une étrange cristallisation de haine, et la volonté, une fois le Mal emprisonné dans un réseau de mots, de l'observer et, qui sait, de tenter d'en comprendre la structure et peut-être même, folle espérance, en atténuer quelque peu l'absolue noirceur : «Une douleur sans espoir s'empara de l'âme du fils : la douceur lasse de septembre lui parut irréelle, une image fuyante des choses impossibles ou perdues. Il eût voulu s'agenouiller et dire : «Pardonne-moi, pardonne-moi ! Maman, c'est moi !» Il dit : Si je te trouve encore une fois dans le bran aux cochons, je vous égorge tous, eux et toi avec» (p. 223). Tâche impossible bien sûr, qui pourtant est toujours celle, ne peut toujours qu'être celle des plus grands romanciers.
Lien : http://www.juanasensio.com/a..
Lien : http://www.juanasensio.com/a..
On suit le docteur qui raconte ses discussions, s'épanche et discute encore, des ragots, des rumeurs, du colportage, des ouï-dire, tout le village y passe, le discours enfle, c'est l'univers sur une tête d'épingle: Gadda, c'est une épistémologie de l'enchevêtrement, une philosophie pour la plèbe à la manière de Chirico, une encyclopédie grotesque et furieuse; du docteur, de sa baguette - les cailloux qui virevoltent, les cigales qui chantent, le ver qui creuse - une tragédie en farce se met en place, cinglante, brutale: c'est toute la puanteur et la misère d'un péon en sabot, mâchonnant des brins d'herbes; toute la puanteur d'un fromage: la puanteur du fascisme. Sans oublier la gloutonnerie de ces filles qui conduisent dangereusement, la Peppa, ou la Peppinna, ou la Giuseppina, la pine qui se confond, s'enfonce, corne d'abondance refusée au fils: de ces poires-beurre en réceptacle, utérus inversé, suave, tant désiré, mais si peu protégé.
Citations et extraits (12)
Voir plus
Ajouter une citation
De nouveau, cédant à une idée, il [Gonzalo, le fils] avait haussé le ton, rageur :
"Le monde des idées : joli monde! Eh : le moi, je : au milieu des amandiers en fleurs, au milieu des poires, des Battistina, des José : le moi, je... entre tous les pronoms le plus abject.
Le médecin sourit à l'algarade, sans comprendre. Il saisit cependant l'occasion de lénifier un peut les mots, sinon l'humeur et les pensées :
- Pourquoi diable? Que vous ont-ils fait de mal, les pronoms? Quand on pense quelque chose, il faut bien dire : je pense. Je pense que le soleil nous court la citrouille, de droit à gauche...
(...)
- I think, oui : but I'm ill of thinking, murmura le fils. Les pronoms sont les poux de la pensée. Quand la pensée a des poux, elle se gratte, comme tous les pouilleux : et sous les ongles, alors, on les retrouve : les pronoms : les pronoms personnels.
"Le monde des idées : joli monde! Eh : le moi, je : au milieu des amandiers en fleurs, au milieu des poires, des Battistina, des José : le moi, je... entre tous les pronoms le plus abject.
Le médecin sourit à l'algarade, sans comprendre. Il saisit cependant l'occasion de lénifier un peut les mots, sinon l'humeur et les pensées :
- Pourquoi diable? Que vous ont-ils fait de mal, les pronoms? Quand on pense quelque chose, il faut bien dire : je pense. Je pense que le soleil nous court la citrouille, de droit à gauche...
(...)
- I think, oui : but I'm ill of thinking, murmura le fils. Les pronoms sont les poux de la pensée. Quand la pensée a des poux, elle se gratte, comme tous les pouilleux : et sous les ongles, alors, on les retrouve : les pronoms : les pronoms personnels.
« Maître corbeau sur un arbre perché : Eh ! Nolite margaritas. Du La Fontaine, à un idiot de cette espèce ! Et ma mère, ma mère ! Qui lui donne des figues, des pêches, des bonbons : à cet idiot. Et qui lui fait des caresses : plus il est bête, plus elle lui en fait : et des petits chocolats. Et elle lui sourit : comme si elle était sa mère : et des petits biscuits, des compliments, et un gros baiser pour finir : parce qu’il s’est montré idiot, superbement idiot : et n’a rien compris à rien : et tout d’un coup qu’est-ce qu’il a demandé ? d’aller faire pipi : et elle, a attendu, patiemment, qu’il redescende après l’avoir fait, son pipi : et ils ont recommencé à lire, enfin : à essayer : de le faire lire : et la scie aussitôt a pris un ch : et Maman s’est mise à rire. Et elle était heureuse ; heureuse ! avec ce polichinelle empoté, sorti de je ne sais quel trou, sous l’effet de je ne sais quelle mécanique de malheur.
L’hidalgo, peut-être, en était à se nier lui-même. A convoquer devant soi les motifs et la connaissance et la vérité de la douleur, plus rien ne restait, du possible. Sous ces violences répétées, tout s’épuisait. Ne demeurait sauf que le sarcasme, des formes et des apparences : tel un masque tragique sur une métope de théâtre.
Visage, à présent, tuméfié, tailladé. Voué à l'abjection par l'efficace d'une causalité mauvaise œuvrant dans l'absurdité de la nuit ; qui avait trouvé des complices jusque dans la confiance et la bonté de Madame. Cet enchaînement de causes ramenait le tendre, le sublime système de la vie, à l'horreur des systèmes subordonnés : nature, sang, matière : solitude des viscères et des visages sans pensée. Abandon.
- Laissons-la se reposer en paix, dit le médecin. Allons, sortez.
Dans la lassitude sans recours où se recueillait le pauvre visage tuméfié, comme en une récupération de dignité ultime, tous eurent le sentiment de déchiffrer le nom terrible de la mort et la souveraine conscience de l'impossibilité de dire : Je.
Le concours de l'art médical - lénitifs, pansements - dissimula l'horreur en partie. On entendait le reste d'eau et d'alcool des gazes essorées tomber en s'égouttant dans une cuvette. Aux fentes des persiennes, l'aube, déjà. Le coq, soudain le fit éclore des monts lointains, ignare et péremptoire, comme toujours : il l'invitait à venir, pour dresser l'inventaire des mûriers, dans la solitudes des champs réapparus.
- Laissons-la se reposer en paix, dit le médecin. Allons, sortez.
Dans la lassitude sans recours où se recueillait le pauvre visage tuméfié, comme en une récupération de dignité ultime, tous eurent le sentiment de déchiffrer le nom terrible de la mort et la souveraine conscience de l'impossibilité de dire : Je.
Le concours de l'art médical - lénitifs, pansements - dissimula l'horreur en partie. On entendait le reste d'eau et d'alcool des gazes essorées tomber en s'égouttant dans une cuvette. Aux fentes des persiennes, l'aube, déjà. Le coq, soudain le fit éclore des monts lointains, ignare et péremptoire, comme toujours : il l'invitait à venir, pour dresser l'inventaire des mûriers, dans la solitudes des champs réapparus.
Cueillir le baiser menteur de l'Apparence, sur la litière ensemble avec elle se vautrer, respirer son haleine, jusqu'à s'en gorger l'âme, s'abreuver de son rot, de son relent de maquerelle. Ou bien, la noyer au contraire, comme en une fosse d'excréments, dans la rancoeur et le mépris, nier, nier: pour se vouloir Seigneur et Maître au jardin privé de son âme.
Video de Carlo Emilio Gadda (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans la catégorie :
Romans, contes, nouvellesVoir plus
>Littérature (Belles-lettres)>Littérature italienne, roumaine et rhéto-romane>Romans, contes, nouvelles (653)
autres livres classés : littérature italienneVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Carlo Emilio Gadda (20)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Grandes oeuvres littéraires italiennes
Ce roman de Dino Buzzati traite de façon suggestive et poignante de la fuite vaine du temps, de l'attente et de l'échec, sur fond d'un vieux fort militaire isolé à la frontière du « Royaume » et de « l'État du Nord ».
Si c'est un homme
Le mépris
Le désert des Tartares
Six personnages en quête d'auteur
La peau
Le prince
Gomorra
La divine comédie
Décaméron
Le Nom de la rose
10 questions
822 lecteurs ont répondu
Thèmes :
italie
, littérature italienneCréer un quiz sur ce livre822 lecteurs ont répondu