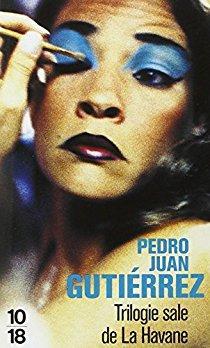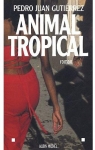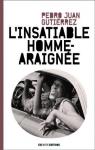“On ne peut pas tout comprendre. Disons que la vie, on ne peut pas à la fois la vivre et l'analyser.”
Je ne vais pas réussir à « analyser » ce livre aussi bien que je l'ai vécu. Peut-être aurais-je dû écrire cet avis après une rasade de rhum cubain, torse poil, sur une musique cubaine face au Malécon.
Cette fresque du cubain Pedro Juan Gutierrez appartient avec Bukowski ou Henry Miller à ce que l'on appelle le « réalisme sale », à ceci près que cette façon de décrire très brute, très érotique, très crue semble partagée par nombre d'auteurs cubains, comme si c'était ça « le goût de la Havane ».
« Des fois, presque toujours, il est bon de se laisser guider par l'intuition, sans réfléchir. Les idées préconçues fichent un sacré bordel dans la vie. » Cette vaste chronique, en trois livres, nous introduit dans le Cuba des années 90, le narrateur, Pedro Juan, nous emmène, à travers de courts chapitres taillés au ciseau, dans l'enfer du quotidien : la quête de thunes, de sexe et de rhum.
Le réalisme sale colle au réel sans l'embellir, sans se raconter d'histoires, dans un style presque oral, empruntant volontiers au registre familier, voire vulgaire mais dans un effort littéraire confinant parfois à la poésie, pour décrire un monde souvent dur, malheureux, désespéré, « il y avait trop de paix dans ses oeuvres pour qu'elles soient vraiment bonnes. L'art n'a de sens que s'il est révolté, tourmenté, traversé de cauchemars et de désespoir. »
“Les gens n'aiment pas la solitude. Moi si.” C'est une formidable épopée du vide existentiel, Gutierrez a le sens de la formule, la mystique de la mélancolie et la politesse de l'ironie. Sa recette : « le mieux, c'est de prendre la réalité, brute, comme elle t'arrive dessus dans la rue. Tu l'attrapes des deux mains et si tu as assez de force tu la soulèves et tu la laisses tomber sur la page blanche, et voilà, c'est fini. Facile. Sans retouches. »
C'est par cette intimité misanthrope, cette distance qu'il met entre lui et les autres, entre lui et les femmes, que Gutierrez arrive à rattraper le fil fragile de l'empathie, noirci par la crasse. L'auteur est-il arrivé à « cet état divin d'insociabilité, dont les philosophes pessimistes et les poètes décadents disent que c'est un état de parfait bonheur » pour reprendre le mot d'Octave Mirbeau ?
A n'en pas douter, l'homme n'est pas fait pour vivre complètement seul, il faut juste trouver le bon équilibre entre la misanthropie aigrie et la fuite de soi dans le tourbillon des mondanités : “je continuais à vivre sans la bonne combinaison de fréquentations et de moments de solitude”, équilibre introuvable ?
“Moi, j'écris pour provoquer un peu et obliger les autres à renifler la merde.” Mais résumer cet ouvrage à une quête égotique et hédoniste est réducteur. La description nihiliste du « Crocodile Vert » au lendemain de l'effondrement de l'U.R.S.S nous rend témoin, de l'intérieur, de la crise qu'a subi le pays tout au long des années 90, sans les aides conséquentes que la Russie communiste apportait et maintenu sous embargo américain, « Dieu n'a pas de solutions à tout, d'accord, c'est vrai mais le communisme encore moins. »
« Quand on est pauvre mieux vaut être crétin qu'intelligent (...). Un pauvre qui a de la lucidité, c'est un parfait candidat au suicide.” On découvre, lors de la parution du succès mondial en 1998, un Cuba interlope où il est question de trafic de drogues, de violences conjugales, d'émigration, de pauvreté, de crasse, de racisme, d'homosexualité, d'immeubles insalubres, de police corrompue « personne ne ressemble autant à un délinquant qu'un flic. Les extrêmes se rejoignent », de tourisme sexuel effréné, de superstitions, de commères et que le potin urbain brulent comme une passion amoureuse, de « papitos » et de « santerias ».
“C'est que le sexe n'est pas fait pour les scrupules”. Une seule évasion : le sexe. Un invariant. Les cubaines et les cubains - est-ce du fait de leur insularité - de Gutierrez ne cessent de s'adonner aux plaisirs de la chair, sans inhibitions aucunes, avec une facilité déconcertante, sans psychanalyse inhibitrice, parce que “c'est comme ça la vie : c'est l'interdit qui nous attire le plus, toujours” à l'image de ce plaidoyer pour l'exhibitionnisme : « les exhibitionnistes remplissent un rôle social formidable : ils apportent de l'érotisme aux passants. »
Le domaine du sexe est un objet littéraire de prédilection pour le réalisme sale qui puise à une source inépuisable d'inspiration, le champ lexical anatomique, les impudeurs du corps, les odeurs et bestialités etc.
L'érotique de Gutierrez ne fait pas de chichi, pas de candélabres et de violoncelles, pas de draps de satins et de langoureux strip-tease, un pénis peut surgir dans une cuisine, entre la poire et le fromage, sans que cela fasse sourciller quiconque, l'adultère est une coutume scrupuleusement respectée et il n'est jamais trop tard pour être candidat à la fuite dans la baise. Pour le narrateur, dont l'organe reproducteur est un personnage du livre à part entière, le défouloir sexuel est un art de vivre : « les réservoirs restent vides et plein de choses se règlent d'elles-mêmes, sans avoir à s'en préoccuper. »
« J'ai besoin de la Havane. Cette ville m'inspire tant. La vie y est plus intense qu'ailleurs ». Rien d'étonnant à ce que la parution de Trilogie Sale de la Havane, qui sans être frontalement politique n'en est pas moins en total décalage avec la vitrine officielle du régime, ne soit toujours pas paru dans son pays d'origine, “c'est la seule méthode pour fabriquer des mercenaires, ça : les persuader qu'ils font partie du pouvoir, alors qu'en réalité ils ne s'approcheront jamais du trône, même de loin.”
Si Cuba ne lui pardonne pas, Gutierrez n'est pourtant pas moins tendre avec le capitalisme : « les bourgeois ne comprennent rien à rien. C'est pour ça qu'ils ont peur de tout, qu'ils veulent sans cesse savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et comment on peut corriger ci, et comment on peut empêcher ça. Tout est anormal, pour eux.”
Partageant sa vie entre l'Espagne et La Havane, celui qui payera cher (licenciement) la parution du livre s'amuse de n'être reconnu que des touristes sur le Malécon.
« Parfois elle est tellement dure la réalité que les gens ne te croient pas ». Les nombreuses figures désabusées que l'on croise dans cette Trilogie sale de la Havane glissent dans la vie comme elles peuvent « sans aucun désir, sans aucune attente”. La réflexion existentielle de l'auteur nous touche tous, au-delà du défouloir du sexe, des odeurs pestilentielles et de la faim « tout ce que j'avais dans le ventre c'était quatre roquets en train de se battre méchamment ». Être affamé est la condition humaine du pauvre qui ne peut « se montrer trop exigeant au niveau de la dignité » autrement il mourra de faim.
Je me répète, de même que le bouquin use volontiers de la répétition, jusqu'à ce qu'on soit ancrés dans sa réalité... bref, les gens sont brisés par le régime, le système économique et cherchent à s'en sortir par tous les moyens, petits trafics, spiritisme, prostitution, infirmières, mendiants, émigrants sont dépeints dans une lucidité à l'état brut : “c'est là que je me suis mis éboueur. Il y avait des primes de danger, de travail de nuit et de pénibilité. En clair, ça voulait dire que dans ce boulot on peut se faire bousiller.”
Dans la résignation, Gutierrez analyse la situation des enfants d'Ogùn comme « un karma collectif », et conseille : “relève surtout pas la tête, parce qu'ils te la coupent tout de suite », pour lui “nous, les humains, nous devrions les rejeter les rêves, poser les pieds au sol et déclarer : « Putain, là d'accord ! Là, je suis bien ancré.”
Pourtant, la réussite d'un Carlos Acosta, le talent reconnu des médecins cubains qui s'exportent désormais, montrent qu'une ouverture de Cuba sur le monde est possible, les récentes réformes constitutionnelles sont-elles un espoir socialiste, après le communisme ? Quand on imagine la vie sous les pays communistes, de la Havane à Moscou, de Kiev à Berlin-Est, de Shanghai à Hanoï, on parle de plus d'un milliard de destins, de générations.
Comme l'expliquaient des témoins dans « La Fin de l'Homme Rouge », de Svetlana Alexievitch, les russes aussi ont cru que la chute du communisme amènerait enfin un socialisme démocratique et ne s'attendaient pas au capitalisme sauvage et autoritaire des années 90.
En fin observateur de la société et de la nature humaine, ce bouquin vide trippes n'est pas exempt de philosophie. le carpe diem de l'auteur cubain ? la résilience, mais une résilience engourdie, un espoir annihilé. Un cynisme sans vertu, où les hommes se prêtent à l'onanisme sur le Malécon comme Diogène sur l'Agora mais sans revendication politique.
Il faut traiter chaque évènement de la même façon pour éviter remords et regrets vis-à-vis des bourbiers successifs dans lesquels on se met : “un homme peut commettre un tas de petites erreurs c'est sans importance. Mais quand les erreurs sont si grosses qu'elles finissent par peser sur sa vie, il ne lui reste plus qu'à tout relativiser. C'est le seul moyen d'éviter de souffrir.”
“Le bon dieu il te sers le cou mais il te l'étrangle pas”. Au-delà du contexte, n'est-ce pas le rapport de l'individuel, petit, fébrile, pris dans un système qui le dépasse, qui l'écrase que nous lisons à travers ces 400 pages ?
Que ce soit le Cuba des années 90, les pays démocratiques et leurs réformes sociales, une vie familiale, amoureuse ou professionnelle destructrice pour l'individu, les mots de Gutierrez sont aisément transposables. Où que nous nous trouvions et quelques soient nos malheurs “finalement, c'est comme ça qu'on vit, par petits bouts qu'on emboîte les uns aux autres”.
Malgré l'enfumage officiel au pays du cigare, le vrai goût de la Havane résonne dans toute son amoralité. Entre dégout, fascination et ouverture d'esprit l'attention du lecteur est captée, c'est bon, il est bien ancré, c'est là qu'il faut être, 100% authentique. Décapant.
Comme dirait Pedro Juan : “enfin. Je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça puisque je m'en fiche.”
Qu'en pensez-vous ?
Je ne vais pas réussir à « analyser » ce livre aussi bien que je l'ai vécu. Peut-être aurais-je dû écrire cet avis après une rasade de rhum cubain, torse poil, sur une musique cubaine face au Malécon.
Cette fresque du cubain Pedro Juan Gutierrez appartient avec Bukowski ou Henry Miller à ce que l'on appelle le « réalisme sale », à ceci près que cette façon de décrire très brute, très érotique, très crue semble partagée par nombre d'auteurs cubains, comme si c'était ça « le goût de la Havane ».
« Des fois, presque toujours, il est bon de se laisser guider par l'intuition, sans réfléchir. Les idées préconçues fichent un sacré bordel dans la vie. » Cette vaste chronique, en trois livres, nous introduit dans le Cuba des années 90, le narrateur, Pedro Juan, nous emmène, à travers de courts chapitres taillés au ciseau, dans l'enfer du quotidien : la quête de thunes, de sexe et de rhum.
Le réalisme sale colle au réel sans l'embellir, sans se raconter d'histoires, dans un style presque oral, empruntant volontiers au registre familier, voire vulgaire mais dans un effort littéraire confinant parfois à la poésie, pour décrire un monde souvent dur, malheureux, désespéré, « il y avait trop de paix dans ses oeuvres pour qu'elles soient vraiment bonnes. L'art n'a de sens que s'il est révolté, tourmenté, traversé de cauchemars et de désespoir. »
“Les gens n'aiment pas la solitude. Moi si.” C'est une formidable épopée du vide existentiel, Gutierrez a le sens de la formule, la mystique de la mélancolie et la politesse de l'ironie. Sa recette : « le mieux, c'est de prendre la réalité, brute, comme elle t'arrive dessus dans la rue. Tu l'attrapes des deux mains et si tu as assez de force tu la soulèves et tu la laisses tomber sur la page blanche, et voilà, c'est fini. Facile. Sans retouches. »
C'est par cette intimité misanthrope, cette distance qu'il met entre lui et les autres, entre lui et les femmes, que Gutierrez arrive à rattraper le fil fragile de l'empathie, noirci par la crasse. L'auteur est-il arrivé à « cet état divin d'insociabilité, dont les philosophes pessimistes et les poètes décadents disent que c'est un état de parfait bonheur » pour reprendre le mot d'Octave Mirbeau ?
A n'en pas douter, l'homme n'est pas fait pour vivre complètement seul, il faut juste trouver le bon équilibre entre la misanthropie aigrie et la fuite de soi dans le tourbillon des mondanités : “je continuais à vivre sans la bonne combinaison de fréquentations et de moments de solitude”, équilibre introuvable ?
“Moi, j'écris pour provoquer un peu et obliger les autres à renifler la merde.” Mais résumer cet ouvrage à une quête égotique et hédoniste est réducteur. La description nihiliste du « Crocodile Vert » au lendemain de l'effondrement de l'U.R.S.S nous rend témoin, de l'intérieur, de la crise qu'a subi le pays tout au long des années 90, sans les aides conséquentes que la Russie communiste apportait et maintenu sous embargo américain, « Dieu n'a pas de solutions à tout, d'accord, c'est vrai mais le communisme encore moins. »
« Quand on est pauvre mieux vaut être crétin qu'intelligent (...). Un pauvre qui a de la lucidité, c'est un parfait candidat au suicide.” On découvre, lors de la parution du succès mondial en 1998, un Cuba interlope où il est question de trafic de drogues, de violences conjugales, d'émigration, de pauvreté, de crasse, de racisme, d'homosexualité, d'immeubles insalubres, de police corrompue « personne ne ressemble autant à un délinquant qu'un flic. Les extrêmes se rejoignent », de tourisme sexuel effréné, de superstitions, de commères et que le potin urbain brulent comme une passion amoureuse, de « papitos » et de « santerias ».
“C'est que le sexe n'est pas fait pour les scrupules”. Une seule évasion : le sexe. Un invariant. Les cubaines et les cubains - est-ce du fait de leur insularité - de Gutierrez ne cessent de s'adonner aux plaisirs de la chair, sans inhibitions aucunes, avec une facilité déconcertante, sans psychanalyse inhibitrice, parce que “c'est comme ça la vie : c'est l'interdit qui nous attire le plus, toujours” à l'image de ce plaidoyer pour l'exhibitionnisme : « les exhibitionnistes remplissent un rôle social formidable : ils apportent de l'érotisme aux passants. »
Le domaine du sexe est un objet littéraire de prédilection pour le réalisme sale qui puise à une source inépuisable d'inspiration, le champ lexical anatomique, les impudeurs du corps, les odeurs et bestialités etc.
L'érotique de Gutierrez ne fait pas de chichi, pas de candélabres et de violoncelles, pas de draps de satins et de langoureux strip-tease, un pénis peut surgir dans une cuisine, entre la poire et le fromage, sans que cela fasse sourciller quiconque, l'adultère est une coutume scrupuleusement respectée et il n'est jamais trop tard pour être candidat à la fuite dans la baise. Pour le narrateur, dont l'organe reproducteur est un personnage du livre à part entière, le défouloir sexuel est un art de vivre : « les réservoirs restent vides et plein de choses se règlent d'elles-mêmes, sans avoir à s'en préoccuper. »
« J'ai besoin de la Havane. Cette ville m'inspire tant. La vie y est plus intense qu'ailleurs ». Rien d'étonnant à ce que la parution de Trilogie Sale de la Havane, qui sans être frontalement politique n'en est pas moins en total décalage avec la vitrine officielle du régime, ne soit toujours pas paru dans son pays d'origine, “c'est la seule méthode pour fabriquer des mercenaires, ça : les persuader qu'ils font partie du pouvoir, alors qu'en réalité ils ne s'approcheront jamais du trône, même de loin.”
Si Cuba ne lui pardonne pas, Gutierrez n'est pourtant pas moins tendre avec le capitalisme : « les bourgeois ne comprennent rien à rien. C'est pour ça qu'ils ont peur de tout, qu'ils veulent sans cesse savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et comment on peut corriger ci, et comment on peut empêcher ça. Tout est anormal, pour eux.”
Partageant sa vie entre l'Espagne et La Havane, celui qui payera cher (licenciement) la parution du livre s'amuse de n'être reconnu que des touristes sur le Malécon.
« Parfois elle est tellement dure la réalité que les gens ne te croient pas ». Les nombreuses figures désabusées que l'on croise dans cette Trilogie sale de la Havane glissent dans la vie comme elles peuvent « sans aucun désir, sans aucune attente”. La réflexion existentielle de l'auteur nous touche tous, au-delà du défouloir du sexe, des odeurs pestilentielles et de la faim « tout ce que j'avais dans le ventre c'était quatre roquets en train de se battre méchamment ». Être affamé est la condition humaine du pauvre qui ne peut « se montrer trop exigeant au niveau de la dignité » autrement il mourra de faim.
Je me répète, de même que le bouquin use volontiers de la répétition, jusqu'à ce qu'on soit ancrés dans sa réalité... bref, les gens sont brisés par le régime, le système économique et cherchent à s'en sortir par tous les moyens, petits trafics, spiritisme, prostitution, infirmières, mendiants, émigrants sont dépeints dans une lucidité à l'état brut : “c'est là que je me suis mis éboueur. Il y avait des primes de danger, de travail de nuit et de pénibilité. En clair, ça voulait dire que dans ce boulot on peut se faire bousiller.”
Dans la résignation, Gutierrez analyse la situation des enfants d'Ogùn comme « un karma collectif », et conseille : “relève surtout pas la tête, parce qu'ils te la coupent tout de suite », pour lui “nous, les humains, nous devrions les rejeter les rêves, poser les pieds au sol et déclarer : « Putain, là d'accord ! Là, je suis bien ancré.”
Pourtant, la réussite d'un Carlos Acosta, le talent reconnu des médecins cubains qui s'exportent désormais, montrent qu'une ouverture de Cuba sur le monde est possible, les récentes réformes constitutionnelles sont-elles un espoir socialiste, après le communisme ? Quand on imagine la vie sous les pays communistes, de la Havane à Moscou, de Kiev à Berlin-Est, de Shanghai à Hanoï, on parle de plus d'un milliard de destins, de générations.
Comme l'expliquaient des témoins dans « La Fin de l'Homme Rouge », de Svetlana Alexievitch, les russes aussi ont cru que la chute du communisme amènerait enfin un socialisme démocratique et ne s'attendaient pas au capitalisme sauvage et autoritaire des années 90.
En fin observateur de la société et de la nature humaine, ce bouquin vide trippes n'est pas exempt de philosophie. le carpe diem de l'auteur cubain ? la résilience, mais une résilience engourdie, un espoir annihilé. Un cynisme sans vertu, où les hommes se prêtent à l'onanisme sur le Malécon comme Diogène sur l'Agora mais sans revendication politique.
Il faut traiter chaque évènement de la même façon pour éviter remords et regrets vis-à-vis des bourbiers successifs dans lesquels on se met : “un homme peut commettre un tas de petites erreurs c'est sans importance. Mais quand les erreurs sont si grosses qu'elles finissent par peser sur sa vie, il ne lui reste plus qu'à tout relativiser. C'est le seul moyen d'éviter de souffrir.”
“Le bon dieu il te sers le cou mais il te l'étrangle pas”. Au-delà du contexte, n'est-ce pas le rapport de l'individuel, petit, fébrile, pris dans un système qui le dépasse, qui l'écrase que nous lisons à travers ces 400 pages ?
Que ce soit le Cuba des années 90, les pays démocratiques et leurs réformes sociales, une vie familiale, amoureuse ou professionnelle destructrice pour l'individu, les mots de Gutierrez sont aisément transposables. Où que nous nous trouvions et quelques soient nos malheurs “finalement, c'est comme ça qu'on vit, par petits bouts qu'on emboîte les uns aux autres”.
Malgré l'enfumage officiel au pays du cigare, le vrai goût de la Havane résonne dans toute son amoralité. Entre dégout, fascination et ouverture d'esprit l'attention du lecteur est captée, c'est bon, il est bien ancré, c'est là qu'il faut être, 100% authentique. Décapant.
Comme dirait Pedro Juan : “enfin. Je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça puisque je m'en fiche.”
Qu'en pensez-vous ?
Dans les années 90, Cuba était, aux dires de ses dirigeants, un véritable paradis terrestre. Pourtant, malgré toute leur bonne volonté, les cubains étaient bien forcés de constater quelques dysfonctionnements : chômage, pénuries diverses, corruption généralisée, libertés en voie de disparition.
Parmi eux, Pedro Juan Gutierrez. Grand voyageur rentré au pays, journaliste au chômage faute de liberté d'expression suffisante, son regard sur la vie de la Havane est bien sombre. Il décrit les petites combines et les trafics qui permettent de survivre quelques jours de plus, le rhum de mauvaise qualité et le sexe débridé pour oublier.
Ce livre rappelle ceux de Bukowski, mais souffre justement de la comparaison. Pedro Juan ne développe jamais cette aura particulière que possède Hank, et ses histoires se ressemblent finalement toutes : il rencontre une fille, trouve un petit boulot, ils picolent et couchent ensemble quelques jours, puis se séparent.
Un roman intéressant au départ pour son réalisme cru, mais qui finit par s'essouffler.
Parmi eux, Pedro Juan Gutierrez. Grand voyageur rentré au pays, journaliste au chômage faute de liberté d'expression suffisante, son regard sur la vie de la Havane est bien sombre. Il décrit les petites combines et les trafics qui permettent de survivre quelques jours de plus, le rhum de mauvaise qualité et le sexe débridé pour oublier.
Ce livre rappelle ceux de Bukowski, mais souffre justement de la comparaison. Pedro Juan ne développe jamais cette aura particulière que possède Hank, et ses histoires se ressemblent finalement toutes : il rencontre une fille, trouve un petit boulot, ils picolent et couchent ensemble quelques jours, puis se séparent.
Un roman intéressant au départ pour son réalisme cru, mais qui finit par s'essouffler.
Bienvenue à Cuba. Mais attention, ce n'est pas le Cuba des cartes postales. La "Trilogie sale" de Pedro Juan Gutierrez nous entraîne dans un pays abimé par la dictature et la misère, où la population crève la dalle et vit de marchés noirs et de débrouille. le rhum coule à flot, la crasse est incrustée dans les moindres recoins de la Havane et la faim grignote les estomacs. Quant au sexe, il est partout. Gutierrez ne s'en cache pas, il aime ça… Il nous livre ici un "réalisme sale" qui contraste salement, justement, avec les cartes postales édulcorées que l'on voit parfois de Cuba. Bref, un roman sans manichéisme et absolument brut de décoffrage !
437 pages de sexe, de stupre, de violence, de mauvais rhum, pourraient lasser.
Mais le style vif et truculent de Gutierrez nous interpelle. Il nous livre un ensemble de nouvelles intéressantes sur la vie à Cuba dans les années 1990.
Une peinture sans concession sur la pauvreté, la faim, l'insalubrité et puis l'alcool, la prostitution, la baise pour survivre, pour oublier la misère.
On prend tout ça de plein fouet, sans détours et de manière brutale.
Un auteur rebelle, cru et trash mais attachant que j'ai découvert avec "le nid du serpent".
Un témoignage réaliste sur sa vie à La Havane, qui ne m'a pas laissée indifférente. Récemment en voyage sur cette île, j'ai bien compris que les cubains vivent toujours avec les tickets de rationnement, le marché noir, le système D, la prostitution. Une sorte de corruption organisée, malgré un embargo assoupli et une libéralisation économique amorcés depuis les années 2000.
Mais le style vif et truculent de Gutierrez nous interpelle. Il nous livre un ensemble de nouvelles intéressantes sur la vie à Cuba dans les années 1990.
Une peinture sans concession sur la pauvreté, la faim, l'insalubrité et puis l'alcool, la prostitution, la baise pour survivre, pour oublier la misère.
On prend tout ça de plein fouet, sans détours et de manière brutale.
Un auteur rebelle, cru et trash mais attachant que j'ai découvert avec "le nid du serpent".
Un témoignage réaliste sur sa vie à La Havane, qui ne m'a pas laissée indifférente. Récemment en voyage sur cette île, j'ai bien compris que les cubains vivent toujours avec les tickets de rationnement, le marché noir, le système D, la prostitution. Une sorte de corruption organisée, malgré un embargo assoupli et une libéralisation économique amorcés depuis les années 2000.
TRILOGIE SALE DE LA HAVANE de PEDRO JUAN GUTTIÉRREZ
Les années 90 à Cuba, Pedro jette en vrac ses souvenirs, ceux d'un journaliste terrorisé d'être pris par la censure, ceux qui l'entraînent d'une femme à l'autre dans une sexualité qui ferait de Miller et Bukowski des enfants de coeur et Zoé Valdès, sa compatriote, une nonne. Car Pedro ne pense qu'au sexe, aux femmes, entre un pétard et un verre de rhum. C'est vrai qu'il a du temps Pedro, il bricole à droite à gauche, récupère des bouteilles de bière vides, va pêcher des langoustes, ce qui est interdit et lui vaudra de la prison. La liste de ses conquêtes est interminable, on peut mentionner malgré tout Jacqueline, sa préférée, avec 12 orgasmes consécutifs qui le quittera pour New York où elle était née. Un temps Pedro fréquente les tripots clandestins de Mantilla, trafique un peu avec l'herbe mais il reste un crève la faim, déséquilibré et triste. Ce ne dont pas ses souvenirs de quatre ans et demi d'armée qui lui remontent le moral, ni la mansarde insalubre sous les toits, ni son incapacité à rester avec une femme. le manque d'eau, les coupures d'électricité, le racisme, la crasse, les odeurs, le tableau de Cuba que dresse Pedro Juan Guttièrez est particulièrement désespéré et désespérant.
Chaque chapitre du livre est une tranche de sa vie, sans ordre chronologique, on passe d'une femme à l'autre, d'un métier à l'autre, d'une chambre à l'autre , tableaux qui donnent une couleur sombre et sale à la vie, égayée tristement par une sexualité débridée qui masque mal la dépression latente.
C'est un livre très vivant, Gutierrez écrit remarquablement bien, le sexe est très présent évidemment, mais l'analyse sociologique, les personnages féminins hauts en couleurs, les plans de survie et la débrouille permanente font qu'on se prend une vraie claque en le lisant.
Les années 90 à Cuba, Pedro jette en vrac ses souvenirs, ceux d'un journaliste terrorisé d'être pris par la censure, ceux qui l'entraînent d'une femme à l'autre dans une sexualité qui ferait de Miller et Bukowski des enfants de coeur et Zoé Valdès, sa compatriote, une nonne. Car Pedro ne pense qu'au sexe, aux femmes, entre un pétard et un verre de rhum. C'est vrai qu'il a du temps Pedro, il bricole à droite à gauche, récupère des bouteilles de bière vides, va pêcher des langoustes, ce qui est interdit et lui vaudra de la prison. La liste de ses conquêtes est interminable, on peut mentionner malgré tout Jacqueline, sa préférée, avec 12 orgasmes consécutifs qui le quittera pour New York où elle était née. Un temps Pedro fréquente les tripots clandestins de Mantilla, trafique un peu avec l'herbe mais il reste un crève la faim, déséquilibré et triste. Ce ne dont pas ses souvenirs de quatre ans et demi d'armée qui lui remontent le moral, ni la mansarde insalubre sous les toits, ni son incapacité à rester avec une femme. le manque d'eau, les coupures d'électricité, le racisme, la crasse, les odeurs, le tableau de Cuba que dresse Pedro Juan Guttièrez est particulièrement désespéré et désespérant.
Chaque chapitre du livre est une tranche de sa vie, sans ordre chronologique, on passe d'une femme à l'autre, d'un métier à l'autre, d'une chambre à l'autre , tableaux qui donnent une couleur sombre et sale à la vie, égayée tristement par une sexualité débridée qui masque mal la dépression latente.
C'est un livre très vivant, Gutierrez écrit remarquablement bien, le sexe est très présent évidemment, mais l'analyse sociologique, les personnages féminins hauts en couleurs, les plans de survie et la débrouille permanente font qu'on se prend une vraie claque en le lisant.
Pedro Juan, un ancien journaliste, est revenu vivre à La Havane dans les années 1990 après avoir bourlingué quelque temps, notamment en Europe.
De retour sur son île, ce Cubain se rend compte que rien n'a changé et que la situation du pays s'est même dégradée. Car, malgré la propagande obligeant les médias à masquer la réalité et à affirmer que Cuba est un véritable paradis terrestre, les Cubains meurent de faim. Les denrées alimentaires les plus basiques se vendent à un prix fou et les plus pauvres ne savent se payer qu'un peu de mauvais rhum.
Désabusé, Pedro Juan décide d'écrire son quotidien afin de mieux exorciser ce qui assombrit son existence et celle de ses compatriotes.
Ce roman était très prometteur lorsque j'ai lu le résumé, mais j'en retire malheureusement un bilan assez mitigé.
Il s'agit d'une espèce de journal intime, puisque l'histoire est en grande partie autobiographique. Les faits relatés sont donc fidèles à la réalité et la misère des Cubains est décrite de telle sorte qu'on la ressent vraiment à la lecture, en cela, on peut dire que l'auteur a un style d'écriture absolument efficace. Cette Trilogie sale de la Havane porte donc très bien son titre, puisqu'elle explique tout ce qu'il y a de peu reluisant dans cette vie misérable que mène la population: on boit du mauvais rhum pour s'ennivrer et oublier bien vite ses conditions de vie; on souffre d'une pénurie d'eau, parfois; on se lance dans de nombreux trafics afin de gagner quelques dollars; et, surtout, on essaye de rentrer clandestinement sur le territoire des Etats-Unis où le rêve américain promet une vie bien meilleure.
Quant au style du texte, il est excellent: agressif quand il doit l'être, poétique lors des rares scènes de douceur qui nous sont contées. Gutiérrez peut donc, d'après ce que l'on lit dans cette Trilogia sucia de la Habana, classé parmi les "bons" auteurs hispanophones, de ceux qui vous prennent aux tripes dès le début et ne vous lâchent plus jusqu'à la dernière page.
Mais le problème majeur du texte, ce sont les scènes de sexe. Il ne se passe pas une page sans qu'on ait droit à une réflexion sexuelle. Et pas de façon voilée, mais de manière très explicite. C'est assez agaçant car cela n'apporte rien au récit; au contraire, puisque cette répétition continuelle des mêmes scènes (on boit du rhum, et une fois qu'on est à peu près ivre on fait l'amour et on se quitte) rend le texte très répétitif. Chaque chapitre du livre se déroulant de la même façon, quand Pedro Juan se retrouve assis à une table avec Carmencita et qu'ils partagent une bouteille de rhum, on peut facilement prévoir ce qu'il va se passer!
Cette façon de ressasser continuellement les mêmes événements en changeant juste un peu les participants et les lieux a plus ou moins gâché mon enthousiasme pour un récit que j'espérais plus centré sur la cause cubaine et sur la dictature. Et c'est d'autant plus dommage que certaines pointes d'humour de la part de l'auteur étaient assez réussies. En commençant ma lecture, je m'attendais plus à une histoire proche de "La Fiesta del Chivo" de Vargas Llosa ou même de la "Chronique d'une mort annoncée" de Garcia Marquez, mais non.
Malgré ce mauvais côté, ce roman méritait d'être lu, ne fût-ce que pour se rendre compte de ce qu'il reste dans la vie des gens lorsqu'ils ont atteint le niveau le plus bas (apparemment, l'alcool, le sexe et la drogue), celui de la pauvreté la plus extrême et de la lutte pour survivre.
De retour sur son île, ce Cubain se rend compte que rien n'a changé et que la situation du pays s'est même dégradée. Car, malgré la propagande obligeant les médias à masquer la réalité et à affirmer que Cuba est un véritable paradis terrestre, les Cubains meurent de faim. Les denrées alimentaires les plus basiques se vendent à un prix fou et les plus pauvres ne savent se payer qu'un peu de mauvais rhum.
Désabusé, Pedro Juan décide d'écrire son quotidien afin de mieux exorciser ce qui assombrit son existence et celle de ses compatriotes.
Ce roman était très prometteur lorsque j'ai lu le résumé, mais j'en retire malheureusement un bilan assez mitigé.
Il s'agit d'une espèce de journal intime, puisque l'histoire est en grande partie autobiographique. Les faits relatés sont donc fidèles à la réalité et la misère des Cubains est décrite de telle sorte qu'on la ressent vraiment à la lecture, en cela, on peut dire que l'auteur a un style d'écriture absolument efficace. Cette Trilogie sale de la Havane porte donc très bien son titre, puisqu'elle explique tout ce qu'il y a de peu reluisant dans cette vie misérable que mène la population: on boit du mauvais rhum pour s'ennivrer et oublier bien vite ses conditions de vie; on souffre d'une pénurie d'eau, parfois; on se lance dans de nombreux trafics afin de gagner quelques dollars; et, surtout, on essaye de rentrer clandestinement sur le territoire des Etats-Unis où le rêve américain promet une vie bien meilleure.
Quant au style du texte, il est excellent: agressif quand il doit l'être, poétique lors des rares scènes de douceur qui nous sont contées. Gutiérrez peut donc, d'après ce que l'on lit dans cette Trilogia sucia de la Habana, classé parmi les "bons" auteurs hispanophones, de ceux qui vous prennent aux tripes dès le début et ne vous lâchent plus jusqu'à la dernière page.
Mais le problème majeur du texte, ce sont les scènes de sexe. Il ne se passe pas une page sans qu'on ait droit à une réflexion sexuelle. Et pas de façon voilée, mais de manière très explicite. C'est assez agaçant car cela n'apporte rien au récit; au contraire, puisque cette répétition continuelle des mêmes scènes (on boit du rhum, et une fois qu'on est à peu près ivre on fait l'amour et on se quitte) rend le texte très répétitif. Chaque chapitre du livre se déroulant de la même façon, quand Pedro Juan se retrouve assis à une table avec Carmencita et qu'ils partagent une bouteille de rhum, on peut facilement prévoir ce qu'il va se passer!
Cette façon de ressasser continuellement les mêmes événements en changeant juste un peu les participants et les lieux a plus ou moins gâché mon enthousiasme pour un récit que j'espérais plus centré sur la cause cubaine et sur la dictature. Et c'est d'autant plus dommage que certaines pointes d'humour de la part de l'auteur étaient assez réussies. En commençant ma lecture, je m'attendais plus à une histoire proche de "La Fiesta del Chivo" de Vargas Llosa ou même de la "Chronique d'une mort annoncée" de Garcia Marquez, mais non.
Malgré ce mauvais côté, ce roman méritait d'être lu, ne fût-ce que pour se rendre compte de ce qu'il reste dans la vie des gens lorsqu'ils ont atteint le niveau le plus bas (apparemment, l'alcool, le sexe et la drogue), celui de la pauvreté la plus extrême et de la lutte pour survivre.
« C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas trop réfléchir, et s'amuser. le rhum, les femmes, l'herbe, une petite bouffe de temps à autre. le reste, c'est de la merde. Et la merde, mieux vaut pas la remuer. Rapport à l'odeur. »
Cuba se remet difficilement du démantèlement de l'Union soviétique dans cette dernière décennie du XXe siècle. Rien ne va plus pour les citoyens cubains, en particulier ceux qui habitent La Havane; une crise économique sans précédent force ceux-ci à divers expédients pour survivre au quotidien : prostitution, trafic de drogue, marché noir, commerces illégaux, squats d'immeubles. Pedro Juan Gutiérrez le raconte crûment dans ce récit autobiographique, une plongée en eaux troubles dans les pires bas-fonds de la capitale où surnage une espèce humaine aux abois, aux prises avec la famine et le surpeuplement, mais qui n'oublie jamais de célébrer la vie en s'adonnant aux plaisirs à sa portée : rhum, sexe et fiesta.
L'auteur a la langue bien pendue et ses historiettes portent le poids du vécu partagé. Exit le cadre doré des complexes hôteliers de Varadero et des visites guidées en autocar : ce que montre Gutiérrez n'est pas visible par les touristes. C'est sale, puant et dégradant. Une réalité qui choque, un envers du décor profondément dérangeant, loin des souvenirs de carte postale de notre séjour en 2011!
Cuba se remet difficilement du démantèlement de l'Union soviétique dans cette dernière décennie du XXe siècle. Rien ne va plus pour les citoyens cubains, en particulier ceux qui habitent La Havane; une crise économique sans précédent force ceux-ci à divers expédients pour survivre au quotidien : prostitution, trafic de drogue, marché noir, commerces illégaux, squats d'immeubles. Pedro Juan Gutiérrez le raconte crûment dans ce récit autobiographique, une plongée en eaux troubles dans les pires bas-fonds de la capitale où surnage une espèce humaine aux abois, aux prises avec la famine et le surpeuplement, mais qui n'oublie jamais de célébrer la vie en s'adonnant aux plaisirs à sa portée : rhum, sexe et fiesta.
L'auteur a la langue bien pendue et ses historiettes portent le poids du vécu partagé. Exit le cadre doré des complexes hôteliers de Varadero et des visites guidées en autocar : ce que montre Gutiérrez n'est pas visible par les touristes. C'est sale, puant et dégradant. Une réalité qui choque, un envers du décor profondément dérangeant, loin des souvenirs de carte postale de notre séjour en 2011!
Depuis quelques semaines ce livre traine dans ma pal comme un étrange objet du désir ....
une trilogie ...
trois petits paquets de scènes de la vie courante ..
La première est "ancré à une terre vacante" ... peut être pour montrer son attachement à sa terre !
La deuxième est "rien à faire" ... parce que les cubains ont vécu "35 ans enfermés derrière les cages du zoo, où l'on nous avait distribué une maigre pitance, quelques médicaments mais aucune idée de ce qui se passait de l'autre côté des barreaux" ... parce que maintenant il ne reste plus qu'à "se risquer dehors, sauter dans la jungle" ... rien à faire, il n'y a plus rien à faire sinon montrer son désespoir !... et se rappeler "aujourd'hui, c'est quand tout commence."
La dernière "le goût de moi" ... une simple chanson, un boléro d'un autre temps pour que "tu gardes à jamais - le goût de moi"
Une trilogie sale ...
Pourquoi sale ? ...
Le sexe est il sale ? ...
C'est un récit qui nous parle de la vie et qu'est ce qui est important dans la vie, entre autre chose il y a le sexe ... à pratiquer comme un sport national ... à voir pour nous permettre de faire travailler notre imagination ... sale mais pas sordide ni obscène ...
Une trilogie sale de la Havane ...
La Havane ... la ville de tous les espoirs ou des désespoirs ... la ville où tout est possible ou impossible ...
Cette trilogie n'est pas un roman, pas de scénario mettant en avant la vie d'un mec à La Havane,
Ce n'est pas non plus un journal, celui d'un paumé affamé toujours entre deux cuites et entre deux parties de baise,
Ce n'est pas non plus une succession de nouvelles, car les scènes décrites ne correspondent pas à une histoire avec un début et un dénouement,
C'est une suite de petites histoires de la vie de tous les jours jetées sur la papier sans aucune chronologie, sans volonté de démontrer quelque chose, juste des flashs de souvenirs racontés comme ils viennent sans souci de cohérence.
Le plus surprenant est certainement que malgré ce fouillis dans lequel nous sommes plongés on prend plaisir à lire, à se laisser porter par l'ambiance, l'atmosphère et le rythme des mots car c'est bien écrit.
une trilogie ...
trois petits paquets de scènes de la vie courante ..
La première est "ancré à une terre vacante" ... peut être pour montrer son attachement à sa terre !
La deuxième est "rien à faire" ... parce que les cubains ont vécu "35 ans enfermés derrière les cages du zoo, où l'on nous avait distribué une maigre pitance, quelques médicaments mais aucune idée de ce qui se passait de l'autre côté des barreaux" ... parce que maintenant il ne reste plus qu'à "se risquer dehors, sauter dans la jungle" ... rien à faire, il n'y a plus rien à faire sinon montrer son désespoir !... et se rappeler "aujourd'hui, c'est quand tout commence."
La dernière "le goût de moi" ... une simple chanson, un boléro d'un autre temps pour que "tu gardes à jamais - le goût de moi"
Une trilogie sale ...
Pourquoi sale ? ...
Le sexe est il sale ? ...
C'est un récit qui nous parle de la vie et qu'est ce qui est important dans la vie, entre autre chose il y a le sexe ... à pratiquer comme un sport national ... à voir pour nous permettre de faire travailler notre imagination ... sale mais pas sordide ni obscène ...
Une trilogie sale de la Havane ...
La Havane ... la ville de tous les espoirs ou des désespoirs ... la ville où tout est possible ou impossible ...
Cette trilogie n'est pas un roman, pas de scénario mettant en avant la vie d'un mec à La Havane,
Ce n'est pas non plus un journal, celui d'un paumé affamé toujours entre deux cuites et entre deux parties de baise,
Ce n'est pas non plus une succession de nouvelles, car les scènes décrites ne correspondent pas à une histoire avec un début et un dénouement,
C'est une suite de petites histoires de la vie de tous les jours jetées sur la papier sans aucune chronologie, sans volonté de démontrer quelque chose, juste des flashs de souvenirs racontés comme ils viennent sans souci de cohérence.
Le plus surprenant est certainement que malgré ce fouillis dans lequel nous sommes plongés on prend plaisir à lire, à se laisser porter par l'ambiance, l'atmosphère et le rythme des mots car c'est bien écrit.
Trilogía sucia de la Habana (1997)
C'est une vaste chronique de la vie à Cuba. le narrateur, un journaliste en rupture avec son milieu, nous entraîne dans les bas-fonds de la Havane. Il nous fait découvrir une ville au début des années 90, en pleine pénurie. Les personnages rencontrés par le narrateur se débattent dans des difficultés sans nom, pour survivre : manque de nourriture, de savon, climat politique difficile, tout se conjugue pour donner une atmosphère de désespoir, malgré le rhum et la salsa..
Un récit très cru et difficile, centré sur un homme, qui survit grâce à son égoïsme. Une langue vive et savoureuse..
Un tableau réaliste et très intéressant de Cuba.
C'est une vaste chronique de la vie à Cuba. le narrateur, un journaliste en rupture avec son milieu, nous entraîne dans les bas-fonds de la Havane. Il nous fait découvrir une ville au début des années 90, en pleine pénurie. Les personnages rencontrés par le narrateur se débattent dans des difficultés sans nom, pour survivre : manque de nourriture, de savon, climat politique difficile, tout se conjugue pour donner une atmosphère de désespoir, malgré le rhum et la salsa..
Un récit très cru et difficile, centré sur un homme, qui survit grâce à son égoïsme. Une langue vive et savoureuse..
Un tableau réaliste et très intéressant de Cuba.
Chronique des années quatre-vingt-dix à Cuba, celles des images à la télévision de désespérés sur des radeaux de fortune tentant de joindre la Floride, Trilogie sale de la Havane est l'oeuvre qui marque l'entrée fracassante de Pedro Juan Gutierrez dans le monde des lettres. Il y retrousse ses manches et plonge les mains dans la fange. Il décrit le rude quotidien d'Havanais rugueux, dans la promiscuité et la pénurie, condamnés à vivre d'expédients, faisant preuve d'inventivité dans leur chasse aux petites combines Gutierrez fait dans le brutal et l'explicite. Portrait de l'artiste en quadragénaire, le chibre dans une main quand ce n'est pas ailleurs, un verre de rhum de contrebande dans l'autre, quelque chose qui se fume à la bouche, licite ou non, le ventre criant famine. Sexe drogue et cha-cha-cha.
La quatrième de couverture avance le non d'Henry Miller comme célèbre devancier. Il nous semble que l'auteur américain faisait plus dans la littérature. D'autres parlent de Bukowski tropical et d'hyperréalisme obscène, c'est vrai que ce roman est de la veine du réalisme sale, mais il y court une plus grande vitalité que chez Bukowski, une fierté indéniable, une volonté de rester digne malgré la déveine et les années qui passent. Direct comme un crochet à la mâchoire.
La quatrième de couverture avance le non d'Henry Miller comme célèbre devancier. Il nous semble que l'auteur américain faisait plus dans la littérature. D'autres parlent de Bukowski tropical et d'hyperréalisme obscène, c'est vrai que ce roman est de la veine du réalisme sale, mais il y court une plus grande vitalité que chez Bukowski, une fierté indéniable, une volonté de rester digne malgré la déveine et les années qui passent. Direct comme un crochet à la mâchoire.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Pedro Juan Gutierrez (13)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les classiques de la littérature sud-américaine
Quel est l'écrivain colombien associé au "réalisme magique"
Gabriel Garcia Marquez
Luis Sepulveda
Alvaro Mutis
Santiago Gamboa
10 questions
371 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature sud-américaine
, latino-américain
, amérique du sudCréer un quiz sur ce livre371 lecteurs ont répondu