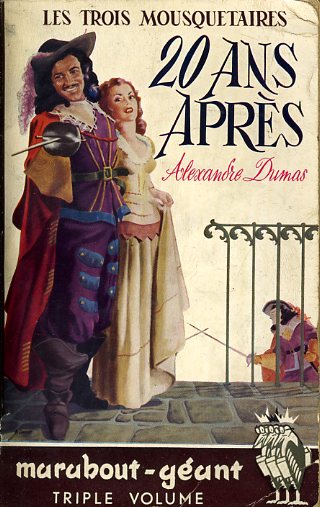Victor HugoLes Misérables tome 2 sur 3
/5 1864 notes
/5 1864 notes
Résumé :
Le drame de Jean Valjean, l'ex-forçat contraint au mal par l'injustice sociale, c'est " le vaste miroir reflétant le genre humain de son siècle ". Sous le nom de Monsieur Madeleine, puis sous celui de Monsieur Fauchelevent, il devient propriétaire d'une maison et connaît les joies de l'amour paternel auprès de Cosette, arrachées à l'affreux couple Thénardier. Mais ces moments de bonheur seront de courte durée Javert le traque avec l'acharnement d'un fanatique, inacc... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les Misérables, tome 2Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (61)
Voir plus
Ajouter une critique
Jeunesse, entourloupe, révolte, ingratitude...
Dans cette version en 2 tomes, nous sommes à la fin de la troisième partie quand commence ce volume.
Marius fait la connaissance de son voisin, alias une vieille connaissance du lecteur dont je vous laisse découvrir l'identité au cas où vous n'auriez pas vu l'une des innombrables adaptations à l'écran.
Une embuscade gigantesque attend l'infortuné Jean Valjean, et toutes les vipères sont prêtes à lui sauter sur le dos.
Marius assiste, impuissant, à l'exécution de ce traquenard diabolique. Il apprend à craindre ce voisin et décide de quitter son voisinage.
Le dépit le gagne car sa belle inconnue lui a glissé entre les doigts.
Ses amis républicains suivent attentivement la montée de la pression sociale et sauront prendre les armes et monter des barricades en temps voulu.
Victor Hugo nous fait entrer de plain-pied dans l'une des multiples insurrections qui ont émaillé la période de la restauration. Il nous fait monter sur les barricades et comprendre pourquoi, quelques années plus tard, Napoléon III a tant tenu à faire redessiner Paris par Haussmann, vu la facilité avec laquelle une guerre de rue pouvait voir le jour dans le Paris d'alors.
L'émeute en question est celle du 5 juin 1832, c'est-à-dire une de celles qui ont avorté, pas comme leurs glorieuses consoeurs de 1830 et 1948.
Marius se joindra-t-il a eux lors de l'insurrection ? Retrouvera-t-il son aimée ? Jean Valjean parviendra-t-il à s'extirper de l'étau et de la malédiction qui le pressent toujours un peu plus ? le père Gillenormand pardonnera-t-il à son petit-fils et le petit-fils au grand-père dans ce gigantesque malentendu ? Hugo saura-t-il nous faire haleter jusqu'au bout ?
La réponse à cette dernière question est oui. Et pour conclure, si papy Hugo ne vous arrache pas une petite larme avec son final, allez d'urgence consulter un cardiologue car vous avez sûrement un petit problème de ce côté-là.
Bref, lisez, re-lisez, re-re-lisez, délectez-vous et chapeau bas très cher Victor ! Mais ceci n'est que mon misérable avis...
Dans cette version en 2 tomes, nous sommes à la fin de la troisième partie quand commence ce volume.
Marius fait la connaissance de son voisin, alias une vieille connaissance du lecteur dont je vous laisse découvrir l'identité au cas où vous n'auriez pas vu l'une des innombrables adaptations à l'écran.
Une embuscade gigantesque attend l'infortuné Jean Valjean, et toutes les vipères sont prêtes à lui sauter sur le dos.
Marius assiste, impuissant, à l'exécution de ce traquenard diabolique. Il apprend à craindre ce voisin et décide de quitter son voisinage.
Le dépit le gagne car sa belle inconnue lui a glissé entre les doigts.
Ses amis républicains suivent attentivement la montée de la pression sociale et sauront prendre les armes et monter des barricades en temps voulu.
Victor Hugo nous fait entrer de plain-pied dans l'une des multiples insurrections qui ont émaillé la période de la restauration. Il nous fait monter sur les barricades et comprendre pourquoi, quelques années plus tard, Napoléon III a tant tenu à faire redessiner Paris par Haussmann, vu la facilité avec laquelle une guerre de rue pouvait voir le jour dans le Paris d'alors.
L'émeute en question est celle du 5 juin 1832, c'est-à-dire une de celles qui ont avorté, pas comme leurs glorieuses consoeurs de 1830 et 1948.
Marius se joindra-t-il a eux lors de l'insurrection ? Retrouvera-t-il son aimée ? Jean Valjean parviendra-t-il à s'extirper de l'étau et de la malédiction qui le pressent toujours un peu plus ? le père Gillenormand pardonnera-t-il à son petit-fils et le petit-fils au grand-père dans ce gigantesque malentendu ? Hugo saura-t-il nous faire haleter jusqu'au bout ?
La réponse à cette dernière question est oui. Et pour conclure, si papy Hugo ne vous arrache pas une petite larme avec son final, allez d'urgence consulter un cardiologue car vous avez sûrement un petit problème de ce côté-là.
Bref, lisez, re-lisez, re-re-lisez, délectez-vous et chapeau bas très cher Victor ! Mais ceci n'est que mon misérable avis...
"Les Misérables" constituent l'un des piliers de la littérature française. C'est presque un lieu commun de déclarer cela et en même temps, c'est très rassurant que ça le soit. Victor Hugo est un monstre dans son domaine et c'est normal que de sa plume se soit naturellement extraite une oeuvre monstrueuse, colossale et dont la grandeur semble insurpassable.
Jamais titre ne fut aussi bien choisi pour introduire une oeuvre. C'est par le titre que le lecteur est d'abord accroché et ce titre "Les Misérables" est un véritable fil d'Ariane tout au long du roman. Tous les personnages de l'oeuvre ont été, sont ou seront à un moment donné dans le récit ce qu'il convient d'appeler "un misérable". de différentes manières : socialement, sentimentalement, pécuniairement, politiquement...
Le récit est très bien mené, les personnages sont fouillés, le rythme est bon, les descriptions sont puissantes, les développements autour de la psychologie et de la nature humaine sont avant-gardistes, le plaisir de lire est intense.
"Les Misérables", un roman prégnant qui place le lecteur devant sa propre humanité, dans un décor grandiose, celui de l'Histoire en mutation et de l'Humanité si désespérément fidèle à elle-même.
Jamais titre ne fut aussi bien choisi pour introduire une oeuvre. C'est par le titre que le lecteur est d'abord accroché et ce titre "Les Misérables" est un véritable fil d'Ariane tout au long du roman. Tous les personnages de l'oeuvre ont été, sont ou seront à un moment donné dans le récit ce qu'il convient d'appeler "un misérable". de différentes manières : socialement, sentimentalement, pécuniairement, politiquement...
Le récit est très bien mené, les personnages sont fouillés, le rythme est bon, les descriptions sont puissantes, les développements autour de la psychologie et de la nature humaine sont avant-gardistes, le plaisir de lire est intense.
"Les Misérables", un roman prégnant qui place le lecteur devant sa propre humanité, dans un décor grandiose, celui de l'Histoire en mutation et de l'Humanité si désespérément fidèle à elle-même.
A la fin du tome 1 ( ma collection Nelson comporte 4 tomes ), je me demandais si Jean Valjean réussirait à extirper la pauvre Cosette des mains des avides Thénardier.
A la fin du tome 2, c'est la même problématique, Jean Valjean, alias M. Leblanc, cette fois, 8 ans plus tard, retourne par hasard chez Thénardier qu'il ne reconnaît pas, sauf que celui-ci, plus misérable encore, est capable du pire, allié à la bande Patron-Minette.
Le tenace inspecteur Javert, "homme de haute taille", n'est pas loin.
Un nouveau personnage apparaît : Marius, au grand-père terrible. Marius, avocat pauvre, a un coup de foudre pour Cosette, qui a 16 ans maintenant, et, heureuse, s'est transformée en belle jeune fille.
Gavroche Thénardier apparaît aussi, mais succinctement dans ce tome.
.
Plusieurs réflexions me viennent à l'esprit sur ce tome.
1 ) Ne fais confiance à personne dès qu'il y a un intérêt, que ce soit le sombre Thénardier, le vieux mendiant ou la vieille portière de Gorbeau.
2 ) Hugo profite de la formidable escalade de Jean Valjean du mur du couvent des Bénédictines / Bernardines du petit Picpus pour donner son sentiment sur la religion, que je résume ainsi :
"Nous sommes pour la religion, pas pour les religions".
3 ) le bagne et le cloître semblent identiques aux yeux d'Hugo, ce sont des exclusions sociales injustes.
4 ) Avec Gavroche, Hugo étudie le gamin de Paris, mais je pense qu'il faut vivre au XIXè siècle pour comprendre l'enfant de ville abandonné et libre. Peut-on les comparer à nos jeunes de banlieues ?
5 ) Pour Charles de Gaulle, Paris, c'étaient quelques adjectifs en 1945, mais pour Hugo, c'est un feu d'artifice, et, comme pour le couvent, une longue digression peu intéressante pour moi qui n'ai rien compris à cette ville : )
6 ) 1830 est un foisonnement politique où les vieux foyers ultra, comme le salon fréquenté par M.Gillenormand côtoient avec mépris les jacobins "guillotineurs" de la première république, les "sabreurs" bonapartistes, les "restaurateurs de la royauté" et les républicains démocrates relativement utopistes dont fait partie Victor Hugo, je pense.
7 ) Émouvant, le ratage de la rencontre père-fils, entre le lion devenu agneau Georges Pontmercy et son fils Marius qui, du coup, ne sait plus où il en est, politiquement, versant fougueusement de l'ultra du grand-père au bonapartisme du père. D'où la "colère politique" de Marius devant les étudiants de l'ABC, envolée-colère éteinte d'une superbe phrase laminaire du philosophe de la bande : Combeferre.
8 ) Hugo, à travers les conversations des étudiants de l'ABC, là encore donne tout son savoir et s'envole dans le lyrisme, avec effusion de références athéniennes, romaines et françaises dans les arguments et contre-arguments de protagonistes.
.
Enfin, je trouve que Victor Hugo a ce don de pénétrer l'âme de chacun de ses personnages, et d'intéresser le lecteur à la motivation profonde de chacun, même si le personnage est antipathique : )
A la fin du tome 2, c'est la même problématique, Jean Valjean, alias M. Leblanc, cette fois, 8 ans plus tard, retourne par hasard chez Thénardier qu'il ne reconnaît pas, sauf que celui-ci, plus misérable encore, est capable du pire, allié à la bande Patron-Minette.
Le tenace inspecteur Javert, "homme de haute taille", n'est pas loin.
Un nouveau personnage apparaît : Marius, au grand-père terrible. Marius, avocat pauvre, a un coup de foudre pour Cosette, qui a 16 ans maintenant, et, heureuse, s'est transformée en belle jeune fille.
Gavroche Thénardier apparaît aussi, mais succinctement dans ce tome.
.
Plusieurs réflexions me viennent à l'esprit sur ce tome.
1 ) Ne fais confiance à personne dès qu'il y a un intérêt, que ce soit le sombre Thénardier, le vieux mendiant ou la vieille portière de Gorbeau.
2 ) Hugo profite de la formidable escalade de Jean Valjean du mur du couvent des Bénédictines / Bernardines du petit Picpus pour donner son sentiment sur la religion, que je résume ainsi :
"Nous sommes pour la religion, pas pour les religions".
3 ) le bagne et le cloître semblent identiques aux yeux d'Hugo, ce sont des exclusions sociales injustes.
4 ) Avec Gavroche, Hugo étudie le gamin de Paris, mais je pense qu'il faut vivre au XIXè siècle pour comprendre l'enfant de ville abandonné et libre. Peut-on les comparer à nos jeunes de banlieues ?
5 ) Pour Charles de Gaulle, Paris, c'étaient quelques adjectifs en 1945, mais pour Hugo, c'est un feu d'artifice, et, comme pour le couvent, une longue digression peu intéressante pour moi qui n'ai rien compris à cette ville : )
6 ) 1830 est un foisonnement politique où les vieux foyers ultra, comme le salon fréquenté par M.Gillenormand côtoient avec mépris les jacobins "guillotineurs" de la première république, les "sabreurs" bonapartistes, les "restaurateurs de la royauté" et les républicains démocrates relativement utopistes dont fait partie Victor Hugo, je pense.
7 ) Émouvant, le ratage de la rencontre père-fils, entre le lion devenu agneau Georges Pontmercy et son fils Marius qui, du coup, ne sait plus où il en est, politiquement, versant fougueusement de l'ultra du grand-père au bonapartisme du père. D'où la "colère politique" de Marius devant les étudiants de l'ABC, envolée-colère éteinte d'une superbe phrase laminaire du philosophe de la bande : Combeferre.
8 ) Hugo, à travers les conversations des étudiants de l'ABC, là encore donne tout son savoir et s'envole dans le lyrisme, avec effusion de références athéniennes, romaines et françaises dans les arguments et contre-arguments de protagonistes.
.
Enfin, je trouve que Victor Hugo a ce don de pénétrer l'âme de chacun de ses personnages, et d'intéresser le lecteur à la motivation profonde de chacun, même si le personnage est antipathique : )
Une terrible rencontre que celle de Jean Valean et de Fantine, une rencontre à la fois de l'espoir et du désespoir, une rencontre à jamais de devoir...un brin d'espoir luit sur les lèvres de Fantine, voici enfin que M Madeleine, M le maire promet d'aller reprendre sa fille entre les mains des Thénardier et de les mettre à l'abri du besoin...tout tarde... Fantine meurt...
Mais pour M Madeleine qui n'est autre que Jean Valjean, le devoir l'appelle, il faut sauver Cosette, la fille de Fantine allant jusqu'à braver les péripéties de sa conscience qui l'insinue à se conformer à la justice après qu'il se soit fait démasquer en tant que Jean Valjean, allant jusqu'à s'enfuir une fois de plus de la prison et braver les poursuites interminables de l'inspecteur Javert...
L'excellente maîtrise de l'art du récit et de la poésie de Victor Hugo nous tient en haleine notamment dans l''implantation de chaque scène, de chaque situation et l'intervention de chaque personnage...
Mais pour M Madeleine qui n'est autre que Jean Valjean, le devoir l'appelle, il faut sauver Cosette, la fille de Fantine allant jusqu'à braver les péripéties de sa conscience qui l'insinue à se conformer à la justice après qu'il se soit fait démasquer en tant que Jean Valjean, allant jusqu'à s'enfuir une fois de plus de la prison et braver les poursuites interminables de l'inspecteur Javert...
L'excellente maîtrise de l'art du récit et de la poésie de Victor Hugo nous tient en haleine notamment dans l''implantation de chaque scène, de chaque situation et l'intervention de chaque personnage...
Jean Valjean est le personnage principal de ce tome 1 (1/2) .Et quelle présence sur ces 1000 pages! On apprend qu'il revient du bagne de Toulon où il a passé 19 ans pour avoir volé un pain. La prison et son injustice, l'ont rendu haineux vis à vis de la société.
L'évêque Meyriel, est présenté dès les premières pages comme un juste. Il faudra au moins cette rencontre pour détourner notre héros d'une destinée , malgré lui, de voleur ou de tueur. Ainsi, de multiples personnages très fouillés et intéressants ( Fantine, Javert, les Thénardier, Cosette, Fauchelevent) vont croiser le chemin de l'ancien forçat, en constante lutte pour, non seulement,sa survie mais aussi celle des misérables qu'il représente.
Victor Hugo a écrit un chef d'oeuvre. Mais il n'est pas simple à lire.
Il y a quelques longueurs:
Ah la 3ème partie appelée "Marius"... La présentation de la famille Gillenormand souffre de l'absence de lien immédiat avec notre héros et la ferveur à tourner les pages peut retomber parfois.
Qu'à cela ne tienne, le lecteur pourra lui pardonner ça et quelques disgressions, puisque cette oeuvre est classée comme un des livres majeurs de la littérature du 19ème siècle.
Il fait tellement partie du patrimoine que les multiples adaptations cinématographiques ont peut-être ramolli la volonté de le lire de beaucoup de lecteurs.
Dont moi. C'est vrai, pourquoi lire les détails d'une histoire (de 2000 pages)que l'on connaît déjà grâce aux talentueux acteurs qui ont interprété les personnages de ce roman?
Je crois que l'on peut se saisir de quelques images de ces écrans et peut-être les raccrocher au livre. Dans le film de Robert Hossein, celles de Lino Ventura dans le rôle de Jean Valjean et de Michel Bouquet dans celui de Javert peuvent, par exemple, servir cet imaginaire.
L'évêque Meyriel, est présenté dès les premières pages comme un juste. Il faudra au moins cette rencontre pour détourner notre héros d'une destinée , malgré lui, de voleur ou de tueur. Ainsi, de multiples personnages très fouillés et intéressants ( Fantine, Javert, les Thénardier, Cosette, Fauchelevent) vont croiser le chemin de l'ancien forçat, en constante lutte pour, non seulement,sa survie mais aussi celle des misérables qu'il représente.
Victor Hugo a écrit un chef d'oeuvre. Mais il n'est pas simple à lire.
Il y a quelques longueurs:
Ah la 3ème partie appelée "Marius"... La présentation de la famille Gillenormand souffre de l'absence de lien immédiat avec notre héros et la ferveur à tourner les pages peut retomber parfois.
Qu'à cela ne tienne, le lecteur pourra lui pardonner ça et quelques disgressions, puisque cette oeuvre est classée comme un des livres majeurs de la littérature du 19ème siècle.
Il fait tellement partie du patrimoine que les multiples adaptations cinématographiques ont peut-être ramolli la volonté de le lire de beaucoup de lecteurs.
Dont moi. C'est vrai, pourquoi lire les détails d'une histoire (de 2000 pages)que l'on connaît déjà grâce aux talentueux acteurs qui ont interprété les personnages de ce roman?
Je crois que l'on peut se saisir de quelques images de ces écrans et peut-être les raccrocher au livre. Dans le film de Robert Hossein, celles de Lino Ventura dans le rôle de Jean Valjean et de Michel Bouquet dans celui de Javert peuvent, par exemple, servir cet imaginaire.
Citations et extraits (387)
Voir plus
Ajouter une citation
C'est devant cette maison Gorbeau que Jean Valjean s'arrêta. Comme les oiseaux sauvages, il avait choisi cet endroit désertique pour construire son nid.
Il fouilla dans la poche de son gilet, en sortit une sorte de passe-partout, ouvrit la porte, entra, la referma soigneusement, et monta l'escalier, portant toujours Cosette.
En haut de l'escalier, il sortit de sa poche une autre clé avec laquelle il ouvrit une autre porte. La chambre dans laquelle il entra, et qu'il referma aussitôt, était une sorte de grenier moyennement spacieux, meublé d'un matelas posé à terre, d'une table et de plusieurs chaises ; un poêle dans lequel brûlait un feu et dont les braises étaient visibles se trouvait dans un coin. Une lanterne sur le boulevard jetait une vague lumière dans cette pauvre chambre. A l'extrémité, il y avait un dressing avec un lit pliant ; Jean Valjean porta l'enfant jusqu'à ce lit et l'y coucha sans la réveiller. Il craqua une allumette et alluma une bougie. Tout cela était préparé d'avance sur la table, et, comme la veille au soir, il se mit à scruter le visage de Cosette avec un regard plein d'extase, où l'expression de bonté et de tendresse allait presque jusqu'à l'aberration. La petite fille, avec cette confiance tranquille qui n'appartient qu'à l'extrême force et à l'extrême faiblesse, s'était endormie sans savoir avec qui elle était, et continuait à dormir sans savoir où elle était.
Jean Valjean se pencha et baisa la main de cet enfant.
Neuf mois auparavant, il avait baisé la main de la mère, qui venait elle aussi de s'endormir.
Le même sentiment triste, perçant et religieux remplissait son cœur.
Il s'agenouilla près du lit de Cosette.
Il faisait grand jour et l'enfant dormait encore. Un pâle rayon du soleil de décembre pénétrait par la fenêtre du grenier et s'étendait sur le plafond en longs filets d'ombre et de lumière. Tout à coup, une charrette lourdement chargée, qui passait sur le boulevard, secoua le lit frêle, comme un coup de tonnerre, et le fit frémir de haut en bas.
"Oui madame!" s'écria Cosette en se réveillant en sursaut, me voici ! me voici !
Et elle sauta du lit, les yeux encore à moitié fermés par la lourdeur du sommeil, étendant les bras vers le coin du mur.
"Ah ! mon Dieu, mon balai !" dit-elle.
Il fouilla dans la poche de son gilet, en sortit une sorte de passe-partout, ouvrit la porte, entra, la referma soigneusement, et monta l'escalier, portant toujours Cosette.
En haut de l'escalier, il sortit de sa poche une autre clé avec laquelle il ouvrit une autre porte. La chambre dans laquelle il entra, et qu'il referma aussitôt, était une sorte de grenier moyennement spacieux, meublé d'un matelas posé à terre, d'une table et de plusieurs chaises ; un poêle dans lequel brûlait un feu et dont les braises étaient visibles se trouvait dans un coin. Une lanterne sur le boulevard jetait une vague lumière dans cette pauvre chambre. A l'extrémité, il y avait un dressing avec un lit pliant ; Jean Valjean porta l'enfant jusqu'à ce lit et l'y coucha sans la réveiller. Il craqua une allumette et alluma une bougie. Tout cela était préparé d'avance sur la table, et, comme la veille au soir, il se mit à scruter le visage de Cosette avec un regard plein d'extase, où l'expression de bonté et de tendresse allait presque jusqu'à l'aberration. La petite fille, avec cette confiance tranquille qui n'appartient qu'à l'extrême force et à l'extrême faiblesse, s'était endormie sans savoir avec qui elle était, et continuait à dormir sans savoir où elle était.
Jean Valjean se pencha et baisa la main de cet enfant.
Neuf mois auparavant, il avait baisé la main de la mère, qui venait elle aussi de s'endormir.
Le même sentiment triste, perçant et religieux remplissait son cœur.
Il s'agenouilla près du lit de Cosette.
Il faisait grand jour et l'enfant dormait encore. Un pâle rayon du soleil de décembre pénétrait par la fenêtre du grenier et s'étendait sur le plafond en longs filets d'ombre et de lumière. Tout à coup, une charrette lourdement chargée, qui passait sur le boulevard, secoua le lit frêle, comme un coup de tonnerre, et le fit frémir de haut en bas.
"Oui madame!" s'écria Cosette en se réveillant en sursaut, me voici ! me voici !
Et elle sauta du lit, les yeux encore à moitié fermés par la lourdeur du sommeil, étendant les bras vers le coin du mur.
"Ah ! mon Dieu, mon balai !" dit-elle.
C'est moi qui me barre à moi-même le passage, et je me traîne, et je me pousse, et je m'arrête, et je m'exécute, et quand on se tient soi-même, on est bien tenu.
Description de la bataille de Waterloo - Tome 1 - page 453
Chapitre XVI. Quot Libras in Duce?
La bataille de Waterloo est une énigme. Elle est aussi obscure pour ceux qui l'ont gagnée que pour celui qui l'a perdue. Pour Napoléon, c'est une panique. Blücher n'y voit que du feu; Wellington n'y comprend rien. Voyez les rapports. Les bulletins sont confus, les commentaires sont embrouillés. Ceux-ci balbutient, ceux-là bégayent. Jomini partage la bataille de Waterloo en quatre moments; Muffling la coupe en trois péripéties; Charras, quoique sur quelques points nous ayons une autre appréciation que lui, a seul saisi de son fier coup d'œil les linéaments caractéristiques de cette catastrophe du génie humain aux prises avec le hasard divin. Tous les autres historiens ont un certain éblouissement, et dans cet éblouissement ils tâtonnent. Journée fulgurante, en effet, écroulement de la monarchie militaire qui, à la grande stupeur des rois, a entraîné tous les royaumes, chute de la force, déroute de la guerre.
Dans cet événement, empreint de nécessité surhumaine, la part des hommes n'est rien. Retirer Waterloo à Wellington et à Blücher, est-ce ôter quelque chose à l'Angleterre et à l'Allemagne? Non. Ni cette illustre Angleterre ni cette auguste Allemagne ne sont en question dans le problème de Waterloo. Grâce au ciel, les peuples sont grands en dehors des lugubres aventures de l'épée. Ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni la France, ne tiennent dans un fourreau. Dans cette époque où Waterloo n'est qu'un cliquetis de sabres, au-dessus de Blücher l'Allemagne a Goethe et au-dessus de Wellington l'Angleterre a Byron. Un vaste lever d'idées est propre à notre siècle, et dans cette aurore l'Angleterre et l'Allemagne ont leur lueur magnifique. Elles sont majestueuses par ce qu'elles pensent. L'élévation de niveau qu'elles apportent à la civilisation leur est intrinsèque; il vient d'elles-mêmes, et non d'un accident. Ce qu'elles ont d'agrandissement au dix-neuvième siècle n'a point Waterloo pour source. Il n'y a que les peuples barbares qui aient des crues subites après une victoire. C'est la vanité passagère des torrents enflés d'un orage. Les peuples civilisés, surtout au temps où nous sommes, ne se haussent ni ne s'abaissent par la bonne ou mauvaise fortune d'un capitaine. Leur poids spécifique dans le genre humain résulte de quelque chose de plus qu'un combat. Leur honneur, Dieu merci, leur dignité, leur lumière, leur génie, ne sont pas des numéros que les héros et les conquérants, ces joueurs, peuvent mettre à la loterie des batailles. Souvent bataille perdue, progrès conquis. Moins de gloire, plus de liberté. Le tambour se tait, la raison prend la parole. C'est le jeu à qui perd gagne. Parlons donc de Waterloo froidement des deux côtés. Rendons au hasard ce qui est au hasard et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Waterloo? Une victoire? Non. Un quine.
Quine gagné par l'Europe, payé par la France.
Ce n'était pas beaucoup la peine de mettre là un lion.
Waterloo du reste est la plus étrange rencontre qui soit dans l'histoire. Napoléon et Wellington. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des contraires. Jamais Dieu, qui se plaît aux antithèses, n'a fait un plus saisissant contraste et une confrontation plus extraordinaire. D'un côté, la précision, la prévision, la géométrie, la prudence, la retraite assurée, les réserves ménagées, un sang-froid opiniâtre, une méthode imperturbable, la stratégie qui profite du terrain, la tactique qui équilibre les bataillons, le carnage tiré au cordeau, la guerre réglée montre en main, rien laissé volontairement au hasard, le vieux courage classique, la correction absolue; de l'autre l'intuition, la divination, l'étrangeté militaire, l'instinct surhumain, le coup d'œil flamboyant, on ne sait quoi qui regarde comme l'aigle et qui frappe comme la foudre, un art prodigieux dans une impétuosité dédaigneuse, tous les mystères d'une âme profonde, l'association avec le destin, le fleuve, la plaine, la forêt, la colline, sommés et en quelque sorte forcés d'obéir, le despote allant jusqu'à tyranniser le champ de bataille, la foi à l'étoile mêlée à la science stratégique, la grandissant, mais la troublant. Wellington était le Barème de la guerre, Napoléon en était le Michel-Ange; et cette fois le génie fut vaincu par le calcul.
Des deux côtés on attendait quelqu'un. Ce fut le calculateur exact qui réussit. Napoléon attendait Grouchy; il ne vint pas. Wellington attendait Blücher; il vint.
Wellington, c'est la guerre classique qui prend sa revanche. Bonaparte, à son aurore, l'avait rencontrée en Italie, et superbement battue. La vieille chouette avait fui devant le jeune vautour. L'ancienne tactique avait été non seulement foudroyée, mais scandalisée. Qu'était-ce que ce Corse de vingt-six ans, que signifiait cet ignorant splendide qui, ayant tout contre lui, rien pour lui, sans vivres, sans munitions, sans canons, sans souliers, presque sans armée, avec une poignée d'hommes contre des masses, se ruait sur l'Europe coalisée, et gagnait absurdement des victoires dans l'impossible? D'où sortait ce forcené foudroyant qui, presque sans reprendre haleine, et avec le même jeu de combattants dans la main, pulvérisait l'une après l'autre les cinq armées de l'empereur d'Allemagne, culbutant Beaulieu sur Alvinzi, Wurmser sur Beaulieu, Mélas sur Wurmser, Mack sur Mélas? Qu'était-ce que ce nouveau venu de la guerre ayant l'effronterie d'un astre? L'école académique militaire l'excommuniait en lâchant pied. De là une implacable rancune du vieux césarisme contre le nouveau, du sabre correct contre l'épée flamboyante, et de l'échiquier contre le génie. Le 18 juin 1815, cette rancune eut le dernier mot, et au-dessous de Lodi, de Montebello, de Montenotte, de Mantoue, de Marengo, d'Arcole, elle écrivit: Waterloo. Triomphe des médiocres, doux aux majorités. Le destin consentit à cette ironie. A son déclin, Napoléon retrouva devant lui Wurmser jeune.
Pour avoir Wurmser en effet, il suffît de blanchir les cheveux de Wellington.
Waterloo est une bataille du premier ordre gagnée par un capitaine du second.
Ce qu'il faut admirer dans la bataille de Waterloo, c'est l'Angleterre, c'est la fermeté anglaise, c'est la résolution anglaise, c'est le sang anglais; ce que l'Angleterre a eu là de superbe, ne lui en déplaise, c'est elle-même. Ce n'est pas son capitaine, c'est son armée. Wellington, bizarrement ingrat, déclare dans une lettre à lord Bathurst que son armée, l'armée qui a combattu le 18 juin 1815, était une «détestable armée». Qu'en pense cette sombre mêlée d'ossements enfouis sous les sillons de Waterloo?
L'Angleterre a été trop modeste vis-à-vis de Wellington. Faire Wellington si grand, c'est faire l'Angleterre petite. Wellington n'est qu'un héros comme un autre. Ces Écossais gris, ces horse-guards, ces régiments de Maitland et de Mitchell, cette infanterie de Pack et de Kempt, cette cavalerie de Ponsonby et de Somerset, ces highlanders jouant du pibroch sous la mitraille, ces bataillons de Rylandt, ces recrues toutes fraîches qui savaient à peine manier le mousquet tenant tête aux vieilles bandes d'Essling et de Rivoli, voilà ce qui est grand. Wellington a été tenace, ce fut là son mérite, et nous ne le lui marchandons pas, mais le moindre de ses fantassins et de ses cavaliers a été tout aussi solide que lui. L'iron-soldier vaut l'iron-duke. Quant à nous, toute notre glorification va au soldat anglais, à l'armée anglaise, au peuple anglais. Si trophée il y a, c'est à l'Angleterre que le trophée est dû. La colonne de Waterloo serait plus juste si au lieu de la figure d'un homme, elle élevait dans la nue la statue d'un peuple.
Mais cette grande Angleterre s'irritera de ce que nous disons ici. Elle a encore, après son 1688 et notre 1789, l'illusion féodale. Elle croit à l'hérédité et à la hiérarchie. Ce peuple, qu'aucun ne dépasse en puissance et en gloire, s'estime comme nation, non comme peuple. En tant que peuple, il se subordonne volontiers et prend un lord pour une tête. Workman, il se laisse dédaigner; soldat, il se laisse bâtonner. On se souvient qu'à la bataille d'Inkermann un sergent qui, à ce qu'il paraît, avait sauvé l'armée, ne put être mentionné par lord Raglan, la hiérarchie militaire anglaise ne permettant de citer dans un rapport aucun héros au-dessous du grade d'officier.
Ce que nous admirons par-dessus tout, dans une rencontre du genre de celle de Waterloo, c'est la prodigieuse habileté du hasard. Pluie nocturne, mur de Hougomont, chemin creux d'Ohain, Grouchy sourd au canon, guide de Napoléon qui le trompe, guide de Bülow qui l'éclaire; tout ce cataclysme est merveilleusement conduit.
Au total, disons-le, il y eut à Waterloo plus de massacre que de bataille.
Waterloo est de toutes les batailles rangées celle qui a le plus petit front sur un tel nombre de combattants. Napoléon, trois quarts de lieue, Wellington, une demi-lieue; soixante-douze mille combattants de chaque côté. De cette épaisseur vint le carnage.
On a fait ce calcul et établi cette proportion: Perte d'hommes: à Austerlitz, Français, quatorze pour cent; Russes, trente pour cent, Autrichiens, quarante-quatre pour cent. A Wagram, Français, treize pour cent; Autrichiens, quatorze. A la Moskova, Français, trente-sept pour cent; Russes, quarante-quatre. A Bautzen, Français, treize pour cent; Russes et Prussiens, quatorze. A Waterloo, Français, cinquante-six pour cent; Alliés, trente et un. Total pour Waterloo, quarante et un pour cent. Cent quarante-quatre mille combattants; soixante mille morts.
Le champ de Waterloo aujourd'hui a le calme qui appartient à la terre, support impassible de l'homme, et il ressemble à toutes les plaines.
La nuit pourtant une espèce de brume visionnaire s'en dégage, et si quelque voyageur s'y promène, s'il regarde, s'il écoute, s'il rêve comme Virgile devant les funestes plaines de Philippes, l'hallucination de la catastrophe le saisit. L'effrayant 18 juin revit;
Chapitre XVI. Quot Libras in Duce?
La bataille de Waterloo est une énigme. Elle est aussi obscure pour ceux qui l'ont gagnée que pour celui qui l'a perdue. Pour Napoléon, c'est une panique. Blücher n'y voit que du feu; Wellington n'y comprend rien. Voyez les rapports. Les bulletins sont confus, les commentaires sont embrouillés. Ceux-ci balbutient, ceux-là bégayent. Jomini partage la bataille de Waterloo en quatre moments; Muffling la coupe en trois péripéties; Charras, quoique sur quelques points nous ayons une autre appréciation que lui, a seul saisi de son fier coup d'œil les linéaments caractéristiques de cette catastrophe du génie humain aux prises avec le hasard divin. Tous les autres historiens ont un certain éblouissement, et dans cet éblouissement ils tâtonnent. Journée fulgurante, en effet, écroulement de la monarchie militaire qui, à la grande stupeur des rois, a entraîné tous les royaumes, chute de la force, déroute de la guerre.
Dans cet événement, empreint de nécessité surhumaine, la part des hommes n'est rien. Retirer Waterloo à Wellington et à Blücher, est-ce ôter quelque chose à l'Angleterre et à l'Allemagne? Non. Ni cette illustre Angleterre ni cette auguste Allemagne ne sont en question dans le problème de Waterloo. Grâce au ciel, les peuples sont grands en dehors des lugubres aventures de l'épée. Ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni la France, ne tiennent dans un fourreau. Dans cette époque où Waterloo n'est qu'un cliquetis de sabres, au-dessus de Blücher l'Allemagne a Goethe et au-dessus de Wellington l'Angleterre a Byron. Un vaste lever d'idées est propre à notre siècle, et dans cette aurore l'Angleterre et l'Allemagne ont leur lueur magnifique. Elles sont majestueuses par ce qu'elles pensent. L'élévation de niveau qu'elles apportent à la civilisation leur est intrinsèque; il vient d'elles-mêmes, et non d'un accident. Ce qu'elles ont d'agrandissement au dix-neuvième siècle n'a point Waterloo pour source. Il n'y a que les peuples barbares qui aient des crues subites après une victoire. C'est la vanité passagère des torrents enflés d'un orage. Les peuples civilisés, surtout au temps où nous sommes, ne se haussent ni ne s'abaissent par la bonne ou mauvaise fortune d'un capitaine. Leur poids spécifique dans le genre humain résulte de quelque chose de plus qu'un combat. Leur honneur, Dieu merci, leur dignité, leur lumière, leur génie, ne sont pas des numéros que les héros et les conquérants, ces joueurs, peuvent mettre à la loterie des batailles. Souvent bataille perdue, progrès conquis. Moins de gloire, plus de liberté. Le tambour se tait, la raison prend la parole. C'est le jeu à qui perd gagne. Parlons donc de Waterloo froidement des deux côtés. Rendons au hasard ce qui est au hasard et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Waterloo? Une victoire? Non. Un quine.
Quine gagné par l'Europe, payé par la France.
Ce n'était pas beaucoup la peine de mettre là un lion.
Waterloo du reste est la plus étrange rencontre qui soit dans l'histoire. Napoléon et Wellington. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des contraires. Jamais Dieu, qui se plaît aux antithèses, n'a fait un plus saisissant contraste et une confrontation plus extraordinaire. D'un côté, la précision, la prévision, la géométrie, la prudence, la retraite assurée, les réserves ménagées, un sang-froid opiniâtre, une méthode imperturbable, la stratégie qui profite du terrain, la tactique qui équilibre les bataillons, le carnage tiré au cordeau, la guerre réglée montre en main, rien laissé volontairement au hasard, le vieux courage classique, la correction absolue; de l'autre l'intuition, la divination, l'étrangeté militaire, l'instinct surhumain, le coup d'œil flamboyant, on ne sait quoi qui regarde comme l'aigle et qui frappe comme la foudre, un art prodigieux dans une impétuosité dédaigneuse, tous les mystères d'une âme profonde, l'association avec le destin, le fleuve, la plaine, la forêt, la colline, sommés et en quelque sorte forcés d'obéir, le despote allant jusqu'à tyranniser le champ de bataille, la foi à l'étoile mêlée à la science stratégique, la grandissant, mais la troublant. Wellington était le Barème de la guerre, Napoléon en était le Michel-Ange; et cette fois le génie fut vaincu par le calcul.
Des deux côtés on attendait quelqu'un. Ce fut le calculateur exact qui réussit. Napoléon attendait Grouchy; il ne vint pas. Wellington attendait Blücher; il vint.
Wellington, c'est la guerre classique qui prend sa revanche. Bonaparte, à son aurore, l'avait rencontrée en Italie, et superbement battue. La vieille chouette avait fui devant le jeune vautour. L'ancienne tactique avait été non seulement foudroyée, mais scandalisée. Qu'était-ce que ce Corse de vingt-six ans, que signifiait cet ignorant splendide qui, ayant tout contre lui, rien pour lui, sans vivres, sans munitions, sans canons, sans souliers, presque sans armée, avec une poignée d'hommes contre des masses, se ruait sur l'Europe coalisée, et gagnait absurdement des victoires dans l'impossible? D'où sortait ce forcené foudroyant qui, presque sans reprendre haleine, et avec le même jeu de combattants dans la main, pulvérisait l'une après l'autre les cinq armées de l'empereur d'Allemagne, culbutant Beaulieu sur Alvinzi, Wurmser sur Beaulieu, Mélas sur Wurmser, Mack sur Mélas? Qu'était-ce que ce nouveau venu de la guerre ayant l'effronterie d'un astre? L'école académique militaire l'excommuniait en lâchant pied. De là une implacable rancune du vieux césarisme contre le nouveau, du sabre correct contre l'épée flamboyante, et de l'échiquier contre le génie. Le 18 juin 1815, cette rancune eut le dernier mot, et au-dessous de Lodi, de Montebello, de Montenotte, de Mantoue, de Marengo, d'Arcole, elle écrivit: Waterloo. Triomphe des médiocres, doux aux majorités. Le destin consentit à cette ironie. A son déclin, Napoléon retrouva devant lui Wurmser jeune.
Pour avoir Wurmser en effet, il suffît de blanchir les cheveux de Wellington.
Waterloo est une bataille du premier ordre gagnée par un capitaine du second.
Ce qu'il faut admirer dans la bataille de Waterloo, c'est l'Angleterre, c'est la fermeté anglaise, c'est la résolution anglaise, c'est le sang anglais; ce que l'Angleterre a eu là de superbe, ne lui en déplaise, c'est elle-même. Ce n'est pas son capitaine, c'est son armée. Wellington, bizarrement ingrat, déclare dans une lettre à lord Bathurst que son armée, l'armée qui a combattu le 18 juin 1815, était une «détestable armée». Qu'en pense cette sombre mêlée d'ossements enfouis sous les sillons de Waterloo?
L'Angleterre a été trop modeste vis-à-vis de Wellington. Faire Wellington si grand, c'est faire l'Angleterre petite. Wellington n'est qu'un héros comme un autre. Ces Écossais gris, ces horse-guards, ces régiments de Maitland et de Mitchell, cette infanterie de Pack et de Kempt, cette cavalerie de Ponsonby et de Somerset, ces highlanders jouant du pibroch sous la mitraille, ces bataillons de Rylandt, ces recrues toutes fraîches qui savaient à peine manier le mousquet tenant tête aux vieilles bandes d'Essling et de Rivoli, voilà ce qui est grand. Wellington a été tenace, ce fut là son mérite, et nous ne le lui marchandons pas, mais le moindre de ses fantassins et de ses cavaliers a été tout aussi solide que lui. L'iron-soldier vaut l'iron-duke. Quant à nous, toute notre glorification va au soldat anglais, à l'armée anglaise, au peuple anglais. Si trophée il y a, c'est à l'Angleterre que le trophée est dû. La colonne de Waterloo serait plus juste si au lieu de la figure d'un homme, elle élevait dans la nue la statue d'un peuple.
Mais cette grande Angleterre s'irritera de ce que nous disons ici. Elle a encore, après son 1688 et notre 1789, l'illusion féodale. Elle croit à l'hérédité et à la hiérarchie. Ce peuple, qu'aucun ne dépasse en puissance et en gloire, s'estime comme nation, non comme peuple. En tant que peuple, il se subordonne volontiers et prend un lord pour une tête. Workman, il se laisse dédaigner; soldat, il se laisse bâtonner. On se souvient qu'à la bataille d'Inkermann un sergent qui, à ce qu'il paraît, avait sauvé l'armée, ne put être mentionné par lord Raglan, la hiérarchie militaire anglaise ne permettant de citer dans un rapport aucun héros au-dessous du grade d'officier.
Ce que nous admirons par-dessus tout, dans une rencontre du genre de celle de Waterloo, c'est la prodigieuse habileté du hasard. Pluie nocturne, mur de Hougomont, chemin creux d'Ohain, Grouchy sourd au canon, guide de Napoléon qui le trompe, guide de Bülow qui l'éclaire; tout ce cataclysme est merveilleusement conduit.
Au total, disons-le, il y eut à Waterloo plus de massacre que de bataille.
Waterloo est de toutes les batailles rangées celle qui a le plus petit front sur un tel nombre de combattants. Napoléon, trois quarts de lieue, Wellington, une demi-lieue; soixante-douze mille combattants de chaque côté. De cette épaisseur vint le carnage.
On a fait ce calcul et établi cette proportion: Perte d'hommes: à Austerlitz, Français, quatorze pour cent; Russes, trente pour cent, Autrichiens, quarante-quatre pour cent. A Wagram, Français, treize pour cent; Autrichiens, quatorze. A la Moskova, Français, trente-sept pour cent; Russes, quarante-quatre. A Bautzen, Français, treize pour cent; Russes et Prussiens, quatorze. A Waterloo, Français, cinquante-six pour cent; Alliés, trente et un. Total pour Waterloo, quarante et un pour cent. Cent quarante-quatre mille combattants; soixante mille morts.
Le champ de Waterloo aujourd'hui a le calme qui appartient à la terre, support impassible de l'homme, et il ressemble à toutes les plaines.
La nuit pourtant une espèce de brume visionnaire s'en dégage, et si quelque voyageur s'y promène, s'il regarde, s'il écoute, s'il rêve comme Virgile devant les funestes plaines de Philippes, l'hallucination de la catastrophe le saisit. L'effrayant 18 juin revit;
III Foliis ac frondibus
tome 1 page 198
Ce jardin ainsi livré à lui-même depuis plus d'un demi-siècle était devenu extraordinaire et charmant. Les passants d'il y a quarante ans s'arrêtaient dans cette rue pour le contempler, sans se douter des secrets qu'il dérobait derrière ses épaisseurs fraîches et vertes. Plus d'un songeur h cette époque a laissé bien des fois ses yeux et sa pensée pénétrer indiscrètement à travers les barreaux de l'antique grille cadenassée, tordue, branlante, scellée à deux piliers verdis et moussus, bizarrement couronnée d'un fronton d'arabesques indéchiffrables.
1l y avait un banc de pierre dans un coin, une ou deux statues moisies, quelques treillages décloués par le temps pourrissant sur le mur, du reste plus d'allées ni de gazon ; du chiendent partout. Le jardinage était parti, et la nature était revenue. Les mauvaises herbes abondaient, aventure admirable pour un pauvre coin de terre. La fête des giroflées y était splendide. Rien dans ce jardin ne contrariait l'effort sacré des choses vers la vie; la croissance vénérable était là chez elle. Les arbres s'étaient baissés vers les ronces, les ronces étaient montées vers les arbres, la plante avait grimpé, la branche avait fléchi, ce qui rampe sur la terre avait été trouver ce qui s'épanouit dans l'air, ce qui flotte au vent s'était penché vers ce qui se traîne dans la mousse; troncs, rameaux, feuilles, fibres, touffes, vrilles, sarments, épines, s'étaient mêlés, traversés, mariés, confondus; la végétation, dans un embrassement étroit et profond, avait célébré et accompli- là, sous l'œil satis
fait du créateur, en cet enclos de trois cents pieds carrés, le saint mystère de sa fraternité, symbole de la fraternité humaine. Ce jardin n'était plus un jardin, c'était une broussaille colossale; c'est-à-dire quelque chose qui est impénétrable comme une forêt, peuplé comme une ville, frissonnant comme un nid, sombre comme une cathédrale, odorant comme un bouquet, solitaire comme une tombe, vivant comme une foule.
En floréal, cet énorme buisson, libre derrière sa grille et dans ses quatre murs, entrait en rut dans le sourd travail de la germination universelle, tressaillait au soleil levant presque comme une bête qui aspire les effluves de l'amour cosmique et qui sent la sève d'avril monter et bouillonner dans ses veines, et, secouant au vent sa prodigieuse chevelure verte, semait sur la terre humide, sur les statues frustes, sur le perron croulant du pavillon et jusque sur le pavé de la rue déserte, les fleurs en étoiles, la rosée en perles, la fécondité, la beauté, la vie, la joie, les parfums. A midi mille papillons blancs s'y réfugiaient, et c'était un spectacle divin de voir là tourbillonner en flocons dans l'ombre cette neige vivante de l'été. Là, dans ces gaies ténèbres de la verdure, une foule de voix innocentes parlaient doucement à l'âme, et ce que les gazouillements avaient oublié de dire, les bourdonnements le complétaient. Le soir une vapeur de rêverie se dégageait du jardin et l'enveloppait; un linceul de brume, une tristesse céleste et calme, le couvraient; l'odeur si enivrante des chèvrefeuilles et des liserons en sortait de toute part comme un poison exquis et subtil ; on entendait les derniers appels des grimpereaux et des bergeronnettes s'assoupissant sous les branchages ; on y sentait cette intimité sacrée de l'oiseau et de l'arbre; le jour les ailes réjouissent les feuilles, la nuit les feuilles protègent les ailes.
L'hiver, la broussaille était noire, mouillée, hérissée, grelottante, et laissait un peu voir la maison. On apercevait, au lieu de fleurs dans les rameaux et de rosée dans les fleurs, les longs rubans d'argent des limaces sur le froid et épais tapis des feuilles jaunes; mais de toute façon, sous tout aspect, en. toute saison, printemps, hiver, été, automne, ce petit enclos respirait la mélancolie, la contemplation, la solitude, la liberté, l'absence de l'homme, la présence de Dieu; et la vieille grille rouillée avait l'air de dire : ce jardin est à moi. Le pavé de Paris avait beau être là tout autour, les hôtels classiques et splendides de la rue de Varennes à deux pas, le dôme des Invalides tout près, la Chambre des députés pas loin; les carrosses de la rue de Bourgogne et de la rue Saint-Dominique avaient beau rouler fastueusement dans le voisinage, les omnibus jaunes, bruns, blancs, rouges, avaient beau se croiser dans le carrefour prochain, le désert était rue Plumet ; et la mort des anciens propriétaires, une révolution qui avait passé, l'écroulement des antiques fortunes, l'absence, l'oubli, quarante ans d'abandon et de viduité, avaient suffi pour ramener dans ce lieu privilégié les fougères, les bouillons -blancs, les ciguës, les achillées, les hautes herbes, les grandes plantes gaufrées aux larges feuilles de drap vert pâle, les lézards, les scarabées, les insectes inquiets et. rapides ; pour faire sortir des profondeurs de la terre et reparaître entre ces quatre murs je ne sais quelle grandeur sauvage et farouche ; et pour que la nature, qui déconcerte les arrangements mesquins de l'homme et qui se répand toujours tout entière là où elle se répand, aussi bien dans la fourmi que dans l'aigle, en vînt à s'épanouir dans un méchant petit jardin parisien avec autant de rudesse et de majesté que dans une forêt vierge du Nouveau Monde.
Rien n'est petit en effet ; quiconque est sujet aux pénétrations profondes de la nature, le sait. Bien qu'aucune satisfaction absolue ne soit donnée à la philosophie, pas plus de circonscrire la cause que de limiter l'effet, le contemplateur tombe dans des extases sans fond à cause de toutes ces décompositions de forces aboutissant à l'unité. Tout travaille à tout.
L'algèbre s'applique aux nuages; l'irradiation de l'astre profite à la rose; aucun penseur n'oserait dire que le parfum de l'aubépine est inutile aux constellations. Qui donc peut calculer le trajet d'une molécule? que savons-nous si des créations de mondes ne sont point déterminées par des chutes de grains de sable? qui donc connaît les flux et les reflux réciproques de l'infiniment grand et de
l'infiniment petit, le retentissement des causes dans les précipices de l'être, et les avalanches de la création? Un ciron importe; le petit est grand, le grand est petit ; tout est en équilibre dans la nécessité ; effrayante vision pour l'esprit. Il y a entre les êtres et les choses des relations de prodige ; dans cet inépuisable ensemble, de soleil à puceron, on ne se méprise pas; on a besoin les uns des autres. La lumière n'emporte pas dans l'azur les parfums terrestres sans savoir ce qu'elle en fait; la nuit fait des distributions d'essence stellaire aux fleurs endormies. Tous les oiseaux qui volent ont à la patte le fil de l'infini. La germination se complique de l'éclosion d'un météore et du coup de bec de l'hirondelle brisant l'œuf, et elle mène de front la naissance d'un ver de terre et l'avènement de Socrate. Où finit le télescope, le microscope commence. Lequel des deux a la vue la plus grande ? Choisissez. Une moisissure est une pléiade de fleurs ; une nébuleuse est une fourmilière d'étoiles. Même promiscuité, et plus inouïe encore, des choses de l'intelligence et des faits de la substance. Les éléments et les principes se mêlent, se combinent, s'épousent, se multiplient les uns par les autres, au point de faire aboutir le monde matériel et le monde moral à la même clarté. Le phénomène est en perpétuel repli sur lui-même. Dans les vastes échanges cosmiques, la
vie universelle va et vient en quantités inconnues, roulant tout dans l'invisible mystère des effluves, employant tout, ne perdant pas un rêve de pas un sommeil, semant un animalcule ici, émiettant un astre là, oscillant et serpentant, faisant de la lumière une force et de la pensée un élément, disséminée et indivisible, dissolvant tout, excepté ce point géométrique, le moi; ramenant tout à l'atome; épanouissant tout en Dieu; enchevêtrant, depuis la plus haute jusqu'à la plus basse, toutes les activités dans l'obscurité d'un mécanisme vertigineux, rattachant le vol d'un insecte au mouvement de la terre, subordonnant, qui sait? ne fût-ce que par l'identité de la loi, l'évolution de la comète dans le firmament au tournoiement de l'infusoire dans la goutte d'eau. Machine faite d'esprit. Engrenage énorme dont le premier moteur est le moucheron et dont la dernière roue est le zodiaque.
Un baiser, et ce fut tout.
Tous deux tressaillirent, et ils se regardèrent dans l'ombre avec des yeux éclatants. Ils ne sentaient ni la nuit fraîche, ni la pierre froide, ni la pierre humide, ni l'herbe mouillée, ils se regardaient et ils avaient le cœur plein de pensées. Ils s'étaient pris les mains, sans savoir.
Elle ne lui demandait pas, elle n'y songeait pas même, par où il était entré et comment il avait pénétré dans le jardin. Cela lui paraissait si simple qu'il fût là !
De temps en temps, le genou de Marius touchait le genou de Cosette, et tous deux frémissaient. Par intervalles, Cosette bégayait une parole. Son âme tremblait à ses lèvres comme une goutte de rosée à une fleur.
Peu à peu ils se parlèrent. L’épanchement succéda au silence qui est la plénitude. La nuit était sereine et splendide au-dessus de leur tête.
Tous deux tressaillirent, et ils se regardèrent dans l'ombre avec des yeux éclatants. Ils ne sentaient ni la nuit fraîche, ni la pierre froide, ni la pierre humide, ni l'herbe mouillée, ils se regardaient et ils avaient le cœur plein de pensées. Ils s'étaient pris les mains, sans savoir.
Elle ne lui demandait pas, elle n'y songeait pas même, par où il était entré et comment il avait pénétré dans le jardin. Cela lui paraissait si simple qu'il fût là !
De temps en temps, le genou de Marius touchait le genou de Cosette, et tous deux frémissaient. Par intervalles, Cosette bégayait une parole. Son âme tremblait à ses lèvres comme une goutte de rosée à une fleur.
Peu à peu ils se parlèrent. L’épanchement succéda au silence qui est la plénitude. La nuit était sereine et splendide au-dessus de leur tête.
Videos de Victor Hugo (314)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Victor Hugo (434)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Victor Hugo (niveau facile)
Lequel de ces livres n'est pas de Victor Hugo ?
Les Misérables
Notre-Dame de Paris
Germinal
Les Contemplations
10 questions
1237 lecteurs ont répondu
Thème :
Victor HugoCréer un quiz sur ce livre1237 lecteurs ont répondu