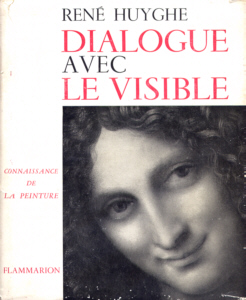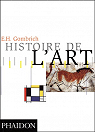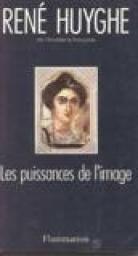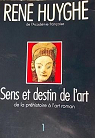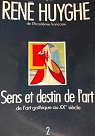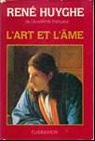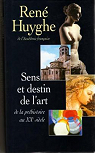René Huyghe
EAN : SIE182456_532
Flammarion (30/11/-1)
/5
8 notes
Flammarion (30/11/-1)
Résumé :
Le Dialogue avec le Visible est une véritable introduction à la connaissance de l'oeuvre d'art, et particulièrement à la peinture.
Si les ouvrages abondent en ce domaine, ils répondent bien rarement au désir du public d'embrasser, en une vue d'ensemble, les problèmes fondamentaux et d'être doté d'un moyen d'étude personnel et global. Comment aborder une oeuvre d'art ? Qu'y chercher ? Qu'y trouver ? et par quelles voies ? René Huyghe répond à ces questions ave... >Voir plus
Si les ouvrages abondent en ce domaine, ils répondent bien rarement au désir du public d'embrasser, en une vue d'ensemble, les problèmes fondamentaux et d'être doté d'un moyen d'étude personnel et global. Comment aborder une oeuvre d'art ? Qu'y chercher ? Qu'y trouver ? et par quelles voies ? René Huyghe répond à ces questions ave... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Dialogue avec le visibleVoir plus
Citations et extraits (22)
Voir plus
Ajouter une citation
Pourquoi écrire encore sur l’Art ?
Pourquoi même écrire sur l’Art ?
N’a-t-on pas déjà trop commenté, trop expliqué ce qui devrait simplement se regarder, ce qui est créé pour être regardé.
La vue n’a que faire des paroles et le tableau des théories…
Oui, si l’homme regardait, savait regarder avec ses yeux, et non avec ses habitudes, avec ses préventions et ses croyances.
Il ne voit que ce qu’il est accoutumé à voir, comme il n’écoute et n’entend que l’écho de ses pensées invétérées.
Tout lui est miroir pour retrouver non pas son vrai visage (le connaît-il ?), mais celui qu’il se suppose et qu’il souhaite.
Que dire de l’homme civilisé, trop intellectuel, dressé, depuis des générations, à tout percevoir par l’entremise des seules idées !
Nous sommes nourris, bourrés, de dogmes sur l’art, de définitions devenues convictions, tellement assimilées que nous les prenons pour des instincts, alors qu’elles se substituent à eux, et interposées, les empêchent de se faire jour.
Les coquilles mortes de nos nourritures abstraites ont élevé autour de nous, sans que nous y prêtions attention, une muraille de détritus qui nous cerne et nous enferme et que nous finissons par prendre pour un horizon.
(page 5)
Pourquoi même écrire sur l’Art ?
N’a-t-on pas déjà trop commenté, trop expliqué ce qui devrait simplement se regarder, ce qui est créé pour être regardé.
La vue n’a que faire des paroles et le tableau des théories…
Oui, si l’homme regardait, savait regarder avec ses yeux, et non avec ses habitudes, avec ses préventions et ses croyances.
Il ne voit que ce qu’il est accoutumé à voir, comme il n’écoute et n’entend que l’écho de ses pensées invétérées.
Tout lui est miroir pour retrouver non pas son vrai visage (le connaît-il ?), mais celui qu’il se suppose et qu’il souhaite.
Que dire de l’homme civilisé, trop intellectuel, dressé, depuis des générations, à tout percevoir par l’entremise des seules idées !
Nous sommes nourris, bourrés, de dogmes sur l’art, de définitions devenues convictions, tellement assimilées que nous les prenons pour des instincts, alors qu’elles se substituent à eux, et interposées, les empêchent de se faire jour.
Les coquilles mortes de nos nourritures abstraites ont élevé autour de nous, sans que nous y prêtions attention, une muraille de détritus qui nous cerne et nous enferme et que nous finissons par prendre pour un horizon.
(page 5)
Dès 1819, Lamennais, dans ses Mélanges religieux et philosophiques, jetait un cri d'alarme : "On ne lit plus, on n'a plus le temps. L'esprit est appelé à la fois de trop de côtés ; il faut lui parler vite où il passe. Mais il y a des choses qui ne peuvent être dites, ni comprises si vite, et ce sont les plus importants pour l'homme. Cette accélération de mouvement qui ne permet de rien enchaîner, de rien méditer, suffirait seule pour affaiblir et, à la longue, pour détruire entièrement la raison humaine". 1819 ! La phrase resta inaperçue. Elle s'éclaire maintenant d'un jour brutal...
... si l'homme regardait, savait regarder avec ses yeux, et non avec ses habitudes, avec ses préventions et ses croyances.
... Que dire de l'homme civilisé, trop intellectuel, dressé, depuis des générations, à tout percevoir par l'entremise des seules idées ! Nous sommes nourris, bourrés de dogmes sur l'art, de définitions devenues convictions, tellement assimilées que nous les prenons pour des instincts, alors qu'elles se substituent à eux, et, interposées, les empêchent de se faire jour. Les coquilles mortes de nos nourritures abstraites ont élevé autour de nous, sans que nous y prêtions attention, une muraille de détritus qui nous cerne et nous enferme et que nous finissons par prendre pour un horizon.
... Que dire de l'homme civilisé, trop intellectuel, dressé, depuis des générations, à tout percevoir par l'entremise des seules idées ! Nous sommes nourris, bourrés de dogmes sur l'art, de définitions devenues convictions, tellement assimilées que nous les prenons pour des instincts, alors qu'elles se substituent à eux, et, interposées, les empêchent de se faire jour. Les coquilles mortes de nos nourritures abstraites ont élevé autour de nous, sans que nous y prêtions attention, une muraille de détritus qui nous cerne et nous enferme et que nous finissons par prendre pour un horizon.
Le réalisme, le perfectionnement du réalisme, fut le but avoué de la progression que s’assigna l’art d’Occident depuis le Moyen Age (surtout à partir du XIIIe siècle) et qui ne s’interrompit qu’au XXe siècle.
Nulle contestation possible ! En témoigne cette poursuite du trompe-l’œil, qui lui est propre.
Depuis les fausses mouches que les primitifs aimaient à poser sur leurs panneaux jusqu’au rideau feint que les Hollandais du XVIIe siècle affectaient d’avoir tiré de devant leur peinture ; depuis les personnages fictifs que Véronèse faisait sortir de la muraille, à la Villa Maser, jusqu’à cette confusion volontaire de ce qui est peint et de ce qui est sculpté, dont s’enivraient les décorateurs baroques de l’Europe centrale, il y a là une tentation innée des écoles d’Occident.
Il serait bien présomptueux de décréter qu’elle doit être exclue de l’Art.
(page 64)
Nulle contestation possible ! En témoigne cette poursuite du trompe-l’œil, qui lui est propre.
Depuis les fausses mouches que les primitifs aimaient à poser sur leurs panneaux jusqu’au rideau feint que les Hollandais du XVIIe siècle affectaient d’avoir tiré de devant leur peinture ; depuis les personnages fictifs que Véronèse faisait sortir de la muraille, à la Villa Maser, jusqu’à cette confusion volontaire de ce qui est peint et de ce qui est sculpté, dont s’enivraient les décorateurs baroques de l’Europe centrale, il y a là une tentation innée des écoles d’Occident.
Il serait bien présomptueux de décréter qu’elle doit être exclue de l’Art.
(page 64)
Fait divers terrorisant et sex-appeal sont devenus les deux ressorts de l'attention publique. Un seul mot couvre de sa clameur répétée le placard de publicité ou l'annonce de spectacles : Sensation ! Sensationnel ! L'anglicisme répond, en écho : Exciting ! C'est ce que Valéry appelait "la rhétorique du choc".
Et l'image, simplifiée, étalée, provocante, tonitruant de ses couleurs et de ses formes ramassées, devient l'instrument d'un racolage universel qu'attend l'avidité des regards et qui déclenche dans les centres nerveux les réflexes de convoitise, d'appétit.
Et l'image, simplifiée, étalée, provocante, tonitruant de ses couleurs et de ses formes ramassées, devient l'instrument d'un racolage universel qu'attend l'avidité des regards et qui déclenche dans les centres nerveux les réflexes de convoitise, d'appétit.
Videos de René Huyghe (3)
Voir plusAjouter une vidéo
INGE
Archive sonore, comité de gestion
Le 9 décembre 1985 à l'INGE
René Huyghe (1906-1997), Écrivain français, membre de l’Académie française, et conservateur au département des peintures du Louvre
autres livres classés : rôle de l'artVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de René Huyghe (27)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Charles Aznavour chansons
Dans quelle chanson, Charles Aznavour s’imagine en haut de l’affiche ?
Emmenez-moi
La Mamma
Je m'voyais déjà
10 questions
409 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, musique
, Variétés
, chanteur
, Chansons françaisesCréer un quiz sur ce livre409 lecteurs ont répondu