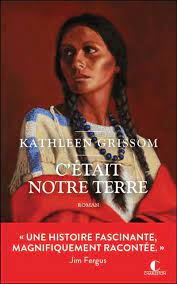INTRODUCTION :
« Le siècle qui commence trouve une Argentine confiante en l'avenir. le positivisme à la mode met une foi illimitée dans les avancées du progrès et de la science, et la croissance de la jeune république autorise une vision optimiste du destin national. La classe dirigeante a bâti son programme sur la base d'une instruction publique et gratuite pour tous, destinée à réaliser l'intégration culturelle de la deuxième génération d'une masse énorme et hétérogène d'immigrants à peine débarqués d'Europe. Cette Argentine, qui est à l'époque une toute jeune nation - sa guerre contre les Indiens n'est terminée que depuis vingt ans -, dépend économiquement de l'Angleterre, est fascinée par la culture française et admire autant l'opéra italien que la technologie allemande. Ce qui ne l'empêchera pas de tâtonner à la recherche de sa propre identité, à la faveur d'un sentiment nationaliste exacerbé dès 1910 […].
L'avant-garde poétique porte le sceau du modernisme, largement diffusé à Buenos Aires par Rubén Darío qui […] marquera d'une empreinte durable la vie culturelle du pays. […] La quête de la modernité inscrite dans le nouveau courant anime déjà ce pays avide de rallier un monde qui ne jure que par Le Louvre, la Sorbonne et Montparnasse. […].
[…]
La seconde décennie du siècle […] marque un tournant décisif dans la réalité argentine. […] Hipólito Yrigoyen accède au pouvoir. Avec lui surgit une nouvelle classe sociale, issue de l'immigration et amenée, pour un temps, à prendre la place de la vieille oligarchie qui a dirigé le pays depuis les premiers jours de l'indépendance. […]
Cette modernité, qui relie les poètes argentins à l'avant-garde européenne, se concrétise avec le retour au pays de Jorge Luis Borges, en 1921. […]
Dans un article polémique paru dans la revue Nosotros (XII, 1921), Borges explique : « Schématiquement, l'ultraïsme aujourd'hui se résume aux principes suivants : 1°) Réduction de la lyrique à son élément fondamental : la métaphore. 2°) Suppression des transitions, des liaisons et des adjectifs inutiles. 3°) Abolition des motifs ornementaux, du confessionnalisme, de la circonstanciation, de l'endoctrinement et d'une recherche d'obscurité. 4°) Synthèse de deux ou plusieurs images en une seule, de façon à en élargir le pouvoir de suggestion. » […]
[…] les jeunes poètes des années 20 se reconnaissent au besoin qu'ils éprouvent de revendiquer une appartenance et de se trouver des racines. […]
Il faut attendre une dizaine d'années encore pour que, dans le calme de l'époque, de jeunes créateurs, avec l'enthousiasme de leurs vingt ans, apportent un élan nouveau et de nouvelles valeurs poétiques. Prenant leurs distances par rapport à l'actualité, ils remettent à l'honneur le paysage et l'abstraction, ainsi qu'un ton empreint de nostalgie et de mélancolie. […]
Les années 60 correspondent en Argentine à une période d'apogée culturel. le secteur du livre est en plein essor ; de nouvelles maisons d'édition voient le jour et, conséquence du boom de la littérature sud-américaine, la demande d'auteurs autochtones augmente, ce qui facilite l'émergence de noms nouveaux. […]
La génération des années 70, à l'inverse, est marquée au coin de la violence. Plus se multiplient les groupes de combat qui luttent pour l'instauration d'un régime de gauche, plus la riposte des dictatures militaires successives donne lieu à une répression sanglante et sans discrimination qui impose au pays un régime de terreur, torture à l'appui, avec pour résultat quelque trente mille disparus. […] » (Horacio Salas.)
CHAPITRES :
0:00 - Titre
0:06 - Enrique Molina
2:09 - Atilio Jorge Castelpoggi
3:37 - Olga Orozco
5:57 - Roberto Juarroz
7:44 - Générique
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE :
Horacio Salas, Poésie argentine du XXe siècle, traduction de Nicole Priollaud, Genève, Patiño, 1996.
IMAGES D'ILLUSTRATION :
Enrique Molina : https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Molina_(poeta)#/media/Archivo:EnriqueMolina.JPG
Atilio Jorge Castelpoggi : https://issuu.com/nuevociclo/docs/nuevo_ciclo_julio_2016/15
Olga Orozco : https://www.unibarcelona.com/es/actualidad/noticias/olga-orozco-testimonio-de-una-derrota
Roberto Juarroz : https://www.bertrand.pt/autor/roberto-juarroz/22813
BANDE SONORE ORIGINALE :
Veill

Roberto Juarroz/5
9 notes
Résumé :
Les poèmes qui composent la Quatorzième poésie verticale accompagnèrent les trois ou quatre dernières années de la vie de Roberto Juarroz. Le ton de l'ensemble est légèrement différent, car certains des poèmes ultimes reflètent une approche majeure de l'élément humain de la souffrance.
Ces poèmes furent ceux qui exigèrent de lui l'effort le plus grand pour atteindre l'équilibre nécessaire entre la parole personnelle et la construction esthétique entre... >Voir plus
Ces poèmes furent ceux qui exigèrent de lui l'effort le plus grand pour atteindre l'équilibre nécessaire entre la parole personnelle et la construction esthétique entre... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Quatorzieme poesie verticaleVoir plus
Citations et extraits (36)
Voir plus
Ajouter une citation
Il n’y a pas de saut dans le vide…
Il n’y a pas de saut dans le vide.
Même si les anges n’existent pas pour nous soutenir
ni non plus des traverses de la pensée,
ni des relativisations ou des absolus
qui puissent nous retenir par les bras.
Il faut par avance gagner le vide,
le coloniser avec nos abandons
comme s’il était un territoire dépouillé
ou une nouvelle liberté jamais exercée.
Et cultiver à l’intérieur ses fragments flottants
qui s’entremêlent aux choses
pour leur apprendre à ne pas être.
Et presque sans le savoir
arriver à aimer le vide.
Ce qui est aimé nous soutient,
même si cela nous pousse vers l’abîme.
Un vide aimé
ne peut pas nous abandonner.
Et dans un vide non aimé
il n’est même pas possible de sauter.
//Traduction: Silvia Baron Supervielle
Il n’y a pas de saut dans le vide.
Même si les anges n’existent pas pour nous soutenir
ni non plus des traverses de la pensée,
ni des relativisations ou des absolus
qui puissent nous retenir par les bras.
Il faut par avance gagner le vide,
le coloniser avec nos abandons
comme s’il était un territoire dépouillé
ou une nouvelle liberté jamais exercée.
Et cultiver à l’intérieur ses fragments flottants
qui s’entremêlent aux choses
pour leur apprendre à ne pas être.
Et presque sans le savoir
arriver à aimer le vide.
Ce qui est aimé nous soutient,
même si cela nous pousse vers l’abîme.
Un vide aimé
ne peut pas nous abandonner.
Et dans un vide non aimé
il n’est même pas possible de sauter.
//Traduction: Silvia Baron Supervielle
Appeler où il n’y a personne…
Appeler où il n’y a personne
c’est comme s’appeler soi-même
ou sa part la plus farouche :
l’ombre de son absence.
Et l’appeler là où elle rejoint
l’ombre de toutes les absences.
C’est pourquoi, il est probable
que frapper où il n’y a personne
se transforme en appeler une présence.
Et convoquer une présence
nous mène toujours à rencontrer une absence.
Alors, même si j’en souffre,
il vaut mieux que tu ne sois pas là quand je t’appelle.
Ou si tu l’es, que tu t’éloignes,
pour tenter la rencontre dans l’absence.
//Traduction: Silvia Baron Supervielle
Appeler où il n’y a personne
c’est comme s’appeler soi-même
ou sa part la plus farouche :
l’ombre de son absence.
Et l’appeler là où elle rejoint
l’ombre de toutes les absences.
C’est pourquoi, il est probable
que frapper où il n’y a personne
se transforme en appeler une présence.
Et convoquer une présence
nous mène toujours à rencontrer une absence.
Alors, même si j’en souffre,
il vaut mieux que tu ne sois pas là quand je t’appelle.
Ou si tu l’es, que tu t’éloignes,
pour tenter la rencontre dans l’absence.
//Traduction: Silvia Baron Supervielle
Il n’y a pas d’explication pour l’ombre…
Il n’y a pas d’explication pour l’ombre.
Il n’y en a pas non plus pour la lumière.
Seules certaines choses intermédiaires s’expliquent :
les poisons déversés ou avalés,
l’entre-deux avec lequel nous lions les choses,
la panne soudaine d’un visage,
le pouls sec du passé,
l’asymétrie de se penser.
La vitesse ne donne pas un sens,
la lenteur non plus.
Chaque monde est une image,
bloqué par son idée.
//Traduction: Silvia Baron Supervielle
Il n’y a pas d’explication pour l’ombre.
Il n’y en a pas non plus pour la lumière.
Seules certaines choses intermédiaires s’expliquent :
les poisons déversés ou avalés,
l’entre-deux avec lequel nous lions les choses,
la panne soudaine d’un visage,
le pouls sec du passé,
l’asymétrie de se penser.
La vitesse ne donne pas un sens,
la lenteur non plus.
Chaque monde est une image,
bloqué par son idée.
//Traduction: Silvia Baron Supervielle
L’impossibilité de vivre…
L’impossibilité de vivre
se glisse en nous au début
comme un caillou dans la chaussure :
on le retire et on l’oublie.
Ensuite arrive une pierre plus grande
qui n’est plus déjà dans la chaussure :
le premier ou le dernier malentendu
se mêle à l’amour ou au doute.
Viennent après d’autres échecs :
la perte d’un mot,
la sauvage irruption d’une douleur,
une mort sur le chemin,
la chute d’une feuille sur notre solitude,
la vieillesse qui s’annonce
comme un soir écorché par la pluie.
Nous émergeons de tout
avec un tremblement qui dissout la confiance.
La lune pâlit,
nous commençons à nous méfier du soleil.
Et un jour quelconque,
dans la prairie ou le ciment,
dans la dissonance qui brise une chanson
ou une rotation inattendue au lit,
quelque chose nous blesse comme un fouet:
vivre c’est dévivre.
La promesse est rompue.
Qui a fait la promesse ?
Et qui peut la croire ?
Nous ne le saurons plus.
La promesse était autre.
Vivre est impossible.
Mais à l’intérieur du vivre il y a autre chose
que nous ne comprendrons jamais
et qui pourtant saute et joue
comme un dieu étonné
qui ne s’accordera jamais
avec les scandales successifs
de vivre sans vivre
et de mourir sans vivre.
//Traduction: Silvia Baron Supervielle
L’impossibilité de vivre
se glisse en nous au début
comme un caillou dans la chaussure :
on le retire et on l’oublie.
Ensuite arrive une pierre plus grande
qui n’est plus déjà dans la chaussure :
le premier ou le dernier malentendu
se mêle à l’amour ou au doute.
Viennent après d’autres échecs :
la perte d’un mot,
la sauvage irruption d’une douleur,
une mort sur le chemin,
la chute d’une feuille sur notre solitude,
la vieillesse qui s’annonce
comme un soir écorché par la pluie.
Nous émergeons de tout
avec un tremblement qui dissout la confiance.
La lune pâlit,
nous commençons à nous méfier du soleil.
Et un jour quelconque,
dans la prairie ou le ciment,
dans la dissonance qui brise une chanson
ou une rotation inattendue au lit,
quelque chose nous blesse comme un fouet:
vivre c’est dévivre.
La promesse est rompue.
Qui a fait la promesse ?
Et qui peut la croire ?
Nous ne le saurons plus.
La promesse était autre.
Vivre est impossible.
Mais à l’intérieur du vivre il y a autre chose
que nous ne comprendrons jamais
et qui pourtant saute et joue
comme un dieu étonné
qui ne s’accordera jamais
avec les scandales successifs
de vivre sans vivre
et de mourir sans vivre.
//Traduction: Silvia Baron Supervielle
D’un abîme à un autre abîme…
D’un abîme à un autre abîme.
Ainsi avons-nous vécu.
Et lorsque c’était le tour de l’interlude
d’une zone de l’air,
où il est facile de respirer et de se soutenir,
nos regrettions sans vouloir l’abîme
qui nous nourrissait du rien.
Du fond de l’être gravit un sortilège
pour demander, lorsque la mort arrive,
que tout soit un abîme, non une autre direction.
Il nous y poussera peut-être des ailes.
A l’intérieur d’un abîme en est toujours un autre.
Et à défaut de différence il y aura distance.
Il ne nous reste qu’à trouver et à être
la distance à l’intérieur de l’abîme.
//Traduction : Silvia Baron Supervielle
D’un abîme à un autre abîme.
Ainsi avons-nous vécu.
Et lorsque c’était le tour de l’interlude
d’une zone de l’air,
où il est facile de respirer et de se soutenir,
nos regrettions sans vouloir l’abîme
qui nous nourrissait du rien.
Du fond de l’être gravit un sortilège
pour demander, lorsque la mort arrive,
que tout soit un abîme, non une autre direction.
Il nous y poussera peut-être des ailes.
A l’intérieur d’un abîme en est toujours un autre.
Et à défaut de différence il y aura distance.
Il ne nous reste qu’à trouver et à être
la distance à l’intérieur de l’abîme.
//Traduction : Silvia Baron Supervielle
Videos de Roberto Juarroz (3)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Roberto Juarroz (15)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)
Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?
Paris
Marseille
Bruxelles
Londres
10 questions
1217 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poèmes
, poètesCréer un quiz sur ce livre1217 lecteurs ont répondu