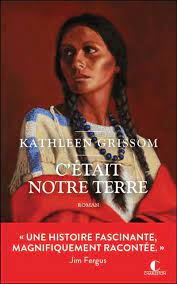Ernst Jünger
Henri Plard (Traducteur)/5 25 notes
Henri Plard (Traducteur)/5 25 notes
Résumé :
Roman de l'étrange, hors du temps, dans un monde que la technique colore de fantastique. Un homme cherche un emploi, n'importe lequel, et s'adresse à un certain Zapparoni, génie de son état et inventeur d'automates extraordinaires... Entre eux deux se noue une relation tortueuse de maître et d'esclave... Abeilles de verre, conte philosophique et récit épique, met en scène le tragique de l'existence confrontée aux exigences de la modernité.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Abeilles de verreVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Un tortueux entretien d'embauche à la jonction de deux mondes : en 1957, un curieux coup d'épée science-fictif porté à une certaine socio-technologie.
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2023/08/05/note-de-lecture-abeilles-de-verre-ernst-junger/
Ancien officier de cavalerie, formé « à l'ancienne », héros et anti-héros de deux guerres, resté largement fidèle à ses conceptions déjà anciennes de l'honneur, Richard végète au chômage, la faillite le guettant de plus en plus alors que, clairement, l'épouse dont il est amoureux comme au premier jour ne mérite pas de vivre pareille déchéance matérielle. S'en remettant à l'habileté de son vieil ami Twinnings, expert madré dans le casage et le recasage d'anciens soldats à divers postes plus ou moins lucratifs dont il maîtrise les ressorts, les arcanes et les chemins de traverse, il se voit proposer de rencontrer Zapparoni, magnat formidable de l'automatisation et de la robotique, appliquées au plus sérieux comme au plus futile de la consommation de masse en plein essor. Celui-ci cherche en effet, semble-t-il, un ex-militaire familier des questions de sécurité opérationnelle, certes, mais également prêt à faire ce qu'il faut pour dissuader de brillantissimes créateurs – employés, à prix d'or, par l'industriel – d'aller voir ailleurs, le moment venu, si l'herbe est plus verte. Un entretien de recrutement est programmé, entretien qui sera riche en dérives intérieures, en chausse-trappes dissimulées et en questionnements éthiques et philosophiques.
Publié en 1957, traduit en français en 1959 par Henri Plard chez Plon (avant d'être repris chez Christian Bourgois en 1971), « Abeilles de verre » a souvent été réduit par les commentateurs à une fable philosophique portant sur l'éthique du progrès technologique et sur la marchandisation des relations humaines. Il est cela, bien entendu, et si c'était tout, ce ne serait déjà pas mal, mais ce court roman (à peine 200 pages), dix-huit ans après la résistance intempestive au déferlement totalitaire que constituait à son corps défendant « Sur les falaises de marbre », douze ans après la fin de la deuxième guerre mondiale et huit ans après « Héliopolis » et sa dystopie ambiguë, couvre, pour peu que l'on veuille être attentif, un peu plus de terrain.
Bruce Sterling ne s'y était pas trompé dans sa lumineuse introduction à la réédition de l'ouvrage en anglais en 2000 (« la technologie ne vise pas tant à accélérer le progrès qu'à intensifier le pouvoir ») : le doute méthodique et néanmoins presque poétique exercé ici par Ernst Jünger vis-à-vis de l'avancée technologique, en résonance avec des réflexions menées ailleurs par Jacques Ellul, par exemple (« La Technique ou l'enjeu du siècle » est paru en 1954), va bien au-delà d'une simple nostalgie apparente (celle du cavalier vis-à-vis de la mécanisation blindée qui habite le capitaine Richard presque constamment, et tout particulièrement lorsqu'il évoque le sévère mentor Monteron – le jeu de l'auteur avec les noms propres est une constante jamais démentie – de sa jeunesse de cadet) comme d'un simple rejet conservateur de l'idée de progrès en soi. Reconstruisant une scène primitive de robots et d'automates qui doit certainement davantage à Karel Čapek qu'à Isaac Asimov, celui qui s'est installé sept ans plus tôt à Wilflingen, en Haute-Souabe (qu'il ne quittera plus pour habiter ailleurs), met le doigt, avec force, sur le devenir industriel du monde (anticipant de plusieurs dizaines d'années la mainmise de facto des grandes entreprises transnationales sur la décision politique qui compte – ce qui ne pouvait que fasciner Bruce Sterling comme membre fondateur du courant cyberpunk) et sur la composante militaire de toute une frange du spectaculaire marchand (et ce, bien avant Guy Debord ou Roger Stahl et son « Militainment Inc. »).
Il ne s'agit pas, loin de là, de masquer les innombrables palinodies ayant jalonné la longue carrière militaire et littéraire d'Ernst Jünger (le précieux ouvrage de Michel Vanoosthuyse, « Fascisme et littérature pure : la fabrique d'Ernst Jünger », recensait en 2005 la manière dont la France, bien plus que l'Allemagne, avait répugné à entériner les vraies failles du guerrier devenu collectionneur d'insectes). Ceci n'empêchera nullement, par exemple, de voir « Abeilles de verre » trouver une place bien particulière au sein du travail de Gilles Deleuze : lors de l'un des séminaires ayant conduit à « Mille plateaux », il utilise en la citant in extenso la remarque portant sur la distinction entre la mort à la guerre et la mort au travail, en extrayant la logique sous-jacente de l'auteur allemand de son contexte volontairement macabre (David Lynch s'en serait-il souvenu au moment de débuter son « Blue Velvet » de 1986 ?), pour nourrir sa réflexion sur les machines de guerre. Multipliant les références à « L'homme au sable » D E.T.A. Hoffmann comme un appel du pied mi-sérieux mi-amusé au fantastique qui irriguerait la technologie (le recours, sans la nommer, à la célèbre troisième loi de Clarke – « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie » – ne fera que le confirmer à la page 46), jouant comme par avance avec les ruptures technico-poétiques d'un Pierre Cendors (« Archives du vent », 2015), Ernst Jünger se permet même ici d'examiner à sa manière personnelle le pacte faustien du salarié de luxe, bien avant Herbert Marcuse, Laurent Thévenot, Luc Boltanski ou Eve Chiapello. Ce court roman, s'il semble d'abord rebondir sur les thématiques d'« Héliopolis », annonce sans aucun doute les développements bien ultérieurs d'« Eumeswil », mais il pratique cette anticipation avec un art bien spécifique du détour et de la digression, comme pour mieux désarçonner les attentes initiales de la lectrice ou du lecteur, et plus encore de celle ou celui ayant déjà bien arpenté ces terres du recours métaphorique aux forêts.
Lien : https://charybde2.wordpress...
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2023/08/05/note-de-lecture-abeilles-de-verre-ernst-junger/
Ancien officier de cavalerie, formé « à l'ancienne », héros et anti-héros de deux guerres, resté largement fidèle à ses conceptions déjà anciennes de l'honneur, Richard végète au chômage, la faillite le guettant de plus en plus alors que, clairement, l'épouse dont il est amoureux comme au premier jour ne mérite pas de vivre pareille déchéance matérielle. S'en remettant à l'habileté de son vieil ami Twinnings, expert madré dans le casage et le recasage d'anciens soldats à divers postes plus ou moins lucratifs dont il maîtrise les ressorts, les arcanes et les chemins de traverse, il se voit proposer de rencontrer Zapparoni, magnat formidable de l'automatisation et de la robotique, appliquées au plus sérieux comme au plus futile de la consommation de masse en plein essor. Celui-ci cherche en effet, semble-t-il, un ex-militaire familier des questions de sécurité opérationnelle, certes, mais également prêt à faire ce qu'il faut pour dissuader de brillantissimes créateurs – employés, à prix d'or, par l'industriel – d'aller voir ailleurs, le moment venu, si l'herbe est plus verte. Un entretien de recrutement est programmé, entretien qui sera riche en dérives intérieures, en chausse-trappes dissimulées et en questionnements éthiques et philosophiques.
Publié en 1957, traduit en français en 1959 par Henri Plard chez Plon (avant d'être repris chez Christian Bourgois en 1971), « Abeilles de verre » a souvent été réduit par les commentateurs à une fable philosophique portant sur l'éthique du progrès technologique et sur la marchandisation des relations humaines. Il est cela, bien entendu, et si c'était tout, ce ne serait déjà pas mal, mais ce court roman (à peine 200 pages), dix-huit ans après la résistance intempestive au déferlement totalitaire que constituait à son corps défendant « Sur les falaises de marbre », douze ans après la fin de la deuxième guerre mondiale et huit ans après « Héliopolis » et sa dystopie ambiguë, couvre, pour peu que l'on veuille être attentif, un peu plus de terrain.
Bruce Sterling ne s'y était pas trompé dans sa lumineuse introduction à la réédition de l'ouvrage en anglais en 2000 (« la technologie ne vise pas tant à accélérer le progrès qu'à intensifier le pouvoir ») : le doute méthodique et néanmoins presque poétique exercé ici par Ernst Jünger vis-à-vis de l'avancée technologique, en résonance avec des réflexions menées ailleurs par Jacques Ellul, par exemple (« La Technique ou l'enjeu du siècle » est paru en 1954), va bien au-delà d'une simple nostalgie apparente (celle du cavalier vis-à-vis de la mécanisation blindée qui habite le capitaine Richard presque constamment, et tout particulièrement lorsqu'il évoque le sévère mentor Monteron – le jeu de l'auteur avec les noms propres est une constante jamais démentie – de sa jeunesse de cadet) comme d'un simple rejet conservateur de l'idée de progrès en soi. Reconstruisant une scène primitive de robots et d'automates qui doit certainement davantage à Karel Čapek qu'à Isaac Asimov, celui qui s'est installé sept ans plus tôt à Wilflingen, en Haute-Souabe (qu'il ne quittera plus pour habiter ailleurs), met le doigt, avec force, sur le devenir industriel du monde (anticipant de plusieurs dizaines d'années la mainmise de facto des grandes entreprises transnationales sur la décision politique qui compte – ce qui ne pouvait que fasciner Bruce Sterling comme membre fondateur du courant cyberpunk) et sur la composante militaire de toute une frange du spectaculaire marchand (et ce, bien avant Guy Debord ou Roger Stahl et son « Militainment Inc. »).
Il ne s'agit pas, loin de là, de masquer les innombrables palinodies ayant jalonné la longue carrière militaire et littéraire d'Ernst Jünger (le précieux ouvrage de Michel Vanoosthuyse, « Fascisme et littérature pure : la fabrique d'Ernst Jünger », recensait en 2005 la manière dont la France, bien plus que l'Allemagne, avait répugné à entériner les vraies failles du guerrier devenu collectionneur d'insectes). Ceci n'empêchera nullement, par exemple, de voir « Abeilles de verre » trouver une place bien particulière au sein du travail de Gilles Deleuze : lors de l'un des séminaires ayant conduit à « Mille plateaux », il utilise en la citant in extenso la remarque portant sur la distinction entre la mort à la guerre et la mort au travail, en extrayant la logique sous-jacente de l'auteur allemand de son contexte volontairement macabre (David Lynch s'en serait-il souvenu au moment de débuter son « Blue Velvet » de 1986 ?), pour nourrir sa réflexion sur les machines de guerre. Multipliant les références à « L'homme au sable » D E.T.A. Hoffmann comme un appel du pied mi-sérieux mi-amusé au fantastique qui irriguerait la technologie (le recours, sans la nommer, à la célèbre troisième loi de Clarke – « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie » – ne fera que le confirmer à la page 46), jouant comme par avance avec les ruptures technico-poétiques d'un Pierre Cendors (« Archives du vent », 2015), Ernst Jünger se permet même ici d'examiner à sa manière personnelle le pacte faustien du salarié de luxe, bien avant Herbert Marcuse, Laurent Thévenot, Luc Boltanski ou Eve Chiapello. Ce court roman, s'il semble d'abord rebondir sur les thématiques d'« Héliopolis », annonce sans aucun doute les développements bien ultérieurs d'« Eumeswil », mais il pratique cette anticipation avec un art bien spécifique du détour et de la digression, comme pour mieux désarçonner les attentes initiales de la lectrice ou du lecteur, et plus encore de celle ou celui ayant déjà bien arpenté ces terres du recours métaphorique aux forêts.
Lien : https://charybde2.wordpress...
Ce petit ouvrage m'avait interpelé d'après son titre et son résumé. La trame générale est la suivante : un homme, ancien officier de l'armée, est dans une situation financière délicate. Il cherche du travail et va tenter d'entrer au service de Zapparoni, un industriel à l'universe particulier, génial inventeur et grand magnat financier.
On va donc suivre le narrateur dans sa quête de ce travail, dans la découverte de l'univers de Zapparoni et surtout dans le souvenirs qui rejaillissent au fil de ses rencontres.
On tient là une sorte de conte philosophique qui fait entrer le lecteur dans une certaine atmosphère. Celle-ci alterne entre beauté/génie et critique de la guerre notamment, ainsi que de la société de l'époque (entre-deux guerres).
On va donc suivre le narrateur dans sa quête de ce travail, dans la découverte de l'univers de Zapparoni et surtout dans le souvenirs qui rejaillissent au fil de ses rencontres.
On tient là une sorte de conte philosophique qui fait entrer le lecteur dans une certaine atmosphère. Celle-ci alterne entre beauté/génie et critique de la guerre notamment, ainsi que de la société de l'époque (entre-deux guerres).
Pour ceux qui ont lu les deux chefs d'oeuvre de Jünger Sur les falaises de marbre et Orages d'acier, cet ouvrage peut surprendre. La forme est plus légère, la construction est originale et le résultat est aérien, onirique : les pensées d'un jeune homme, s'évadant lors d'une rencontre avec un étrange industriel.
Toutes ces divagations sont traversées de messages très actuels sur les débuts de la mécanisation face à la poésie d'une société naturelle, poindrait presque un sentiment écologique d'avant l'heure.
A lire !
Toutes ces divagations sont traversées de messages très actuels sur les débuts de la mécanisation face à la poésie d'une société naturelle, poindrait presque un sentiment écologique d'avant l'heure.
A lire !
Citations et extraits (15)
Voir plus
Ajouter une citation
Aux temps anciens, tout était plus simple. On jouissait sans doute d’un confort moindre, mais on avait bonne conscience quand on allongeait ses jambes sous sa propre table. C’est justement cette impression que j’éprouvais chez Zapparoni : qu’ici encore charbonnier était maître chez lui. J’aurais parié qu’il n’y avait ici ni compteur ni raccordement – du moins pas un seul qui rattachât la maison au monde du dehors. Il est probable que Zapparoni avait adapté à sa vie domestique le modèle de l’État commercial fermé, conçu par d’autres époques, et que ses automates lui en avaient donné le pouvoir. Dans les automates, c’est l’énergie abstraite qui se rend concrète, qui retourne à l’objet. Cependant, je ne voyais ici rien de pareil : il s’agirait plutôt de la conscience d’une atmosphère. La table portait même des bougies, et la cheminée un tablier.
Ici vivait, de toute évidence, non un rentier, mais bien plutôt un distributeur de rentes. Ici, la police ne pouvait pénétrer, quels que fussent son mandat ou son prétexte. Zapparoni ne se contentait pas d’entretenir sa propre police, chargée d’exécuter ses instructions, et elles seules. Ses chantiers et les chemins qui les reliaient étaient en outre surveillés par des agents et des ingénieurs de l’État ou de l’armée qui, aux termes de leur ordre de mission, devaient travailler « en bonne intelligence » avec lui, mais qui, en fait, ne pouvaient avoir d’autre opinion que la sienne.
La question se pose naturellement de savoir pourquoi un homme d’une telle puissance était contraint de recourir à un pauvre hère qui avait le couteau sous la gorge. C’est justement là que réside le mystère dont j’ai touché un mot. Fait curieux, et qui doit avoir de profondes racines, un être humain, si nombreux que soient les moyens légaux dont il dispose, ne peut mener à bien ses plans sans portes dérobées. Le domaine du droit, qu’il soit étroit ou vaste, confine toujours à l’illégalité. La frontière s’allonge en même temps que les droits reconnus. Nous trouvons plus de transgressions chez de grands seigneurs que chez l’homme quelconque. Quand les pouvoirs deviennent absolus, on aboutit à une situation telle que les frontières risquent de s’effacer, et que le juste et l’injuste sont presque indiscernables. Il vous faut alors des gens avec qui l’on puisse voler des chevaux.
Ici vivait, de toute évidence, non un rentier, mais bien plutôt un distributeur de rentes. Ici, la police ne pouvait pénétrer, quels que fussent son mandat ou son prétexte. Zapparoni ne se contentait pas d’entretenir sa propre police, chargée d’exécuter ses instructions, et elles seules. Ses chantiers et les chemins qui les reliaient étaient en outre surveillés par des agents et des ingénieurs de l’État ou de l’armée qui, aux termes de leur ordre de mission, devaient travailler « en bonne intelligence » avec lui, mais qui, en fait, ne pouvaient avoir d’autre opinion que la sienne.
La question se pose naturellement de savoir pourquoi un homme d’une telle puissance était contraint de recourir à un pauvre hère qui avait le couteau sous la gorge. C’est justement là que réside le mystère dont j’ai touché un mot. Fait curieux, et qui doit avoir de profondes racines, un être humain, si nombreux que soient les moyens légaux dont il dispose, ne peut mener à bien ses plans sans portes dérobées. Le domaine du droit, qu’il soit étroit ou vaste, confine toujours à l’illégalité. La frontière s’allonge en même temps que les droits reconnus. Nous trouvons plus de transgressions chez de grands seigneurs que chez l’homme quelconque. Quand les pouvoirs deviennent absolus, on aboutit à une situation telle que les frontières risquent de s’effacer, et que le juste et l’injuste sont presque indiscernables. Il vous faut alors des gens avec qui l’on puisse voler des chevaux.
incipit :
Quand nous étions à la côte, Twinnings nous servait de Providence. J'étais assis dans son bureau. Cette fois, je n'avais que trop tardé ; j'aurais dû depuis longtemps me décider à lui rendre visite, mais la misère brise en nous toute volonté. On s'incruste dans les cafés, tant qu'on a de la petite monnaie en poche, on use ses fonds de culotte et on baye aux corneilles.
Quand nous étions à la côte, Twinnings nous servait de Providence. J'étais assis dans son bureau. Cette fois, je n'avais que trop tardé ; j'aurais dû depuis longtemps me décider à lui rendre visite, mais la misère brise en nous toute volonté. On s'incruste dans les cafés, tant qu'on a de la petite monnaie en poche, on use ses fonds de culotte et on baye aux corneilles.
Quand nous étions à la côte, Twinnings nous servait de Providence. J’étais assis dans son bureau. Cette fois, je n’avais que trop tardé ; j’aurais dû depuis longtemps me décider à lui rendre visite, mais la misère brise en nous toute volonté. On s’incruste dans les cafés, tant qu’on a de la petite monnaie en poche, on use ses fonds de culotte et on baye aux corneilles. Le guignon n’arrivait pas à me lâcher. Je possédais encore un complet sortable, mais quand j’étais chez des gens, je n’osais plus croiser les jambes, car je marchais sur des semelles trouées. Ce sont des cas où l’on préfère la solitude.
Twinnings, qui avait servi avec moi dans les chevau-légers, m’avait déjà tiré de plus d’un mauvais pas, moi et d’autres camarades du vieux temps. Il connaissait toutes sortes de personnes. Après m’avoir écouté, il me fit comprendre que je ne pouvais plus aspirer qu’à des emplois en rapport avec ma situation, en d’autres termes, où l’on pouvait tomber sur un bec. Ce n’était que trop juste : je n’avais pas le droit de faire la petite bouche.
Nous étions amis, ce qui n’est pas beaucoup dire, car Twinnings était ami de presque tous ceux qu’il connaissait, à moins d’être positivement brouillé avec eux. C’était son job. Mais la manière dont il me traitait, sans nulle gêne, ne m’humiliait pas : on eût dit plutôt un de ces médecins qui vous auscultent consciencieusement et ne font pas de phrases. Il me prit par le revers de mon veston pour en tâter le drap. J’en aperçus les taches, comme si mes sens s’étaient affinés.
Puis il entra dans les détails de ma situation. J’étais déjà passablement brûlé ; certes, j’avais vu du pays, mais sans avoir grand-chose dont je pusse me vanter – il me fallut bien le reconnaître. Les meilleurs emplois étaient ceux dont on tire de gros revenus sans travailler, et en jouissant de l’envie générale. Mais est-ce que j’avais des parents capables de distribuer honneurs et commandes, comme, par exemple, Paulot Domann, dont le beau-père avait une usine de locomotives, et qui gagnait plus en un seul déjeuner que d’autres ne font en s’éreintant d’un bout à l’autre de l’année, le dimanche comme en semaine ? Plus les affaires où l’on sert de démarcheur sont importantes, et moins elles vous donnent de peine ; une locomotive se vend plus facilement qu’un aspirateur.
J’avais bien eu un oncle sénateur, mais il était mort depuis longtemps. Personne ne se souvenait plus de lui. Mon père avait mené une existence placide de fonctionnaire ; il y avait belle lurette que j’avais mangé son petit héritage. J’avais épousé une femme pauvre. Un sénateur défunt, une femme qui va ouvrir elle-même quand on sonne : il n’y avait pas de quoi jouer les grands seigneurs.
Venaient en second lieu les emplois qui demandent beaucoup de travail et dont on est sûr qu’ils ne rapportent rien du tout. Il fallait placer des réfrigérateurs ou des machines à laver, de porte en porte, à en attraper la phobie des boutons de sonnette. Il fallait empoisonner de vieux camarades, qu’on allait voir et à qui on refilait perfidement des caisses de Moselle, ou à qui on faisait souscrire une police d’assurances. Twinnings les laissa de côté, avec un sourire, ce dont je lui sus gré. Il aurait pu me demander si j’étais à la hauteur de meilleurs emplois. Il n’ignorait sans doute pas que j’avais travaillé à la réception des blindés, mais n’ignorait pas non plus que je figurais sur les listes noires du service. J’y reviendrai.
Restaient en somme les affaires risquées. On avait la vie facile et de quoi vivre, mais on dormait mal. Twinnings en passa quelques-unes en revue : il s’agissait de postes de détective privé, ou du même genre. Qui, de nos jours, n’a pas sa police ? Les temps n’étaient pas sûrs. On vous chargeait de protéger la vie et les biens, de surveiller les terrains et les transferts, de faire échouer le chantage et les attentats. L’impudence croissait à la même vitesse que la philanthropie. Parvenu à un certain niveau de célébrité, on ne pouvait plus se fier à la force publique : il fallait avoir son gourdin à domicile.
Twinnings, qui avait servi avec moi dans les chevau-légers, m’avait déjà tiré de plus d’un mauvais pas, moi et d’autres camarades du vieux temps. Il connaissait toutes sortes de personnes. Après m’avoir écouté, il me fit comprendre que je ne pouvais plus aspirer qu’à des emplois en rapport avec ma situation, en d’autres termes, où l’on pouvait tomber sur un bec. Ce n’était que trop juste : je n’avais pas le droit de faire la petite bouche.
Nous étions amis, ce qui n’est pas beaucoup dire, car Twinnings était ami de presque tous ceux qu’il connaissait, à moins d’être positivement brouillé avec eux. C’était son job. Mais la manière dont il me traitait, sans nulle gêne, ne m’humiliait pas : on eût dit plutôt un de ces médecins qui vous auscultent consciencieusement et ne font pas de phrases. Il me prit par le revers de mon veston pour en tâter le drap. J’en aperçus les taches, comme si mes sens s’étaient affinés.
Puis il entra dans les détails de ma situation. J’étais déjà passablement brûlé ; certes, j’avais vu du pays, mais sans avoir grand-chose dont je pusse me vanter – il me fallut bien le reconnaître. Les meilleurs emplois étaient ceux dont on tire de gros revenus sans travailler, et en jouissant de l’envie générale. Mais est-ce que j’avais des parents capables de distribuer honneurs et commandes, comme, par exemple, Paulot Domann, dont le beau-père avait une usine de locomotives, et qui gagnait plus en un seul déjeuner que d’autres ne font en s’éreintant d’un bout à l’autre de l’année, le dimanche comme en semaine ? Plus les affaires où l’on sert de démarcheur sont importantes, et moins elles vous donnent de peine ; une locomotive se vend plus facilement qu’un aspirateur.
J’avais bien eu un oncle sénateur, mais il était mort depuis longtemps. Personne ne se souvenait plus de lui. Mon père avait mené une existence placide de fonctionnaire ; il y avait belle lurette que j’avais mangé son petit héritage. J’avais épousé une femme pauvre. Un sénateur défunt, une femme qui va ouvrir elle-même quand on sonne : il n’y avait pas de quoi jouer les grands seigneurs.
Venaient en second lieu les emplois qui demandent beaucoup de travail et dont on est sûr qu’ils ne rapportent rien du tout. Il fallait placer des réfrigérateurs ou des machines à laver, de porte en porte, à en attraper la phobie des boutons de sonnette. Il fallait empoisonner de vieux camarades, qu’on allait voir et à qui on refilait perfidement des caisses de Moselle, ou à qui on faisait souscrire une police d’assurances. Twinnings les laissa de côté, avec un sourire, ce dont je lui sus gré. Il aurait pu me demander si j’étais à la hauteur de meilleurs emplois. Il n’ignorait sans doute pas que j’avais travaillé à la réception des blindés, mais n’ignorait pas non plus que je figurais sur les listes noires du service. J’y reviendrai.
Restaient en somme les affaires risquées. On avait la vie facile et de quoi vivre, mais on dormait mal. Twinnings en passa quelques-unes en revue : il s’agissait de postes de détective privé, ou du même genre. Qui, de nos jours, n’a pas sa police ? Les temps n’étaient pas sûrs. On vous chargeait de protéger la vie et les biens, de surveiller les terrains et les transferts, de faire échouer le chantage et les attentats. L’impudence croissait à la même vitesse que la philanthropie. Parvenu à un certain niveau de célébrité, on ne pouvait plus se fier à la force publique : il fallait avoir son gourdin à domicile.
« Qui est-ce qui n’a pas son casier judiciaire, à l’heure actuelle ? Toi, peut-être, parce que tu as toujours su nager ; mais à part cela, rien que les planqués de la guerre et de la paix. »
Twinnings se mit à rire.
« Ne t’énerve pas, Richard – nous savons tous que tu as quelques taches à ton écusson. Mais la différence, c’est que tes condamnations sont les bonnes. »
Il était payé pour le savoir, puisqu’il avait siégé au jury d’honneur qui m’avait jugé : non le premier, quand j’avais été cassé de mon grade pour tentative de haute trahison, après avoir été condamné, pour commencer, par le conseil de guerre – je n’appris ces deux sentences qu’en Asturie, où elles me furent profitables. Non, je veux parler du second jury d’honneur, qui me rétablit dans mon grade. Mais qu’est-ce qu’un jury d’honneur, quand le terme d’honneur, lui aussi, est de ces mots qui sont devenus hautement suspects ?
Je fus donc réhabilité par des gens comme Twinnings, qui s’était replié, le malin, chez ses parents d’Angleterre. À tout prendre, c’eut été à lui de se justifier. Et le curieux, c’est que la condamnation subsistait dans mes papiers. Les gouvernements changent, les dossiers sont inébranlables. Restait ce paradoxe que dans les registres de l’État, le fait d’avoir risqué sa peau pour lui était inscrit, note indélébile, sous la rubrique de la trahison. Quand on mentionnait mon nom, les scribouillards des bureaux, que moi et mes pareils avions hissé sur leurs ronds-de-cuir, faisaient la petite bouche.
Outre cette grande affaire, mes pièces contenaient quelques broutilles – je ne le nierai point ; entre autres l’un de ces bons tours dont notre esprit accouche quand nous avons trop de chance : il remontait encore aux temps de la monarchie. Il y avait là, entre autres affaires, une « provocation en duel ». On avait aussi pris note de la profanation d’un monument, encore l’un de ces mots qui se fondent sur un respect d’autrefois, à une époque où les monuments n’en sont plus. Nous avions culbuté un bloc de béton qui portait un nom – du diable soit si je me souviens duquel. D’abord, nous avions bu plus que de raison, et puis, rien ne s’oublie plus facilement de nos jours que les noms qui, hier encore, étaient dans toutes les bouches et sur toutes les plaques des rues. L’ardeur à leur dresser des monuments est peu commune, et souvent elle ne survit guère à leurs porteurs.
Il est de fait que tout cela, non seulement m’avait nui, mais n’avait servi à rien du tout. Je n’aimais plus y repenser. Mais les autres en gardaient fidèlement la mémoire.
Donc, Twinnings trouvait que mes condamnations étaient les bonnes. Mais, de nouveau, il me semblait peu rassurant que Zapparoni les tint pour telles. Car qu’est-ce que cela signifiait ? Cela voulait dire qu’il cherchait un bâton à prendre par les deux bouts : l’un sûr, par lequel on pût le tenir, mais aussi un autre. Il avait besoin de quelqu’un qui fût sérieux, mais pas tout à fait sérieux.
Le peuple dit d’un factotum comme il en cherchait un : « Quelqu’un avec qui on pourrait voler des chevaux. » La formule doit remonter à des époques où le vol de chevaux passait pour une entreprise périlleuse, certes, mais sans rien de déshonorant. Si le coup réussissait, il était glorieux ; sinon, on était branché au saule, ou bien on y laissait ses oreilles.
Cette tournure convenait assez exactement à ma situation. Il s’y trouvait encore, à dire vrai, une petite différence : Zapparoni cherchait, de toute évidence, un homme avec qui il pût voler des chevaux, tout en étant trop grand seigneur pour se mêler personnellement de l’expédition. Mais à quoi bon ces réserves ? Il y avait aussi un autre diction adapté à mon état, savoir : faute de grives on mange des merles.
Twinnings se mit à rire.
« Ne t’énerve pas, Richard – nous savons tous que tu as quelques taches à ton écusson. Mais la différence, c’est que tes condamnations sont les bonnes. »
Il était payé pour le savoir, puisqu’il avait siégé au jury d’honneur qui m’avait jugé : non le premier, quand j’avais été cassé de mon grade pour tentative de haute trahison, après avoir été condamné, pour commencer, par le conseil de guerre – je n’appris ces deux sentences qu’en Asturie, où elles me furent profitables. Non, je veux parler du second jury d’honneur, qui me rétablit dans mon grade. Mais qu’est-ce qu’un jury d’honneur, quand le terme d’honneur, lui aussi, est de ces mots qui sont devenus hautement suspects ?
Je fus donc réhabilité par des gens comme Twinnings, qui s’était replié, le malin, chez ses parents d’Angleterre. À tout prendre, c’eut été à lui de se justifier. Et le curieux, c’est que la condamnation subsistait dans mes papiers. Les gouvernements changent, les dossiers sont inébranlables. Restait ce paradoxe que dans les registres de l’État, le fait d’avoir risqué sa peau pour lui était inscrit, note indélébile, sous la rubrique de la trahison. Quand on mentionnait mon nom, les scribouillards des bureaux, que moi et mes pareils avions hissé sur leurs ronds-de-cuir, faisaient la petite bouche.
Outre cette grande affaire, mes pièces contenaient quelques broutilles – je ne le nierai point ; entre autres l’un de ces bons tours dont notre esprit accouche quand nous avons trop de chance : il remontait encore aux temps de la monarchie. Il y avait là, entre autres affaires, une « provocation en duel ». On avait aussi pris note de la profanation d’un monument, encore l’un de ces mots qui se fondent sur un respect d’autrefois, à une époque où les monuments n’en sont plus. Nous avions culbuté un bloc de béton qui portait un nom – du diable soit si je me souviens duquel. D’abord, nous avions bu plus que de raison, et puis, rien ne s’oublie plus facilement de nos jours que les noms qui, hier encore, étaient dans toutes les bouches et sur toutes les plaques des rues. L’ardeur à leur dresser des monuments est peu commune, et souvent elle ne survit guère à leurs porteurs.
Il est de fait que tout cela, non seulement m’avait nui, mais n’avait servi à rien du tout. Je n’aimais plus y repenser. Mais les autres en gardaient fidèlement la mémoire.
Donc, Twinnings trouvait que mes condamnations étaient les bonnes. Mais, de nouveau, il me semblait peu rassurant que Zapparoni les tint pour telles. Car qu’est-ce que cela signifiait ? Cela voulait dire qu’il cherchait un bâton à prendre par les deux bouts : l’un sûr, par lequel on pût le tenir, mais aussi un autre. Il avait besoin de quelqu’un qui fût sérieux, mais pas tout à fait sérieux.
Le peuple dit d’un factotum comme il en cherchait un : « Quelqu’un avec qui on pourrait voler des chevaux. » La formule doit remonter à des époques où le vol de chevaux passait pour une entreprise périlleuse, certes, mais sans rien de déshonorant. Si le coup réussissait, il était glorieux ; sinon, on était branché au saule, ou bien on y laissait ses oreilles.
Cette tournure convenait assez exactement à ma situation. Il s’y trouvait encore, à dire vrai, une petite différence : Zapparoni cherchait, de toute évidence, un homme avec qui il pût voler des chevaux, tout en étant trop grand seigneur pour se mêler personnellement de l’expédition. Mais à quoi bon ces réserves ? Il y avait aussi un autre diction adapté à mon état, savoir : faute de grives on mange des merles.
Zapparoni disposait d’un état-major d’excellent spécialistes. Ce qu’il préférait, c’était voir les inventeurs qui lui soumettaient leurs modèles s’attacher définitivement à lui. Ils reproduisaient leurs inventions, ou y apportaient des variantes. Celles-ci étaient surtout nécessaires dans les branches soumises à la mode, comme celle du jouet. On n’avait rien vu d’aussi incroyable dans ce domaine, avant l’ère zapparonienne – il créait un royaume pour Lilliputiens, un monde animé de nains qui fascinaient les adultes, et non pas seulement les enfants, jusqu’à leur faire perdre, comme en rêve, la notion du temps. Ces jeux dépassaient ceux de l’imagination. Mais ce théâtre de Lilliput, il fallait l’orner tous les ans, pour Noël, de nouveaux décors, y faire monter des vedettes nouvelles.
Zapparoni allouait aux travailleurs qu’il employait des traitements de professeurs d’Université, voire de ministres. Ils le lui rendaient largement. Un contrat dénoncé eût entraîné pour lui des pertes irrémédiables, et jusqu’à une catastrophe, si le lâcheur avait poursuivi son travail chez un concurrent, soit dans le pays même, soit, pis encore, à l’étranger. La richesse de Zapparoni, le monopole dont il jouissait, n’étaient pas seulement fondés sur des secrets de fabrication, mais aussi sur des méthodes qui ne pouvaient être acquises qu’après des dizaines d’années, et qui, même alors, n’étaient pas à la portée du premier venu. Et cette technique collait au corps du travailleur, à ses mains, à sa tête.
Il est vrai qu’on n’en voyait guère désireux de quitter une place où on les payait et les traitait comme des princes. Mais il se rencontrait des exceptions. Une vieille sagesse nous dit que l’homme est insatiable. Et, cette règle mise à part, Zapparoni avait affaire à un personnel décidément difficile à manier ; à force de fréquenter des objets minuscules et souvent bizarres, ils devenaient à la longue maniaques et bourrelés de scrupules ; leur travail produisait des caractères qui trébuchaient sur un grain de poussière et trouvaient un cheveu dans toutes les soupes. C’étaient des artistes qui fabriquaient sur mesure des fers pour pattes de puce, et les adaptaient. Ils vivaient à l’extrême limite du pur et simple imaginaire. Le monde d’automates sur lequel régnait Zapparoni, assez étrange en soi, tirait sa vie d’esprits qui s’adonnaient aux plus curieuses des marottes. Dans son bureau privé, on se serait souvent cru, disait-on, chez le médecin-chef d’un asile de fous. Le fait est qu’il n’existait pas encore de robots à fabriquer les robots. C’eût été la pierre philosophale, la quadrature du cercle.
Zapparoni était bien obligé de tenir compte de ces faits. Ils étaient impliqués par la nature même de ses usines. Il s’en tirait sans maladresse. Dans son usine de modèles, il se réservait les rapports avec le personnel et y déployait tout le charme, toute la souplesse d’un imprésario méridional. Il frôlait dans ce domaine la limite du possible. Être un jour exploité comme par Zapparoni, c’était le rêve de tous les jeunes gens à vocation de technicien. Il était rare que son sang-froid, sa bonne grâce lui fissent défaut : alors éclataient des scènes épouvantables.
Bien entendu, il cherchait à se couvrir par ses contrats d’embauche, fût-ce sous les apparences d’une parfaite amabilité. Ils étaient conclus à vie, prévoyaient des échelles de salaire, des primes, des assurances et des sanctions forfaitaires, en cas de rupture de contrat. Quand on avait signé un papier avec Zapparoni et qu’on pouvait se dire maître ou auteur dans ses usines, on avait fortune faite. On possédait sa maison, son auto, ses congés payés à Ténériffe ou en Norvège.
Zapparoni allouait aux travailleurs qu’il employait des traitements de professeurs d’Université, voire de ministres. Ils le lui rendaient largement. Un contrat dénoncé eût entraîné pour lui des pertes irrémédiables, et jusqu’à une catastrophe, si le lâcheur avait poursuivi son travail chez un concurrent, soit dans le pays même, soit, pis encore, à l’étranger. La richesse de Zapparoni, le monopole dont il jouissait, n’étaient pas seulement fondés sur des secrets de fabrication, mais aussi sur des méthodes qui ne pouvaient être acquises qu’après des dizaines d’années, et qui, même alors, n’étaient pas à la portée du premier venu. Et cette technique collait au corps du travailleur, à ses mains, à sa tête.
Il est vrai qu’on n’en voyait guère désireux de quitter une place où on les payait et les traitait comme des princes. Mais il se rencontrait des exceptions. Une vieille sagesse nous dit que l’homme est insatiable. Et, cette règle mise à part, Zapparoni avait affaire à un personnel décidément difficile à manier ; à force de fréquenter des objets minuscules et souvent bizarres, ils devenaient à la longue maniaques et bourrelés de scrupules ; leur travail produisait des caractères qui trébuchaient sur un grain de poussière et trouvaient un cheveu dans toutes les soupes. C’étaient des artistes qui fabriquaient sur mesure des fers pour pattes de puce, et les adaptaient. Ils vivaient à l’extrême limite du pur et simple imaginaire. Le monde d’automates sur lequel régnait Zapparoni, assez étrange en soi, tirait sa vie d’esprits qui s’adonnaient aux plus curieuses des marottes. Dans son bureau privé, on se serait souvent cru, disait-on, chez le médecin-chef d’un asile de fous. Le fait est qu’il n’existait pas encore de robots à fabriquer les robots. C’eût été la pierre philosophale, la quadrature du cercle.
Zapparoni était bien obligé de tenir compte de ces faits. Ils étaient impliqués par la nature même de ses usines. Il s’en tirait sans maladresse. Dans son usine de modèles, il se réservait les rapports avec le personnel et y déployait tout le charme, toute la souplesse d’un imprésario méridional. Il frôlait dans ce domaine la limite du possible. Être un jour exploité comme par Zapparoni, c’était le rêve de tous les jeunes gens à vocation de technicien. Il était rare que son sang-froid, sa bonne grâce lui fissent défaut : alors éclataient des scènes épouvantables.
Bien entendu, il cherchait à se couvrir par ses contrats d’embauche, fût-ce sous les apparences d’une parfaite amabilité. Ils étaient conclus à vie, prévoyaient des échelles de salaire, des primes, des assurances et des sanctions forfaitaires, en cas de rupture de contrat. Quand on avait signé un papier avec Zapparoni et qu’on pouvait se dire maître ou auteur dans ses usines, on avait fortune faite. On possédait sa maison, son auto, ses congés payés à Ténériffe ou en Norvège.
Videos de Ernst Jünger (8)
Voir plusAjouter une vidéo
À travers les différents ouvrages que l'auteur a écrit pendant et après ses voyages à travers le monde, la poésie a pris une place importante. Mais pas que ! Sylvain Tesson est venu sur le plateau de la grande librairie avec les livres ont fait de lui l'écrivain qu'il est aujourd'hui, au-delàs de ses voyages. "Ce sont les livres que je consulte tout le temps. Je les lis, je les relis et je les annote" raconte-il à François Busnel. Parmi eux, "Entretiens" de Julien Gracq, un professeur de géographie, "Sur les falaises de marbres" d'Ernst Jünger ou encore, "La Ferme africaine" de Karen Blixen.
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous : https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous : https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
+ Lire la suite
autres livres classés : iconoclastieVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Ernst Jünger (74)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz: l'Allemagne et la Littérature
Les deux frères Jacob et Whilhelm sont les auteurs de contes célèbres, quel est leur nom ?
Hoffmann
Gordon
Grimm
Marx
10 questions
413 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature allemande
, guerre mondiale
, allemagneCréer un quiz sur ce livre413 lecteurs ont répondu