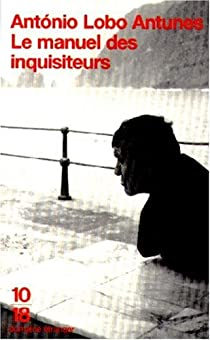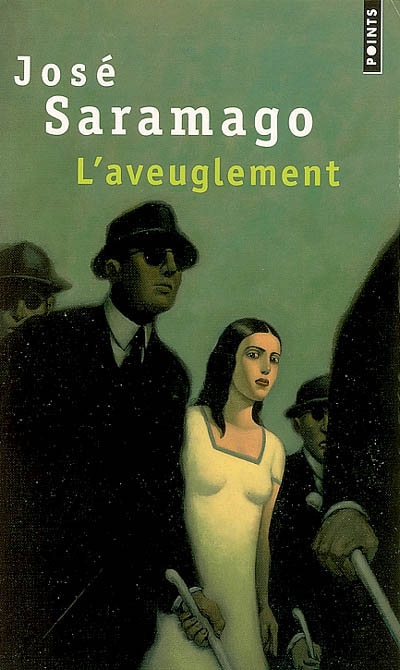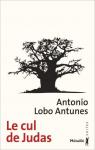Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Et si pour comprendre les racines de la violence, on écoutait ceux qui traquent la violence et ceux qui s'y adonnent ? Quitte à plonger au coeur du mal…
« Mon nom est légion » d'Antonio Lobo Antunes, c'est à lire en poche chez Points.

Antonio Lobo Antunes
Carlos Batista (Traducteur)/5 34 notes
" En quinze ans, Antonio Lobo Antunes est devenu l'un des emblèmes du Portugal de l'après-salazarisme. A cinquante-trois ans, il fait partie de la génération qui, avec Lidia Jorge, José Cardoso Pires et José Saramago, a renouvelé depuis vingt ans les lettres portugaises, jusque-là hantées par le fantôme de Fernando Pessoa et dominées par la figure rebelle mais en définitive traditionaliste de Miguel Torga. C'est peut-être lui qui symbolise le mieux le va... >Voir plus
Carlos Batista (Traducteur)/5 34 notes
Résumé :
" En quinze ans, Antonio Lobo Antunes est devenu l'un des emblèmes du Portugal de l'après-salazarisme. A cinquante-trois ans, il fait partie de la génération qui, avec Lidia Jorge, José Cardoso Pires et José Saramago, a renouvelé depuis vingt ans les lettres portugaises, jusque-là hantées par le fantôme de Fernando Pessoa et dominées par la figure rebelle mais en définitive traditionaliste de Miguel Torga. C'est peut-être lui qui symbolise le mieux le va... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le manuel des inquisiteursVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (7)
Voir plus
Ajouter une critique
Antonio Lobo Antunes c'est avant tout une plume unique, stupéfiante, d'une élégance folle, qui le place parmi les auteurs nobélisables. Une plume à nulle autre pareille, reconnaissable entre toute. Lobo Antunes, c'est la phrase qui court sur des pages et des pages, voire un chapitre entier, la phrase qui entremêle le passé et le présent, qui entrelace pensées brutes sans filtre, souvenirs, rêves, faits et gestes du moment dans un mouvement de vient et va incessant donnant au déploiement de la phrase la fluidité, le rythme et les rondeurs d'un ruban lancé au vent, d'un ruban tour à tour claquant ou caressant ; Lobo Antunes ce sont certaines phrases répétées, mantras hypnotiques et métronomiques, ritournelles révélant failles, amertume, malaise, part de folie ; Lobo Antunes c'est une prose sublime qui mêle détestation de la dictature Salazarienne et nostalgie de l'enfance, qui fait se conjuguer faits passés crus, violents et radicaux, et poésie sensorielle et bucolique, prose au charme suranné liée aux souvenirs. Voilà pourquoi Lobo Antunes aura le Prix Nobel, doit avoir le Prix Nobel, et comme il vient de sortir un nouveau livre, « La dernière porte avant la nuit », aux fameuses éditions Bourgois, je ne peux m'empêcher de penser que c'est peut-être pour cette année. Pour bientôt. La dernière porte avant le Graal. Boa Sorte Antonio !
Le passé et le présent, l'avant et l'après, pour Lobo Antunes se résume très souvent à l'avant et l'après Révolution portugaise des oeillets d'avril 1974 renversant la dictature, et par là même le pouvoir de toutes les personnes gravitant autour de Salazar. La dictature par opposition à la démocratie. Avec au milieu cette fracture béante qu'a constitué la guerre coloniale en Afrique, en Angola en particulier. Antonio Lobo Antunes y a servi vingt-sept mois, entre 1971 et 1973, comme jeune médecin militaire. Il y amputait les blessés à la scie. de cette expérience terrible va émerger un écrivain unique. Qui sait à la fois crier les horreurs, dénoncer la société portugaise, ses inégalités, son patriarcat, son racisme envers les africains, dire clairement sans détour ce qui est, tout en étant d'une sensibilité extrême à la beauté.
« C'était le mois de juillet et les vagues si bleues si bleues si bleues, vous n'imaginez pas combien elles étaient bleues, d'un bleu plus intense que ce chemisier, jamais au grand jamais, ni en Sicile ni en Grèce, je n'ai vu un bleu pareil, ça donnait envie d'être pauvre et d'habiter dans une cabane rien que pour le bleu de la mer, quel dommage que ces gens, par manque de sensibilité, n'apprécient pas la nature et préfèrent à une vue de rêve les cinq premiers escudos venus, je ne comprends pas comment fait Dieu dans le ciel pour traiter avec ces gens sans manières, quelle corvée… »
Cet avant et après Révolution est témoin d'une évolution radicale de la société : le Portugal passe d'une société de castes, une société patriarcale où le pouvoir est détenu par une poignée d'hommes sans foi ni loi, à une société plus démocratique. Je suis le fruit de cette société. La petite-fille d'un dominant ayant abusé d'une femme pauvre. La petite fille d'une union hasardeuse entre un maitre tout puissant et une servante qui n'a jamais osé protester. La fille d'un batard. D'un père biberonné au « fils de pute » répété à l'envi. Ce livre a fait vibrer mes racines qui ont même réussi, en forçant douloureusement à bourgeonner, légèrement, du terreau de mon âme.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Dans le manuel des inquisiteurs, le narrateur, Joao, est le fils d'un tel homme de pouvoir, un personnage proche du dictateur Salazar, un quasi ministre ou député, on ne sait pas trop, gouvernant en secret, pouvant décider d'un coup de téléphone l'emprisonnement ou la libération de n'importe qui, propriétaire dans la ville de Palmela d'un magnifique domaine, une vaste demeure aux escaliers flanqués d'anges de granit, aux jacinthes poussant le long des murs, a la magnifique serre d'orchidées, aux eucalyptus murmurant dans le marais, croissant et diminuant suivant la respiration des algues, aux effluves de rose-thé.
Le décor est aussi sublime que le personnage est haïssable. Un homme au sans-gêne incroyable, à l'impudence inouïe, renversant sur la table de l'office, du bout de ses bottes crasseuses, les servantes muettes sans même prendre la peine d'ôter son chapeau de la tête, jugeant les femmes, leur hanche, leurs mensurations, comme on juge une génisse, s'achetant pour quelques mensualités une jeune fille pétrifiée de peur qu'il déguise en épouse de notable, buvant le thé en compagnie de Salazar et d'un amiral à la poitrine blindée de médailles, tout en distribuant ses conseils sur le gouvernement du monde. Un homme odieux, dangereux, marqué du sceau de l'oppression, du mépris de classe, du mépris pour les femmes, de l'arrogance, du pouvoir tout puissant. Mon mystérieux grand-père fut, à un degré moindre, un tel homme.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Aujourd'hui cet homme (l'homme du livre, concernant mon aïeul inconnu, je ne sais pas) est un vieillard sénile placé dans un institut, un vase de nuit glissé entre ses jambes squelettiques, atteint de la maladie d'Alzheimer. le tout puissant « transformé en un mikado de tibias, en une paire de narines dilatées, en un fantoche sans mérite ». Nourri comme un petit enfant, changé comme un nourrisson. Décrépitude d'un homme au pouvoir bref, chute vertigineuse, le fils Joao raconte avec amertume, avec haine comment fut ce père, ce qu'il a vu et entendu alors qu'il était haut comme trois pommes, et ce qu'est devenu ce père haï. Il raconte comment, de façon concomitante, avec le déclin de son propriétaire, le domaine a également sombré laissant une maison éventrée, dévorée par son marais avec ses eucalyptus monstrueux, aux conduits d'irrigation obstrués par le chiendent, aux hêtres et aux cyprès dépouillés par les corbeaux, aux tableaux éparpillés au sol, aux tapis décolorés, à la chapelle envahie par des plantes grimpantes et à la piscine dans laquelle l'eau est en train de pourrir...Intimidante majesté décrépite des moulures dorées en miette sur le sol. Décadence d'un homme, décadence d'un lieu avec l'arrive de la démocratie.
Des chapitres intercalés laissent parler les personnages qui ont gravité autour de cet homme, notamment de nombreuses femmes, toutes humiliées, depuis la jeune servante abusée de façon odieuse par le père, en passant par la belle-fille qu'il ne ménage pas, ou encore la vieille nourrice Titina qui a élevé ce fils sans repère, ce fils devenu presque le sien, mais on entend aussi la voix de quelques hommes comme le vétérinaire se transformant parfois en accoucheur des pauvres femmes que cet homme a engrossé.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Le côté choral du livre permet de se placer tour à tour dans les pensées et les sentiments des opprimés et des oppresseurs pendant la dictature, au moment du renversement et après la dictature. Ce fut passionnant et intéressant de voir les prises de positions des uns et des autres, leurs craintes, leurs croyances. Mes racines plongent dans ces deux camps extrêmes, ce fut pour moi perturbant.
« Les vitres brisées de la serre, les châssis fracassés, les vases en morceaux, les orchidées aux pétales dilatés pendillant en longues lèvres violacées » métaphore de ce qui s'est passé…un tesson de miroir vert-de-gris ce livre qui fait comme une coupure de laquelle s'écoule une « tristesse mielleuse comme lorsqu'il arrive de pleuvoir un après-midi de septembre » …Le manuel des inquisiteurs, c'est la tentative douce-amère de se construire lorsqu'on hérite de cette histoire...un chef d'oeuvre.
Le passé et le présent, l'avant et l'après, pour Lobo Antunes se résume très souvent à l'avant et l'après Révolution portugaise des oeillets d'avril 1974 renversant la dictature, et par là même le pouvoir de toutes les personnes gravitant autour de Salazar. La dictature par opposition à la démocratie. Avec au milieu cette fracture béante qu'a constitué la guerre coloniale en Afrique, en Angola en particulier. Antonio Lobo Antunes y a servi vingt-sept mois, entre 1971 et 1973, comme jeune médecin militaire. Il y amputait les blessés à la scie. de cette expérience terrible va émerger un écrivain unique. Qui sait à la fois crier les horreurs, dénoncer la société portugaise, ses inégalités, son patriarcat, son racisme envers les africains, dire clairement sans détour ce qui est, tout en étant d'une sensibilité extrême à la beauté.
« C'était le mois de juillet et les vagues si bleues si bleues si bleues, vous n'imaginez pas combien elles étaient bleues, d'un bleu plus intense que ce chemisier, jamais au grand jamais, ni en Sicile ni en Grèce, je n'ai vu un bleu pareil, ça donnait envie d'être pauvre et d'habiter dans une cabane rien que pour le bleu de la mer, quel dommage que ces gens, par manque de sensibilité, n'apprécient pas la nature et préfèrent à une vue de rêve les cinq premiers escudos venus, je ne comprends pas comment fait Dieu dans le ciel pour traiter avec ces gens sans manières, quelle corvée… »
Cet avant et après Révolution est témoin d'une évolution radicale de la société : le Portugal passe d'une société de castes, une société patriarcale où le pouvoir est détenu par une poignée d'hommes sans foi ni loi, à une société plus démocratique. Je suis le fruit de cette société. La petite-fille d'un dominant ayant abusé d'une femme pauvre. La petite fille d'une union hasardeuse entre un maitre tout puissant et une servante qui n'a jamais osé protester. La fille d'un batard. D'un père biberonné au « fils de pute » répété à l'envi. Ce livre a fait vibrer mes racines qui ont même réussi, en forçant douloureusement à bourgeonner, légèrement, du terreau de mon âme.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Dans le manuel des inquisiteurs, le narrateur, Joao, est le fils d'un tel homme de pouvoir, un personnage proche du dictateur Salazar, un quasi ministre ou député, on ne sait pas trop, gouvernant en secret, pouvant décider d'un coup de téléphone l'emprisonnement ou la libération de n'importe qui, propriétaire dans la ville de Palmela d'un magnifique domaine, une vaste demeure aux escaliers flanqués d'anges de granit, aux jacinthes poussant le long des murs, a la magnifique serre d'orchidées, aux eucalyptus murmurant dans le marais, croissant et diminuant suivant la respiration des algues, aux effluves de rose-thé.
Le décor est aussi sublime que le personnage est haïssable. Un homme au sans-gêne incroyable, à l'impudence inouïe, renversant sur la table de l'office, du bout de ses bottes crasseuses, les servantes muettes sans même prendre la peine d'ôter son chapeau de la tête, jugeant les femmes, leur hanche, leurs mensurations, comme on juge une génisse, s'achetant pour quelques mensualités une jeune fille pétrifiée de peur qu'il déguise en épouse de notable, buvant le thé en compagnie de Salazar et d'un amiral à la poitrine blindée de médailles, tout en distribuant ses conseils sur le gouvernement du monde. Un homme odieux, dangereux, marqué du sceau de l'oppression, du mépris de classe, du mépris pour les femmes, de l'arrogance, du pouvoir tout puissant. Mon mystérieux grand-père fut, à un degré moindre, un tel homme.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Aujourd'hui cet homme (l'homme du livre, concernant mon aïeul inconnu, je ne sais pas) est un vieillard sénile placé dans un institut, un vase de nuit glissé entre ses jambes squelettiques, atteint de la maladie d'Alzheimer. le tout puissant « transformé en un mikado de tibias, en une paire de narines dilatées, en un fantoche sans mérite ». Nourri comme un petit enfant, changé comme un nourrisson. Décrépitude d'un homme au pouvoir bref, chute vertigineuse, le fils Joao raconte avec amertume, avec haine comment fut ce père, ce qu'il a vu et entendu alors qu'il était haut comme trois pommes, et ce qu'est devenu ce père haï. Il raconte comment, de façon concomitante, avec le déclin de son propriétaire, le domaine a également sombré laissant une maison éventrée, dévorée par son marais avec ses eucalyptus monstrueux, aux conduits d'irrigation obstrués par le chiendent, aux hêtres et aux cyprès dépouillés par les corbeaux, aux tableaux éparpillés au sol, aux tapis décolorés, à la chapelle envahie par des plantes grimpantes et à la piscine dans laquelle l'eau est en train de pourrir...Intimidante majesté décrépite des moulures dorées en miette sur le sol. Décadence d'un homme, décadence d'un lieu avec l'arrive de la démocratie.
Des chapitres intercalés laissent parler les personnages qui ont gravité autour de cet homme, notamment de nombreuses femmes, toutes humiliées, depuis la jeune servante abusée de façon odieuse par le père, en passant par la belle-fille qu'il ne ménage pas, ou encore la vieille nourrice Titina qui a élevé ce fils sans repère, ce fils devenu presque le sien, mais on entend aussi la voix de quelques hommes comme le vétérinaire se transformant parfois en accoucheur des pauvres femmes que cet homme a engrossé.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Le côté choral du livre permet de se placer tour à tour dans les pensées et les sentiments des opprimés et des oppresseurs pendant la dictature, au moment du renversement et après la dictature. Ce fut passionnant et intéressant de voir les prises de positions des uns et des autres, leurs craintes, leurs croyances. Mes racines plongent dans ces deux camps extrêmes, ce fut pour moi perturbant.
« Les vitres brisées de la serre, les châssis fracassés, les vases en morceaux, les orchidées aux pétales dilatés pendillant en longues lèvres violacées » métaphore de ce qui s'est passé…un tesson de miroir vert-de-gris ce livre qui fait comme une coupure de laquelle s'écoule une « tristesse mielleuse comme lorsqu'il arrive de pleuvoir un après-midi de septembre » …Le manuel des inquisiteurs, c'est la tentative douce-amère de se construire lorsqu'on hérite de cette histoire...un chef d'oeuvre.
Un des premiers « Manuel de l'Inquisiteur », écrit en 1376 par Eymerich pour légiférer la torture et déjouer les astuces des hérétiques, utilise à la fois la véhémence « on les gardera dans une prison horrible et obscure », le pragmatisme, car les ruses de ces hérétiques sont cousues de fil blanc, et le cynisme « la condamnation à mort n'a pas pour but de sauver l'âme de ces damnés, mais de terroriser le peuple. »
Antonio Lobo Antunes reprend le titre, presque la pagination entre récit et commentaire ( appelés scolies au Moyen-Age) et sûrement l'esprit des inquisiteurs, en leur donnant la parole, cynique, brute de décoffrage, brutale , à propos du ministre Francisco, celui à qui Salazar demandait : « que fait-on pour l'Europe ? Que fait-on pour l'Afrique ? » -celui qui pouvait tout se permettre, décider de la prison ou de la mort, « suicider » son père, tuer ses chiens, demander à une petite paysanne à qui il dit « bouge pas poulette » et qui pense alors qu'il veut la vider comme un poulet pendant qu'elle se courbe pour qu'il la possède par derrière- .
Paroles –souvent ponctuées du : « Oui, vous pouvez le noter » des interrogés- du vétérinaire qui fait accoucher une « génisse », autrement dit, une petite violée, du fils, méprisé par le père, pas aimé de la première épouse, Isabel, qui a fui, de l'autre petite, que Francisco s'évertue à vêtir des dentelles moisies et des chaussures usées, en lui demandant « est ce que tu m'aimes, Isabel », de la gouvernante Titina toute puissante, épousant les pensées du maitre, de la belle famille du fils, persuadée qu'elle peut en toute bonne foi ruiner et le fils et le père, et , forte de la Révolution des oeillets, détruire le palais , les serres des orchidées, fusiller les oiseaux, et construire un centre de loisirs.
Avec des phrases longues, très longues, et cependant seulement descriptives, à la différence de Proust, seulement parlant de détails culinaires, décoratifs ou vestimentaires, Antonio Lobo Antunes nous présente une certaine société, celle de la dictature, puis celle d'après la révolution.
C'est l'histoire d'une chute, d'une déperdition, d'un déclassement de ces possédants qui ne se doutent pas du tout de ce qui est dit derrière eux. Ils croient que ce monde durera toujours, et la seule solution pour eux serait de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, les pauvres ne demandant jamais autre chose que de ne rien faire, d'attendre et de mendier un peu de soupe. Les Noirs d'Angola n'ont eux aussi qu'une chose à faire, continuer d'applaudir pour remercier de mourir de faim.
Et pourtant :
La phrase : « Je fais tout ce qu'elles veulent, mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron », reprise maintes fois, est détournée de façon cynique : « le chapeau, pour qu'on ne voit pas les cornes ». (de plus, il ne fait jamais ce qu'elles veulent, pour lui ce sont des animaux.)
Et l'autre phrase « un petit pipi, je dois rendre mon autobus, vous n'allez pas mouiller votre pyjama »répétée maintes et maintes fois, nous fait mesurer la distance entre le « monsieur le ministre », cocu , certes, mais tout puissant dans son domaine, et le pauvre vieux incontinent qu'il est devenu, muet, soumis, inutile, humilié aux mains d'infirmières pressées.
Ai-je aimé ce roman ? Non, je dois l'avouer, malgré l'écriture enthousiaste de Chystèle. Beaucoup trop long, avec ce tic de répétition de la même phrase qui m'a plus paru un jeu stylistique qu'une nécessité, ces descriptions qui veulent symboliser la politique, comme si nous avions besoin d'un chat en porcelaine pour comprendre le changement définitif accueilli par le Portugal, enfin l'Angola n'étant que profilé de loin.
Pour positiver, ce serait, transposé littérairement, la fin d'un monde colonial et dictatorial dont, avec un plaisir évident Lobo Antunes nous fait partager les pensées
rétrogrades et répétitives donnant une idée du monde ancien révolu qui rabâche.
Antonio Lobo Antunes reprend le titre, presque la pagination entre récit et commentaire ( appelés scolies au Moyen-Age) et sûrement l'esprit des inquisiteurs, en leur donnant la parole, cynique, brute de décoffrage, brutale , à propos du ministre Francisco, celui à qui Salazar demandait : « que fait-on pour l'Europe ? Que fait-on pour l'Afrique ? » -celui qui pouvait tout se permettre, décider de la prison ou de la mort, « suicider » son père, tuer ses chiens, demander à une petite paysanne à qui il dit « bouge pas poulette » et qui pense alors qu'il veut la vider comme un poulet pendant qu'elle se courbe pour qu'il la possède par derrière- .
Paroles –souvent ponctuées du : « Oui, vous pouvez le noter » des interrogés- du vétérinaire qui fait accoucher une « génisse », autrement dit, une petite violée, du fils, méprisé par le père, pas aimé de la première épouse, Isabel, qui a fui, de l'autre petite, que Francisco s'évertue à vêtir des dentelles moisies et des chaussures usées, en lui demandant « est ce que tu m'aimes, Isabel », de la gouvernante Titina toute puissante, épousant les pensées du maitre, de la belle famille du fils, persuadée qu'elle peut en toute bonne foi ruiner et le fils et le père, et , forte de la Révolution des oeillets, détruire le palais , les serres des orchidées, fusiller les oiseaux, et construire un centre de loisirs.
Avec des phrases longues, très longues, et cependant seulement descriptives, à la différence de Proust, seulement parlant de détails culinaires, décoratifs ou vestimentaires, Antonio Lobo Antunes nous présente une certaine société, celle de la dictature, puis celle d'après la révolution.
C'est l'histoire d'une chute, d'une déperdition, d'un déclassement de ces possédants qui ne se doutent pas du tout de ce qui est dit derrière eux. Ils croient que ce monde durera toujours, et la seule solution pour eux serait de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, les pauvres ne demandant jamais autre chose que de ne rien faire, d'attendre et de mendier un peu de soupe. Les Noirs d'Angola n'ont eux aussi qu'une chose à faire, continuer d'applaudir pour remercier de mourir de faim.
Et pourtant :
La phrase : « Je fais tout ce qu'elles veulent, mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron », reprise maintes fois, est détournée de façon cynique : « le chapeau, pour qu'on ne voit pas les cornes ». (de plus, il ne fait jamais ce qu'elles veulent, pour lui ce sont des animaux.)
Et l'autre phrase « un petit pipi, je dois rendre mon autobus, vous n'allez pas mouiller votre pyjama »répétée maintes et maintes fois, nous fait mesurer la distance entre le « monsieur le ministre », cocu , certes, mais tout puissant dans son domaine, et le pauvre vieux incontinent qu'il est devenu, muet, soumis, inutile, humilié aux mains d'infirmières pressées.
Ai-je aimé ce roman ? Non, je dois l'avouer, malgré l'écriture enthousiaste de Chystèle. Beaucoup trop long, avec ce tic de répétition de la même phrase qui m'a plus paru un jeu stylistique qu'une nécessité, ces descriptions qui veulent symboliser la politique, comme si nous avions besoin d'un chat en porcelaine pour comprendre le changement définitif accueilli par le Portugal, enfin l'Angola n'étant que profilé de loin.
Pour positiver, ce serait, transposé littérairement, la fin d'un monde colonial et dictatorial dont, avec un plaisir évident Lobo Antunes nous fait partager les pensées
rétrogrades et répétitives donnant une idée du monde ancien révolu qui rabâche.
Je sors un peu "sonnée" de la lecture de ce roman d'Antonio Lobo Antunes : le manuel des inquisiteurs et en proie à des sentiments contradictoires...
La première partie du roman m'a emballée, même si entrer dans l'écriture disruptive de l'auteur demande un temps d'adaptation. Mais j'ai aimé la peinture de ces derniers moments de la dictature militaire salazariste. Une époque de bruit et de fureur que l'auteur évoque et dénonce avec rage et un sens inégalé de la caricature. Dans ce récit qui ressemble à une toile d'araignée tant les fils de l'intrigue se croisent et s'entrecroisent, défile une galerie de personnages qui incarnent un des aspects les plus condamnables de ce régime. Francisco est un propriétaire terrien, au comportement de seigneur féodal. Il vit en rentier dans son domaine de Palmela et mène en parallèle une carrière politique dans l'orbite du pouvoir de Salazar, jusqu'au jour où la Révolution des oeillets en 1974 va petit à petit le faire basculer dans une forme de folie paranoïaque dont il ne sortira plus. A l'autre extrême, une bourgeoisie capitaliste déjà très experte dans le transfert de capitaux à l'étranger, est incarnée par un personnage de banquier, l'oncle de Sofia, l'épouse du fils de Francisco. C'est un voyou de haute volée et son cynisme ne le fait reculer devant rien, pas même le "meurtre arrangé" de son père qui le gênait dans ses affaires. L'auteur se livre à travers le personnage de Sofia et sa famille à une satire féroce des préjugés de classe et de la grande hypocrisie qui consiste à transformer en actes de charité, des comportements qui reposent sur un mépris de classe éhonté. Un empêcheur de tourner en rond dans ce " beau monde " Joao, le fils de Francisco, le prototype du fils de famille déchu, inconsistant, méprisé de tous et pour son plus grand malheur, parfaitement conscient de sa médiocrité et sa lâcheté !
Face à cette classe sociale, soutien sans faille du régime de Salazar : les "petites gens" , ceux qui vivent dans la pauvreté et la peur de perdre le peu qu'ils ont et ceux qui servent les puissants avec un dévouement et un auto-aveuglement déroutants, telle Titina, la gouvernante du domaine de Palmela, qui se dévoue corps et âme à son maître Francisco et qui malgré tout finira ses jours dans un hospice misérable ! Un personnage émouvant et qui d'ailleurs n'est pas la seule femme qui interpelle dans ce roman où elles sont nombreuses. Ce qui m'a frappée, c'est que, quelle que soit leur position sociale, elles sont victimes consentantes ou exploitées, telle Sofia, le prototype même de la courtisane ou la cuisinière du domaine qui, engrossée par son maître, sera séparée brutalement et contre son gré de la petite fille dont elle a accouchée.. Un univers féminin qui, aujourd'hui fait frémir d'indignation... La satire, la drôlerie féroce, on les retrouve également tout au long du roman dans l'évocation de la vieillesse, celle que va connaître Francisco, abandonné de tous dans un hospice où il va finir ses jours. Ce qui donne lieu à des scènes où le grotesque est tellement appuyé que le rire se transforme en grimace...
Jusque là, j'ai bien suivi l'auteur mais dans la deuxième partie du livre, j'ai "décroché". Je pense que c'est d'abord au niveau de l'écriture à laquelle j'avais adhéré dans la première partie car elle était pour moi porteuse de sens, au service de personnages très présents et d'une dénonciation vigoureuse du régime salazariste. Petit à petit j'ai perdu de vue les personnages principaux et le fil de l'intrigue, qui n'était déjà pas facile à suivre, s'est complètement délité... J'ai eu l'impression que l'on entrait dans une thématique de la destruction tous azimuts : celle de la phrase et du narratif pour ce qui est du récit, celle de la société, de la nature et de la psyché humaine pour le contenu. Pour illustrer mes propos, je donnerai deux exemples : la folie et la passion très présentes dans le roman sous formes de scènes hallucinatoires ou tragiques, conduisent inexorablement à la mort... le domaine de Palmela, presque un personnage dans le roman, une fois abandonné de ses habitants, fait l'objet d'une description apocalyptique où tout n'est que désordre et saccage. Un paysage de fin du monde...
Quant aux deux derniers chapitres, il m'ont laissé dans la plus profonde perplexité tant je me suis demandé quel message voulait faire passer l'auteur... Une sorte d'apothéose finale de cette thématique du chaos ?
Je ne sais pas...
Je ne regrette pourtant pas cette "aventure " littéraire qui m'a permis de mieux cerner mes limites de lectrice.
La première partie du roman m'a emballée, même si entrer dans l'écriture disruptive de l'auteur demande un temps d'adaptation. Mais j'ai aimé la peinture de ces derniers moments de la dictature militaire salazariste. Une époque de bruit et de fureur que l'auteur évoque et dénonce avec rage et un sens inégalé de la caricature. Dans ce récit qui ressemble à une toile d'araignée tant les fils de l'intrigue se croisent et s'entrecroisent, défile une galerie de personnages qui incarnent un des aspects les plus condamnables de ce régime. Francisco est un propriétaire terrien, au comportement de seigneur féodal. Il vit en rentier dans son domaine de Palmela et mène en parallèle une carrière politique dans l'orbite du pouvoir de Salazar, jusqu'au jour où la Révolution des oeillets en 1974 va petit à petit le faire basculer dans une forme de folie paranoïaque dont il ne sortira plus. A l'autre extrême, une bourgeoisie capitaliste déjà très experte dans le transfert de capitaux à l'étranger, est incarnée par un personnage de banquier, l'oncle de Sofia, l'épouse du fils de Francisco. C'est un voyou de haute volée et son cynisme ne le fait reculer devant rien, pas même le "meurtre arrangé" de son père qui le gênait dans ses affaires. L'auteur se livre à travers le personnage de Sofia et sa famille à une satire féroce des préjugés de classe et de la grande hypocrisie qui consiste à transformer en actes de charité, des comportements qui reposent sur un mépris de classe éhonté. Un empêcheur de tourner en rond dans ce " beau monde " Joao, le fils de Francisco, le prototype du fils de famille déchu, inconsistant, méprisé de tous et pour son plus grand malheur, parfaitement conscient de sa médiocrité et sa lâcheté !
Face à cette classe sociale, soutien sans faille du régime de Salazar : les "petites gens" , ceux qui vivent dans la pauvreté et la peur de perdre le peu qu'ils ont et ceux qui servent les puissants avec un dévouement et un auto-aveuglement déroutants, telle Titina, la gouvernante du domaine de Palmela, qui se dévoue corps et âme à son maître Francisco et qui malgré tout finira ses jours dans un hospice misérable ! Un personnage émouvant et qui d'ailleurs n'est pas la seule femme qui interpelle dans ce roman où elles sont nombreuses. Ce qui m'a frappée, c'est que, quelle que soit leur position sociale, elles sont victimes consentantes ou exploitées, telle Sofia, le prototype même de la courtisane ou la cuisinière du domaine qui, engrossée par son maître, sera séparée brutalement et contre son gré de la petite fille dont elle a accouchée.. Un univers féminin qui, aujourd'hui fait frémir d'indignation... La satire, la drôlerie féroce, on les retrouve également tout au long du roman dans l'évocation de la vieillesse, celle que va connaître Francisco, abandonné de tous dans un hospice où il va finir ses jours. Ce qui donne lieu à des scènes où le grotesque est tellement appuyé que le rire se transforme en grimace...
Jusque là, j'ai bien suivi l'auteur mais dans la deuxième partie du livre, j'ai "décroché". Je pense que c'est d'abord au niveau de l'écriture à laquelle j'avais adhéré dans la première partie car elle était pour moi porteuse de sens, au service de personnages très présents et d'une dénonciation vigoureuse du régime salazariste. Petit à petit j'ai perdu de vue les personnages principaux et le fil de l'intrigue, qui n'était déjà pas facile à suivre, s'est complètement délité... J'ai eu l'impression que l'on entrait dans une thématique de la destruction tous azimuts : celle de la phrase et du narratif pour ce qui est du récit, celle de la société, de la nature et de la psyché humaine pour le contenu. Pour illustrer mes propos, je donnerai deux exemples : la folie et la passion très présentes dans le roman sous formes de scènes hallucinatoires ou tragiques, conduisent inexorablement à la mort... le domaine de Palmela, presque un personnage dans le roman, une fois abandonné de ses habitants, fait l'objet d'une description apocalyptique où tout n'est que désordre et saccage. Un paysage de fin du monde...
Quant aux deux derniers chapitres, il m'ont laissé dans la plus profonde perplexité tant je me suis demandé quel message voulait faire passer l'auteur... Une sorte d'apothéose finale de cette thématique du chaos ?
Je ne sais pas...
Je ne regrette pourtant pas cette "aventure " littéraire qui m'a permis de mieux cerner mes limites de lectrice.
Un titre étrange donné à un roman hors-norme, époustouflant, (conseillé par Chrystèle, Hordedu Contrevent, une référence chez Babelio! )
Ce roman se passe au Portugal dans les périodes de la dictature de Salazar puis de la révolution de 1974 et de ses suites.
Il m'a fait penser à une fresque ou à une galerie de tableaux, peints plutôt à la manière de Goya, tableaux qui sont des variations sur la vie d'un ministre de Salazar, un homme de pouvoir brutal et inhumain, sur sa déchéance politique puis physique, et sur celles de personnes qui l'ont côtoyé, famille, subalternes, la plupart ses victimes; mais aussi apparaissent dans cette galerie, souvent sordide, celles et ceux qui sont liés de plus loin à l'histoire de cet homme.
Et tout cela est raconté par chacun ces personnages dans des chapitres successifs intitulés successivement récit et commentaire.
Et c'est à chaque fois une longue litanie proférée par un personnage différent, un monologue lancinant par ses répétitions, dont le sens se dévoile peu à peu, ainsi que le lien avec d'autres chapitres.
Et la chronologie est chamboulée au profit d'un temps psychologique qui tire les fils du roman, et tient en permanence l'attention du lecteur.
Cette façon de raconter est unique, sans équivalent dans toutes les oeuvres littéraires que j'ai lu (mais il est vrai que je ne connais pas toute la littérature mondiale d'hier et d'aujourd'hui!).
Au début, j'avoue avoir été décontenancé par ce mode de narration, mais très vite, cette façon fiévreuse, quasi hypnotique, façon derviche tourneur, vous emporte dans son tourbillon.
Et puis, j'ai été saisi par le pessimisme de ce roman.
Se mêlent brutalité, désarroi, désillusion, méchanceté, cupidité, déchéance physique, sans qu'aucune lumière de bienveillance, d'espoir, n'apparaisse.
Ainsi ce ministre est à la fois violent et grossier avec celles et ceux qui lui résistent, méprisant à l'égard son fils puis sa belle-fille, ignoble avec ses servantes qu'il agresse sexuellement et de façon bestiale, perdu dans son délire de vouloir faire revivre la femme qui l'a quitté avec une femme de substitution. Mais aussi, on le verra perdre tout, suite à la révolution, entraînant dans sa chute toutes celles et ceux qui sont de près ou de loin à son service.Et on assistera au spectacle pitoyable de sa déchéance physique et mentale.
Et c'est aussi dur pour celles qui l'entourent, victimes parfois consentantes, je pense par exemple à sa servante Titina, vivant dans un hospice espérant toujours que son maître ou le fils de son maître viendront la chercher, ou encore à la jeune Mila qui accepte d'être affublée des vêtements moisis d'Isabelle, la première femme du ministre.
Et enfin, à côté des nombreuses victimes il y a les quelques gagnants, tels la belle-fille Sofia, l'oncle de Sofia, des bourgeois cupides et racistes, méprisant les «pauvres », sans aucune bonté.
Mais de cette boue humaine, l'auteur tire un prodigieux objet littéraire, fascinant, et qui s'imprime en vous.
Après tout, Baudelaire n'a-t-il pas écrit: « Tu m'a donné ta boue et j'en ai fait de l'or ».
Ce roman se passe au Portugal dans les périodes de la dictature de Salazar puis de la révolution de 1974 et de ses suites.
Il m'a fait penser à une fresque ou à une galerie de tableaux, peints plutôt à la manière de Goya, tableaux qui sont des variations sur la vie d'un ministre de Salazar, un homme de pouvoir brutal et inhumain, sur sa déchéance politique puis physique, et sur celles de personnes qui l'ont côtoyé, famille, subalternes, la plupart ses victimes; mais aussi apparaissent dans cette galerie, souvent sordide, celles et ceux qui sont liés de plus loin à l'histoire de cet homme.
Et tout cela est raconté par chacun ces personnages dans des chapitres successifs intitulés successivement récit et commentaire.
Et c'est à chaque fois une longue litanie proférée par un personnage différent, un monologue lancinant par ses répétitions, dont le sens se dévoile peu à peu, ainsi que le lien avec d'autres chapitres.
Et la chronologie est chamboulée au profit d'un temps psychologique qui tire les fils du roman, et tient en permanence l'attention du lecteur.
Cette façon de raconter est unique, sans équivalent dans toutes les oeuvres littéraires que j'ai lu (mais il est vrai que je ne connais pas toute la littérature mondiale d'hier et d'aujourd'hui!).
Au début, j'avoue avoir été décontenancé par ce mode de narration, mais très vite, cette façon fiévreuse, quasi hypnotique, façon derviche tourneur, vous emporte dans son tourbillon.
Et puis, j'ai été saisi par le pessimisme de ce roman.
Se mêlent brutalité, désarroi, désillusion, méchanceté, cupidité, déchéance physique, sans qu'aucune lumière de bienveillance, d'espoir, n'apparaisse.
Ainsi ce ministre est à la fois violent et grossier avec celles et ceux qui lui résistent, méprisant à l'égard son fils puis sa belle-fille, ignoble avec ses servantes qu'il agresse sexuellement et de façon bestiale, perdu dans son délire de vouloir faire revivre la femme qui l'a quitté avec une femme de substitution. Mais aussi, on le verra perdre tout, suite à la révolution, entraînant dans sa chute toutes celles et ceux qui sont de près ou de loin à son service.Et on assistera au spectacle pitoyable de sa déchéance physique et mentale.
Et c'est aussi dur pour celles qui l'entourent, victimes parfois consentantes, je pense par exemple à sa servante Titina, vivant dans un hospice espérant toujours que son maître ou le fils de son maître viendront la chercher, ou encore à la jeune Mila qui accepte d'être affublée des vêtements moisis d'Isabelle, la première femme du ministre.
Et enfin, à côté des nombreuses victimes il y a les quelques gagnants, tels la belle-fille Sofia, l'oncle de Sofia, des bourgeois cupides et racistes, méprisant les «pauvres », sans aucune bonté.
Mais de cette boue humaine, l'auteur tire un prodigieux objet littéraire, fascinant, et qui s'imprime en vous.
Après tout, Baudelaire n'a-t-il pas écrit: « Tu m'a donné ta boue et j'en ai fait de l'or ».
Il y a des livres que l'on vous met dans les mains en vous disant "c'est génial, j'ai adoré". Et vous, rien qu'en regardant la couverture, vous savez que vous allez avoir un peu de mal... "Le manuel des inquisiteurs" est un livre comme ça. Il est resté longtemps sur mon étagère, et puis un jour j'ai eu le courage de me lancer.
Nous sommes au Portugal, au moment de la révolution des Oeillets. Francisco est un des dirigeants du parti au coté de Salazar, et règne en maitre sur sa propriété de Palmela. Mais quand il se fait larguer par sa femme, tout fout le camp, et pour tout le monde...
Ce qui m'a d'abord marqué, c'est le contexte historique du roman : l'histoire contemporaine du Portugal, j'avoue que c'était un peu flou pour moi, le livre m'a permis d'y voir beaucoup plus clair ! Et puis il y a la narration, et avec Antonio Lobo Antunes, elle est complétement déstructurée : aucun point ne vient finir les phrases des 528 pages du livre, et chaque chapitre mélange les phrases de 3 instants de vie différents du protagoniste... Bref, il faut s'accrocher, même si souvent la magie opère et que l'on se laisse charmer.
En résumé, beau, mais pas fastoche.
Nous sommes au Portugal, au moment de la révolution des Oeillets. Francisco est un des dirigeants du parti au coté de Salazar, et règne en maitre sur sa propriété de Palmela. Mais quand il se fait larguer par sa femme, tout fout le camp, et pour tout le monde...
Ce qui m'a d'abord marqué, c'est le contexte historique du roman : l'histoire contemporaine du Portugal, j'avoue que c'était un peu flou pour moi, le livre m'a permis d'y voir beaucoup plus clair ! Et puis il y a la narration, et avec Antonio Lobo Antunes, elle est complétement déstructurée : aucun point ne vient finir les phrases des 528 pages du livre, et chaque chapitre mélange les phrases de 3 instants de vie différents du protagoniste... Bref, il faut s'accrocher, même si souvent la magie opère et que l'on se laisse charmer.
En résumé, beau, mais pas fastoche.
Citations et extraits (14)
Voir plus
Ajouter une citation
le major qu'on asseyait à l'heure du goûter sur le sofa, une couverture de laine sur les genoux, au milieu du reste des épouvantails, chacun avec sa couverture de laine, placés en demi-cercle devant la télévision où passait le feuilleton brésilien, sans que les épisodes les divertissent, muets comme des carpes, des épouvantails sans incisives ou avec tout au plus unes incisive qu'il fallait alimenter à la cuillère comme des bébés vétustes, en leur braillant aux oreilles
- Ah cette petite bouche cousue monsieur l'architecte cette petite bouche qui ne veut rien avaler
jusqu'à ce que la bouilloire de l'un d'eux se taise sans prévenir et on le remplaçait la semaine suivante par un épouvantail identique, également incapable de parler, avec une même couverture de laine, avec sur son petit crâne chauve les mêmes deux ou trois mèches de cheveux moisissants de poupée de grenier,
- Ah cette petite bouche cousue monsieur l'architecte cette petite bouche qui ne veut rien avaler
jusqu'à ce que la bouilloire de l'un d'eux se taise sans prévenir et on le remplaçait la semaine suivante par un épouvantail identique, également incapable de parler, avec une même couverture de laine, avec sur son petit crâne chauve les mêmes deux ou trois mèches de cheveux moisissants de poupée de grenier,
Ma femme s'affalant doucement comme une pieuvre s'endort, plongeant ses tentacules dans le sable des draps
- Quel soulagement
moi, craignant qu'elle ne me dévore, de m'habiller dare-dare avant qu'elle ne me demande dans son sommeil
- Tu ne me fais pas un bisou Luis ?
et que je ne soit obligé de me couler jusqu'à cette chose flasque en chemisier à volants et de frotter mon menton sur un front enduit de crème hydratante, pendant qu'une paume visqueuse me pincerait l'oreille
- A ce soir Luis
me rappelant une fille brune, boulotte, en train de m'enfiler une alliance au doigt sur la photo de l'album, j'ai fait chauffer du café dans la cuisine en priant pour qu'elle ne s'amène pas en chaussons histoire de m'aider à allumer le gaz, trouver le sucre, ouvrir le placard au-dessus du micro-ondes.
- Tu n'as jamais su où se trouvaient les tasses Luis
et de me quitter sous le porche en me gâchant la matinée avec son petit au-revoir d'adolescente décrépite, j'ai traversé le jardin à pas feutrés, la cravate pendue autour du cou, j'ai fais les nœuds à mes lacets...
- Quel soulagement
moi, craignant qu'elle ne me dévore, de m'habiller dare-dare avant qu'elle ne me demande dans son sommeil
- Tu ne me fais pas un bisou Luis ?
et que je ne soit obligé de me couler jusqu'à cette chose flasque en chemisier à volants et de frotter mon menton sur un front enduit de crème hydratante, pendant qu'une paume visqueuse me pincerait l'oreille
- A ce soir Luis
me rappelant une fille brune, boulotte, en train de m'enfiler une alliance au doigt sur la photo de l'album, j'ai fait chauffer du café dans la cuisine en priant pour qu'elle ne s'amène pas en chaussons histoire de m'aider à allumer le gaz, trouver le sucre, ouvrir le placard au-dessus du micro-ondes.
- Tu n'as jamais su où se trouvaient les tasses Luis
et de me quitter sous le porche en me gâchant la matinée avec son petit au-revoir d'adolescente décrépite, j'ai traversé le jardin à pas feutrés, la cravate pendue autour du cou, j'ai fais les nœuds à mes lacets...
- Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron -
Mon père, la main ouverte sur la nuque de la fille du métayer, une adolescente nu-pieds, sale, rousse, suspendue aux mamelles des vaches sur un petit banc de bois accroupie, la prenant par le collet et l'obligeant à se pencher sur la mangeoire sans qu'elle lâche ses seaux à lait, mon père encore une fois écarlate lui écrasant son nombril sur les fesses, le cigarillo allumé pointant vers les poutres du plafond, sans que la fille du métayer ne proteste, sans que personne ne proteste ou ne songe à protester, mon père retirant sa main de ma nuque et désignant avec mépris la cuisine, les chambres des domestiques, le verger, le domaine tout entier, le monde enfin
- je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron -
Mon père, la main ouverte sur la nuque de la fille du métayer, une adolescente nu-pieds, sale, rousse, suspendue aux mamelles des vaches sur un petit banc de bois accroupie, la prenant par le collet et l'obligeant à se pencher sur la mangeoire sans qu'elle lâche ses seaux à lait, mon père encore une fois écarlate lui écrasant son nombril sur les fesses, le cigarillo allumé pointant vers les poutres du plafond, sans que la fille du métayer ne proteste, sans que personne ne proteste ou ne songe à protester, mon père retirant sa main de ma nuque et désignant avec mépris la cuisine, les chambres des domestiques, le verger, le domaine tout entier, le monde enfin
- je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron -
Et en pénétrant dans l'enceinte du tribunal à Lisbonne, c'est au domaine que je pensais. Non au domaine d'aujourd'hui avec ses statues brisées dans le jardin, la piscine vide, le chiendent qui envahissait les chenils et qui ravageait les parterres, la grande maison au toit percé où il pleuvait sur le piano garni d'un portrait autographié de la reine, sur la table de l'échiquier auquel manquaient des pièces, sur les déchirures de la moquette et sur le lit en aluminium que j'ai rangé dans la cuisine, adossé au fourneau, en vue d'un sommeil torturé toute la nuit par le ricanement des corbeaux et en pénétrant dans l'enceinte du tribunal à Lisbonne, je ne pensais pas au domaine d'aujourd'hui mais à la maison et au domaine du temps de mon père quand Setùbal (une ville aussi insignifiante qu'un village de province, aux lumières voltigeant autour du kiosque à musique dans un vibrement de ténèbres et lacérées par les hurlements des chiens) n'était pas arrivé jusqu'aux saules et au portail du mur, et ne descendait pas droit jusqu'au fleuve dans une pagaille de tavernes et de chalutiers, Setùbal où la gouvernante m'emmenait avec elle faire les commissions les dimanches matin en me trainant par le coude sous le volettement des pigeons...
(incipit)
(incipit)
...le château tout là-haut après des files et des files d'oliviers somnolents, après une volière et un restaurant de muletiers avec un réfrigérateur de cornets de glace à l'entrée, on tournait à gauche et on tombait sur le portail du domaine, son nom en lettres peintes sur un azulejo, ses colonnes de pierres, l'allée de cyprès conduisant à la maison, sauf que cette fois aucun chien n'a aboyé, le moulin s'est arrêté, les oranges du verger, sans éclat, se ramollissaient éparses sur le sol, le tracteur gisait immobile à demi-renversé parmi les décombres de la serre et une de ses roues arrière tournait en silence depuis des semaines et tournerait toujours (les vitres brisées de la serre, les châssis fracassés, les vases en morceaux, les orchidées aux pétales dilatés pendillant en longues lèvres violacées) ...
Videos de Antonio Lobo Antunes (12)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : littérature portugaiseVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Antonio Lobo Antunes (33)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le jeu des je, en chansons (1)
Qui chante : " J'ai 10 ans" ?
Jacques Brel
Thomas Dutronc
S. Gainsbourg/J. Birkin
Maxime Le Forestier
Renaud
Alain Souchon
13 questions
34 lecteurs ont répondu
Thèmes :
chanteur
, musique
, chanson française
, nostalgieCréer un quiz sur ce livre34 lecteurs ont répondu