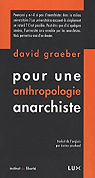Frédéric Lordon/5
17 notes
Résumé :
Après avoir longtemps refusé d'y toucher, les sciences sociales découvrent que la société marche aux désirs et aux affects. Mais quand on voit que l'économie, bien dans sa manière, poursuit son fantasme de science dure en s'associant maintenant avec la neurobiologie, on devine que le risque est grand que le " tournant émotionnel " porte à son comble le retour à l'individu et signe l'abandon définitif des structures, institutions, rapports sociaux, par construction c... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La société des affectsVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Rhapsode de textes pour la plupart parus dans des revues ou lors de colloque, La société des affects de Frédéric Lordon propose un paradigme révolutionnaire et iconoclaste sur la conception de l'homme, de la politique et de la société.
Pour ce faire, l'auteur, économiste de formation et chercheur au CNRS, commence par réconcilier la sociologie et la philosophie, l'une consistant à étudier des objets sans conceptualisation et l'autre à conceptualiser sans s'intéresser aux objets. Il a principalement recours à Spinoza, mais aussi au "plus philosophe des sociologues", Pierre Bourdieu. Souvent pensées en opposition, ces deux disciplines, une fois réunies, s'avèrent fécondes et offrent une nouvelle compréhension du monde politique.
A titre d'exemple, en sociologie, la domination des institutions dépend en partie de sa légitimité, c'est-à-dire de la reconnaissance par les institués de la domination de l'institution comme légitime, naturelle, allant de soi. Or, avec Spinoza, la légitimité est une notion inutile pour comprendre les institutions. Lordon explique d'une part que le concept de légitimité est introuvable et d'autre part que "si les institutions sont des agencements de puissances et d'affects, alors la légitimité n'est rien", c'est-à-dire que "si dans le monde institutionnel et social il n'y a que le jeu des puissances et des affects, alors la légitimité n'existe pas. Il n'y a que l'état des forces - pour autant qu'on sache voir leur diversité, bien au-delà des forces de domination brute : forces impersonnelles inscrites dans des structures, mais aussi forces intimes des affects à l'oeuvre jusque dans les productions de l'imaginaire (le "sens") - tel qu'il détermine des rapports à durer ou à se défaire." Avec ce décalage paradigmatique, l'institution légitime en sociologie devient ici l'institution qui créé chez les dominés un affect de joie ou de tristesse pour dominer. La légitimité n'est finalement, pour l'auteur, que l'appellation "supplémentaire, mais superfétatoire, ajoutée au simple fait de l'existence d'une institution".
Toute cette socio-philosophie aux applications bien pratiques s'attache à déconstruire un par un les piliers de la doctrine humaniste. Premier pilier : le libre arbitre n'existe pas. Second pilier : la légitimité institutionnelle n'existe pas. Troisième pilier : on ne décide pas la révolution, elle est provoquée lorsque les institutions se rendent suffisamment odieuses pour la provoquer. Toute la pensée de l'auteur consiste en la réactualisation et en la réhabilitation du précieux système spinoziste.
Lordon ne fait ainsi que répéter ce que Spinoza expliquait déjà à son époque : "L'homme n'est pas dans la nature comme un empire dans un empire". On ne change pas le monde "si on le veut". Tous les discours militants, écologiques, de responsabilisations individuelles rencontrent trois objections aux yeux de l'auteur : une objection théorique, empirique et sociologique. Par exemple, par quoi sont déterminés les comportements individuels ? "On voudrait que ce soit par la vertu - la vertu des individus à vouloir le bien (l'équité dans le café, la solidarité dans la microfinance et les robinets bien fermés). Mais cela est supposé la nativité de la vertu, hypothèse extrêmement aventureuse, vouée le plus souvent à ne soutenir que des paris perdus. Même Kant n'avait pas manqué de voir que dans le monde sensible régi par la causalité phénoménale, il n'y a de moralité qu'à concurrence des intérêts (passionnels) à la moralité."
En définitive, cet ouvrage est passionnant et fascinant. Il est passionnant car Frédéric Lordon prend le temps de développer ses points de vue, les explique de plusieurs façons, y revient à plusieurs reprises dans des termes différents. L'ensemble est d'une pédagogie et d'une cohérence exemplaires. Il est fascinant, car il est aux antipodes de la pensée humaniste néolibérale qui réside en chacun de nous de façon axiomatique. L'écrit laisse derrière lui des certitudes en miettes, de nouveaux savoirs et une interrogation...
Cette interrogation est la suivante : Frédéric Lordon a-t-il raison de postuler avec autant de virulence l'inexistence du libre-arbitre ? Il est vrai que neurologues, sociologues, philosophes et autres s'accordent de plus en plus à rejeter l'humanisme cartésien et à donner raison au déterminisme spinoziste. Des expériences scientifiques vont en ce sens. Cependant, l'économiste n'explique presque jamais les raisons formelles qui peuvent laisser penser que le libre arbitre n'est qu'une illusion moderne. C'est l'unique partie manquante au livre. Quels sont les débats en vigueur au sujet du libre-arbitre ? Frédéric Lordon part-il d'un déterminisme extrême avéré par les sciences ou bien s'agit-il d'une simple hypothèse ou encore est-ce un sujet actuellement débattu par les chercheurs ? L'hypothèse du compatibilisme (combinaison du libre arbitre et du déterminisme) est-elle à rejeter aux oubliettes ? Ces questions sans réponse constituent l'unique absence du libre. Cependant, c'est avec un certain sentiment d'angoisse existentielle que se termine la lecture de cet ouvrage. Preuve que l'iconoclasme est réel.
Pour ce faire, l'auteur, économiste de formation et chercheur au CNRS, commence par réconcilier la sociologie et la philosophie, l'une consistant à étudier des objets sans conceptualisation et l'autre à conceptualiser sans s'intéresser aux objets. Il a principalement recours à Spinoza, mais aussi au "plus philosophe des sociologues", Pierre Bourdieu. Souvent pensées en opposition, ces deux disciplines, une fois réunies, s'avèrent fécondes et offrent une nouvelle compréhension du monde politique.
A titre d'exemple, en sociologie, la domination des institutions dépend en partie de sa légitimité, c'est-à-dire de la reconnaissance par les institués de la domination de l'institution comme légitime, naturelle, allant de soi. Or, avec Spinoza, la légitimité est une notion inutile pour comprendre les institutions. Lordon explique d'une part que le concept de légitimité est introuvable et d'autre part que "si les institutions sont des agencements de puissances et d'affects, alors la légitimité n'est rien", c'est-à-dire que "si dans le monde institutionnel et social il n'y a que le jeu des puissances et des affects, alors la légitimité n'existe pas. Il n'y a que l'état des forces - pour autant qu'on sache voir leur diversité, bien au-delà des forces de domination brute : forces impersonnelles inscrites dans des structures, mais aussi forces intimes des affects à l'oeuvre jusque dans les productions de l'imaginaire (le "sens") - tel qu'il détermine des rapports à durer ou à se défaire." Avec ce décalage paradigmatique, l'institution légitime en sociologie devient ici l'institution qui créé chez les dominés un affect de joie ou de tristesse pour dominer. La légitimité n'est finalement, pour l'auteur, que l'appellation "supplémentaire, mais superfétatoire, ajoutée au simple fait de l'existence d'une institution".
Toute cette socio-philosophie aux applications bien pratiques s'attache à déconstruire un par un les piliers de la doctrine humaniste. Premier pilier : le libre arbitre n'existe pas. Second pilier : la légitimité institutionnelle n'existe pas. Troisième pilier : on ne décide pas la révolution, elle est provoquée lorsque les institutions se rendent suffisamment odieuses pour la provoquer. Toute la pensée de l'auteur consiste en la réactualisation et en la réhabilitation du précieux système spinoziste.
Lordon ne fait ainsi que répéter ce que Spinoza expliquait déjà à son époque : "L'homme n'est pas dans la nature comme un empire dans un empire". On ne change pas le monde "si on le veut". Tous les discours militants, écologiques, de responsabilisations individuelles rencontrent trois objections aux yeux de l'auteur : une objection théorique, empirique et sociologique. Par exemple, par quoi sont déterminés les comportements individuels ? "On voudrait que ce soit par la vertu - la vertu des individus à vouloir le bien (l'équité dans le café, la solidarité dans la microfinance et les robinets bien fermés). Mais cela est supposé la nativité de la vertu, hypothèse extrêmement aventureuse, vouée le plus souvent à ne soutenir que des paris perdus. Même Kant n'avait pas manqué de voir que dans le monde sensible régi par la causalité phénoménale, il n'y a de moralité qu'à concurrence des intérêts (passionnels) à la moralité."
En définitive, cet ouvrage est passionnant et fascinant. Il est passionnant car Frédéric Lordon prend le temps de développer ses points de vue, les explique de plusieurs façons, y revient à plusieurs reprises dans des termes différents. L'ensemble est d'une pédagogie et d'une cohérence exemplaires. Il est fascinant, car il est aux antipodes de la pensée humaniste néolibérale qui réside en chacun de nous de façon axiomatique. L'écrit laisse derrière lui des certitudes en miettes, de nouveaux savoirs et une interrogation...
Cette interrogation est la suivante : Frédéric Lordon a-t-il raison de postuler avec autant de virulence l'inexistence du libre-arbitre ? Il est vrai que neurologues, sociologues, philosophes et autres s'accordent de plus en plus à rejeter l'humanisme cartésien et à donner raison au déterminisme spinoziste. Des expériences scientifiques vont en ce sens. Cependant, l'économiste n'explique presque jamais les raisons formelles qui peuvent laisser penser que le libre arbitre n'est qu'une illusion moderne. C'est l'unique partie manquante au livre. Quels sont les débats en vigueur au sujet du libre-arbitre ? Frédéric Lordon part-il d'un déterminisme extrême avéré par les sciences ou bien s'agit-il d'une simple hypothèse ou encore est-ce un sujet actuellement débattu par les chercheurs ? L'hypothèse du compatibilisme (combinaison du libre arbitre et du déterminisme) est-elle à rejeter aux oubliettes ? Ces questions sans réponse constituent l'unique absence du libre. Cependant, c'est avec un certain sentiment d'angoisse existentielle que se termine la lecture de cet ouvrage. Preuve que l'iconoclasme est réel.
Avouons-le d'emblée : l'intelligence de Lordon nous paralyse. L'homme a réponse à tout, du moins est-ce ainsi que nous le lisons, sans oser discuter ses thèses, de peur de les déformer. Quelles sont-elles, ces thèses ? Tout repose sur Spinoza et sur sa théorie des affects comme mouvements : nos passions et donc nos actions sont mues par des structures qui nous échappent – structure économiques, politiques, mentales mêmes – et nos désirs sont déterminés par ces affects, recherche du bonheur, peur du malheur, etc. Bref, la liberté n'est qu'un leurre, et l'individu croit vouloir quand en fait il est forcé par la société à désirer ceci ou cela. le pouvoir serait alors – si j'ai bien compris – le fait de parvenir à faire croire aux hommes qu'il est le pouvoir. Rien de transcendant dans le pouvoir, puis qu'un pouvoir n'a d'autorité que si ceux sur qui il s'exerce admettent cette autorité et s'y soumettent – volontairement ? peut-être pas, structurellement peut-être – tout en ignorant – l'enjeu de ce livre serait de nous faire sortir de cette ignorance – qu'ils ne font qu'obéir, alors qu'ils croient n'être motivé que par leurs propres désirs. La réussite du néolibéralisme – son miracle ou/et son arnaque – c'est d'être parvenu à s'accaparer les désirs des salariés, qui ne travaillent plus simplement pour éviter le pire – la pauvreté, le déclassement social, la faim – mais qui travaillent par envie de s'épanouir dans des activités qui, si on les regarde sans oeillères, n'ont rien d'épanouissement. Bref, on se fait avoir, nous dit Lordon, en le simplifiant à l'extrême, faute de se sentir – quel affect nous pousse à éprouver ceci ? – capable de saisir toutes les nuances d'une pensée complexe.
Lordon est un brillant philosophe, au sens deleuzien du terme, c'est-à-dire un prolifique créateur de concepts, souvent très intéressants, qu'il tire de la rencontre entre plusieurs philosophies, la plus notable étant la rencontre Marx-Spinoza. C'est cette démarche de philosophe avant tout qui séduit le lecteur : Lordon est inspiré, donc inspirant. Et c'est finalement de cette inspiration dont l'individu moderne, vivant dans la société néolibérale, a le plus besoin ; c'est peut-être cela, la Joie de Spinoza, ce "troisième genre de connaissance" vers lequel ce dernier nous guide dans l'Éthique, au-delà de la pseudo-vérité de l'expérience sensible et de la vérité théorique de l'intellect.
Mais Lordon écrit dans une perspective qui n'est pas seulement philosophique, pas seulement critique, mais aussi militante. Dans sa volonté de renouvellement paradigmatique, il délaisse un peu hâtivement l'aspect dialectique de la philosophie marxiste au profit d'un positivisme des affects. Il y a de toute évidence dans les théories lordoniennes des "restes" althussériens. La notion de structure est par essence anti-dialectique. Matérialisme certes, dialectique non. Dès lors, le négatif ne travaille plus, il est au repos, ou au chômage. Ce qui, pour revenir aux affects, est un peu triste.
Mais Lordon écrit dans une perspective qui n'est pas seulement philosophique, pas seulement critique, mais aussi militante. Dans sa volonté de renouvellement paradigmatique, il délaisse un peu hâtivement l'aspect dialectique de la philosophie marxiste au profit d'un positivisme des affects. Il y a de toute évidence dans les théories lordoniennes des "restes" althussériens. La notion de structure est par essence anti-dialectique. Matérialisme certes, dialectique non. Dès lors, le négatif ne travaille plus, il est au repos, ou au chômage. Ce qui, pour revenir aux affects, est un peu triste.
critiques presse (2)
S’inspirant du spinozisme, F. Lordon propose de restaurer la considération des affects dans les sciences sociales. Les affects sont à la fois des effets des structures sociales, qu’ils reproduisent ou subvertissent. Ce qui conduit peut-être l’auteur à négliger leur ambivalence.
Lire la critique sur le site : LaViedesIdees
Frédéric Lordon associe philosophie et sciences sociales contre le capitalisme
Lire la critique sur le site : Liberation
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
(p.207) Les briguants
S’il y a bien un paradoxe flagrant du capitalisme néolibéral – il faudrait même dire : une insoluble contradiction –, c’est que jamais mode de production n’a poussé si loin la division du travail, donc le caractère profondément collectif de toute production, mais pour l’accompagner d’une rhétorique de la performance individuelle, de l’attribution à soi-même et du mérite personnel exclusif.
Comme toujours, ce sont les cas maximaux qui sont dotés des meilleures propriétés révélatrices, c’est pourquoi il faudrait avoir le temps de s’attarder sur les édifiants récits qui nous sont proposés comme légendes du capitalisme, épopées de la création héroïque d’entreprise, entièrement imputable au génie personnel du créateur : Bill Gates, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg sont ainsi tour à tour offerts à l’imaginaire de la surpuissance et de la suffisance… alors que, même au niveau le plus superficiel, toutes ces histoires commencent par du collectif et, symptomatiquement, finissent par de la spoliation. Ainsi, même au moment réputé le plus individualiste des commencements, Bill Gates s’appuie sur Paul Allen avant de le faire oublier, Steve Jobs sur Steven Wozniak avant de l’escamoter, Mark Zuckerberg sur les frères Winklevoss avant de les passer à la trappe. Et dans une répétition du même schéma, où l’on pourrait voir une insistance propre au mythe, il s’agit toujours d’éliminer le tiers encombrant, celui qui dit l’insuffisance originelle du faux créateur, obligé de se faire vrai spoliateur, pour pouvoir se poser in fine comme vrai faux entrepreneur, au prix d’une manœuvre d’élimination qui n’est pas sans faire penser aux effacements photographiques staliniens. La légende du créateur autosuffisant se construit donc sur une spoliation originelle, et le paradoxe veut que les histoires présentées comme les archétypes de la saga individualiste commencent toutes en fait par des dénis de collaboration, c’est-à-dire de codétermination.
Ces histoires, dont la réalité dit l’exact contraire de ce qu’elles voudraient raconter, mettent alors sur la voie d’une autre caractéristique de l’imaginaire néolibéral, qui est en surface un imaginaire de la suffisance, mais se révèle aussi, contradictoirement et sur le mode de la mauvaise conscience, un imaginaire de la captation – contradiction manifeste en effet puisque la captation vaut par elle-même aveu de l’insuffisance du captateur. Ainsi, en décalage complet d’avec ses fantasmes et ses légendes, la réalité du capitalisme néolibéral et entrepreneurial n’est pas celle de la plénitude du mérite personnel, mais celle du constat répété de l’insuffisance individuelle, à plus forte raison dans une économie de division du travail, insuffisance complétée, ou compensée, par les pratiques de la brigue, c’est-à-dire de la captation. Car voici en effet un mot – la brigue – dont nous avons perdu le sens originel alors qu’il est probablement le concept central du capitalisme. Il faut le secours du Dictionnaire de l’Académie française de 1718 pour retrouver que la brigue se définit comme « poursuite vive qu’on fait par le moyen de plusieurs personnes qu’on engage dans ses intérêts ». Tout y est ! « Poursuite vive » dit l’élan du désir impérieux du créateur ou du conducteur d’entreprise ; « par le moyen de plusieurs personnes » dit son insuffisance à mener cette poursuite par ses propres moyens seulement, c’est-à-dire l’excès de son désir par rapport à ses possibilités personnelles, et partant l’impossibilité de son accomplissement par soi seul ; « qu’on engage » dit le rapport d’enrôlement imposé par le désir-maître aux tiers impliqués dans la réalisation d’un désir qui n’est pas d’abord le leur ; enfin « dans ses intérêts » annonce la spoliation à venir, captation par le désir-maître des produits, monétaires et plus encore symboliques, d’une activité fondamentalement collective : des dizaines de milliers d’employés travaillent pour Apple, mais c’est Steve Jobs qui « a fait l’iPhone ».
Le capitalisme, c’est donc le règne de la brigue érigée en principe. Et littéralement parlant on peut dire des capitalistes qu’ils sont des briguants : ils sont les bénéficiaires d’un système de brigue instituée. À côté de la suffisance, et précisément parce que celle-ci est un mensonge, la brigue est l’autre part, à la fois vivace et sombre, de l’imaginaire néolibéral. Vivace, car tous les petits apprentis-capitalistes savent de connaissance intuitive les possibilités de profit que leur ouvre le système de la brigue – et piaffent de les réaliser. Sombre, car elle est évidemment le symétrique, et le désaveu flagrant, de la part lumineuse, la part de la suffisance et de l’autonomie. Brigue est donc le nom d’une prétention : la prétention de se faire attribuer des effets qui excèdent ses propres puissances, c’est-à-dire d’établir une égalité (mensongère) entre le briguant et les effets qui suivent en fait de puissances autres que les siennes. La prétention du briguant, c’est par excellence le mensonge néolibéral du mérite.
S’il y a bien un paradoxe flagrant du capitalisme néolibéral – il faudrait même dire : une insoluble contradiction –, c’est que jamais mode de production n’a poussé si loin la division du travail, donc le caractère profondément collectif de toute production, mais pour l’accompagner d’une rhétorique de la performance individuelle, de l’attribution à soi-même et du mérite personnel exclusif.
Comme toujours, ce sont les cas maximaux qui sont dotés des meilleures propriétés révélatrices, c’est pourquoi il faudrait avoir le temps de s’attarder sur les édifiants récits qui nous sont proposés comme légendes du capitalisme, épopées de la création héroïque d’entreprise, entièrement imputable au génie personnel du créateur : Bill Gates, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg sont ainsi tour à tour offerts à l’imaginaire de la surpuissance et de la suffisance… alors que, même au niveau le plus superficiel, toutes ces histoires commencent par du collectif et, symptomatiquement, finissent par de la spoliation. Ainsi, même au moment réputé le plus individualiste des commencements, Bill Gates s’appuie sur Paul Allen avant de le faire oublier, Steve Jobs sur Steven Wozniak avant de l’escamoter, Mark Zuckerberg sur les frères Winklevoss avant de les passer à la trappe. Et dans une répétition du même schéma, où l’on pourrait voir une insistance propre au mythe, il s’agit toujours d’éliminer le tiers encombrant, celui qui dit l’insuffisance originelle du faux créateur, obligé de se faire vrai spoliateur, pour pouvoir se poser in fine comme vrai faux entrepreneur, au prix d’une manœuvre d’élimination qui n’est pas sans faire penser aux effacements photographiques staliniens. La légende du créateur autosuffisant se construit donc sur une spoliation originelle, et le paradoxe veut que les histoires présentées comme les archétypes de la saga individualiste commencent toutes en fait par des dénis de collaboration, c’est-à-dire de codétermination.
Ces histoires, dont la réalité dit l’exact contraire de ce qu’elles voudraient raconter, mettent alors sur la voie d’une autre caractéristique de l’imaginaire néolibéral, qui est en surface un imaginaire de la suffisance, mais se révèle aussi, contradictoirement et sur le mode de la mauvaise conscience, un imaginaire de la captation – contradiction manifeste en effet puisque la captation vaut par elle-même aveu de l’insuffisance du captateur. Ainsi, en décalage complet d’avec ses fantasmes et ses légendes, la réalité du capitalisme néolibéral et entrepreneurial n’est pas celle de la plénitude du mérite personnel, mais celle du constat répété de l’insuffisance individuelle, à plus forte raison dans une économie de division du travail, insuffisance complétée, ou compensée, par les pratiques de la brigue, c’est-à-dire de la captation. Car voici en effet un mot – la brigue – dont nous avons perdu le sens originel alors qu’il est probablement le concept central du capitalisme. Il faut le secours du Dictionnaire de l’Académie française de 1718 pour retrouver que la brigue se définit comme « poursuite vive qu’on fait par le moyen de plusieurs personnes qu’on engage dans ses intérêts ». Tout y est ! « Poursuite vive » dit l’élan du désir impérieux du créateur ou du conducteur d’entreprise ; « par le moyen de plusieurs personnes » dit son insuffisance à mener cette poursuite par ses propres moyens seulement, c’est-à-dire l’excès de son désir par rapport à ses possibilités personnelles, et partant l’impossibilité de son accomplissement par soi seul ; « qu’on engage » dit le rapport d’enrôlement imposé par le désir-maître aux tiers impliqués dans la réalisation d’un désir qui n’est pas d’abord le leur ; enfin « dans ses intérêts » annonce la spoliation à venir, captation par le désir-maître des produits, monétaires et plus encore symboliques, d’une activité fondamentalement collective : des dizaines de milliers d’employés travaillent pour Apple, mais c’est Steve Jobs qui « a fait l’iPhone ».
Le capitalisme, c’est donc le règne de la brigue érigée en principe. Et littéralement parlant on peut dire des capitalistes qu’ils sont des briguants : ils sont les bénéficiaires d’un système de brigue instituée. À côté de la suffisance, et précisément parce que celle-ci est un mensonge, la brigue est l’autre part, à la fois vivace et sombre, de l’imaginaire néolibéral. Vivace, car tous les petits apprentis-capitalistes savent de connaissance intuitive les possibilités de profit que leur ouvre le système de la brigue – et piaffent de les réaliser. Sombre, car elle est évidemment le symétrique, et le désaveu flagrant, de la part lumineuse, la part de la suffisance et de l’autonomie. Brigue est donc le nom d’une prétention : la prétention de se faire attribuer des effets qui excèdent ses propres puissances, c’est-à-dire d’établir une égalité (mensongère) entre le briguant et les effets qui suivent en fait de puissances autres que les siennes. La prétention du briguant, c’est par excellence le mensonge néolibéral du mérite.
(p.123) La légitimité, ou « Dieu et mon droit »
Ce sont des différences que les sujets de ces institutions savent très bien faire. Tous les agents d’ailleurs n’ont pas la même possibilité sociale d’accéder aux domaines des agonistiques instituées, et certains d’entre eux, dépourvus des formes de capital social qui permettent d’en acquitter les « droits d’entrée », n’ont pas d’autre choix que de vivre la régulation de leur conatus pronateur sous le régime d’affects tristes des institutions de répression. Rien ne permet d’affirmer que ces institutions sont plus ou moins « légitimes ». La seule chose qu’on puisse en dire est qu’elles sont moins pourvoyeuses d’affects joyeux. « Légitime » ou « illégitime », c’est toujours une question d’affirmation singulière, de points de vue particuliers. Celui dont l’élan pronateur, voué aux institutions de répression, ne se voit offrir qu’un nombre restreint de possibilités d’effectuation de puissance, trouve « légitimes » les solutions d’accomplissement qu’il s’invente malgré tout, quand bien même elles sont déclarées illégales. Ainsi appelle-t-il légitimes ses rares sources d’affects joyeux. De fait, l’économie souterraine et la lutte des gangs ne sont pas moins porteuses d’enjeux de grandeur que les compétitions des artistes ou des cadres supérieurs… et celles-ci, réciproquement, pas moins violentes en leur fond : « En réalité la nature humaine est une, et commune à tous, mais nous sommes trompés par la puissance et par la culture : de là vient que lorsque deux hommes font une même chose, nous disons souvent qu’elle est acceptable de l’un mais pas de l’autre, non parce qu’elle diffère, mais parce qu’ils diffèrent » (TP, VII, 27). Comme toutes les effectuations de puissance sans exception, celles qui demeurent offertes aux conatus les plus empêchés, fût-ce au risque de l’illégalité, sont trouvées légitimes par eux et de la légitimité de leur droit naturel (ou de ce qu’il en reste), c’est-à-dire parce que ce sont les leurs. Par un argument implicite de droit naturel absolument identique, celui dont le conatus jouit de l’accès aux formes les plus hautes et les plus reconnues de la symbolisation sociale des mêmes pulsions trouve illégitimes tous les efforts qui ne respectent pas strictement la légalité de l’état civil qui lui garantit, à lui, des accomplissements existentiels aussi gratifiants et aussi reconnus. Chacun s’accorde donc à soi-même le privilège de la légitimité, et cela, en dernière analyse, selon la même ultime justification conative – « parce que c’est moi » –, ou à la rigueur consent à en faire profiter d’autres avec lesquels ils se sent une proximité d’une certaine nature ou, pour mieux dire, une sympathie, c’est-à-dire une manière ponctuellement semblable d’être affecté. Hors de cette forme faible, et pourtant maximale, de décentrement, chacun indexe la légitimité sur son conatus et ses propres affects joyeux, son activité est la forme supérieure de l’activité – mépris de l’entrepreneur pour l’artiste (improductif), de l’intellectuel pour l’entrepreneur (inculte), du scientifique pour le philosophe (ignorant des réalités) ; et ce ne sont partout que luttes pour une métacapture, celle de la légitimité, c’est-à-dire de la qualification comme légitime(s) de sa propre activité de capture et de ses propres objets à capturer.
Ce sont des différences que les sujets de ces institutions savent très bien faire. Tous les agents d’ailleurs n’ont pas la même possibilité sociale d’accéder aux domaines des agonistiques instituées, et certains d’entre eux, dépourvus des formes de capital social qui permettent d’en acquitter les « droits d’entrée », n’ont pas d’autre choix que de vivre la régulation de leur conatus pronateur sous le régime d’affects tristes des institutions de répression. Rien ne permet d’affirmer que ces institutions sont plus ou moins « légitimes ». La seule chose qu’on puisse en dire est qu’elles sont moins pourvoyeuses d’affects joyeux. « Légitime » ou « illégitime », c’est toujours une question d’affirmation singulière, de points de vue particuliers. Celui dont l’élan pronateur, voué aux institutions de répression, ne se voit offrir qu’un nombre restreint de possibilités d’effectuation de puissance, trouve « légitimes » les solutions d’accomplissement qu’il s’invente malgré tout, quand bien même elles sont déclarées illégales. Ainsi appelle-t-il légitimes ses rares sources d’affects joyeux. De fait, l’économie souterraine et la lutte des gangs ne sont pas moins porteuses d’enjeux de grandeur que les compétitions des artistes ou des cadres supérieurs… et celles-ci, réciproquement, pas moins violentes en leur fond : « En réalité la nature humaine est une, et commune à tous, mais nous sommes trompés par la puissance et par la culture : de là vient que lorsque deux hommes font une même chose, nous disons souvent qu’elle est acceptable de l’un mais pas de l’autre, non parce qu’elle diffère, mais parce qu’ils diffèrent » (TP, VII, 27). Comme toutes les effectuations de puissance sans exception, celles qui demeurent offertes aux conatus les plus empêchés, fût-ce au risque de l’illégalité, sont trouvées légitimes par eux et de la légitimité de leur droit naturel (ou de ce qu’il en reste), c’est-à-dire parce que ce sont les leurs. Par un argument implicite de droit naturel absolument identique, celui dont le conatus jouit de l’accès aux formes les plus hautes et les plus reconnues de la symbolisation sociale des mêmes pulsions trouve illégitimes tous les efforts qui ne respectent pas strictement la légalité de l’état civil qui lui garantit, à lui, des accomplissements existentiels aussi gratifiants et aussi reconnus. Chacun s’accorde donc à soi-même le privilège de la légitimité, et cela, en dernière analyse, selon la même ultime justification conative – « parce que c’est moi » –, ou à la rigueur consent à en faire profiter d’autres avec lesquels ils se sent une proximité d’une certaine nature ou, pour mieux dire, une sympathie, c’est-à-dire une manière ponctuellement semblable d’être affecté. Hors de cette forme faible, et pourtant maximale, de décentrement, chacun indexe la légitimité sur son conatus et ses propres affects joyeux, son activité est la forme supérieure de l’activité – mépris de l’entrepreneur pour l’artiste (improductif), de l’intellectuel pour l’entrepreneur (inculte), du scientifique pour le philosophe (ignorant des réalités) ; et ce ne sont partout que luttes pour une métacapture, celle de la légitimité, c’est-à-dire de la qualification comme légitime(s) de sa propre activité de capture et de ses propres objets à capturer.
(p.105)
Ainsi, par exemple, l’affection d’une réforme fiscale qui baisse les impôts peut affecter joyeusement un même individu comme contribuable, mais aussi tristement s’il a contracté une manière de juger politiquement « à gauche » qui lui fait regretter le retrait de l’État social, de la solidarité redistributive, etc. De quel côté son âme penchera-t-elle in fine ? La réponse est : du côté des affects les plus puissants. Ici apparaît l’un des aspects les plus centraux du spinozisme, à savoir d’être un quantitativisme universel de la puissance. La vie psychique, comme toute chose dans l’univers, est régie par le principe de mesure des forces : des choses s’affrontent, les plus puissantes l’emporteront. La grande originalité de Spinoza consiste à avoir fait entrer ce principe, qu’on entend assez bien pour les affrontements de choses extérieures, dans l’« intériorité » de la vie psychique : « Un affect ne peut être réprimé ni supprimé si ce n’est par un affect contraire et plus fort que l’affect à réprimer » (Éth., IV, 7). Sous ce principe général, les propositions 9 à 18 de (Éth., IV) développent ces lois de puissance qui déterminent l’issue des conflits d’affects – selon que la cause des affects est imaginée présente ou absente, proche ou lointaine dans le temps, nécessaire ou contingente, etc.
Pour sommaire qu’il soit, quels traits singuliers ce portrait de l’homme-conatus fait-il déjà apparaître ? On ne lui voit aucun des caractères qui font le sujet classique ou l’acteur des sciences sociales individualistes (ou interactionnistes). Ici aucune conscience unitaire, réfléchissant et décidant souverainement de l’action. L’homme est un élan de puissance mais originellement intransitif et sous-déterminé. Or toutes ses déterminations complémentaires lui viennent du dehors. Il n’est pour rien dans les affections qui lui arrivent et tout ce qui s’en suit se produit sur un mode quasi-automatique : loin d’être l’instance de commandement qu’on imagine souvent, la psyché n’est qu’un lieu sur lequel s’affrontent les affects déterminés par le travail de l’ingenium, tel qu’il est lui-même le produit hétéronome d’une trajectoire (socio-) biographique. Les balances affectives qui en résultent déterminent à leur tour des efforts vers les sources imaginées de joie et loin des causes imaginées de tristesse. Toutes ces idées ont été formées, non par quelque cogito souverain, mais dans le sillage même des affects antérieurement éprouvés par lesquels se sont constituées des manières de sentir et de juger. L’homme est un automate conatif et affectif, les orientations que prendra son élan de puissance sont déterminées par des forces qui sont pour l’essentiel hors de lui. Il en suit, sans même s’en rendre compte, les directions, et pourtant rien de tout cela ne l’empêche de nourrir, par des mécanismes cognitifs que Spinoza n’omet pas de détailler (Éth., I, Appendice), l’idée de son libre arbitre ou bien celle que son esprit commande à son corps ! C’est dire le régime de conscience tronquée et de connaissance mutilée où il se tient d’abord : « Les hommes se trompent quand ils se croient libres ; car cette opinion consiste en cela seul qu’ils sont conscients de leurs actes mais ignorants des causes qui les déterminent » (Éth., II, 35, scolie).
Ainsi, par exemple, l’affection d’une réforme fiscale qui baisse les impôts peut affecter joyeusement un même individu comme contribuable, mais aussi tristement s’il a contracté une manière de juger politiquement « à gauche » qui lui fait regretter le retrait de l’État social, de la solidarité redistributive, etc. De quel côté son âme penchera-t-elle in fine ? La réponse est : du côté des affects les plus puissants. Ici apparaît l’un des aspects les plus centraux du spinozisme, à savoir d’être un quantitativisme universel de la puissance. La vie psychique, comme toute chose dans l’univers, est régie par le principe de mesure des forces : des choses s’affrontent, les plus puissantes l’emporteront. La grande originalité de Spinoza consiste à avoir fait entrer ce principe, qu’on entend assez bien pour les affrontements de choses extérieures, dans l’« intériorité » de la vie psychique : « Un affect ne peut être réprimé ni supprimé si ce n’est par un affect contraire et plus fort que l’affect à réprimer » (Éth., IV, 7). Sous ce principe général, les propositions 9 à 18 de (Éth., IV) développent ces lois de puissance qui déterminent l’issue des conflits d’affects – selon que la cause des affects est imaginée présente ou absente, proche ou lointaine dans le temps, nécessaire ou contingente, etc.
Pour sommaire qu’il soit, quels traits singuliers ce portrait de l’homme-conatus fait-il déjà apparaître ? On ne lui voit aucun des caractères qui font le sujet classique ou l’acteur des sciences sociales individualistes (ou interactionnistes). Ici aucune conscience unitaire, réfléchissant et décidant souverainement de l’action. L’homme est un élan de puissance mais originellement intransitif et sous-déterminé. Or toutes ses déterminations complémentaires lui viennent du dehors. Il n’est pour rien dans les affections qui lui arrivent et tout ce qui s’en suit se produit sur un mode quasi-automatique : loin d’être l’instance de commandement qu’on imagine souvent, la psyché n’est qu’un lieu sur lequel s’affrontent les affects déterminés par le travail de l’ingenium, tel qu’il est lui-même le produit hétéronome d’une trajectoire (socio-) biographique. Les balances affectives qui en résultent déterminent à leur tour des efforts vers les sources imaginées de joie et loin des causes imaginées de tristesse. Toutes ces idées ont été formées, non par quelque cogito souverain, mais dans le sillage même des affects antérieurement éprouvés par lesquels se sont constituées des manières de sentir et de juger. L’homme est un automate conatif et affectif, les orientations que prendra son élan de puissance sont déterminées par des forces qui sont pour l’essentiel hors de lui. Il en suit, sans même s’en rendre compte, les directions, et pourtant rien de tout cela ne l’empêche de nourrir, par des mécanismes cognitifs que Spinoza n’omet pas de détailler (Éth., I, Appendice), l’idée de son libre arbitre ou bien celle que son esprit commande à son corps ! C’est dire le régime de conscience tronquée et de connaissance mutilée où il se tient d’abord : « Les hommes se trompent quand ils se croient libres ; car cette opinion consiste en cela seul qu’ils sont conscients de leurs actes mais ignorants des causes qui les déterminent » (Éth., II, 35, scolie).
(p.122) Sous ce rapport on pourrait voir dans le don/contre-don une sorte de paradigme civilisationnel, en tant qu’il offre peut-être l’une des toutes premières réalisations de cette solution extrêmement générale de régulation des pulsions pronatrices des conatus. Ôter les biens à saisir et les remplacer par des trophées, cristallisations des jugements de grandeur rendus par le groupe, est une stratégie de mise en forme des énergies conquérantes des conatus dont on retrouvera maintes déclinaisons, jusque dans les univers sociaux les plus contemporains. Comme les scènes archaïques où se sont d’abord tenues les compétitions somptuaires du don cérémoniel, bon nombre de ces microcosmes que Bourdieu nomme des « champs » sont autant de théâtres d’une agonistique instituée : on y lutte intensément pour la conquête des trophées locaux, formes de la grandeur spécifiques au champ, souvent poursuivies avec une grande violence, mais une violence toujours symbolisée, c’est-à-dire conforme au nomos du champ : la grandeur politique se gagne par la conquête électorale du pouvoir, la grandeur sportive par la performance physique selon les règles, la grandeur capitaliste par l’OPA validée par les marchés, etc. Mais en tous ces univers, comme jadis sur les scènes du don cérémoniel, le conatus, interdit de pronation unilatérale brutale, et frustré de ses prises spontanées, se voit tout de même offrir des solutions d’accomplissement. Là où la prohibition du droit légal était sans appel et sans au-delà, laissant l’élan réprimé à ses seuls affects tristes, les solutions de sublimation offertes par les agonistiques instituées proposent des effectuations de puissance alternatives et substitutives. En dépit des renoncements qui lui sont imposés, comme dans tous les rapports institutionnels, le conatus y trouve donc son compte – c’est-à-dire des affects joyeux. Aussi la vie sous les institutions de sublimation est-elle plus agréable que sous les institutions de répression. L’élan existentiel du conatus n’y rencontre pas qu’un attristant déni de s’effectuer, mais au contraire des possibilités de réalisation qui peuvent s’avérer intensément mobilisatrices. Un même renoncement à exercer pleinement son droit naturel est produit – puisque dans l’un et l’autre cas le « droit » de saisir sans phrase est barré – mais sous des régimes d’affects très différents. Le même problème de régulation du prendre offre donc, en ses diverses solutions institutionnelles, des possibilités d’effectuation de puissances inégales, et en définitive des formes de vie dissemblables.
Videos de Frédéric Lordon (18)
Voir plusAjouter une vidéo
Entretien du 31.01.2012 avec Frédéric Lordon "Ma mondialisation" (2006), issu de l'excellent documentaire de Gilles Perret.
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Frédéric Lordon (21)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
437 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre437 lecteurs ont répondu