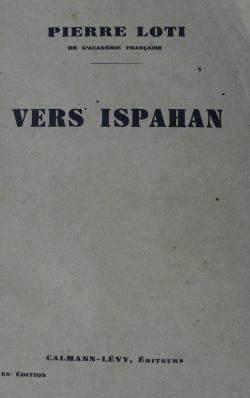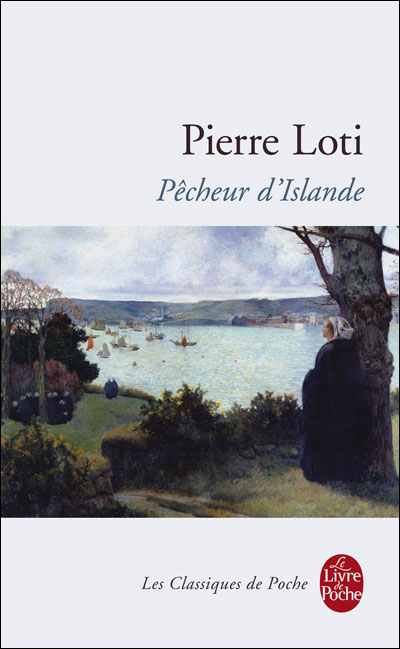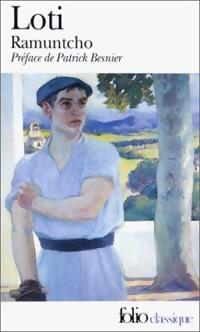Pierre Loti
EAN : SIE142815_139
Calmann-Lévy (30/11/-1)
/5
20 notes
Calmann-Lévy (30/11/-1)
Résumé :
En 1903, au retour de l'Inde, Pierre Loti visite la Perse pendant six semaines environ : Chiraz, Persépolis et Ispahan, voilà les grandes étapes. Les mosquées, les bazars, les jardins pleins de roses et les Persans, voilà le champ d'observation. Vers Ispahan est une peinture fastueuse de la Perse aux mours féodales, alors tenue à l'écart du monde. Extrait : Qui veut venir avec moi voir apparaître, dans sa triste oasis, au milieu de ses champs de pavots blancs et de ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Vers IspahanVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
La littérature semble nous apprendre qu'il ne faut jamais visiter les pays dont on a rêvé, qu'il ne faut pas voyager dans ces lieux qui peuplent notre imaginaire, parfois depuis l'enfance.
Le Narrateur de la Recherche du Temps perdu rêve de Venise, fantasme Venise, et, quand il s'y rend enfin, ne voit que les façades défraichies, trouve les femmes laides, ne sent que les odeurs de pourriture qui s'exhalent des canaux.
Pierre Loti ressent la même déception, avant Proust même, sauf qu'il ne s'git pas d'une fiction, mais d'un récit de voyage sous forme de journal. Il connaît la Perse de façon artistique, livresque : par ses études classiques en ayant traduit des passages en grec sur la Perse de Darius au temps d'Alexandre le Grand, par les récits de voyage des explorateurs, par des gravures. Avant de partir, ses rêves sont déterminés par un imaginaire orientaliste - jardins de rose, caravanes de chameaux, minarets dorés et bleutés... Et, peut-être surtout, femmes sensuelles, érotisées, aux yeux de biche et au teint de porcelaine comme dans une miniature persane.
La réalité s'avère toute autre... "Écroulements, décombres, et pourriture" déclare Loti au milieu de son texte, une formule qui pourrait résumer toutes ses étapes : à chaque journée de voyage, il note la puanteur des cadavres de mules ou de chevaux laissés en putréfaction, les ordures dans les rues ou dans les caravansérails. Il insiste sur les morceaux de mosaïque, de maçonnerie, de dorures même, qui s'effondrent faute d'entretien, même sur les plus beaux palais ou les plus belles mosquées. Quand aux "écroulements", le terme pourrait s'appliquer aux palais de Darius, les empereurs perses : ce sont certes des ruines archéologiques, mais sans aucune mise en valeur, sans patrimonialisation dirait-on aujourd'hui, qui permettrait aux visiteurs de reconstituer la grande Perse de ses études classiques. Non, les nomades y campent, les chèvres y paissent... Et c'est un sentiment de mélancolie qui étreint le voyageur. Enfin, les femmes qu'il fantasmaient se révèlent être des "fantômes" drapées dans leur voile qui dissimulent leurs traits, leurs corps et leur personnalité.
Cependant la lecture s'est révélée un peu fastidieuse, surtout au début : les premiers jours sont très répétitifs : le départ de la caravane, un paysage monotone de nuit, une arrivée au petit matin dans un caravansérail sale, le bruit des troupeaux... Loti voyage pour des paysages et des monuments, pas pour des rencontres, et il rentre donc peu en contact avec les habitants.
C'est donc le récit mélancolique d'un monde en train de disparaître, Loti regrettant d'ailleurs les traces de modernisation et d'occidentalisation de ce monde : les chemins de fer, l'influence coloniale britannique, les modes de vie... Il voudrait prendre ses repas assis sur un tapis, en fumant un narghilé, pas un repas pris à l'européenne avec des serveurs en gants blancs.
Oui, la réalité est décevante par rapport aux rêves...
Le Narrateur de la Recherche du Temps perdu rêve de Venise, fantasme Venise, et, quand il s'y rend enfin, ne voit que les façades défraichies, trouve les femmes laides, ne sent que les odeurs de pourriture qui s'exhalent des canaux.
Pierre Loti ressent la même déception, avant Proust même, sauf qu'il ne s'git pas d'une fiction, mais d'un récit de voyage sous forme de journal. Il connaît la Perse de façon artistique, livresque : par ses études classiques en ayant traduit des passages en grec sur la Perse de Darius au temps d'Alexandre le Grand, par les récits de voyage des explorateurs, par des gravures. Avant de partir, ses rêves sont déterminés par un imaginaire orientaliste - jardins de rose, caravanes de chameaux, minarets dorés et bleutés... Et, peut-être surtout, femmes sensuelles, érotisées, aux yeux de biche et au teint de porcelaine comme dans une miniature persane.
La réalité s'avère toute autre... "Écroulements, décombres, et pourriture" déclare Loti au milieu de son texte, une formule qui pourrait résumer toutes ses étapes : à chaque journée de voyage, il note la puanteur des cadavres de mules ou de chevaux laissés en putréfaction, les ordures dans les rues ou dans les caravansérails. Il insiste sur les morceaux de mosaïque, de maçonnerie, de dorures même, qui s'effondrent faute d'entretien, même sur les plus beaux palais ou les plus belles mosquées. Quand aux "écroulements", le terme pourrait s'appliquer aux palais de Darius, les empereurs perses : ce sont certes des ruines archéologiques, mais sans aucune mise en valeur, sans patrimonialisation dirait-on aujourd'hui, qui permettrait aux visiteurs de reconstituer la grande Perse de ses études classiques. Non, les nomades y campent, les chèvres y paissent... Et c'est un sentiment de mélancolie qui étreint le voyageur. Enfin, les femmes qu'il fantasmaient se révèlent être des "fantômes" drapées dans leur voile qui dissimulent leurs traits, leurs corps et leur personnalité.
Cependant la lecture s'est révélée un peu fastidieuse, surtout au début : les premiers jours sont très répétitifs : le départ de la caravane, un paysage monotone de nuit, une arrivée au petit matin dans un caravansérail sale, le bruit des troupeaux... Loti voyage pour des paysages et des monuments, pas pour des rencontres, et il rentre donc peu en contact avec les habitants.
C'est donc le récit mélancolique d'un monde en train de disparaître, Loti regrettant d'ailleurs les traces de modernisation et d'occidentalisation de ce monde : les chemins de fer, l'influence coloniale britannique, les modes de vie... Il voudrait prendre ses repas assis sur un tapis, en fumant un narghilé, pas un repas pris à l'européenne avec des serveurs en gants blancs.
Oui, la réalité est décevante par rapport aux rêves...
C'est à l'écoute du poème symphonique Les heures persanes de Charles Koechlin que j'ai été amené à m'intéresser à ce récit de voyage de Pierre Loti. C'est au début du XXe siècle qu'il passe quelques mois en Perse. L'écriture de cet auteur est toujours agréable, simple, jolie, enfin bref démodée mais intéressante. Pierre Loti ne cherche pas à donner dans l'orientalisme à travers ce récit. Il fait plutôt état de ses impressions de voyage avec un regard étonné, intéressé qui va s'avérer de façon surprenante très proche de ce qui pourrait être raconté aujourd'hui. La Perse est un pays contrasté et difficile. S'y déplacer n'est pas de tout repos. Il va y rencontrer tour à tour la chaleur, le froid, le désert, la montagne. Autant d'épreuves à traverser pour arriver à chaque fois au but suivant, une nouvelle ville. Pierre loti va traverser Chiraz, Ispahan qui s'avèreront être des villes iraniennes toujours ancrées dans un Orient qui ne cesse de nous surprendre. Évidemment à Ispahan nous serons au milieu des roses et des contes des mille et une nuits. le dépaysement est grand et le regard de l'occidental est critique et pourrait faire penser à une certaine idée que nous avons de la vie dans un pays islamique. Voir le visage d'une femme derrière son niqab relève de l'exploit. Nous sommes des voyeurs dont les musulmans se protègent. L'État de ce pays fait frémir quand on pense aux millénaires d'avance que cette civilisation a eu sur la nôtre. Téhéran est déjà une ville occidentalisée. On y rencontre des francophones ayant étudié à Paris et même les tenues vestimentaires font penser aux villes européennes.
Ce périple est donc non seulement une belle histoire qui nous est contée, mais aussi une visite d'un pays appelé aujourd'hui l'Iran dans lequel nous pourrions nous retrouver à notre époque.
(En lien vous trouverez la possibilité d'écouter des heures personne de Charles Koechlin, version originale pour piano)
Lien : https://www.youtube.com/watc..
Ce périple est donc non seulement une belle histoire qui nous est contée, mais aussi une visite d'un pays appelé aujourd'hui l'Iran dans lequel nous pourrions nous retrouver à notre époque.
(En lien vous trouverez la possibilité d'écouter des heures personne de Charles Koechlin, version originale pour piano)
Lien : https://www.youtube.com/watc..
On plonge dans l'Iran du début du XXème siècle, magnifique voyage décrit dans les carnets de route de Pierre Loti.
Citations et extraits (7)
Voir plus
Ajouter une citation
3
Neuf heures et demie. Le vent s’apaise ; les nuages partout se déchirent, montrant les étoiles. Tout est empaqueté, chargé. Mes trois soldats sont en selle, tenant leurs longs fusils droits. On amène nos chevaux, nous montons aussi. Avec un ensemble joyeux de sonneries, ma caravane s’ébranle, en petite cohorte confuse, et pointe enfin dans une direction déterminée, à travers la plaine sans bornes.
Plaine de vase grise, qui tout de suite commence après les sables, plaine de vase séchée au soleil et criblée d’empreintes ; des traînées d’un gris plus pâle, faites à la longue par des piétinemens innombrables, sont les sentes qui nous guident et vont se perdre en avant dans l’infini.
Elle est en marche, ma caravane ! et c’est pour six heures de route, ce qui nous fera arriver à l’étape vers trois ou quatre heures du matin.
Malgré cette partance décourageante, qui semblait ne devoir aboutir jamais, elle est en marche, ma caravane, assez rapide, assez légère et aisée, h travers l’espace imprécis dont rien ne jalonne l’étendue...
Jamais encore je n’avais cheminé dans le désert en pleine nuit. Au Maroc, en Syrie, en Arabie, on campait toujours avant l’heure du Moghreb. Mais ici, le soleil est tellement meurtrier que ni les hommes ni les bêtes ne résisteraient à un trajet de plein jour : ces routes ne connaissent que la vie nocturne.
La lune monte dans le ciel, où de gros nuages, qui persistent encore, la font de temps à autre mystérieuse.
Escorte d’inconnus, silhouettes très persanes ; pour moi, visages nouveaux, costumes et harnais vus pour la première fois.
Avec un carillon d’harmonie monotone, nous progressons dans le désert : grosses cloches aux notes graves, suspendues sous le ventre des mules ; petites clochettes ou grelots, formant guirlande à leur cou. Et j’entends aussi des gens de ma suite qui chantent en voix haute de muezzin, tout doucement, comme s’ils rêvaient.
C’est devenu déjà une seule et même chose, ma caravane, un seul et même tout, qui parfois s’allonge à la file, s’espace démesurément sous la lune, dans l’infini gris ; mais qui d’instinct se resserre, se groupe à nouveau en une mêlée compacte, où les jambes se frôlent. Et on prend confiance dans cette cohésion instinctive, on en vient peu à peu à laisser les bêtes cheminer comme elles l’entendent.
Le ciel de plus en plus se dégage ; avec la rapidité propre h de tels climats, ces nuées, là-haut, qui semblaient si lourdes achèvent de s’évaporer sans pluie. Et la pleine l’une maintenant resplendit, superbe et seule dans le vide ; toute la chaude atmosphère est imprégnée de rayons, toute l’étendue visible est inondée de clarté blanche.
Il arrive bien de temps à autre qu’une mule fantaisiste s’éloigne sournoisement, pointe, on ne sait pourquoi, dans une direction oblique ; mais elle est très facile à distinguer, se détachant en noir, avec sa charge qui lui fait un gros dos bossu, au milieu de ces lointains lisses et clairs, où ne tranche ni un rocher ni une touffe d’herbe ; un de nos hommes court après et la ramène, en poussant ce long beuglement à bouche close, qui est ici le cri de rappel des muletiers.
Et la petite musique de nos cloches de route continue de nous bercer avec sa monotonie douce ; le perpétuel carillon, dans le perpétuel silence, nous endort. Des gens sommeillent tout à fait, allongés, couchés inertes sur le cou de leur mule, qu’ils enlacent machinalement des deux bras, corps abandonnés qu’un rien désarçonnerait, et longues jambes nues qui pendent. D’autres, restés droits, persistent à chanter, dans le carillon des cloches suspendues, mais peut-être dorment aussi.
Il y a maintenant des zones de sable rose, tracées avec une régularité bizarre ; sur le sol de vase séchée, elles font comme des zébrures, l’étendue du désert ressemble à une nappe de moire. Et, à l’horizon devant nous, mais si loin encore, toujours cette chaîne de montagnes en muraille droite, qui limite l’étouffante région d’en bas, qui est le rebord des grands plateaux d’Asie, le rebord de la vraie Perse, de la Perse de Chiraz et d’Ispahan : là-haut, à deux ou trois mille mètres au-dessus de ces plaines mortelles, est le but de notre voyage, le pays désiré, mais difficilement accessible, où Uniront nos peines.
Minuit. Une quasi-fraîcheur tout à coup, délicieuse après la fournaise du jour, nous rend plus légers ; sur l’immensité, moirée de rose et de gris, nous allons comme hypnotisés.
Une heure, deux heures du matin... De même qu’en mer, les nuits de quart par très beau temps, alors que tout est facile et qu’il suffit de laisser le navire glisser, on perd ici la notion des durées, tantôt les minutes paraissent longues comme des heures, tantôt les heures, brèves comme des minutes. Du reste, pas plus que sur une mer calme, rien de saillant sur le désert pour indiquer le chemin parcouru...
Je dors sans doute, car ceci ne peut être qu’un rêve !... A mes côtés, une jeune fille, que la lune me montre adorablement jolie, avec un voile et des bandeaux à la vierge, chemine tout près sur un ânon, qui, pour se maintenir là, remue ses petites jambes en un trottinement silencieux...
Mais non, elle est bien réelle, la si jolie voyageuse, et je suis éveillé !... Alors, dans une première minute d’effarement, l’idée me passe que mon cheval, profitant de mon demi-sommeil, a dû m’égarer, se joindre à quelque caravane étrangère...
Cependant je reconnais, à deux pas, les longues moustaches d’un de mes soldats d’escorte ; et ce cavalier devant moi est bien mon tcharvadar, qui se retourne en selle pour me sourire, de son air le plus tranquille... D’autres femmes, sur d’autres petits ânes, de droite et de gauche, sont là qui font route parmi nous : tout simplement, un groupe de Persans et de Persanes, revenant de Bender-Bouchir, a demandé, pour plus de sécurité, la permission de voyager cette nuit en notre compagnie.
Trois heures du matin. Sur l’étendue claire, une tache noire, en avant de nous, se dessine et grandit : ce sont les arbres, les palmiers, les verdures de l’oasis ; c’est l’étape, et nous arrivons.
Devant un village, devant des huttes endormies, je mets pied à terre d’un mouvement machinal ; je dors debout, harassé de bonne et saine fatigue. C’est sous une sorte de hangar, recouvert de chaume et tout pénétré de rayons de lune, que mes serviteurs persans dressent en hâte les petits-lits de campagne, pour mon serviteur français et pour moi-même, après avoir refermé sur nous un portail à claire-voie, grossier, mais solide. Je vois cela vaguement, je me couche, et perds conscience de toutes choses.
Neuf heures et demie. Le vent s’apaise ; les nuages partout se déchirent, montrant les étoiles. Tout est empaqueté, chargé. Mes trois soldats sont en selle, tenant leurs longs fusils droits. On amène nos chevaux, nous montons aussi. Avec un ensemble joyeux de sonneries, ma caravane s’ébranle, en petite cohorte confuse, et pointe enfin dans une direction déterminée, à travers la plaine sans bornes.
Plaine de vase grise, qui tout de suite commence après les sables, plaine de vase séchée au soleil et criblée d’empreintes ; des traînées d’un gris plus pâle, faites à la longue par des piétinemens innombrables, sont les sentes qui nous guident et vont se perdre en avant dans l’infini.
Elle est en marche, ma caravane ! et c’est pour six heures de route, ce qui nous fera arriver à l’étape vers trois ou quatre heures du matin.
Malgré cette partance décourageante, qui semblait ne devoir aboutir jamais, elle est en marche, ma caravane, assez rapide, assez légère et aisée, h travers l’espace imprécis dont rien ne jalonne l’étendue...
Jamais encore je n’avais cheminé dans le désert en pleine nuit. Au Maroc, en Syrie, en Arabie, on campait toujours avant l’heure du Moghreb. Mais ici, le soleil est tellement meurtrier que ni les hommes ni les bêtes ne résisteraient à un trajet de plein jour : ces routes ne connaissent que la vie nocturne.
La lune monte dans le ciel, où de gros nuages, qui persistent encore, la font de temps à autre mystérieuse.
Escorte d’inconnus, silhouettes très persanes ; pour moi, visages nouveaux, costumes et harnais vus pour la première fois.
Avec un carillon d’harmonie monotone, nous progressons dans le désert : grosses cloches aux notes graves, suspendues sous le ventre des mules ; petites clochettes ou grelots, formant guirlande à leur cou. Et j’entends aussi des gens de ma suite qui chantent en voix haute de muezzin, tout doucement, comme s’ils rêvaient.
C’est devenu déjà une seule et même chose, ma caravane, un seul et même tout, qui parfois s’allonge à la file, s’espace démesurément sous la lune, dans l’infini gris ; mais qui d’instinct se resserre, se groupe à nouveau en une mêlée compacte, où les jambes se frôlent. Et on prend confiance dans cette cohésion instinctive, on en vient peu à peu à laisser les bêtes cheminer comme elles l’entendent.
Le ciel de plus en plus se dégage ; avec la rapidité propre h de tels climats, ces nuées, là-haut, qui semblaient si lourdes achèvent de s’évaporer sans pluie. Et la pleine l’une maintenant resplendit, superbe et seule dans le vide ; toute la chaude atmosphère est imprégnée de rayons, toute l’étendue visible est inondée de clarté blanche.
Il arrive bien de temps à autre qu’une mule fantaisiste s’éloigne sournoisement, pointe, on ne sait pourquoi, dans une direction oblique ; mais elle est très facile à distinguer, se détachant en noir, avec sa charge qui lui fait un gros dos bossu, au milieu de ces lointains lisses et clairs, où ne tranche ni un rocher ni une touffe d’herbe ; un de nos hommes court après et la ramène, en poussant ce long beuglement à bouche close, qui est ici le cri de rappel des muletiers.
Et la petite musique de nos cloches de route continue de nous bercer avec sa monotonie douce ; le perpétuel carillon, dans le perpétuel silence, nous endort. Des gens sommeillent tout à fait, allongés, couchés inertes sur le cou de leur mule, qu’ils enlacent machinalement des deux bras, corps abandonnés qu’un rien désarçonnerait, et longues jambes nues qui pendent. D’autres, restés droits, persistent à chanter, dans le carillon des cloches suspendues, mais peut-être dorment aussi.
Il y a maintenant des zones de sable rose, tracées avec une régularité bizarre ; sur le sol de vase séchée, elles font comme des zébrures, l’étendue du désert ressemble à une nappe de moire. Et, à l’horizon devant nous, mais si loin encore, toujours cette chaîne de montagnes en muraille droite, qui limite l’étouffante région d’en bas, qui est le rebord des grands plateaux d’Asie, le rebord de la vraie Perse, de la Perse de Chiraz et d’Ispahan : là-haut, à deux ou trois mille mètres au-dessus de ces plaines mortelles, est le but de notre voyage, le pays désiré, mais difficilement accessible, où Uniront nos peines.
Minuit. Une quasi-fraîcheur tout à coup, délicieuse après la fournaise du jour, nous rend plus légers ; sur l’immensité, moirée de rose et de gris, nous allons comme hypnotisés.
Une heure, deux heures du matin... De même qu’en mer, les nuits de quart par très beau temps, alors que tout est facile et qu’il suffit de laisser le navire glisser, on perd ici la notion des durées, tantôt les minutes paraissent longues comme des heures, tantôt les heures, brèves comme des minutes. Du reste, pas plus que sur une mer calme, rien de saillant sur le désert pour indiquer le chemin parcouru...
Je dors sans doute, car ceci ne peut être qu’un rêve !... A mes côtés, une jeune fille, que la lune me montre adorablement jolie, avec un voile et des bandeaux à la vierge, chemine tout près sur un ânon, qui, pour se maintenir là, remue ses petites jambes en un trottinement silencieux...
Mais non, elle est bien réelle, la si jolie voyageuse, et je suis éveillé !... Alors, dans une première minute d’effarement, l’idée me passe que mon cheval, profitant de mon demi-sommeil, a dû m’égarer, se joindre à quelque caravane étrangère...
Cependant je reconnais, à deux pas, les longues moustaches d’un de mes soldats d’escorte ; et ce cavalier devant moi est bien mon tcharvadar, qui se retourne en selle pour me sourire, de son air le plus tranquille... D’autres femmes, sur d’autres petits ânes, de droite et de gauche, sont là qui font route parmi nous : tout simplement, un groupe de Persans et de Persanes, revenant de Bender-Bouchir, a demandé, pour plus de sécurité, la permission de voyager cette nuit en notre compagnie.
Trois heures du matin. Sur l’étendue claire, une tache noire, en avant de nous, se dessine et grandit : ce sont les arbres, les palmiers, les verdures de l’oasis ; c’est l’étape, et nous arrivons.
Devant un village, devant des huttes endormies, je mets pied à terre d’un mouvement machinal ; je dors debout, harassé de bonne et saine fatigue. C’est sous une sorte de hangar, recouvert de chaume et tout pénétré de rayons de lune, que mes serviteurs persans dressent en hâte les petits-lits de campagne, pour mon serviteur français et pour moi-même, après avoir refermé sur nous un portail à claire-voie, grossier, mais solide. Je vois cela vaguement, je me couche, et perds conscience de toutes choses.
4
Mercredi 18 avril. — Éveillé avant le jour, par des voix d’hommes et de femmes, qui chuchotent tout près et tout bas ; avec mon interprète, ils parlementent discrètement pour demander la permission d’ouvrir le portail et de sortir.
Le village, paraît-il, est enclos de murs et de palissades, presque fortifié, contre les rôdeurs de nuit et contre les fauves. Or, nous étions couchés à l’entrée même, à l’unique entrée, sous le hangar de la porte. Et ces gens, qui nous réveillent à regret, sont des bergers, des bergères : il est l’heure de mener les troupeaux dans les champs, car l’aube est proche.
Aussitôt la permission donnée et le portail ouvert, un vrai torrent de chèvres et de chevreaux noirs, nous frôlant dans le passage étroit, commence de couler entre nous, le long de nos lits ; on entend leurs bêlemens contenus et, sur le sol, le bruit léger de leurs myriades de petits sabots ; ils sentent bon l’étable, l’herbe, les aromates du désert. Et c’est si long, cette sortie, il y en a tant et tant, que je me demande à la fin si je suis halluciné, si je rêve : j’étends le bras pour vérifier si c’est réel, pour toucher au passage les dos, les toisons rudes. Le peuple des ânes et des ânons vient ensuite, nous frôlant de même ; j’en ai cependant la perception moins nette, car voici que je sombre à nouveau dans l’inconscience du sommeil...
Eveillé encore, peut-être une heure après, mais cette fois par une sensation cuisante aux tempes : c’est l’aveuglant soleil, qui a remplacé la lune ; à peine levé, il brûle. Nos mains, nos visages sont déjà noirs de mouches. Et un attroupement de petits bébés, bruns et nus, s’est formé autour de nos lits ; leurs jeunes yeux vifs, très ouverts, nous regardent avec stupeur.
Vite, il faut se lever, chercher un abri, n’importe où se mettre à l’ombre.
Je loue jusqu’au soir une maison, que l’on se hâte de vider pour nous. Murs croulans, en terre battue qui s’émiette sous l’haleine du désert ; troncs de palmier pour solives, feuilles de palmier pour toiture, et porte à claire-voie en nervures de palme.
Des enfans viennent à plusieurs reprises nous y voir, des très petits de cinq ou six ans, tout nus et adorablement jolis ; ils nous font des saints, nous tiennent des discours, et se retirent. Ce sont ceux de la maison, paraît-il, qui se considèrent comme un peu chez eux. Des poules s’obstinent de même à entrer, et nous finissons par le permettre. Au moment de la sieste méridienne, des chèvres entrent aussi pour se mettre à l’ombre, et nous les laissons faire.
Des percées dans le mur servent de fenêtres, par où souffle lin vent comme l’haleine d’un brasier. Elles donnent d’un côté sur l’éblouissant désert ; de l’autre, sur des blés où la moisson est commencée, et sur la muraille Persique, là-bas, qui durant la nuit a sensiblement monté dans le ciel. Après la longue marche nocturne, ou voudrait dormir, dans ce silence de midi et cette universelle torpeur. Mais les mauvaises mouches sont là, innombrables ; dès qu’on s’immobilise, on en est couvert, an en est tout noir ; coûte que coûte, il faut se remuer, agiter des éventails.
A l’heure où commence à s’allonger l’ombre des maisonnettes de terre, nous sortons pour nous asseoir devant notre porte. Et chez tous les voisins, on fait de même ; la vie reprend son cours dans cet humble village de pasteurs ; des hommes aiguisent des faucilles ; des femmes, assises sur des nattes, tissent la laine de leurs moutons ; — les yeux très peints, elles sont presque toutes jolies, ces filles de l’oasis, avec le fin profil et les lignes pures des races de l’Iran.
Sur un cheval ruisselant de sueur, arrive un beau grand jeune homme ; les petits enfans de notre maison, qui lui ressemblent de visage, accourent à sa rencontre, en lui apportant de l’eau fraîche, et il les embrasse ; c’est leur frère, le fils aîné de la famille.
Maintenant voici venir un vieillard à chevelure blanche, qui se dirige vers moi, et devant lequel chacun s’incline ; pour le faire asseoir, on se hâte d’étendre par terre le plus beau tapis du quartier ; les femmes, par respect, se retirent avec de profonds saints, et des personnages, à long fusil, à longue moustache, qui l’accompagnaient, forment cercle farouche alentour : il est le chef de l’oasis ; c’est à lui que j’avais envoyé ma lettre de réquisition, pour avoir une escorte la nuit prochaine, et il vient me dire qu’il me fournira trois cavaliers avant l’instant du Moghreb.
Sept heures du soir, le limpide crépuscule, l’heure où j’avais décidé de partir. Malgré de longues discussions avec mon tcharvadar, qui a réussi à m’imposer une mule et un muletier de plus, tout serait prêt, ou peu s’en faut ; mais les trois cavaliers promis manquent à l’appel, je les ai envoyé chercher et mes émissaires ne reviennent plus. Comme hier, il sera nuit noire quand nous nous mettrons en route.
Huit heures bientôt. Nous attendons toujours. Tant pis pour ces trois cavaliers ! Je me passerai d’escorte ; qu’on m’amène mon cheval, et partons !... Mais cette petite place du village, où l’on n’y voit plus, et qui est déjà encombrée de tous mes gens, de toutes mes bêtes, est brusquement envahie par le flot noir des troupeaux, qui rentrent en bêlant ; la poussée inoffensive et joyeuse d’un millier de moutons, de chèvres ou de cabris nous sépare les uns des autres, nous met en complète déroute, il en passe entre nos jambes, il en passe sous le ventre de nos mules, il s’en faufile partout, il en arrive toujours...
Et quand c’est fini, quand la place est dégagée et le bétail couché, voici bien une autre aventure : où donc est mon cheval ? Pendant la bagarre des chèvres, l’homme qui le tenait l’a lâché ; la porte du village était ouverte et il s’est évadé ; avec sa selle sur le dos, sa bride sur le cou, il a pris le galop, vers les sables libres... Dix hommes s’élancent à sa poursuite, lâchant toutes nos autres bêtes qui aussitôt commencent à se mêler et à faire le diable. Nous ne partirons jamais...
Huit heures passées. Enfin on ramène le fugitif très agité et d’humeur impatiente. Et nous sortons du village, baissant la tête pour les solives, sous ce hangar de la porte où nous avions dormi la nuit dernière.
D’abord les grands dattiers, autour de nous, découpent de tous côtés leurs plumes noires sur le ciel plein d’étoiles. Mais, bientôt, ils sont plus clairsemés ; les vastes plaines nous montrent à nouveau leur cercle vide. Comme nous allions sortir de l’oasis, trois cavaliers en armes se présentent devant moi et me saluent ; mes trois gardes, dont j’avais fait mon deuil ; mêmes silhouettes que ceux d’hier, belles tournures, hauts bonnets et longues moustaches. Et, après un gué que nous passons à la débandade, ma caravane se reforme, au complet et à peu près en ligne, dans l’espace illimité, dans le vague désert nocturne.
Il est plus inhospitalier encore que celui de la veille, l’âpre désert de cette fois ; le sol y est mauvais, n’inspire plus de confiance ; des pierres sournoises et coupantes font trébucher nos bêtes. Et la lune, hélas ! n’est pas près de se lever. Parmi les étoiles lointaines, Vénus seule, très brillante et argentine, nous verse un peu de lumière.
Après deux heures et demie de marche, autre oasis, beaucoup plus grande, plus touffue que celle d’hier. Nous la longeons sans y pénétrer, mais une fraîcheur exquise nous vient, dans le voisinage de tous ces palmiers sous lesquels on entend courir des ruisseaux.
Onze heures. Enfin, derrière la montagne là-bas, — toujours cette même montagne dont chaque heure nous rapproche et qui est le rebord, l’immense falaise de l’Iran, — derrière la montagne, une clarté annonce l’entrée en scène de la lune, amie des caravanes. Elle se lève, pure et belle, jetant la lumière à flots, et nous révélant des vapeurs que nous n’avions pas vues. Non plus de ces voiles de sable et de poussière, comme les jours précédens, mais de vraies et précieuses vapeurs d’eau qui, sur toute l’oasis, sont posées au ras du sol, comme pour couver la vie des hommes et des plantes, en cette petite zone privilégiée, quand tout est sécheresse et désolation aux abords ; elles ont des formes très nettes, et on dirait des nuages échoués, qui seraient tangibles ; leurs contours s’éclairent du même or pâle que les flocons aériens en suspens là-haut près de la lune ; et les tiges des dattiers émergent au-dessus, avec toutes leurs palmes arrangées en bouquets noirs. Ce n’est plus un paysage terrestre, car le sol a disparu ; non, c’est quelque jardin de la fée Morgane, qui a poussé sur un coin du ciel...
Sans y rentrer, nous frôlons Boradjoune, le grand village de l’oasis, dont les maisons blanches sont là, parmi les brumes nacrées et les palmiers sombres. Alors deux voyageurs persans, qui avaient demandé de cheminer avec nous, m’annoncent qu’ils s’arrêtent ici, prennent congé et s’éclipsent. Et mes trois cavaliers, qui s’étaient présentés avec de si beaux saints, où donc sont-ils ? Qui les a vus ? — Personne. Ils ont filé avant la lune levée, pour qu’on ne s’en aperçoive pas. Voici donc ma caravane réduite au plus juste : mon tcharvadar, mes quatre muletiers, mes deux domestiques persans loués à Bouchir, mon fidèle serviteur français et moi-même. J’ai bien une lettre de réquisition pour le chef de Boradjoune, me donnant le droit d’exiger de lui trois autres cavaliers ; mais il doit être couché, car il est onze heures passées et tout le pays semble dormir ; que de temps nous perdrions, pour recruter de fuyans personnages qui, au premier tournant du désert, nous lâcheraient encore ! A la grâce de Dieu, continuons seuls, puisque la pleine l’une nous protège.
Mercredi 18 avril. — Éveillé avant le jour, par des voix d’hommes et de femmes, qui chuchotent tout près et tout bas ; avec mon interprète, ils parlementent discrètement pour demander la permission d’ouvrir le portail et de sortir.
Le village, paraît-il, est enclos de murs et de palissades, presque fortifié, contre les rôdeurs de nuit et contre les fauves. Or, nous étions couchés à l’entrée même, à l’unique entrée, sous le hangar de la porte. Et ces gens, qui nous réveillent à regret, sont des bergers, des bergères : il est l’heure de mener les troupeaux dans les champs, car l’aube est proche.
Aussitôt la permission donnée et le portail ouvert, un vrai torrent de chèvres et de chevreaux noirs, nous frôlant dans le passage étroit, commence de couler entre nous, le long de nos lits ; on entend leurs bêlemens contenus et, sur le sol, le bruit léger de leurs myriades de petits sabots ; ils sentent bon l’étable, l’herbe, les aromates du désert. Et c’est si long, cette sortie, il y en a tant et tant, que je me demande à la fin si je suis halluciné, si je rêve : j’étends le bras pour vérifier si c’est réel, pour toucher au passage les dos, les toisons rudes. Le peuple des ânes et des ânons vient ensuite, nous frôlant de même ; j’en ai cependant la perception moins nette, car voici que je sombre à nouveau dans l’inconscience du sommeil...
Eveillé encore, peut-être une heure après, mais cette fois par une sensation cuisante aux tempes : c’est l’aveuglant soleil, qui a remplacé la lune ; à peine levé, il brûle. Nos mains, nos visages sont déjà noirs de mouches. Et un attroupement de petits bébés, bruns et nus, s’est formé autour de nos lits ; leurs jeunes yeux vifs, très ouverts, nous regardent avec stupeur.
Vite, il faut se lever, chercher un abri, n’importe où se mettre à l’ombre.
Je loue jusqu’au soir une maison, que l’on se hâte de vider pour nous. Murs croulans, en terre battue qui s’émiette sous l’haleine du désert ; troncs de palmier pour solives, feuilles de palmier pour toiture, et porte à claire-voie en nervures de palme.
Des enfans viennent à plusieurs reprises nous y voir, des très petits de cinq ou six ans, tout nus et adorablement jolis ; ils nous font des saints, nous tiennent des discours, et se retirent. Ce sont ceux de la maison, paraît-il, qui se considèrent comme un peu chez eux. Des poules s’obstinent de même à entrer, et nous finissons par le permettre. Au moment de la sieste méridienne, des chèvres entrent aussi pour se mettre à l’ombre, et nous les laissons faire.
Des percées dans le mur servent de fenêtres, par où souffle lin vent comme l’haleine d’un brasier. Elles donnent d’un côté sur l’éblouissant désert ; de l’autre, sur des blés où la moisson est commencée, et sur la muraille Persique, là-bas, qui durant la nuit a sensiblement monté dans le ciel. Après la longue marche nocturne, ou voudrait dormir, dans ce silence de midi et cette universelle torpeur. Mais les mauvaises mouches sont là, innombrables ; dès qu’on s’immobilise, on en est couvert, an en est tout noir ; coûte que coûte, il faut se remuer, agiter des éventails.
A l’heure où commence à s’allonger l’ombre des maisonnettes de terre, nous sortons pour nous asseoir devant notre porte. Et chez tous les voisins, on fait de même ; la vie reprend son cours dans cet humble village de pasteurs ; des hommes aiguisent des faucilles ; des femmes, assises sur des nattes, tissent la laine de leurs moutons ; — les yeux très peints, elles sont presque toutes jolies, ces filles de l’oasis, avec le fin profil et les lignes pures des races de l’Iran.
Sur un cheval ruisselant de sueur, arrive un beau grand jeune homme ; les petits enfans de notre maison, qui lui ressemblent de visage, accourent à sa rencontre, en lui apportant de l’eau fraîche, et il les embrasse ; c’est leur frère, le fils aîné de la famille.
Maintenant voici venir un vieillard à chevelure blanche, qui se dirige vers moi, et devant lequel chacun s’incline ; pour le faire asseoir, on se hâte d’étendre par terre le plus beau tapis du quartier ; les femmes, par respect, se retirent avec de profonds saints, et des personnages, à long fusil, à longue moustache, qui l’accompagnaient, forment cercle farouche alentour : il est le chef de l’oasis ; c’est à lui que j’avais envoyé ma lettre de réquisition, pour avoir une escorte la nuit prochaine, et il vient me dire qu’il me fournira trois cavaliers avant l’instant du Moghreb.
Sept heures du soir, le limpide crépuscule, l’heure où j’avais décidé de partir. Malgré de longues discussions avec mon tcharvadar, qui a réussi à m’imposer une mule et un muletier de plus, tout serait prêt, ou peu s’en faut ; mais les trois cavaliers promis manquent à l’appel, je les ai envoyé chercher et mes émissaires ne reviennent plus. Comme hier, il sera nuit noire quand nous nous mettrons en route.
Huit heures bientôt. Nous attendons toujours. Tant pis pour ces trois cavaliers ! Je me passerai d’escorte ; qu’on m’amène mon cheval, et partons !... Mais cette petite place du village, où l’on n’y voit plus, et qui est déjà encombrée de tous mes gens, de toutes mes bêtes, est brusquement envahie par le flot noir des troupeaux, qui rentrent en bêlant ; la poussée inoffensive et joyeuse d’un millier de moutons, de chèvres ou de cabris nous sépare les uns des autres, nous met en complète déroute, il en passe entre nos jambes, il en passe sous le ventre de nos mules, il s’en faufile partout, il en arrive toujours...
Et quand c’est fini, quand la place est dégagée et le bétail couché, voici bien une autre aventure : où donc est mon cheval ? Pendant la bagarre des chèvres, l’homme qui le tenait l’a lâché ; la porte du village était ouverte et il s’est évadé ; avec sa selle sur le dos, sa bride sur le cou, il a pris le galop, vers les sables libres... Dix hommes s’élancent à sa poursuite, lâchant toutes nos autres bêtes qui aussitôt commencent à se mêler et à faire le diable. Nous ne partirons jamais...
Huit heures passées. Enfin on ramène le fugitif très agité et d’humeur impatiente. Et nous sortons du village, baissant la tête pour les solives, sous ce hangar de la porte où nous avions dormi la nuit dernière.
D’abord les grands dattiers, autour de nous, découpent de tous côtés leurs plumes noires sur le ciel plein d’étoiles. Mais, bientôt, ils sont plus clairsemés ; les vastes plaines nous montrent à nouveau leur cercle vide. Comme nous allions sortir de l’oasis, trois cavaliers en armes se présentent devant moi et me saluent ; mes trois gardes, dont j’avais fait mon deuil ; mêmes silhouettes que ceux d’hier, belles tournures, hauts bonnets et longues moustaches. Et, après un gué que nous passons à la débandade, ma caravane se reforme, au complet et à peu près en ligne, dans l’espace illimité, dans le vague désert nocturne.
Il est plus inhospitalier encore que celui de la veille, l’âpre désert de cette fois ; le sol y est mauvais, n’inspire plus de confiance ; des pierres sournoises et coupantes font trébucher nos bêtes. Et la lune, hélas ! n’est pas près de se lever. Parmi les étoiles lointaines, Vénus seule, très brillante et argentine, nous verse un peu de lumière.
Après deux heures et demie de marche, autre oasis, beaucoup plus grande, plus touffue que celle d’hier. Nous la longeons sans y pénétrer, mais une fraîcheur exquise nous vient, dans le voisinage de tous ces palmiers sous lesquels on entend courir des ruisseaux.
Onze heures. Enfin, derrière la montagne là-bas, — toujours cette même montagne dont chaque heure nous rapproche et qui est le rebord, l’immense falaise de l’Iran, — derrière la montagne, une clarté annonce l’entrée en scène de la lune, amie des caravanes. Elle se lève, pure et belle, jetant la lumière à flots, et nous révélant des vapeurs que nous n’avions pas vues. Non plus de ces voiles de sable et de poussière, comme les jours précédens, mais de vraies et précieuses vapeurs d’eau qui, sur toute l’oasis, sont posées au ras du sol, comme pour couver la vie des hommes et des plantes, en cette petite zone privilégiée, quand tout est sécheresse et désolation aux abords ; elles ont des formes très nettes, et on dirait des nuages échoués, qui seraient tangibles ; leurs contours s’éclairent du même or pâle que les flocons aériens en suspens là-haut près de la lune ; et les tiges des dattiers émergent au-dessus, avec toutes leurs palmes arrangées en bouquets noirs. Ce n’est plus un paysage terrestre, car le sol a disparu ; non, c’est quelque jardin de la fée Morgane, qui a poussé sur un coin du ciel...
Sans y rentrer, nous frôlons Boradjoune, le grand village de l’oasis, dont les maisons blanches sont là, parmi les brumes nacrées et les palmiers sombres. Alors deux voyageurs persans, qui avaient demandé de cheminer avec nous, m’annoncent qu’ils s’arrêtent ici, prennent congé et s’éclipsent. Et mes trois cavaliers, qui s’étaient présentés avec de si beaux saints, où donc sont-ils ? Qui les a vus ? — Personne. Ils ont filé avant la lune levée, pour qu’on ne s’en aperçoive pas. Voici donc ma caravane réduite au plus juste : mon tcharvadar, mes quatre muletiers, mes deux domestiques persans loués à Bouchir, mon fidèle serviteur français et moi-même. J’ai bien une lettre de réquisition pour le chef de Boradjoune, me donnant le droit d’exiger de lui trois autres cavaliers ; mais il doit être couché, car il est onze heures passées et tout le pays semble dormir ; que de temps nous perdrions, pour recruter de fuyans personnages qui, au premier tournant du désert, nous lâcheraient encore ! A la grâce de Dieu, continuons seuls, puisque la pleine l’une nous protège.
2
EN ROUTE
Mardi 17 avril. — En désordre par terre, notre déballage de nomades s’étale, mouillé d’embruns et piteux à voir, au crépuscule. Beaucoup de vent sous des nuages en voûte sombre ; les lointains des plaines de sable, où il faudra s’enfoncer tout à l’heure à la grâce de Dieu, se détachent en clair sur l’horizon ; le désert est moins obscur que le ciel.
Une grande barque à voile, que nous avions frétée à Bender-Bouchir, vient de nous jeter ici, au seuil des solitudes, sur la rive brûlante de ce Golfe Persique, où l’air empli de fièvre est à peine respirable pour les hommes de nos climats. Et c’est le point où se forment d’habitude les caravanes qui doivent remonter vers Chiraz et la Perse centrale.
Nous étions partis de l’Inde, il y a environ trois semaines, sur un navire qui nous a lentement amenés, le long de la côte, en se traînant sur les eaux lourdes et chaudes. Et depuis plusieurs jours nous avons commencé de voir, à l’horizon du Nord, une sorte de muraille mondiale, tantôt bleue, tantôt rose, qui semblait nous suivre, et qui est là, ce soir encore, dressée devant nous : le rebord de cette Perse, but de notre voyage, qui gît à deux ou trois mille mètres d’altitude, sur les immenses plateaux d’Asie.
Le premier accueil nous a été rude sur la terre persane : comme nous arrivions de Bombay, où sévit la peste, il a fallu faire six jours de quarantaine, mon serviteur français et moi, seuls sur un îlot de marécage, où une barque nous apportait chaque soir de quoi ne pas mourir de faim. Dans une chaleur d’étuve, au milieu de tourmentes de sable chaud que nous envoyait l’Arabie voisine, au milieu d’orages aux aspects apocalyptiques, nous avons là souffert longuement, accablés dans le jour par le soleil, couverts de taons et de mauvaises mouches ; la nuit, en proie à d’innommables vermines dont l’herbe était infestée.
Admis enfin à Bender-Bouchir, ville de tristesse et de mort s’il en fut, groupe de masures croulantes sous un ciel maudit, nous avons fait en hâte nos apprêts, acheté des objets de campement, et loué des chevaux, des mules, des muletiers, qui ont dû partir ce matin pour nous rejoindre en contournant une baie, tandis que nous coupions par mer en ligne droite, afin d’éviter une marche sous le soleil mortel.
Donc, nous voici déposés à l’entrée de ce désert, en face d’un semblant de village en ruines, où des gens vêtus de haillons s’asseyent sur des pans de murailles, pour fumer en nous observant.
Longs pourparlers avec nos bateliers demi-nus, — qui nous ont apportés à terre sur leurs épaules ruisselantes, car la barque a dû rester à cent mètres de la rive, à cause des bancs de sable. Longs pourparlers avec le chef du lieu, qui a reçu du gouverneur de Bouchir l’ordre de me donner des cavaliers d’escorte, et ensuite avec mon « tcharvadar » (mon chef de caravane), dont les chevaux et les mules devraient être là, mais n’arrivent pas.
De tous côtés, c’est l’étendue agitée par le vent, l’étendue du désert ou de la mer. Et nous sommes sans abri, nos bagages épars. Et le jour achève de s’éteindre, sur notre désarroi.
Quelques gouttes de pluie. Mais, dans ce pays, on n’y prend pas garde ; on sait qu’il ne pleuvra pas, qu’il ne peut pas pleuvoir. Les gens qui s’étaient assis à fumer dans les ruines viennent de faire leur prière du Moghreb, et la nuit tombe, sinistre.
Nous attendons nos bêtes, qui continuent de ne pas venir. Dans l’obscurité, de temps à autre, des clochettes s’approchent en carillon, chaque fois nous donnant espoir. Mais non, c’est quelque caravane étrangère qui passe ; par vingt ou trente, les mules défilent près de nous ; pour les empêcher de piétiner nos bagages et nous-mêmes, nos gens crient, — et tout de suite elles disparaissent, vers le ténébreux lointain. (Nous sommes ici à l’entrée de la route de Bouchir à Ispahan, l’une des grandes routes de la Perse, et ce petit port en ruines est un passage très fréquenté.)
Enfin elles arrivent, les nôtres, avec force clochettes aussi.
Nuit de plus en plus épaisse, sous un ciel bas et tourmenté. Tout est par terre, jeté pêle-mêle ; les bêtes font des sauts, des ruades, — et l’heure s’avance, nous devrions être en route. Dans les cauchemars du sommeil, on a passé quelquefois par de tels embarras insolubles, on a connu de ces fouillis indébrouillables, au milieu de ténèbres croissantes. Vraiment cela semble impossible que tant de choses quelconques, armes, couvertures, vaisselle, achetées en hâte à Bouchir et non emballées, gisant à même le sable, puissent, avec la nuit qu’il fait, s’arranger bientôt sur ces mules à sonnettes et s’enfoncer, à la file derrière nous, dans le noir désert.
Cependant on commence la besogne, en s’interrompant de temps à autre pour dire des prières. Enfermer les objets dans de grands sacs de caravane en laine bariolée ; ficeler, corder, soupeser ; équilibrer la charge de chaque bête,... cela se fait à la lueur de deux petites lanternes, lamentables au milieu de la tourmente obscure. Pas une étoile ; pas une trouée là-haut, par où le moindre rayon tombe. Les rafales, avec un bruit gémissant, soulèvent le sable en tourbillons. Et tout le temps, à la cantonade, des sonneries de grelots et de clochettes : caravanes inconnues qui passent.
Maintenant le chef du village vient me présenter les trois soldats qui, avec mes domestiques et mes muletiers, constitueront ma garde cette nuit. Toujours les deux mêmes petites lanternes, que l’on a posées par terre et qui attirent les sauterelles, me les éclairent vaguement par en dessous, ces nouveaux venus : hauts bonnets noirs sur de fins visages ; longs cheveux et longues moustaches, grandes robes serrées à la taille, et mancherons qui pendent comme des ailes...
Enfin la lune, amie des nomades, vient débrouiller le chaos noir. Dans une déchirure soudaine, au ras de l’horizon, elle surgit énorme et rouge, du même coup révélant des eaux encore proches, sur lesquelles son reflet s’allonge en nappe sanglante (un coin du Golfe Persique), et des montagnes, là-bas, qu’elle découpe en silhouette (cette grande chaîne qu’il nous faudra commencer de gravir demain). Sa lueur bienfaisante s’épand sur le désert, mettant fin à ces impossibilités de cauchemar, nous délivrant de la confusion inextricable ; nous indiquant les uns aux autres, personnages dessinés en noirâtre sur des sables clairs ; et surtout nous isolant, nous, groupes destinés à une même caravane, des autres groupes indifférens ou pillards qui stationnaient çà et là, et dont la présence nous inquiétait alentour..
EN ROUTE
Mardi 17 avril. — En désordre par terre, notre déballage de nomades s’étale, mouillé d’embruns et piteux à voir, au crépuscule. Beaucoup de vent sous des nuages en voûte sombre ; les lointains des plaines de sable, où il faudra s’enfoncer tout à l’heure à la grâce de Dieu, se détachent en clair sur l’horizon ; le désert est moins obscur que le ciel.
Une grande barque à voile, que nous avions frétée à Bender-Bouchir, vient de nous jeter ici, au seuil des solitudes, sur la rive brûlante de ce Golfe Persique, où l’air empli de fièvre est à peine respirable pour les hommes de nos climats. Et c’est le point où se forment d’habitude les caravanes qui doivent remonter vers Chiraz et la Perse centrale.
Nous étions partis de l’Inde, il y a environ trois semaines, sur un navire qui nous a lentement amenés, le long de la côte, en se traînant sur les eaux lourdes et chaudes. Et depuis plusieurs jours nous avons commencé de voir, à l’horizon du Nord, une sorte de muraille mondiale, tantôt bleue, tantôt rose, qui semblait nous suivre, et qui est là, ce soir encore, dressée devant nous : le rebord de cette Perse, but de notre voyage, qui gît à deux ou trois mille mètres d’altitude, sur les immenses plateaux d’Asie.
Le premier accueil nous a été rude sur la terre persane : comme nous arrivions de Bombay, où sévit la peste, il a fallu faire six jours de quarantaine, mon serviteur français et moi, seuls sur un îlot de marécage, où une barque nous apportait chaque soir de quoi ne pas mourir de faim. Dans une chaleur d’étuve, au milieu de tourmentes de sable chaud que nous envoyait l’Arabie voisine, au milieu d’orages aux aspects apocalyptiques, nous avons là souffert longuement, accablés dans le jour par le soleil, couverts de taons et de mauvaises mouches ; la nuit, en proie à d’innommables vermines dont l’herbe était infestée.
Admis enfin à Bender-Bouchir, ville de tristesse et de mort s’il en fut, groupe de masures croulantes sous un ciel maudit, nous avons fait en hâte nos apprêts, acheté des objets de campement, et loué des chevaux, des mules, des muletiers, qui ont dû partir ce matin pour nous rejoindre en contournant une baie, tandis que nous coupions par mer en ligne droite, afin d’éviter une marche sous le soleil mortel.
Donc, nous voici déposés à l’entrée de ce désert, en face d’un semblant de village en ruines, où des gens vêtus de haillons s’asseyent sur des pans de murailles, pour fumer en nous observant.
Longs pourparlers avec nos bateliers demi-nus, — qui nous ont apportés à terre sur leurs épaules ruisselantes, car la barque a dû rester à cent mètres de la rive, à cause des bancs de sable. Longs pourparlers avec le chef du lieu, qui a reçu du gouverneur de Bouchir l’ordre de me donner des cavaliers d’escorte, et ensuite avec mon « tcharvadar » (mon chef de caravane), dont les chevaux et les mules devraient être là, mais n’arrivent pas.
De tous côtés, c’est l’étendue agitée par le vent, l’étendue du désert ou de la mer. Et nous sommes sans abri, nos bagages épars. Et le jour achève de s’éteindre, sur notre désarroi.
Quelques gouttes de pluie. Mais, dans ce pays, on n’y prend pas garde ; on sait qu’il ne pleuvra pas, qu’il ne peut pas pleuvoir. Les gens qui s’étaient assis à fumer dans les ruines viennent de faire leur prière du Moghreb, et la nuit tombe, sinistre.
Nous attendons nos bêtes, qui continuent de ne pas venir. Dans l’obscurité, de temps à autre, des clochettes s’approchent en carillon, chaque fois nous donnant espoir. Mais non, c’est quelque caravane étrangère qui passe ; par vingt ou trente, les mules défilent près de nous ; pour les empêcher de piétiner nos bagages et nous-mêmes, nos gens crient, — et tout de suite elles disparaissent, vers le ténébreux lointain. (Nous sommes ici à l’entrée de la route de Bouchir à Ispahan, l’une des grandes routes de la Perse, et ce petit port en ruines est un passage très fréquenté.)
Enfin elles arrivent, les nôtres, avec force clochettes aussi.
Nuit de plus en plus épaisse, sous un ciel bas et tourmenté. Tout est par terre, jeté pêle-mêle ; les bêtes font des sauts, des ruades, — et l’heure s’avance, nous devrions être en route. Dans les cauchemars du sommeil, on a passé quelquefois par de tels embarras insolubles, on a connu de ces fouillis indébrouillables, au milieu de ténèbres croissantes. Vraiment cela semble impossible que tant de choses quelconques, armes, couvertures, vaisselle, achetées en hâte à Bouchir et non emballées, gisant à même le sable, puissent, avec la nuit qu’il fait, s’arranger bientôt sur ces mules à sonnettes et s’enfoncer, à la file derrière nous, dans le noir désert.
Cependant on commence la besogne, en s’interrompant de temps à autre pour dire des prières. Enfermer les objets dans de grands sacs de caravane en laine bariolée ; ficeler, corder, soupeser ; équilibrer la charge de chaque bête,... cela se fait à la lueur de deux petites lanternes, lamentables au milieu de la tourmente obscure. Pas une étoile ; pas une trouée là-haut, par où le moindre rayon tombe. Les rafales, avec un bruit gémissant, soulèvent le sable en tourbillons. Et tout le temps, à la cantonade, des sonneries de grelots et de clochettes : caravanes inconnues qui passent.
Maintenant le chef du village vient me présenter les trois soldats qui, avec mes domestiques et mes muletiers, constitueront ma garde cette nuit. Toujours les deux mêmes petites lanternes, que l’on a posées par terre et qui attirent les sauterelles, me les éclairent vaguement par en dessous, ces nouveaux venus : hauts bonnets noirs sur de fins visages ; longs cheveux et longues moustaches, grandes robes serrées à la taille, et mancherons qui pendent comme des ailes...
Enfin la lune, amie des nomades, vient débrouiller le chaos noir. Dans une déchirure soudaine, au ras de l’horizon, elle surgit énorme et rouge, du même coup révélant des eaux encore proches, sur lesquelles son reflet s’allonge en nappe sanglante (un coin du Golfe Persique), et des montagnes, là-bas, qu’elle découpe en silhouette (cette grande chaîne qu’il nous faudra commencer de gravir demain). Sa lueur bienfaisante s’épand sur le désert, mettant fin à ces impossibilités de cauchemar, nous délivrant de la confusion inextricable ; nous indiquant les uns aux autres, personnages dessinés en noirâtre sur des sables clairs ; et surtout nous isolant, nous, groupes destinés à une même caravane, des autres groupes indifférens ou pillards qui stationnaient çà et là, et dont la présence nous inquiétait alentour..
VERS ISPAHAN
PREMIERE PARTIE
PRÉLUDE
Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses, prenne son parti de cheminer lentement à mes côtés, par étapes, ainsi qu’au moyen âge.
Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses, consente au danger des chevauchées par les sentiers mauvais où les bêtes tombent, et à la promiscuité des caravansérails où l’on dort entassés dans une niche de terre battue, parmi les mouches et la vermine.
Qui veut venir avec moi voir apparaître, dans sa triste oasis, au milieu de ses champs de pavots blancs et de ses jardins de roses roses, la vieille ville de ruines et de mystère, avec tous ses dômes bleus, tous ses minarets bleus d’un inaltérable émail ; qui veut venir avec moi voir Ispahan sous le beau ciel de mai, se prépare à de longues marches, au brûlant soleil, dans le vent âpre et froid des altitudes extrêmes, à travers ces plateaux d’Asie, les plus élevés et les plus vastes du monde, qui furent le berceau des humanités, mais sont devenus aujourd’hui des déserts.
Nous passerons devant des fantômes de palais, tout en un silex couleur de souris, dont le grain est plus durable et plus fin que celui des marbres. Là, jadis, habitaient les maîtres de la Terre, et, aux abords, veillent depuis plus de deux mille ans des colosses à grandes ailes, qui ont la forme d’un taureau, le visage d’un homme et la tiare d’un roi. Nous passerons, mais, alentour, il n’y aura rien, que le silence infini des foins en fleur et des orges vertes.
Qui veut venir avec moi voir la saison des roses à Ispahan, s’attende à d’interminables plaines, aussi haut montées que les sommets des Alpes, tapissées d’herbes rases et d’étranges fleurettes pâles, où à peine de loin en loin surgira quelque village en terre d’un gris tourterelle, avec sa petite mosquée croulante, au dôme plus adorablement bleu qu’une turquoise ; qui veut me suivre, se résigne à beaucoup de jours passés dans les solitudes, dans la monotonie et les mirages...
PREMIERE PARTIE
PRÉLUDE
Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses, prenne son parti de cheminer lentement à mes côtés, par étapes, ainsi qu’au moyen âge.
Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses, consente au danger des chevauchées par les sentiers mauvais où les bêtes tombent, et à la promiscuité des caravansérails où l’on dort entassés dans une niche de terre battue, parmi les mouches et la vermine.
Qui veut venir avec moi voir apparaître, dans sa triste oasis, au milieu de ses champs de pavots blancs et de ses jardins de roses roses, la vieille ville de ruines et de mystère, avec tous ses dômes bleus, tous ses minarets bleus d’un inaltérable émail ; qui veut venir avec moi voir Ispahan sous le beau ciel de mai, se prépare à de longues marches, au brûlant soleil, dans le vent âpre et froid des altitudes extrêmes, à travers ces plateaux d’Asie, les plus élevés et les plus vastes du monde, qui furent le berceau des humanités, mais sont devenus aujourd’hui des déserts.
Nous passerons devant des fantômes de palais, tout en un silex couleur de souris, dont le grain est plus durable et plus fin que celui des marbres. Là, jadis, habitaient les maîtres de la Terre, et, aux abords, veillent depuis plus de deux mille ans des colosses à grandes ailes, qui ont la forme d’un taureau, le visage d’un homme et la tiare d’un roi. Nous passerons, mais, alentour, il n’y aura rien, que le silence infini des foins en fleur et des orges vertes.
Qui veut venir avec moi voir la saison des roses à Ispahan, s’attende à d’interminables plaines, aussi haut montées que les sommets des Alpes, tapissées d’herbes rases et d’étranges fleurettes pâles, où à peine de loin en loin surgira quelque village en terre d’un gris tourterelle, avec sa petite mosquée croulante, au dôme plus adorablement bleu qu’une turquoise ; qui veut me suivre, se résigne à beaucoup de jours passés dans les solitudes, dans la monotonie et les mirages...
Et derrière nous s’éloigne l’oasis, toute sa fantasmagorie de nuages dorés et de palmes noires. A nouveau, c’est le désert ; — mais un désert de plus en plus affreux, où il y a de quoi perdre courage. Des trous, des ravins, des fondrières ; un pays ondulé, bossue ; un pays de grandes pierres cassées et roulantes, où les sentiers ne font que monter et descendre, où nos bêtes trébuchent à chaque pas. Et sur tout cela qui est blanc, tombe la pleine lumière blanche de la lune.
C’est fini de ce semblant de fraîcheur, qui nous était venu de la verdure et des ruisseaux ; nous retrouvons la torride chaleur sèche, qui même aux environs de minuit ne s’apaise pas.
Nos mules, agacées, ne marchent plus à la file ; les unes s’échappent, disparaissent derrière des rochers ; d’autres, qui s’étaient laissé attarder, s’épeurent de se voir seules, se mettent à courir pour reprendre la tête, et, en passant, vous raclent cruellement les jambes avec leur charge.
Cependant la terrible falaise Persique, toujours devant nous, s’est dédoublée en s’approchant ; elle se détaille, elle nous montre plusieurs étages superposés ; et la première assise, nous allons bientôt l’atteindre.
Plus moyen ici de cheminer tranquille en rêvant, ce qui est le charme des déserts unis et monotones ; dans cet horrible chaos de pierres blanches, où l’on se sent perdu, il faut constamment veiller à son cheval, veiller aux mules, veiller à toutes choses ; — veiller, veiller quand même, alors qu’un irrésistible sommeil commence à vous fermer les yeux. Cela devient une vraie angoisse, de lutter contre cette torpeur soudaine qui vous envahit les bras, vous rend les mains molles pour tenir la bride et vous embrouille les idées. On essaie de tous les moyens, changer de position, allonger les jambes, ou les croiser devant le pommeau, à la manière des Bédouins sur leurs méharis. On essaie de mettre pied à terre, — mais alors les cailloux pointus vous blessent dans cette marche accélérée, et le cheval s’échappe, et on est distancé, au milieu de la grande solitude blanche où à peine se voit-on les uns les autres, parmi ce pêle-mêle de rochers : coûte que coûte, il faut rester en selle...
L’heure de minuit nous trouve au pied même de la chaîne Persique, effroyable à regarder d’en bas et de si près ; muraille droite, d’un brun noir, dont la lune accuse durement les plis, les trous, les cavernes, toute l’immobile et colossale tourmente. De ces amas de roches silencieuses et mortes, nous vient une plus lourde chaleur, qu’elles ont prise au soleil pendant le jour, — ou bien qu’elles tirent du grand feu souterrain où les volcans s’alimentent, car elles sentent le soufre, la fournaise et l’enfer.
Une heure, deux heures, trois heures durant, nous nous traînons au pied de la falaise géante, qui encombre la moitié du ciel au-dessus de nos têtes ; elle continue de se dresser brune et rougeâtre devant ces plaines de pierres blanches ; l’odeur de soufre, d’œuf pourri qu’elle exhale devient odieuse lorsqu’on passe devant ses grandes fissures, devant ses grands trous béans qui ont l’air de plonger jusqu’aux entrailles de la terre. Dans un infini de silence, où semblent se perdre, s’éteindre les piétinemens de notre humble caravane et les longs cris à bouche fermée de nos muletiers, nous nous traînons toujours, par les ravins et les fondrières de ce désert pâle. Il y a çà et là des groupemens de formes noires, dont la lune projette l’ombre sur la blancheur des pierres ; on dirait des bêtes ou des hommes postés pour nous guetter ; mais ce ne sont que des broussailles, lorsqu’on s’approche, des arbustes tordus et rabougris. Il fait chaud comme s’il y avait des brasiers partout ; on étouffe, et on a soif. Parfois on entend bouillonner de l’eau, dans les rochers de l’infernale muraille, et en effet des torrens en jaillissent, qu’il faut passer à gué ; mais c’est une eau tiède, pestilentielle, qui est blanchâtre sous la lune, et qui répand une irrespirable puanteur sulfureuse. — II doit y avoir d’immenses richesses métallurgiques, encore inexploitées et inconnues, dans ces montagnes.
Souvent on se figure distinguer là-bas les palmiers de l’oasis désirée, — qui cette fois s’appellera Daliki, — et où l’on pourra enfin boire et s’étendre. Mais non ; encore les tristes broussailles, et rien d’autre. On est vaincu, on dort en cheminant, on n’a plus le courage de veiller à rien, on s’en remet à l’instinct des bêtes et au hasard...
Cette fois, cependant, nous ne nous trompons pas, c’est bien l’oasis : ces masses sombres ne peuvent être que des rideaux de palmiers ; ces petits carrés blancs, les maisons du village. Et, pour nous affirmer la réalité de ces choses encore lointaines, pour nous chanter l’accueil, voici les aboiemens des chiens de garde, qui ont déjà flairé notre approche, voici l’aubade claire des coqs, dans le grand silence de trois heures du matin.
Bientôt nous sommes dans les petits chemins du village, parmi les tiges des dattiers magnifiques, et devant nous s’ouvre enfin la lourde porte du caravansérail, où nous nous engouffrons pêle-mêle, comme dans un asile délicieux.
C’est fini de ce semblant de fraîcheur, qui nous était venu de la verdure et des ruisseaux ; nous retrouvons la torride chaleur sèche, qui même aux environs de minuit ne s’apaise pas.
Nos mules, agacées, ne marchent plus à la file ; les unes s’échappent, disparaissent derrière des rochers ; d’autres, qui s’étaient laissé attarder, s’épeurent de se voir seules, se mettent à courir pour reprendre la tête, et, en passant, vous raclent cruellement les jambes avec leur charge.
Cependant la terrible falaise Persique, toujours devant nous, s’est dédoublée en s’approchant ; elle se détaille, elle nous montre plusieurs étages superposés ; et la première assise, nous allons bientôt l’atteindre.
Plus moyen ici de cheminer tranquille en rêvant, ce qui est le charme des déserts unis et monotones ; dans cet horrible chaos de pierres blanches, où l’on se sent perdu, il faut constamment veiller à son cheval, veiller aux mules, veiller à toutes choses ; — veiller, veiller quand même, alors qu’un irrésistible sommeil commence à vous fermer les yeux. Cela devient une vraie angoisse, de lutter contre cette torpeur soudaine qui vous envahit les bras, vous rend les mains molles pour tenir la bride et vous embrouille les idées. On essaie de tous les moyens, changer de position, allonger les jambes, ou les croiser devant le pommeau, à la manière des Bédouins sur leurs méharis. On essaie de mettre pied à terre, — mais alors les cailloux pointus vous blessent dans cette marche accélérée, et le cheval s’échappe, et on est distancé, au milieu de la grande solitude blanche où à peine se voit-on les uns les autres, parmi ce pêle-mêle de rochers : coûte que coûte, il faut rester en selle...
L’heure de minuit nous trouve au pied même de la chaîne Persique, effroyable à regarder d’en bas et de si près ; muraille droite, d’un brun noir, dont la lune accuse durement les plis, les trous, les cavernes, toute l’immobile et colossale tourmente. De ces amas de roches silencieuses et mortes, nous vient une plus lourde chaleur, qu’elles ont prise au soleil pendant le jour, — ou bien qu’elles tirent du grand feu souterrain où les volcans s’alimentent, car elles sentent le soufre, la fournaise et l’enfer.
Une heure, deux heures, trois heures durant, nous nous traînons au pied de la falaise géante, qui encombre la moitié du ciel au-dessus de nos têtes ; elle continue de se dresser brune et rougeâtre devant ces plaines de pierres blanches ; l’odeur de soufre, d’œuf pourri qu’elle exhale devient odieuse lorsqu’on passe devant ses grandes fissures, devant ses grands trous béans qui ont l’air de plonger jusqu’aux entrailles de la terre. Dans un infini de silence, où semblent se perdre, s’éteindre les piétinemens de notre humble caravane et les longs cris à bouche fermée de nos muletiers, nous nous traînons toujours, par les ravins et les fondrières de ce désert pâle. Il y a çà et là des groupemens de formes noires, dont la lune projette l’ombre sur la blancheur des pierres ; on dirait des bêtes ou des hommes postés pour nous guetter ; mais ce ne sont que des broussailles, lorsqu’on s’approche, des arbustes tordus et rabougris. Il fait chaud comme s’il y avait des brasiers partout ; on étouffe, et on a soif. Parfois on entend bouillonner de l’eau, dans les rochers de l’infernale muraille, et en effet des torrens en jaillissent, qu’il faut passer à gué ; mais c’est une eau tiède, pestilentielle, qui est blanchâtre sous la lune, et qui répand une irrespirable puanteur sulfureuse. — II doit y avoir d’immenses richesses métallurgiques, encore inexploitées et inconnues, dans ces montagnes.
Souvent on se figure distinguer là-bas les palmiers de l’oasis désirée, — qui cette fois s’appellera Daliki, — et où l’on pourra enfin boire et s’étendre. Mais non ; encore les tristes broussailles, et rien d’autre. On est vaincu, on dort en cheminant, on n’a plus le courage de veiller à rien, on s’en remet à l’instinct des bêtes et au hasard...
Cette fois, cependant, nous ne nous trompons pas, c’est bien l’oasis : ces masses sombres ne peuvent être que des rideaux de palmiers ; ces petits carrés blancs, les maisons du village. Et, pour nous affirmer la réalité de ces choses encore lointaines, pour nous chanter l’accueil, voici les aboiemens des chiens de garde, qui ont déjà flairé notre approche, voici l’aubade claire des coqs, dans le grand silence de trois heures du matin.
Bientôt nous sommes dans les petits chemins du village, parmi les tiges des dattiers magnifiques, et devant nous s’ouvre enfin la lourde porte du caravansérail, où nous nous engouffrons pêle-mêle, comme dans un asile délicieux.
Videos de Pierre Loti (18)
Voir plusAjouter une vidéo
En partenariat avec l'Opéra National de Bordeaux, rencontre avec Alain Quella-Villéger autour de l'oeuvre de Pierre Loti. Entretien avec Christophe Lucet.
Retrouvez les livres : https://www.mollat.com/Recherche/Auteur/0-1303180/quella-villeger-alain
Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat
Retrouvez les livres : https://www.mollat.com/Recherche/Auteur/0-1303180/quella-villeger-alain
Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat
+ Lire la suite
autres livres classés : récit de voyageVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Pierre Loti (130)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le pays des Lotiphiles
Le vrai nom de Pierre Loti était :
Louis Poirier
Henri Beyle
Julien Viaud
Fréderic Louis Sauser
10 questions
49 lecteurs ont répondu
Thème :
Pierre LotiCréer un quiz sur ce livre49 lecteurs ont répondu