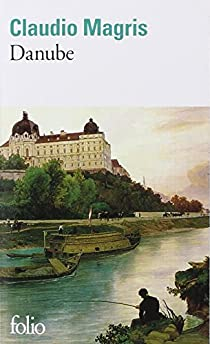>
Critique de NMTB
Patiemment, depuis sa publication, loin des raz-de-marée douteux de l'actualité du livre, le Danube de Claudio Magris creuse son lit de lecteurs. Je ne croyais pas qu'un jour je tiendrais dans mes mains un livre contemporain qui puisse soutenir la comparaison avec Les promenades dans Rome de Stendhal. Et pourtant, le Danube de Magris est de cet acabit. le journal d'un voyage (plus ou moins imaginaire) dans lequel l'auteur, accompagné d'un groupe d'amis ou seul, se permet un grand nombre de digressions sur divers sujets, avec la plus grande liberté, dans le but de donner une image – un instantané en mouvement – de toute une civilisation : la civilisation danubienne ou la Mitteleuropa.
Peut-être n'est-ce qu'une lubie de ma part, car les différences entre l'ouvrage de Stendhal et celui de Magris sont plus visibles que cette commune base de départ. L'attention de ce dernier est davantage portée sur l'Histoire et la politique ; il ne parle quasiment jamais d'art, malgré quelques belles descriptions et une large part du livre dévolue à la littérature. Mais je veux croire que Magris, un Italien passionné par cette culture de l'Europe centrale, s'est en partie inspiré de l'ouvrage de Stendhal, dont il cite le nom à plusieurs reprises parmi une multitude d'autres références. Et c'est un ouvrage savant, car toutes ces références (des plus grandes aux plus modestes, de Musil à un anonyme écolier), sont le reflet d'une admirable culture personnelle, avec laquelle chaque lecteur aura forcément ses affinités et des différends.
Deux ou trois choses ont retenu particulièrement mon attention. D'abord ce livre a été écrit au milieu des années 1980 et il est étonnant de se rendre compte à quel point ce « Danube » qui symbolise « l'écoulement du présent dans le passé », vieux de seulement trente ans, aux préoccupations toutes contemporaines, paraît si proche et si lointain. L'Union européenne n'existait pas, les grandes migrations avaient à peine commencé, la chute de l'Union soviétique et la guerre de Yougoslavie n'avaient pas encore eu lieu. On sent que Magris appelle de ses voeux une véritable union de l'Europe, se lamente des totalitarismes, du repliement sur soi et de l'étouffement des minorités. En ce qui concerne la guerre de Yougoslavie, il est désolant de constater - quand Magris évoque une certaine Mémé Anka, personnage attendrissant et fort mais prise aussi dans le jeu fatal des rivalités ethniques - que les haines étaient très ancrées dans le coeur des Yougoslaves et que la guerre civile semblait déjà couver depuis longtemps. Avec un optimisme, auquel on peut reprocher un trop grand aveuglement sur l'orgueil humain, il écrit au sujet des préjugés haineux : « Derrière ces présupposés absurdes, il y a peut-être une once de vérité, du fait qu'aucun peuple, qu'aucune culture – non plus qu'aucun individu – n'est totalement innocent sur le plan historique ; le fait de se rendre compte impitoyablement des défauts et des obscurités de tous et de soi-même peut-être une fructueuse promesse de convivialité et de tolérance civile ». Et que penser, pour nous qui connaissons l'histoire des années 1990, du grand espoir que représentait aux yeux de Magris la Yougoslavie : « A la ressemblance de celle des Habsbourg, la mosaïque yougoslave est aujourd'hui à la fois imposante et précaire, elle joue un rôle très important dans la politique internationale, et elle se consacre à endiguer et à gommer ses propres poussées destructrices internes ; sa solidité est aussi nécessaire à l'équilibre européen, avec ce qu'aurait de catastrophique son éventuelle désagrégation, que l'était celle de la double monarchie pour le monde d'hier. »
Magris montre une admiration marquée mais lucide vis-à-vis de la maison des Habsbourg. Il admire l'unification des divers peuples maintenue pendant des siècles grâce à cette dynastie, mais se demande si un trop grand repliement sur soi, les peurs d'interactions avec l'étranger ne sont pas une cause de sa décadence. Et il faut quand même évoquer ici Kafka, et son intériorité, qui nous accompagne tout le long de ce voyage ; car de tous les écrivains, il représente le mieux cet esprit danubien, cosmopolite, tiraillé entre recherche d'identité et universalisme supranational. Deux quêtes sans fin, vouées à l'échec, une corde raide tendue au-dessus du gouffre des totalitarismes. Magris se définit lui-même comme « un pathétique épigone de Kafka ».
Les guerres mondiales, les totalitarismes, ont évidemment une place importante dans ce livre, tout comme dans l'Histoire de l'Europe centrale. L'auteur semble en particulier avoir été très influencé par la banalité du mal théorisée par Hannah Arendt, mais plutôt que de banalité il préfère évoquer la bêtise du mal. Il y a certes du mépris dans ce terme, comme toujours lorsqu'on évoque la bêtise, mais je crois que Magris ne tenait pas à rendre ce Mal méprisable ou négligeable. Bien au contraire, la bêtise est lourde, pesante, dévastatrice, sourde et indestructible. Tant qu'il est encore temps, la bêtise du mal ne s'attaque pas de front. Elle s'érode, patiemment. Et en commençant par sa propre bêtise, en lisant ce livre qui a la rare amabilité de considérer son lecteur comme autre chose qu'un vulgaire consommateur d'imbécilités.
Peut-être n'est-ce qu'une lubie de ma part, car les différences entre l'ouvrage de Stendhal et celui de Magris sont plus visibles que cette commune base de départ. L'attention de ce dernier est davantage portée sur l'Histoire et la politique ; il ne parle quasiment jamais d'art, malgré quelques belles descriptions et une large part du livre dévolue à la littérature. Mais je veux croire que Magris, un Italien passionné par cette culture de l'Europe centrale, s'est en partie inspiré de l'ouvrage de Stendhal, dont il cite le nom à plusieurs reprises parmi une multitude d'autres références. Et c'est un ouvrage savant, car toutes ces références (des plus grandes aux plus modestes, de Musil à un anonyme écolier), sont le reflet d'une admirable culture personnelle, avec laquelle chaque lecteur aura forcément ses affinités et des différends.
Deux ou trois choses ont retenu particulièrement mon attention. D'abord ce livre a été écrit au milieu des années 1980 et il est étonnant de se rendre compte à quel point ce « Danube » qui symbolise « l'écoulement du présent dans le passé », vieux de seulement trente ans, aux préoccupations toutes contemporaines, paraît si proche et si lointain. L'Union européenne n'existait pas, les grandes migrations avaient à peine commencé, la chute de l'Union soviétique et la guerre de Yougoslavie n'avaient pas encore eu lieu. On sent que Magris appelle de ses voeux une véritable union de l'Europe, se lamente des totalitarismes, du repliement sur soi et de l'étouffement des minorités. En ce qui concerne la guerre de Yougoslavie, il est désolant de constater - quand Magris évoque une certaine Mémé Anka, personnage attendrissant et fort mais prise aussi dans le jeu fatal des rivalités ethniques - que les haines étaient très ancrées dans le coeur des Yougoslaves et que la guerre civile semblait déjà couver depuis longtemps. Avec un optimisme, auquel on peut reprocher un trop grand aveuglement sur l'orgueil humain, il écrit au sujet des préjugés haineux : « Derrière ces présupposés absurdes, il y a peut-être une once de vérité, du fait qu'aucun peuple, qu'aucune culture – non plus qu'aucun individu – n'est totalement innocent sur le plan historique ; le fait de se rendre compte impitoyablement des défauts et des obscurités de tous et de soi-même peut-être une fructueuse promesse de convivialité et de tolérance civile ». Et que penser, pour nous qui connaissons l'histoire des années 1990, du grand espoir que représentait aux yeux de Magris la Yougoslavie : « A la ressemblance de celle des Habsbourg, la mosaïque yougoslave est aujourd'hui à la fois imposante et précaire, elle joue un rôle très important dans la politique internationale, et elle se consacre à endiguer et à gommer ses propres poussées destructrices internes ; sa solidité est aussi nécessaire à l'équilibre européen, avec ce qu'aurait de catastrophique son éventuelle désagrégation, que l'était celle de la double monarchie pour le monde d'hier. »
Magris montre une admiration marquée mais lucide vis-à-vis de la maison des Habsbourg. Il admire l'unification des divers peuples maintenue pendant des siècles grâce à cette dynastie, mais se demande si un trop grand repliement sur soi, les peurs d'interactions avec l'étranger ne sont pas une cause de sa décadence. Et il faut quand même évoquer ici Kafka, et son intériorité, qui nous accompagne tout le long de ce voyage ; car de tous les écrivains, il représente le mieux cet esprit danubien, cosmopolite, tiraillé entre recherche d'identité et universalisme supranational. Deux quêtes sans fin, vouées à l'échec, une corde raide tendue au-dessus du gouffre des totalitarismes. Magris se définit lui-même comme « un pathétique épigone de Kafka ».
Les guerres mondiales, les totalitarismes, ont évidemment une place importante dans ce livre, tout comme dans l'Histoire de l'Europe centrale. L'auteur semble en particulier avoir été très influencé par la banalité du mal théorisée par Hannah Arendt, mais plutôt que de banalité il préfère évoquer la bêtise du mal. Il y a certes du mépris dans ce terme, comme toujours lorsqu'on évoque la bêtise, mais je crois que Magris ne tenait pas à rendre ce Mal méprisable ou négligeable. Bien au contraire, la bêtise est lourde, pesante, dévastatrice, sourde et indestructible. Tant qu'il est encore temps, la bêtise du mal ne s'attaque pas de front. Elle s'érode, patiemment. Et en commençant par sa propre bêtise, en lisant ce livre qui a la rare amabilité de considérer son lecteur comme autre chose qu'un vulgaire consommateur d'imbécilités.