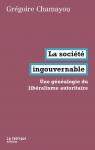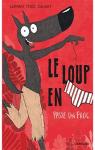Groupe Marcuse/5
10 notes
La publicité ne cesse d'étendre son empire. Nous sommes chaque jour soumis à plus de sept mille messages publicitaires. Jusqu'où ira ce bombardement ? En France, plus de vingt milliards d'euros sont investis par an en publicité - trente fois plus que le budget du ministère de l'Environnement ! Qu'y a-t-il là de si décisif pour qu'on y consacre tant d'argent, de talent et d'énergie ? C'est que la croissance est ... >Voir plus
Résumé :
La publicité ne cesse d'étendre son empire. Nous sommes chaque jour soumis à plus de sept mille messages publicitaires. Jusqu'où ira ce bombardement ? En France, plus de vingt milliards d'euros sont investis par an en publicité - trente fois plus que le budget du ministère de l'Environnement ! Qu'y a-t-il là de si décisif pour qu'on y consacre tant d'argent, de talent et d'énergie ? C'est que la croissance est ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après De la misère humaine en milieu publicitaire : Comment le monde se meurt de notre mode de vieVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
Tout le monde aura certainement remarqué que c'est d'une manière de plus en plus pressante que le discours marchand (la publicité) cherche à s'imposer sur internet; et la question n'est plus désormais de savoir si cela nous convient mais comment l'on va nous contraindre à l'accepter. L'avenir du Web : bouffer de la pub ! Et c'est notre propre activité qui va lui servir de support. Amusant de penser que certains ne comprennent toujours pas ce que peut bien être la domination dans cette société où nous vivons.
Analyse exhaustive et sans concessions du système publicitaire et, au delà, du modèle de société qu'il sous tend et contribue à promouvoir. Essai accessible, brillant.
Citations et extraits (1)
Ajouter une citation
Pour rester efficace, la publicité doit donc transgresser les normes et dépasser perpétuellement les limites qu'elle avait atteintes. Seuls l'ignorent ceux qui ont l'impression de renaître chaque matin dans un monde nouveau. En 1952, l'"histoire choquante de la publicité" avait déjà été écrite. Et dès 1883, Zola dénonçait dans "Au Bonheur des dames" le matraquage des grands magasins, l'"envahissement définitif des journaux, des murs, des oreilles du public" par le "vacarme des grandes mises en ventes".
Lire un extrait
autres livres classés : société de consommationVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Groupe Marcuse (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philosophes au cinéma
Ce film réalisé par Derek Jarman en 1993 retrace la vie d'un philosophe autrichien né à Vienne en 1889 et mort à Cambridge en 1951. Quel est son nom?
Ludwig Wittgenstein
Stephen Zweig
Martin Heidegger
8 questions
154 lecteurs ont répondu
Thèmes :
philosophie
, philosophes
, sociologie
, culture générale
, cinema
, adapté au cinéma
, adaptation
, littératureCréer un quiz sur ce livre154 lecteurs ont répondu