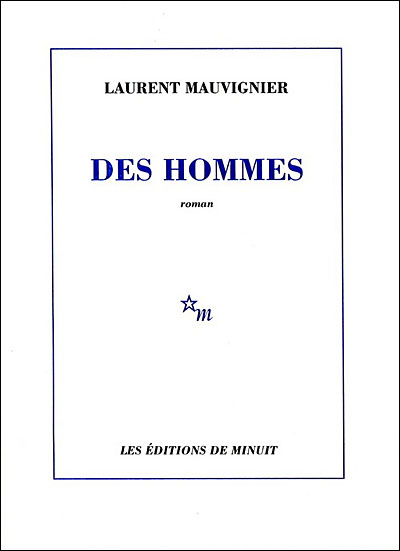Critiques filtrées sur 5 étoiles
Laurent Mauvignier ne nous laisse pas le temps de nous préparer. Il nous pousse directement dans l'insensé, dans l'indicible et pourtant quels mots! Quelle claque! Il nous place d'emblée dans le drame, trop tard pour reculer,c'est déjà fait, puisque nous commençons la lecture par une phrase dont le début nous manque Cette phrase ne nous laisse pas de répit puisqu'elle nous tient jusqu'à la fin, jusqu'au point final, le seul. Chronique d'une mort annoncée, pour rien "quelle honte de mourir pour si peu". On pourrait dire que cet homme est mort sous la violence des coups de vigiles parce qu'il buvait une canette dans le magasin, ou parce qu'il avait un sweat-shirt jaune,ou une sale tête . On pourrait aussi dire qu'il est mort parce que la violence une fois enclenchée était jouissive pour les vigiles. On pourrait tout aussi bien dire qu' il est mort pour rien...
Le narrateur s'adresse au frère de cet homme. Veut-il le consoler? Lui donner une raison de vivre pour poursuivre la vie qui a été volée à son grand frère ?
A partir d'un fait divers réellement survenu à Lyon en 2009, L.Mauvugnier réussit l'exploit incroyable de dénoncer la plus brutale et la plus gratuite des violences par un texte très proche de la poésie. Un petit chef d'oeuvre en une seule phrase,un seul souffle qui s'éteint à la soixantième page...
Le narrateur s'adresse au frère de cet homme. Veut-il le consoler? Lui donner une raison de vivre pour poursuivre la vie qui a été volée à son grand frère ?
A partir d'un fait divers réellement survenu à Lyon en 2009, L.Mauvugnier réussit l'exploit incroyable de dénoncer la plus brutale et la plus gratuite des violences par un texte très proche de la poésie. Un petit chef d'oeuvre en une seule phrase,un seul souffle qui s'éteint à la soixantième page...
Un fait divers sordide qui eu lieu en 2009 dans la réserve d un centre commercial lyonnais. Quatre vigiles ont tabassé à mort un jeune homme de vingt- cinq ans parce qu il avait bu une bière dans les allées du supermarché sans passer par la caisse.
Cet homme comprend très vite qu il va passer un sale moment lorsque les vigiles l emmènent loin des yeux et des oreilles de tous témoins.
Nez cassé, foie éclaté, poumons perforés, l'homme est mort étouffé, écrasé par le poids, l'indifférentes et le mépris de quatre agents de sécurité. Battu à mort pour une canette, des hommes ont tué leur frère.
Une porte, une séparation de caoutchouc opaque, un tapis de canette de bière.Un jeune homme face à nous, nous interpelle et nous raconte les dernières heures d un condamné à mort.
"la vie va tenir, encore, ils vont cesser parce qu'ils vont comprendre que ma vie est trop petite dans mon corps et qu'elle s'amenuise trop maintenant pour durer plus qu'une bulle de savon qui monte et éclate, oui, jusqu'au bout l'espoir lui aura fait mal, jusqu'au dernier moment, la réception, et jusqu'au dernier moment il ne peut pas croire qu'il va laisser sans lui les gens qu'il aime, il y en a quelques-uns à qui il a tenu si fort, comme toi"
Un texte puissant, d'après un texte de Laurent Mauvignier qui livre un monologue puissant écrit d'une seule phrase00
Les mots, comme un staccato Un texte dense comme en apnée. de littérature comme un uppercut à l'estomac,
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Souvent les textes de Laurent Mauvignier se sont vus qualifiés d'« écriture de l'évènement », surtout parce qu'ils entretiennent généralement un lien privilégié avec un certain nombre de faits divers, que l'on songe à la tragédie du Heyssel qui a donné lieu à Dans la Foule, ou encore à ce drame de la Part-Dieu durant lequel un sans abri se fit rouer de coup par des vigiles, jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour avoir volé une canette dans le centre commercial, et que reprend librement Ce que j'appelle oubli.
Cette dernière fiction – le terme est important – peut ainsi se lire comme la reconstitution de la scène terrible qu'a vécu cet homme dont jamais l'on ne saura le nom, jusqu'à ce moment où « il ne lui restera plus que la nudité et la froidure sur un matelas de fer ou d'Inox, et aussi, attachée à un doigt de pied, une étiquette avec son nom, un numéro » (p. 17). Il ne s'agit alors pas tant de dire cette mort que de la donner à vivre, que de nous la faire éprouver, par une plongée dans le coeur même du processus de mise à mort, dans toute la tension que cela suppose et qui se trouve restituée par le déploiement dans tout le corps du texte d'une unique phrase, qui nous tient en haleine. Toutefois, l'orientation donnée au récit, qui veut que soit accordée aux perceptions et sensations une place de première importance, donne à penser que ce n'est pas tant la mort elle-même qui retient l'attention que la façon dont la vie peut échapper brusquement, alors que quelques minutes avant seulement, nous pouvions encore voir, sentir entendre tout ce qui nous entoure. Ainsi, la description des rayons du magasin, de l'allure des vigiles qui fondent sur l'homme, de la traversée vers la réserve, s'estompe progressivement pour ne laisser rapidement plus place qu'à celle d'un corps en train de lâcher peu à peu. Depuis le « nez qui éclate et [le] sang qui coule jusque sur la lèvre […] le sang [qui] coule dans sa bouche, (…) sa langue [qui] lèche le flot de sang, la surprise du sang sur ses doigts » (p. 21) au « coeur [qui] a lâché, le foie explosé, les poumons perforés » (p. 18), en passant par les « bras [qui] tombent aussi, l'abandonnent » et ce manque de force qui fait qu'« il ne peut pas les relever, ni les bras, ni les mains, ni les jambes non plus et la poitrine ne sait plus où trouver la ressource pour se soulever, prendre l'air, il faudrait de la force et il n'en a presque plus » (p. 26), l'on ne nous épargne aucun détail pour le dire, pour dire comment cette vie « se fait minuscule et finit par se faire la malle comme un parasite abandonne une carcasse qui ne lui convient plus » (p. 34).
Par là-même l'auteur replace l'humain au coeur de son projet, cet humain que tendent généralement à occulter les autres discours qui ont pu se déployer à partir de cette disparition, et qui tendent invariablement à la diluer derrière des considérations rationalisantes ou à la banaliser. Dès ses premières lignes, le récit devient alors l'occasion d'un retour réflexif sur ceux-ci, pour en dénoncer toute l'impropriété. Il s'inscrit d'abord dans le contrepoint des propos tenus par le procureur, qui voudraient qu'un « homme ne doit pas mourir pour si peu, qu'il est injuste de mourir à cause d'une canette de bière que le type aura gardée assez longtemps entre les mains pour que les vigiles puissent l'accuser de vol » (p. 7), comme si le caractère choquant de l'affaire ne tenait qu'au nombre de cannettes volées. Ce point fera ultérieurement l'objet d'un commentaire plus ironique et révolté : « il pourrait dire je vaux, je valais, une vie doit valoir un peu plus qu'une bière, un pack de six ? de douze ? de vingt-quatre bières, non, tu crois ? c'est trop ? et est-ce qu'en amassant de quoi remplir un Caddie le procureur aurait trouvé que c'était le juste prix et que ça ne valait pas plus ? que cette fois ils pouvaient y aller et lui donner une bonne correction et le faire payer plein pot » (p. 40). Seule demeure l'inanité de la déclaration, qui n'a d'égale que celle des « mots que la police a dits et répétés et qu'on a entendus dans les rues et les journaux, jetés sur la voie publique comme pour y faire pousser des fleurs (comme si toute la vérité du monde tenait là-dedans !) » (p. 37), toutes ces banalités qui perdent sans cesse de vue que ce qui s'est éteint là, c'est une vie, une vie singulière. Les rares fois où l'individu se trouve pris en compte par eux, ce n'est généralement que pour tenter de l'incriminer, pour chercher des circonstances atténuantes aux responsables d'un meurtre pourtant si inacceptable : « ils ont tout fait pour essayer de la comprendre cette mort, tout fait pour lui donner un sens et la trouver un peu normale, ils ont écrit des papiers, ils en ont balancé sur lui pour savoir s'il était SDF ou quoi, s'il avait des antécédents et combien de vols à la tire ? ils en ont trouvé des trucs à dire, est-ce qu'il a fait de la taule ? des gardes à vue ? combien il a fait de gardes à vue, ton frère ? et est-ce qu'il était violent et alcoolique ? (…) il vivait en foyer, c'est ça ? dans quel foyer, avec qui ? d'allocations ? de quoi ? de petits boulots ou bien ». Rapidement, le défunt se trouve réduit à une position sociale, à un casier judiciaire ; il n'est plus que ce sac que chacun peut « remplir de pierres, de gravats, de déchets » (p. 28). Dès lors, il est net que cette fiction tend à dépasser le cadre de ce moment d'extrême violence dont il est initialement question, pour devenir un véritable cri contre notre société, cette société dans laquelle nous disparaissons finalement en permanence, de façon insidieuse, jusqu'à ne plus être que « l'ombre d'un homme » (p. 39), ou même « un « tee-shirt jaune et noir » dont le « grotesque » (p. 32) déplaît au point de mériter des coups sans que cela n'émeuve particulièrement les foules, cette société dans laquelle « [l]a mort n'est pas l'évènement le plus triste de [l]a vie », parce que « ce qui est triste dans [l]a vie c'est ce monde avec des vigiles et des gens qui s'ignorent dans des vies mortes comme cette pâleur, cette mort tout le temps, tous les jours » (p. 60). S'intéresser au cas d'un marginal comme c'est ici le cas permet bien sûr de rendre cette dimension plus sensible encore, dans la mesure où il est par excellence celui face à qui « tous ont baissé les yeux parce qu'ils ont du travail qui les attend et une pelouse à tondre ou des trains à prendre, des enfants qu'il faut aller chercher à la sortie de l'école et aussi parce qu'ils espèrent échapper à leur propre misère, ce que j'appelle misère, à tous les malheurs quand sur le chemin c'est un type comme lui qu'ils croisent, nu comme un cauchemar, son visage crasseux éclairé par leurs phares en lieu et place des animaux à la sortie d'un bois » (p. 51). Il est celui auquel l'on préfère n'accorder aucune attention, et aucune place parmi nous. Il est celui dont on va jusqu'à ignorer qu'il puisse être un homme.
La fiction devient alors le lieu où le mort retrouve sa qualité d'homme. Elle est même le lieu où l'on rappelle « ses peurs d'enfants qu'il avait en regardant au-dessus de l'armoire, face au lit, la vierge phosphorescente dans sa boule de verre et la neige » (p. 53), ou encore « combien il aimait marcher dans les rues, des heures et des heures à ne plus sentir la douleur dans les jambes, [s]e protéger de la pluie sous le store d'un magasin ou dans une cabane téléphonique, l'orage sur Paris » (p. 57). Elle est aussi ce lieu où ressurgissent les paroles de sa mère, mais aussi la rencontre avec cette personne « voulait le revoir et que lui aussi voulait revoir, entre cette gare et la rue de Lyon », et plus largement toute cette famille, tous ces amis pour qui il était quelqu'un. L'adresse permanente au frère de la victime participe de cette même dynamique, tout en introduisant dans le texte un important pathos à même de refléter, en partie du moins, la douleur de la perte. En somme, tout concourt à dire qu' « il va laisser sans lui les gens qu'il aime, [qu']il y en a quelques-uns à qui il a tenu si fort, comme toi [son frère], des gens qui viendront espérer qu'un dieu existe autre part que dans la tête des hommes, quand ils verront le trou et le cercueil glissant, comme coulant au-dedans de cette terre épaisse et noire, avec les roses rouges qu'ils jetteront dessus » (p. 49), tout concourt à extirper cette existence de l'oubli.
Ecrire cette disparition c'est donc d'une certaine façon une occasion de dire avec Georges Perec « je me souviens », je me souviens de ce drame, je me souviens de cet homme, et surtout je me souviens de la valeur d'une vie, quelle qu'elle soit. C'est lutter contre cette petite mort quotidienne, « ce que j'appelle oubli », qui vous saisit quotidiennement dans les sociétés où prévaut l'indifférence générale. En ce sens, Laurent Mauvignier s'inscrit ici tout à fait dans cette lignée d'écrivains contemporains qui, comme François Bon, Marie Rovanet ou Le Clezio, refusent le silence et la faculté d'oubli de notre mémoire collective.
Lien : http://ecumedespages.wordpre..
Cette dernière fiction – le terme est important – peut ainsi se lire comme la reconstitution de la scène terrible qu'a vécu cet homme dont jamais l'on ne saura le nom, jusqu'à ce moment où « il ne lui restera plus que la nudité et la froidure sur un matelas de fer ou d'Inox, et aussi, attachée à un doigt de pied, une étiquette avec son nom, un numéro » (p. 17). Il ne s'agit alors pas tant de dire cette mort que de la donner à vivre, que de nous la faire éprouver, par une plongée dans le coeur même du processus de mise à mort, dans toute la tension que cela suppose et qui se trouve restituée par le déploiement dans tout le corps du texte d'une unique phrase, qui nous tient en haleine. Toutefois, l'orientation donnée au récit, qui veut que soit accordée aux perceptions et sensations une place de première importance, donne à penser que ce n'est pas tant la mort elle-même qui retient l'attention que la façon dont la vie peut échapper brusquement, alors que quelques minutes avant seulement, nous pouvions encore voir, sentir entendre tout ce qui nous entoure. Ainsi, la description des rayons du magasin, de l'allure des vigiles qui fondent sur l'homme, de la traversée vers la réserve, s'estompe progressivement pour ne laisser rapidement plus place qu'à celle d'un corps en train de lâcher peu à peu. Depuis le « nez qui éclate et [le] sang qui coule jusque sur la lèvre […] le sang [qui] coule dans sa bouche, (…) sa langue [qui] lèche le flot de sang, la surprise du sang sur ses doigts » (p. 21) au « coeur [qui] a lâché, le foie explosé, les poumons perforés » (p. 18), en passant par les « bras [qui] tombent aussi, l'abandonnent » et ce manque de force qui fait qu'« il ne peut pas les relever, ni les bras, ni les mains, ni les jambes non plus et la poitrine ne sait plus où trouver la ressource pour se soulever, prendre l'air, il faudrait de la force et il n'en a presque plus » (p. 26), l'on ne nous épargne aucun détail pour le dire, pour dire comment cette vie « se fait minuscule et finit par se faire la malle comme un parasite abandonne une carcasse qui ne lui convient plus » (p. 34).
Par là-même l'auteur replace l'humain au coeur de son projet, cet humain que tendent généralement à occulter les autres discours qui ont pu se déployer à partir de cette disparition, et qui tendent invariablement à la diluer derrière des considérations rationalisantes ou à la banaliser. Dès ses premières lignes, le récit devient alors l'occasion d'un retour réflexif sur ceux-ci, pour en dénoncer toute l'impropriété. Il s'inscrit d'abord dans le contrepoint des propos tenus par le procureur, qui voudraient qu'un « homme ne doit pas mourir pour si peu, qu'il est injuste de mourir à cause d'une canette de bière que le type aura gardée assez longtemps entre les mains pour que les vigiles puissent l'accuser de vol » (p. 7), comme si le caractère choquant de l'affaire ne tenait qu'au nombre de cannettes volées. Ce point fera ultérieurement l'objet d'un commentaire plus ironique et révolté : « il pourrait dire je vaux, je valais, une vie doit valoir un peu plus qu'une bière, un pack de six ? de douze ? de vingt-quatre bières, non, tu crois ? c'est trop ? et est-ce qu'en amassant de quoi remplir un Caddie le procureur aurait trouvé que c'était le juste prix et que ça ne valait pas plus ? que cette fois ils pouvaient y aller et lui donner une bonne correction et le faire payer plein pot » (p. 40). Seule demeure l'inanité de la déclaration, qui n'a d'égale que celle des « mots que la police a dits et répétés et qu'on a entendus dans les rues et les journaux, jetés sur la voie publique comme pour y faire pousser des fleurs (comme si toute la vérité du monde tenait là-dedans !) » (p. 37), toutes ces banalités qui perdent sans cesse de vue que ce qui s'est éteint là, c'est une vie, une vie singulière. Les rares fois où l'individu se trouve pris en compte par eux, ce n'est généralement que pour tenter de l'incriminer, pour chercher des circonstances atténuantes aux responsables d'un meurtre pourtant si inacceptable : « ils ont tout fait pour essayer de la comprendre cette mort, tout fait pour lui donner un sens et la trouver un peu normale, ils ont écrit des papiers, ils en ont balancé sur lui pour savoir s'il était SDF ou quoi, s'il avait des antécédents et combien de vols à la tire ? ils en ont trouvé des trucs à dire, est-ce qu'il a fait de la taule ? des gardes à vue ? combien il a fait de gardes à vue, ton frère ? et est-ce qu'il était violent et alcoolique ? (…) il vivait en foyer, c'est ça ? dans quel foyer, avec qui ? d'allocations ? de quoi ? de petits boulots ou bien ». Rapidement, le défunt se trouve réduit à une position sociale, à un casier judiciaire ; il n'est plus que ce sac que chacun peut « remplir de pierres, de gravats, de déchets » (p. 28). Dès lors, il est net que cette fiction tend à dépasser le cadre de ce moment d'extrême violence dont il est initialement question, pour devenir un véritable cri contre notre société, cette société dans laquelle nous disparaissons finalement en permanence, de façon insidieuse, jusqu'à ne plus être que « l'ombre d'un homme » (p. 39), ou même « un « tee-shirt jaune et noir » dont le « grotesque » (p. 32) déplaît au point de mériter des coups sans que cela n'émeuve particulièrement les foules, cette société dans laquelle « [l]a mort n'est pas l'évènement le plus triste de [l]a vie », parce que « ce qui est triste dans [l]a vie c'est ce monde avec des vigiles et des gens qui s'ignorent dans des vies mortes comme cette pâleur, cette mort tout le temps, tous les jours » (p. 60). S'intéresser au cas d'un marginal comme c'est ici le cas permet bien sûr de rendre cette dimension plus sensible encore, dans la mesure où il est par excellence celui face à qui « tous ont baissé les yeux parce qu'ils ont du travail qui les attend et une pelouse à tondre ou des trains à prendre, des enfants qu'il faut aller chercher à la sortie de l'école et aussi parce qu'ils espèrent échapper à leur propre misère, ce que j'appelle misère, à tous les malheurs quand sur le chemin c'est un type comme lui qu'ils croisent, nu comme un cauchemar, son visage crasseux éclairé par leurs phares en lieu et place des animaux à la sortie d'un bois » (p. 51). Il est celui auquel l'on préfère n'accorder aucune attention, et aucune place parmi nous. Il est celui dont on va jusqu'à ignorer qu'il puisse être un homme.
La fiction devient alors le lieu où le mort retrouve sa qualité d'homme. Elle est même le lieu où l'on rappelle « ses peurs d'enfants qu'il avait en regardant au-dessus de l'armoire, face au lit, la vierge phosphorescente dans sa boule de verre et la neige » (p. 53), ou encore « combien il aimait marcher dans les rues, des heures et des heures à ne plus sentir la douleur dans les jambes, [s]e protéger de la pluie sous le store d'un magasin ou dans une cabane téléphonique, l'orage sur Paris » (p. 57). Elle est aussi ce lieu où ressurgissent les paroles de sa mère, mais aussi la rencontre avec cette personne « voulait le revoir et que lui aussi voulait revoir, entre cette gare et la rue de Lyon », et plus largement toute cette famille, tous ces amis pour qui il était quelqu'un. L'adresse permanente au frère de la victime participe de cette même dynamique, tout en introduisant dans le texte un important pathos à même de refléter, en partie du moins, la douleur de la perte. En somme, tout concourt à dire qu' « il va laisser sans lui les gens qu'il aime, [qu']il y en a quelques-uns à qui il a tenu si fort, comme toi [son frère], des gens qui viendront espérer qu'un dieu existe autre part que dans la tête des hommes, quand ils verront le trou et le cercueil glissant, comme coulant au-dedans de cette terre épaisse et noire, avec les roses rouges qu'ils jetteront dessus » (p. 49), tout concourt à extirper cette existence de l'oubli.
Ecrire cette disparition c'est donc d'une certaine façon une occasion de dire avec Georges Perec « je me souviens », je me souviens de ce drame, je me souviens de cet homme, et surtout je me souviens de la valeur d'une vie, quelle qu'elle soit. C'est lutter contre cette petite mort quotidienne, « ce que j'appelle oubli », qui vous saisit quotidiennement dans les sociétés où prévaut l'indifférence générale. En ce sens, Laurent Mauvignier s'inscrit ici tout à fait dans cette lignée d'écrivains contemporains qui, comme François Bon, Marie Rovanet ou Le Clezio, refusent le silence et la faculté d'oubli de notre mémoire collective.
Lien : http://ecumedespages.wordpre..
Mourir pour une cannette de bière..
"Le procureur a dit qu'un homme
ne doit pas mourir pour si peu.."
Mauvignier s'empare de ce fait divers
survenu à Lyon en 2009.
Le texte commence
sans majuscule, se termine par un tiret
Des virgules en pagaille
des points d'interrogation à l'envi
Pas de point final car une histoire pareille
ne peut être close.
On pourrait lire ces lignes en apnée,
et, tomber nous aussi...
Ou très lentement au rythme
de l'agonie de ce jeune homme .
L'auteur interroge ces quatre vigiles
costard-cravate qui se transforment en nazillons.
Des humiliés qui humilient..à mort?
La barbarie envahit
ceux, censés faire respecter l'ordre .
Soixante pages percutantes
qui nous accompagneront longtemps .
"Le procureur a dit qu'un homme
ne doit pas mourir pour si peu.."
Mauvignier s'empare de ce fait divers
survenu à Lyon en 2009.
Le texte commence
sans majuscule, se termine par un tiret
Des virgules en pagaille
des points d'interrogation à l'envi
Pas de point final car une histoire pareille
ne peut être close.
On pourrait lire ces lignes en apnée,
et, tomber nous aussi...
Ou très lentement au rythme
de l'agonie de ce jeune homme .
L'auteur interroge ces quatre vigiles
costard-cravate qui se transforment en nazillons.
Des humiliés qui humilient..à mort?
La barbarie envahit
ceux, censés faire respecter l'ordre .
Soixante pages percutantes
qui nous accompagneront longtemps .
J'ai découvert ce texte à la faveur de la représentation donnée à la Comédie française par Denis Podalydès. Une mise en scène sobre qui déploie toute l'intensité du propos.
Ce texte d'une soixantaine de pages n'est qu'une longue phrase dont le début et la fin ne sont pas notés, une grande respiration qui raconte comment un homme qui a volé et consommé une canette de bière dans un supermarché, a été battu à mort par les vigiles de la sécurité.
Chaque ressenti est décomposé, ceux de l'homme qui reçoit les coups, ceux des hommes qui les donnent. Les pensées sont séquencées, contextualisées, comme un ralenti d'une violence inouïe.
La construction de ce récit adapté d'un fait divers plonge le lecteur en apnée, l'empêchant de reprendre sa respiration, le faisant vibrer de tout son être.
Prévoir une bonne heure pour la lecture, elle ne peut se faire que d'une traite.
Un narrateur énigmatique raconte à un homme qui n'est pas nommé la mort absurde de son frère aîné, tué sauvagement par quatre vigiles dans un magasin où il avait bu une canette de bière sans passer au préalable par la caisse.
Ainsi que l'indique la quatrième de couverture, « cette fiction est librement inspirée d'un fait divers, survenu à Lyon, en décembre 2009 ». Ce court récit, qui m'a bouleversée, m'a beaucoup questionnée, à de multiples titres.
Ce qui surprend le lecteur, de prime abord, c'est la ponctuation : pas un seul point ne figure dans ce court roman (62 pages au total). Faut-il voir dans l'espace de ces pages comme une immense phrase, à lire d'une traite, ainsi que je l'ai fait ? Mais un regard attentif corrige cette première impression : le premier mot du roman, « et », ne commence pas par une majuscule, le dernier signe de ponctuation, qui clôt le récit, est un tiret. Ce style, que je découvrais ici, ne m'a nullement gênée dans ma lecture. J'ai trouvé qu'il était particulièrement bien pensé au regard du contenu abordé.
L'événement dramatique qui est conté n'est pas présenté de manière chronologique ou selon la logique classique. le narrateur opère de nombreuses digressions, raconte selon le fil d'associations d'idées. le lecteur reconstruit l'événement dans sa globalité une fois arrivé au terme du récit. A mon sens, cette construction chaotique reflète l'absurdité de cet événement tragique, le chaos, la violence d'une fin de vie.
La question cruciale du récit, en effet, peut se réduire au mot « sens » : quel sens cet événement a-t-il ? Ainsi, Mauvignier me semble aller plus loin que Jean Teulé dans « Mangez-le si vous voulez » paru en 2009 qui raconte la mise à mort d'un élu en 1870 sur fond de guerre de Prusse. Ce fait divers sordide était présenté de manière crue et réaliste, aucun détail n'était épargné au lecteur, mais les motivations des assassins n'étaient pas questionnées. Dans « Ce que j'appelle oubli », certains détails peuvent être également très réalistes, mais Mauvignier explore habilement la résonance de cet événement sur les autres (le frère, destinataire du récit, les acteurs du monde judiciaire, du monde des médias, les assassins eux-mêmes), avec en filigrane la question du sens et des motivations.
Ainsi, le procureur et les journalistes souhaitent comprendre cet acte en essayant de circonscrire la victime dans une catégorie : SDF, voleur, … susceptible d'éclairer sa mort violente.
« que ni le procureur ni les journalistes ni la police ni personne n'admettra jamais, que ces types-là se soient payés sur sa tête, et ils ont tout fait pour essayer de la comprendre, cette mort, tout fait pour lui donner un sens et la trouver un peu normale, ils ont écrit des papiers, ils en ont balancé sur lui pour savoir s'il était SDF ou quoi, s'il avait des antécédents et combien de vols à la tire ? » (p. 38-39)
Cette démarche a-t-elle elle-même du sens ? Au-delà de toute emprise déterministe, la liberté du sujet demeure.
Le frère survivant, plus jeune, souhaite également comprendre – du moins, c'est ce que suppose le narrateur qui s'adresse à lui :
« ton frère, il sera pour toi comme une lacération dans ta vie, et tu voudras comprendre, des années entières à te torturer l'esprit pour vouloir revivre chacune des minutes et des secondes entre les palettes et les chariots élévateurs, pour comprendre, parce que – n'est-ce pas ? – tu diras, je veux comprendre, je veux savoir pourquoi les tours de conserves hautes comme des montagnes de bouffe et de fer » (p. 41)
Le narrateur cherche lui aussi à délivrer des éléments d'intelligibilité sur la personnalité de la victime. Au détour de certains mots, le lecteur peut appréhender la vie d'errance que semblait mener celle-ci :
« ils n'ont pas eu le temps de faire l'amour et puis, voilà, quand il allait rencontrer quelqu'un, elle ou lui, quand il allait sortir de l'oubli, ce que j'appelle oubli, lui qui marchait souvent dans la rue du côté de Montparnasse et traînait dès le matin, comme ce matin où il n'avait pas encore eu le courage d'aller prendre une douche à la piscine ni de se raser ni rien » (p. 47.)
Cette citation – en clin d'oeil au titre – montre combien la victime (toujours nommée en un « il » qui éloigne) aimait déambuler. Un passage vers la fin illustre également son parcours d'errance sexuelle, tissé de relations éphémères avec des hommes et des femmes.
Qui est le narrateur ? Qui parle ? Qui rapporte cet événement ? Pas un témoin neutre, extérieur, en tout cas. Etait-il présent quand cet homme est mort ? Ce dernier n'est pas nommé, à travers un prénom ou un nom. Il n'existe que par la voix d'un autre qui rapporte un fait, à la fois à distance (en témoigne ce « il » qui désigne la victime) et en même temps engagé, souhaitant délivrer un message (au frère de la victime, en premier lieu, mais aussi au lecteur).
Un livre coup de coeur, mais aussi, et surtout coup de poing, dans lequel l'auteur essaie de remettre du sens autour d'un événement tragique, pour pointer, in fine, son absurdité. Un récit violent, bouleversant, questionnant.
Ainsi que l'indique la quatrième de couverture, « cette fiction est librement inspirée d'un fait divers, survenu à Lyon, en décembre 2009 ». Ce court récit, qui m'a bouleversée, m'a beaucoup questionnée, à de multiples titres.
Ce qui surprend le lecteur, de prime abord, c'est la ponctuation : pas un seul point ne figure dans ce court roman (62 pages au total). Faut-il voir dans l'espace de ces pages comme une immense phrase, à lire d'une traite, ainsi que je l'ai fait ? Mais un regard attentif corrige cette première impression : le premier mot du roman, « et », ne commence pas par une majuscule, le dernier signe de ponctuation, qui clôt le récit, est un tiret. Ce style, que je découvrais ici, ne m'a nullement gênée dans ma lecture. J'ai trouvé qu'il était particulièrement bien pensé au regard du contenu abordé.
L'événement dramatique qui est conté n'est pas présenté de manière chronologique ou selon la logique classique. le narrateur opère de nombreuses digressions, raconte selon le fil d'associations d'idées. le lecteur reconstruit l'événement dans sa globalité une fois arrivé au terme du récit. A mon sens, cette construction chaotique reflète l'absurdité de cet événement tragique, le chaos, la violence d'une fin de vie.
La question cruciale du récit, en effet, peut se réduire au mot « sens » : quel sens cet événement a-t-il ? Ainsi, Mauvignier me semble aller plus loin que Jean Teulé dans « Mangez-le si vous voulez » paru en 2009 qui raconte la mise à mort d'un élu en 1870 sur fond de guerre de Prusse. Ce fait divers sordide était présenté de manière crue et réaliste, aucun détail n'était épargné au lecteur, mais les motivations des assassins n'étaient pas questionnées. Dans « Ce que j'appelle oubli », certains détails peuvent être également très réalistes, mais Mauvignier explore habilement la résonance de cet événement sur les autres (le frère, destinataire du récit, les acteurs du monde judiciaire, du monde des médias, les assassins eux-mêmes), avec en filigrane la question du sens et des motivations.
Ainsi, le procureur et les journalistes souhaitent comprendre cet acte en essayant de circonscrire la victime dans une catégorie : SDF, voleur, … susceptible d'éclairer sa mort violente.
« que ni le procureur ni les journalistes ni la police ni personne n'admettra jamais, que ces types-là se soient payés sur sa tête, et ils ont tout fait pour essayer de la comprendre, cette mort, tout fait pour lui donner un sens et la trouver un peu normale, ils ont écrit des papiers, ils en ont balancé sur lui pour savoir s'il était SDF ou quoi, s'il avait des antécédents et combien de vols à la tire ? » (p. 38-39)
Cette démarche a-t-elle elle-même du sens ? Au-delà de toute emprise déterministe, la liberté du sujet demeure.
Le frère survivant, plus jeune, souhaite également comprendre – du moins, c'est ce que suppose le narrateur qui s'adresse à lui :
« ton frère, il sera pour toi comme une lacération dans ta vie, et tu voudras comprendre, des années entières à te torturer l'esprit pour vouloir revivre chacune des minutes et des secondes entre les palettes et les chariots élévateurs, pour comprendre, parce que – n'est-ce pas ? – tu diras, je veux comprendre, je veux savoir pourquoi les tours de conserves hautes comme des montagnes de bouffe et de fer » (p. 41)
Le narrateur cherche lui aussi à délivrer des éléments d'intelligibilité sur la personnalité de la victime. Au détour de certains mots, le lecteur peut appréhender la vie d'errance que semblait mener celle-ci :
« ils n'ont pas eu le temps de faire l'amour et puis, voilà, quand il allait rencontrer quelqu'un, elle ou lui, quand il allait sortir de l'oubli, ce que j'appelle oubli, lui qui marchait souvent dans la rue du côté de Montparnasse et traînait dès le matin, comme ce matin où il n'avait pas encore eu le courage d'aller prendre une douche à la piscine ni de se raser ni rien » (p. 47.)
Cette citation – en clin d'oeil au titre – montre combien la victime (toujours nommée en un « il » qui éloigne) aimait déambuler. Un passage vers la fin illustre également son parcours d'errance sexuelle, tissé de relations éphémères avec des hommes et des femmes.
Qui est le narrateur ? Qui parle ? Qui rapporte cet événement ? Pas un témoin neutre, extérieur, en tout cas. Etait-il présent quand cet homme est mort ? Ce dernier n'est pas nommé, à travers un prénom ou un nom. Il n'existe que par la voix d'un autre qui rapporte un fait, à la fois à distance (en témoigne ce « il » qui désigne la victime) et en même temps engagé, souhaitant délivrer un message (au frère de la victime, en premier lieu, mais aussi au lecteur).
Un livre coup de coeur, mais aussi, et surtout coup de poing, dans lequel l'auteur essaie de remettre du sens autour d'un événement tragique, pour pointer, in fine, son absurdité. Un récit violent, bouleversant, questionnant.
N°1735 – Avril 2023
Ce que j'appelle oubli– Laurent Mauvignier – Les éditions de Minuit.
Cela paraît à peine croyable tant les choses sont simples. Un jeune marginal entre dans un supermarché se dirige vers une gondole de bières, prend une canette, la boit, quatre vigiles interviennent, le traînent dans un local de stockage à l'abri des regards, le frappent et le tuent, pour une simple bière volée! On se croirait revenu au Moyen-âge. C'est un simple « fait divers » comme on dit, c'est à dire un événement que la presse locale mentionne à peine en quelques lignes maigres en fin de journal entre les développements d‘une guerre lointaine qui fait rage et bouleverse des vies innocentes et les misérables tergiversations clownesques de politicards véreux, une anecdote authentique qui s'est produite à Lyon en décembre 2009 qui serait passée inaperçue si elle n'avait inspiré ce récit.
Le narrateur remet la victime au centre du récit, s'adresse à son frère pour lui raconter ce qu'il n'a pas vu, pour évoquer ce qu'il ne pourra plus vivre avec lui, décrit les quatre vigiles qui maintenant vont devoir répondre devant la justice d'un assassinat qui n'aurait jamais dû avoir lieu, tant l'enjeu était dérisoire. Ils se sont mal défendus, ont évidemment menti, ont protesté de leur absence de volonté de tuer, ont invoqué enchaînement absurde des événements... Ils n'en sont pas moins devenus des assassins, responsables d'un meurtre gratuit et injustifiable, que rien, pas même le paiement de leur dette à la société, comme on dit, n'effacera, que rien ne pourra jamais justifier, ni la nécessité, ni la légitime défense, ni l'ostracisme, ni une improbable conscience professionnelle. Cela leur collera à la peau toute leur existence, avoir sans aucune raison pris une vie, avoir à ce point outrepassé leurs fonctions, imposer une sanction définitive à un être humain. On pourra dire tout ce qu'on voudra, que nous sommes mortels, simples usufruitiers d'une vie qui peut nous être enlevée à tout moment sans préavis, que ce pauvre jeune homme s'est trouvé là au mauvais moment, au mauvais endroit, que l'espèce humaine est capable du pire comme du meilleur mais bien souvent du pire, mais cet homme qui vivait, faisait l'amour, respirait, ne le fera plus et maintenant n'est plus qu'un cadavre voué à l'oubli. Ces vigiles devront affronter les tribunaux et surtout la violence des prisons, légale celle-là, qui aura au moins l'avantage pour eux, si on peut dire, de les maintenir en vie alors que leur victime elle ne vieillira pas.
Ce geste est révélateur de ceux qui sont dépositaires d'une parcelle même infime de l'autorité et se croient autorisés à en abuser, une image banale mais pourtant quotidienne qui s'inscrit dans une société de plus en plus en manque de repères, où la violence est devenue tellement banale qu'elle n'étonne même plus, où un nombre exponentiel d'individus ordinaires ne rêvent que d'en découdre et pour cela ne reculent devant rien pour s'affirmer, se prouver qu'ils existent.
J'ai déjà dit dans cette chronique que j'apprécie Laurent Mauvignier non pas tant pour le longueur de ses phrases (ces 61 pages ne sont qu'une seule et même phrase) mais notamment parce qu'il est, ce que devrait être un écrivain, c'est à dire le reflet de son temps, jusques et y compris si celui-ci, n'est pas reluisant.
Ce que j'appelle oubli– Laurent Mauvignier – Les éditions de Minuit.
Cela paraît à peine croyable tant les choses sont simples. Un jeune marginal entre dans un supermarché se dirige vers une gondole de bières, prend une canette, la boit, quatre vigiles interviennent, le traînent dans un local de stockage à l'abri des regards, le frappent et le tuent, pour une simple bière volée! On se croirait revenu au Moyen-âge. C'est un simple « fait divers » comme on dit, c'est à dire un événement que la presse locale mentionne à peine en quelques lignes maigres en fin de journal entre les développements d‘une guerre lointaine qui fait rage et bouleverse des vies innocentes et les misérables tergiversations clownesques de politicards véreux, une anecdote authentique qui s'est produite à Lyon en décembre 2009 qui serait passée inaperçue si elle n'avait inspiré ce récit.
Le narrateur remet la victime au centre du récit, s'adresse à son frère pour lui raconter ce qu'il n'a pas vu, pour évoquer ce qu'il ne pourra plus vivre avec lui, décrit les quatre vigiles qui maintenant vont devoir répondre devant la justice d'un assassinat qui n'aurait jamais dû avoir lieu, tant l'enjeu était dérisoire. Ils se sont mal défendus, ont évidemment menti, ont protesté de leur absence de volonté de tuer, ont invoqué enchaînement absurde des événements... Ils n'en sont pas moins devenus des assassins, responsables d'un meurtre gratuit et injustifiable, que rien, pas même le paiement de leur dette à la société, comme on dit, n'effacera, que rien ne pourra jamais justifier, ni la nécessité, ni la légitime défense, ni l'ostracisme, ni une improbable conscience professionnelle. Cela leur collera à la peau toute leur existence, avoir sans aucune raison pris une vie, avoir à ce point outrepassé leurs fonctions, imposer une sanction définitive à un être humain. On pourra dire tout ce qu'on voudra, que nous sommes mortels, simples usufruitiers d'une vie qui peut nous être enlevée à tout moment sans préavis, que ce pauvre jeune homme s'est trouvé là au mauvais moment, au mauvais endroit, que l'espèce humaine est capable du pire comme du meilleur mais bien souvent du pire, mais cet homme qui vivait, faisait l'amour, respirait, ne le fera plus et maintenant n'est plus qu'un cadavre voué à l'oubli. Ces vigiles devront affronter les tribunaux et surtout la violence des prisons, légale celle-là, qui aura au moins l'avantage pour eux, si on peut dire, de les maintenir en vie alors que leur victime elle ne vieillira pas.
Ce geste est révélateur de ceux qui sont dépositaires d'une parcelle même infime de l'autorité et se croient autorisés à en abuser, une image banale mais pourtant quotidienne qui s'inscrit dans une société de plus en plus en manque de repères, où la violence est devenue tellement banale qu'elle n'étonne même plus, où un nombre exponentiel d'individus ordinaires ne rêvent que d'en découdre et pour cela ne reculent devant rien pour s'affirmer, se prouver qu'ils existent.
J'ai déjà dit dans cette chronique que j'apprécie Laurent Mauvignier non pas tant pour le longueur de ses phrases (ces 61 pages ne sont qu'une seule et même phrase) mais notamment parce qu'il est, ce que devrait être un écrivain, c'est à dire le reflet de son temps, jusques et y compris si celui-ci, n'est pas reluisant.
Le suspense. Certains auteurs le créent en travaillant l'ambiance de leurs romans. C'est le cas d'Anthony Horowitz. D'autres préfèrent se concentrer sur le jeu des personnages. C'est le cas d'Agatha Christie. Laurent Mauvignier, lui, se base uniquement sur la syntaxe, dans Ce que j'appelle oubli.
Une syntaxe très rythmée, qui oblige le lecteur à ne pas fermer le livre avant de l'avoir terminé. Un homme, soupçonné d'avoir volé une bouteille dans un supermarché, est interpellé par les vigiles qui vont le passer à tabac afin d'obtenir des aveux.
Un livre qui tient en haleine. C'est une qualité que l'on recherche souvent lorsqu'
on lit des romans à suspense, des romans noirs. Une intrigue complexe, des rebondissements, un dénouement qui se profile vaguement au fil des pages, et un lecteur qui a hâte de connaître l'issue du roman.
Laurent Mauvignier, lui, n'a pas besoin de toutes ces ressources pour tenir son lecteur en haleine. Cinquante-cinq pages, une seule phrase. On connaît l'issue assez rapidement, mais ce n'est pas ce qui fait l'intérêt du livre. Ce texte s'élève comme un plaidoyer contre la cruauté, la cruauté de ces vigiles face à cet homme, dont on ne connaît pas vraiment l'identité, dont on sait simplement qu'il n'avait pas grand-chose pour lui dans la vie. Violence gratuite de la part des vigiles ? ou bien préjugés qu'ils ont voulu exprimer à force de coups ? Quoi qu'il en soit, ça n'est pas seulement pour la canette de bière volée, car « on ne tue pas pour ça ». Abus de pouvoir, mensonge, violence, voilà ce que Laurent Mauvignier refuse de laisser tomber dans l'oubli.
Une syntaxe très rythmée, qui oblige le lecteur à ne pas fermer le livre avant de l'avoir terminé. Un homme, soupçonné d'avoir volé une bouteille dans un supermarché, est interpellé par les vigiles qui vont le passer à tabac afin d'obtenir des aveux.
Un livre qui tient en haleine. C'est une qualité que l'on recherche souvent lorsqu'
on lit des romans à suspense, des romans noirs. Une intrigue complexe, des rebondissements, un dénouement qui se profile vaguement au fil des pages, et un lecteur qui a hâte de connaître l'issue du roman.
Laurent Mauvignier, lui, n'a pas besoin de toutes ces ressources pour tenir son lecteur en haleine. Cinquante-cinq pages, une seule phrase. On connaît l'issue assez rapidement, mais ce n'est pas ce qui fait l'intérêt du livre. Ce texte s'élève comme un plaidoyer contre la cruauté, la cruauté de ces vigiles face à cet homme, dont on ne connaît pas vraiment l'identité, dont on sait simplement qu'il n'avait pas grand-chose pour lui dans la vie. Violence gratuite de la part des vigiles ? ou bien préjugés qu'ils ont voulu exprimer à force de coups ? Quoi qu'il en soit, ça n'est pas seulement pour la canette de bière volée, car « on ne tue pas pour ça ». Abus de pouvoir, mensonge, violence, voilà ce que Laurent Mauvignier refuse de laisser tomber dans l'oubli.
C'est un court texte, une soixante de pages seulement; Ce texte, c'est une phrase, attrapée au vol et qui ne se terminera qu'avec le point final. Cette phrase faite de disgressions, d'incises, de changements de ton raconte l'histoire d'un jeune homme, dont on ne connait pas grand chose. Sauf qu'il avait un frère, qu'il vivait de petits boulots et qu'il est mort dans la réserve d'un supermarché, tabassé par quatre vigiles pour avoir bu une canette de bière dans les rayons.
Cette histoire est tirée d'un fait divers sordide qui s'est passé à Lyon, en 2009. Laurent Mauvignier s'en empare, et loin du documentaire, signe un texte poignant, touchant, émouvant. En alternant récit de ce moment d'horreur et la victoire de l'arbitraire, suppositions sur ce que pouvait être la vie de ce jeune homme et réflexions sur la condition humaine. Un livre dont on ne sort pas indemne, tant le fait divers à l'origine du récit est abject et tant l'écriture de Mauvignier rend le côté horrible de cette situation.
Lien : http://livres-et-cin.over-bl..
Cette histoire est tirée d'un fait divers sordide qui s'est passé à Lyon, en 2009. Laurent Mauvignier s'en empare, et loin du documentaire, signe un texte poignant, touchant, émouvant. En alternant récit de ce moment d'horreur et la victoire de l'arbitraire, suppositions sur ce que pouvait être la vie de ce jeune homme et réflexions sur la condition humaine. Un livre dont on ne sort pas indemne, tant le fait divers à l'origine du récit est abject et tant l'écriture de Mauvignier rend le côté horrible de cette situation.
Lien : http://livres-et-cin.over-bl..
"Ce que j'appelle oubli" est un texte très court qui, se basant sur un terrible fait divers, raconte comment un homme qui boit une bière dans un supermarché, sans la payer, n'en ressort plus jamais vivant, tabassé en règle et à mort par quatre vigiles. "Ce que j'appelle oubli" est un court texte constitué d'une phrase unique, et qui résonne comme un coup en plein visage, qui fait mal, qui secoue, qui laisse sans souffle ; et qui tourne en boucle dans le cerveau une fois la lecture achevée.
Une seule phrase, comme le dernier souffle d'un condamné ; dite dans l'urgence de ce que plus jamais on ne pourra exprimer.
Une seule phrase, comme la tentative désespérée du narrateur, qui s'embrouille à trouver des mots pour dire l'indicible, et comprendre cet acte qui ne peut l'être. Et les mots se chevauchent, et n'éclairent pas, ne font pas sens.
Une seule phrase, des mots qui tombent et s'entrechoquent et nous font apercevoir le rythme de la violence des coups reçus jusqu'à la mort.
Et pourtant, au milieu de ce flot ininterrompu, il y a la beauté de la langue de Mauvignier, celle qui rend ce livre "lisible" ; le choix des mots, toujours justes ; l'émotion contenue, alors que le narrateur voudrait hurler sa rage et son assourdissement.
Il y a aussi de plus en plus visible, jusqu'à prendre toute la place, le portrait d'un être humain, que l'on a nié, à qui justement on a refusé puis ôté son humanité ; et cette révolte de son ami-narrateur, comme si c'était si simple d'ôter l'humanité d'un homme, comme si on allait vous laisser faire ; et ce délire verbal pour lutter contre "ce qu'il appelle oubli".
Et finalement, c'est quoi "ce que j'appelle oubli" ?
Le moment où l'humanité se détraque, où pour une canette à peine volée on se fait cogner à en crever ?
Le moment où, à bout de force, on s'assoit au sol d'une gare en espérant que les passants ne jetent pas une pièce ?
Ou ce moment où deux regards se croisent et se reconnaissent et se promettent d'aller chercher plus loin, ailleurs, par delà les apparences ?
Ou ce risque de voir l'image d'un frère réduite à son corps démantelé dans son sac plastique de mort ?
Ou encore, ce procureur qui dit - lui qui sait - qu'on ne meure pas pour ça, pour si peu, quand même ; mais pour combien, alors ?
C'est pour et contre tout ça en même temps que Mauvignier écrit ici. Et remarquablement encore !
Une seule phrase, comme le dernier souffle d'un condamné ; dite dans l'urgence de ce que plus jamais on ne pourra exprimer.
Une seule phrase, comme la tentative désespérée du narrateur, qui s'embrouille à trouver des mots pour dire l'indicible, et comprendre cet acte qui ne peut l'être. Et les mots se chevauchent, et n'éclairent pas, ne font pas sens.
Une seule phrase, des mots qui tombent et s'entrechoquent et nous font apercevoir le rythme de la violence des coups reçus jusqu'à la mort.
Et pourtant, au milieu de ce flot ininterrompu, il y a la beauté de la langue de Mauvignier, celle qui rend ce livre "lisible" ; le choix des mots, toujours justes ; l'émotion contenue, alors que le narrateur voudrait hurler sa rage et son assourdissement.
Il y a aussi de plus en plus visible, jusqu'à prendre toute la place, le portrait d'un être humain, que l'on a nié, à qui justement on a refusé puis ôté son humanité ; et cette révolte de son ami-narrateur, comme si c'était si simple d'ôter l'humanité d'un homme, comme si on allait vous laisser faire ; et ce délire verbal pour lutter contre "ce qu'il appelle oubli".
Et finalement, c'est quoi "ce que j'appelle oubli" ?
Le moment où l'humanité se détraque, où pour une canette à peine volée on se fait cogner à en crever ?
Le moment où, à bout de force, on s'assoit au sol d'une gare en espérant que les passants ne jetent pas une pièce ?
Ou ce moment où deux regards se croisent et se reconnaissent et se promettent d'aller chercher plus loin, ailleurs, par delà les apparences ?
Ou ce risque de voir l'image d'un frère réduite à son corps démantelé dans son sac plastique de mort ?
Ou encore, ce procureur qui dit - lui qui sait - qu'on ne meure pas pour ça, pour si peu, quand même ; mais pour combien, alors ?
C'est pour et contre tout ça en même temps que Mauvignier écrit ici. Et remarquablement encore !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Laurent Mauvignier (20)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3661 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3661 lecteurs ont répondu