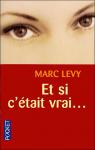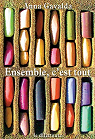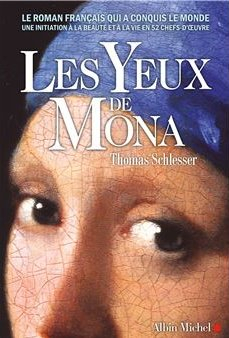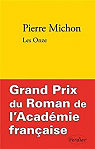Pierre MichonPierre Alechinsky/5
57 notes
Résumé :
" Qu'il meure de ma main ou que je meure de la sienne, il n'assouvira pas sa faim, il n'entendra pas le mot de l'énigme ; pas plus que je ne l'entendrai, moi, Aetius. Tout cela me lasse jusqu'à la mort. Tout cela doit être. Combattons. Des chevaux galopent, des flèches passent comme un vol d'ibis. Mon casque. "
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'empereur d'OccidentVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (7)
Voir plus
Ajouter une critique
Dans ce court texte que j'hésite à qualifier de roman ou de poème en prose, Pierre Michon nous régale d'une très belle écriture, peut-être un peu exigeante au début, mais à laquelle on prend vite goût, à tel point qu'on pourrait presque avoir envie de lire certains passages à haute voix .
Le narrateur rencontre un vieux sage qui lui raconte ses souvenirs, il y est question de musique, mais aussi de pouvoir dans le sillage d'Alaric. Les deux hommes se retrouvent également dans la recherche d'un père.
À la fin du livre,on comprend que le narrateur est Aetius, et qu'il repense à ces échanges au moment d'affronter Attila, successeur d'Alaric, aux champs catalauniques, et on découvre aussi qui est le vieux musicien, personnage historique que je ne connaissais pas et qui donne son titre au roman.
Ce livre est une très belle découverte qui me donne envie de lire d'autres ouvrages de Pierre Michon.
Mon seul regret est de l'avoir lu dans l'édition de poche, car j'aurais aimé voir les illustrations de Pierre Alechinsky dans le grand format.
Le narrateur rencontre un vieux sage qui lui raconte ses souvenirs, il y est question de musique, mais aussi de pouvoir dans le sillage d'Alaric. Les deux hommes se retrouvent également dans la recherche d'un père.
À la fin du livre,on comprend que le narrateur est Aetius, et qu'il repense à ces échanges au moment d'affronter Attila, successeur d'Alaric, aux champs catalauniques, et on découvre aussi qui est le vieux musicien, personnage historique que je ne connaissais pas et qui donne son titre au roman.
Ce livre est une très belle découverte qui me donne envie de lire d'autres ouvrages de Pierre Michon.
Mon seul regret est de l'avoir lu dans l'édition de poche, car j'aurais aimé voir les illustrations de Pierre Alechinsky dans le grand format.
L'Empereur d'Occident est un court texte d'une grande puissance narrative.
La prose de Pierre Michon est très poétique. On se laisse bercer par le texte tout le long des 80 pages.
Au Vè siècle, Aetius, un soldat romain rencontre un vieux sage. Une discussion s'engage entre les deux hommes mêlant histoire, philosophie et mythologie. Leur échange porte principalement sur Alaric roi des Wisigoth, le premier à faire plier Rome la Conquérante, dont l'homme a longtemps accompagné les pas.
Plus tard, à l'aube de la bataille qu'il s'apprête à mener contre Attila, cet autre Alaric, le narrateur devenu Capitaine Général des armées romaines se souviendra de ces échanges au moment de lancer son cheval au galop.
Le style très recherché peut dérouter ou rebuter certains lecteurs.
Le texte se fait le chantre des arts, de la musique et des plaisirs épicuriens.
L'auteur se moque lui-même des discours alambiqués et ampoulés d'une façon que j'ai trouvée assez ironique.
Pour ma part, j'ai apprécié l'écriture de Pierre Michon, un auteur dont je vais tenter de découvrir d'autres oeuvres.
La prose de Pierre Michon est très poétique. On se laisse bercer par le texte tout le long des 80 pages.
Au Vè siècle, Aetius, un soldat romain rencontre un vieux sage. Une discussion s'engage entre les deux hommes mêlant histoire, philosophie et mythologie. Leur échange porte principalement sur Alaric roi des Wisigoth, le premier à faire plier Rome la Conquérante, dont l'homme a longtemps accompagné les pas.
Plus tard, à l'aube de la bataille qu'il s'apprête à mener contre Attila, cet autre Alaric, le narrateur devenu Capitaine Général des armées romaines se souviendra de ces échanges au moment de lancer son cheval au galop.
Le style très recherché peut dérouter ou rebuter certains lecteurs.
Le texte se fait le chantre des arts, de la musique et des plaisirs épicuriens.
L'auteur se moque lui-même des discours alambiqués et ampoulés d'une façon que j'ai trouvée assez ironique.
Pour ma part, j'ai apprécié l'écriture de Pierre Michon, un auteur dont je vais tenter de découvrir d'autres oeuvres.
J'ai découvert Pierre Michon il y a peu et ai lu 3 de ses oeuvres à la suite: "corps du roi", "les Onze" et donc "l'empereur d'Occident".
Pour commencer, je n'ai eu aucune lassitude à les enchaîner tant le style de Michon approche d'une perfection dont je n'avais pas idée et qui épouse à merveille le fond du roman.
Nous ne sommes pas là dans la démonstration ou la recherche technique pompeuse et m'as-tu-vu.
J'ai parfois l'impression que si l'on demandait à Michon pourquoi il écrit, il répondrait simplement "pour écrire".
Cet homme ne cherche pas à plaire, il semble juste vouloir être intelligent de façon intelligible.
"l'Empereur d'Occident" est une sorte de long poème en prose qui évoque le déclin de l'Empire Romain d'Occident, la puissance, l'eau, le rapport filial que Michon aborde toujours dans ses livres, ici par la transposition habile et érudite de la Trinité, etc...
Dit comme ça, comment trouver cela excitant et justifier les 5 étoiles ?
Et bien, parce que les images convoquées sont celles de l'héroïsme et de la nostalgie, de la grandeur déchue, de la fin de la légèreté olympienne au profit du sérieux chrétien, de l'irruption de la mort dans la mythologie: les dieux ont été tués par un dieu qui est lui-même mort.
Il n'y aura donc plus jamais de pères, il y aura la recherche d'un père qui ne sera plus jamais là.
Il faudra donc perdre de soi pour rester soi.
Pour commencer, je n'ai eu aucune lassitude à les enchaîner tant le style de Michon approche d'une perfection dont je n'avais pas idée et qui épouse à merveille le fond du roman.
Nous ne sommes pas là dans la démonstration ou la recherche technique pompeuse et m'as-tu-vu.
J'ai parfois l'impression que si l'on demandait à Michon pourquoi il écrit, il répondrait simplement "pour écrire".
Cet homme ne cherche pas à plaire, il semble juste vouloir être intelligent de façon intelligible.
"l'Empereur d'Occident" est une sorte de long poème en prose qui évoque le déclin de l'Empire Romain d'Occident, la puissance, l'eau, le rapport filial que Michon aborde toujours dans ses livres, ici par la transposition habile et érudite de la Trinité, etc...
Dit comme ça, comment trouver cela excitant et justifier les 5 étoiles ?
Et bien, parce que les images convoquées sont celles de l'héroïsme et de la nostalgie, de la grandeur déchue, de la fin de la légèreté olympienne au profit du sérieux chrétien, de l'irruption de la mort dans la mythologie: les dieux ont été tués par un dieu qui est lui-même mort.
Il n'y aura donc plus jamais de pères, il y aura la recherche d'un père qui ne sera plus jamais là.
Il faudra donc perdre de soi pour rester soi.
Pierre Michon est un auteur du vocabulaire. Il aime donner vie à des mots peu usités, donnant à ces récits l'envie de les prononcer, de les parler à haute voix, donnant envie de les entendre, à la manière des recueils de poème. La musicalité de sa prose donne aussi de la matière aux paysages et aux situations décrites.
"L'Empereur d'Occident" en est un bon exemple, où l'on assiste à la rencontre d'un militaire des armées de Rome envoyé sur les côtes siciliennes pour des opérations de police avec un vieil homme vivant dans une villa isolée sur le bord de mer, face au Stromboli. Les récits du vieux sage nous font revivre l'épopée d'Alaric, celui qui fit plier la ville de Rome, celui qui alluma pour la première fois la lumière du déclin.
"L'Empereur d'Occident" en est un bon exemple, où l'on assiste à la rencontre d'un militaire des armées de Rome envoyé sur les côtes siciliennes pour des opérations de police avec un vieil homme vivant dans une villa isolée sur le bord de mer, face au Stromboli. Les récits du vieux sage nous font revivre l'épopée d'Alaric, celui qui fit plier la ville de Rome, celui qui alluma pour la première fois la lumière du déclin.
Texte assez petit qui narre la rencontre et le dialogue entre un décurion et un vieil homme ancien allié de l'empereur Alaric. le style est toujours génial, parfois ampoulé mais il demeure une référence de la langue française parmi nos auteurs vivants. de la poésie en prose est l'expression qui décrirait le mieux la joliesse du style de Pierre Michon. Et l'on est transporté par la musique des mots, par l'harmonie des phrases, par la fluidité du récit. Quand on lit un livre de Pierre Michon on sait d'avance que l'expérience stylistique sera extraordinaire. Mais comme dans [b]Rimbaud le fils[/b] je ne fus pas intéressé par le sujet. je n'en ai ressenti aucune déception ni aucune amertume car si un jour le sujet d'un livre de Pierre Michon s'associe à son style et que j'en fais l'expérience je toucherais alors la perfection et ce serait peut être la fin de ma vie de lecteur. heureusement Je n'en suis pas là et je peux continuer à lire et me satisfaire que tout ne soit pas parfait chez Pierre Michon. La beauté de son texte est déjà un plaisir immodéré.
Citations et extraits (12)
Voir plus
Ajouter une citation
Le voilà mort. Tout le monde connaît la suite. On sait ce qu’il voulut, et ce qui fut fait. Un fleuve coulait là, épais, noir, dans les fonds aux forêts tombées, le Busentin : trois jours toute la Scythie éplorée, furibonde, avec des pelles, des glaives, à pleins boucliers, creusa un bief parallèle au fleuve, dans des nuées de moustiques ; toute cette armée de boue, de langues mêlées, s’enlisa jusqu’aux cuisses, dans ses casques cornus à bout de bras porta de la terre morte, brisa des chênes comme elle l’avait fait des colonnes dans les temples, et de même qu’en brisant des temples chanta des psaumes, pour un grand cadavre qui attendait, la face tournée vers les nuages ; cette armée pour qui rien de ténu ne chanterait plus, mais qui peut-être accomplissait, définitif, son plus haut fait d’armes. Et quand toute l’eau se fut en maugréant engouffrée dans le bief, quand le lit franc du fleuve fut à sec, dans cette boue où des carpes crevaient, où des racines spectrales étaient pour la première et dernière fois surprises par le jour, toute la Scythie descendit là-dedans, pataugeante, geignante et pathétique comme les légions de Germanie ressuscitées retourneraient à leurs tourbières, toute la Scythie fit encore un grand trou, y précipita les trophées pris à Rome, les dieux et les petits objets familiers qui furent chers aux Sabins, à Carthage, aux Grecs, le labarum sous quoi marchait Constantin, sept siècles de victoire, et par là-dessus enfin jeta comme un sac d’or et de pelisse le roi qui s’enfonça doucement dans de gros remous, et, ventre à l’air, disparut soudain sous les carpes. Alors, avec des psaumes accrus comme pour l’assaut final, à grands coups de glaive ou à pleines mains, la Scythie exultante rompit les digues du bief, et toute l’eau du monde, tumultueuse, sourde, passa tout naturellement sur le corps d’un principicule scythe qui avait marché dans Rome en avant des Césars. Sur cette rive je chantai, une fois pour toutes.
Pierre Michon, L’empereur d’Occident
Pierre Michon, L’empereur d’Occident
Il avait exercé des charges ; deux doigts manquaient à sa main droite ; il n'était plus jeune, vêtu avec une insouciance lasse, et à l'étonnement hautain des sourcils, à une lourdeur sinueuse des mâchoires sous la barbe souple,au nez trop visible, je reconnus un Levantin. Il était chauve ; il était immobile, assis. il cillait un peu pour retenir l'image d'une voile fuyante, emportée de ce-ci, de-là, sans recours s'amenuisant, vers l'île Stromboli, ou le blanc révélé du ventre des mouettes quand face au soleil elle virent de bord, se cabrent avec lenteur, s'offrent sans fin. Il voulait jouir des choses, sans doute ; il était myope. Ou eut-être ne regardait-il rien que la mer, l'étendue qu'on n'étreint pas, la trop vieille métaphore insensée.
Je suis le fils de Gaudentius, qui fût maître général de la cavalerie dans les territoires scythes ; à la haute fonction de mon père, je dois une enfance de prison dorée et de vacance perpétuelle, un caractère de garçon trop gâté et toujours menacé de mort. Gaudentius traitait avec les barbares turbulents des marches, que déjà les seules armes ne pouvaient contenir ; en gage de sa bonne foi, il me cédait comme otage à ceux avec qui il passait alliance.
Nous parlions. Il parlait plutôt, avec de très longs silences, des mots soudain suspendus comme son geste, des arrêts fascinés qui nous rejetaient dans la contemplation de la mer, jusqu’à ce qu’elle devînt violette, puis noire, et qu’alors nous nous quittions sans plus de discours, à moins qu’un mot de moi n’ait relancé sa parole ténue, ce petit souffle vite perdu qui était sa vie même et la prolongeait encore une fois jusqu’à la nuit, jusqu’à ce pastiche bruissant et visible de l’invisible, du silence, et dans sa bouche que je ne voyais plus le récit de sa vie devenait la nuit même, ce chuchotement obstiné où une à une apparaissaient les étoiles. Il mentait.
On dit que ses quelques discours furent obscurs, creux, ampoulés ; je veux bien le croire : il était peu apte à la limpidité forcée des politiques, à ce fantôme de la parole quand elle est efficace, citoyenne ; il aimait et craignait le verbe, son clinquant dans le jour, son pouvoir vide, sonore.
Videos de Pierre Michon (39)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Quel roman, devenu culte, rend un hommage sublime aux vies humbles et silencieuses ? Par un écrivain devenu culte, lui aussi…
« Vies minuscules », de Pierre Michon, c'est à lire en poche chez Folio.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Quel roman, devenu culte, rend un hommage sublime aux vies humbles et silencieuses ? Par un écrivain devenu culte, lui aussi…
« Vies minuscules », de Pierre Michon, c'est à lire en poche chez Folio.
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
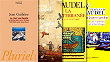
Méditerranée(s)
Antiochos
28 livres
Autres livres de Pierre Michon (21)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
438 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre438 lecteurs ont répondu