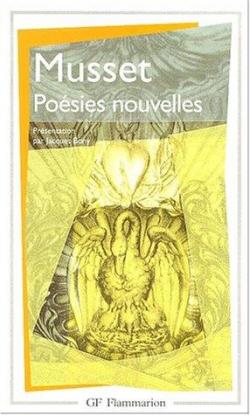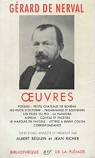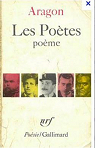*RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE* :
« La confession d'un enfant du siècle », _in_ _Oeuvres de Alfred de Musset,_ ornées de dessins de M. Bida, Paris, Charpentier, 1867, p. 432.
#AlfredDeMusset #LaConfessionDUnEnfantDuSiècle #LittératureFrançaise

Alfred de Musset/5
21 notes
Résumé :
Le recueil "Poésies nouvelles" comprends soixante et onze poèmes d'Alfred de Musset.
Ces poèmes ont été écrits entre 1836 et 1852.
Ces poèmes ont été écrits entre 1836 et 1852.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Poésies nouvelles (1836-1852)Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Premières poesies,premiers écrits d'un jeune Musset qui etait né pour l'écriture. Est ce pourtant seulement un brouillon ?Non,déjà tout est là.....Son romantisme charnel,cette quête de passions et d'amours absolus sont présents en ces textes, mais aussi cette sourde désespérance de savoir qu'il ne peut avoir l'une sans abandonner l'autre .Musset consumma sa vie comme il consumma son oeuvre. Il fut le poète de l'instant amoureux,du premier regard et de la passion qu'il s'avait vite enfuie .Il n'en n'en est que plus attachant dans l'amertume grandissante de sa vie,peut-être était -il conscient de sa brièveté et contrairement à Hugo ,son oeuvre n'était pas un piédestal pour son immortalité.
Citations et extraits (22)
Voir plus
Ajouter une citation
« Oui, j’écris rarement, et me plais de le faire :
Non pas que la paresse en moi soit ordinaire ;
Mais, sitôt que je prends la plume à ce dessein,
Je crois prendre en galère une rame à la main. »
Qui croyez-vous, mon cher, qui parle de la sorte ?
C’est Alfred, direz-vous, ou le diable m’emporte !
Non, ami. Plût à Dieu que j’eusse dit si bien
Et si net et si court, pourquoi je ne dis rien !
L’esprit mâle et hautain dont la sobre pensée
Fut dans ces rudes vers librement cadencée
(Ôtez votre chapeau), c’est Mathurin Régnier,
De l’immortel Molière immortel devancier,
Qui ploya notre langue, et dans sa cire molle
Sut pétrir et dresser la romaine hyperbole ;
Premier maître jadis sous lequel j’écrivis,
Alors que du voisin je prenais les avis,
Et qui me fut montré, dans l’âge où tout s’ignore,
Par de plus fiers que moi, qui l’imitent encore ;
Mais la cause était bonne, et, quel qu’en soit l’effet,
Quiconque m’a fait voir cette route a bien fait.
Or je me demandais hier dans la solitude :
Ce cœur sans peur, sans gêne et sans inquiétude,
Qui vécut et mourut dans un si brave ennui,
S’il se taisait jadis, qu’eût-il fait aujourd’hui ?
Alors à mon esprit se présentaient en hâte
Nos vices, nos travers, et toute cette pâte
Dont il aurait su faire un plat de son métier
À nous désopiler pendant un siècle entier :
D’abord, le grand fléau qui nous rend tous malades,
Le seigneur Journalisme et ses pantalonnades,
Ce droit quotidien qu’un sot a de berner
Trois ou quatre milliers de sots, à déjeuner ;
Le règne du papier, l’abus de l’écriture,
Qui d’un plat feuilleton fait une dictature,
Tonneau d’encre bourbeux par Fréron défoncé,
Dont, jusque sur le trône, on est éclaboussé ;
En second lieu, nos mœurs, qui se croient plus sévères,
Parce que nous cachons et nous rinçons nos verres,
Quand nous avons commis dans quelque coin honteux
Ces éternels péchés dont pouffaient nos aïeux ;
Puis nos discours pompeux, nos fleurs de bavardage,
L’esprit européen de nos coqs de village,
Ce bel art si choisi d’offenser poliment,
Et de se souffleter parlementairement ;
Puis, nos livres mort-nés, nos poussives chimères,
Pâture des portiers ; et ces pauvres commères,
Qui, par besoin d’amants ou faute de maris,
Font du moins leur besogne en pondant leurs écrits ;
Ensuite, un mal profond, la croyance envolée,
La prière inquiète, errante et désolée,
Et, pour qui joint les mains, pour qui lève les yeux,
Une croix en poussière et le désert aux cieux ;
Ensuite, un mal honteux, le bruit de la monnaie,
La jouissance brute et qui croit être vraie,
La mangeaille, le vin, l’égoïsme hébété,
Qui se berce en ronflant dans sa brutalité ;
Puis un tyran moderne, une peste nouvelle,
lia médiocrité, qui ne comprend rien qu’elle,
Qui, pour chauffer la cuve où son fer fume et bout,
Y jetterait le bronze où César est debout,
Instinct de la basoche, odeur d’épicerie,
Qui fait lever le cœur à la mère patrie,
Capable, avec le temps, de la déshonorer,
Si sa fierté native en pouvait s’altérer ;
Ensuite, un tort léger, tant il est ridicule,
Et qui ne vaut pas même un revers de férule,
Les lamentations des chercheurs d’avenir,
Ceux qui disent : Ma sœur, ne vois-tu rien venir ?
Puis, un mal dangereux qui touche à tous les crimes,
La sourde ambition de ces tristes maximes
Qui ne sont même pas de vieilles vérités,
Et qu’on vient nous donner comme des nouveautés ;
Vieux galons de Rousseau, défroque de Voltaire,
Carmagnole en haillons volée à Robespierre,
Charmante garde-robe où sont emmaillotés
Du peuple souverain les courtisans crottés ;
Puis enfin, tout au bas, la dernière de toutes,
La fièvre de ces fous qui s’en vont par les routes
Arracher la charrue aux mains du laboureur,
Dans l’atelier désert corrompre le malheur,
Au nom d’un Dieu de paix qui nous prescrit l’aumône
Traîner au carrefour le pauvre qui frissonne,
D’un fer rouillé de sang armer sa maigre main,
Et se sauver dans l’ombre en poussant l’assassin.
Qu’aurait dit à cela ce grand traîneur d’épée,
Ce flâneur « qui prenait les vers à la pipée ? »
Si dans ce gouffre obscur son regard eût plongé,
Sous quel étrange aspect l’eût-il envisagé ?
Quelle affreuse tristesse ou quel rire homérique
Eût ouvert ou serré ce cœur mélancolique ?
Se fût-il contenté de nous prendre en pitié,
De consoler sa vie avec quelque amitié,
Et de laisser la foule étourdir ses oreilles,
Comme un berger qui dort au milieu des abeilles ?
Ou bien, le cœur ému d’un mépris généreux,
Aurait-il là-dessus versé, comme un vin vieux,
Ses hardis hiatus, flot jailli du Parnasse,
Où Despréaux mêla sa tisane à la glace ?
Certes, s’il eût parlé, ses robustes gros mots
Auraient de pied en cap ébouriffé les sots :
Qu’il se fût abattu sur une telle proie,
L’ombre de Juvénal en eût frémi de joie,
Et sur ce noir torrent qui mène tout à rien
Quelques mots flotteraient, dits pour les gens de bien.
Franchise du vieux temps, muse de la patrie,
Où sont ta verte allure et ta sauvagerie ?
Comme ils tressailliraient, les paternels tombeaux,
Si ta voix douce et rude en frappait les échos !
Comme elles tomberaient, nos gloires mendiées,
De patois étrangers nos muses barbouillées,
Devant toi qui puisas ton immortalité
Dans ta beauté féconde et dans ta liberté !
Avec quelle rougeur et quel piteux visage
Notre bégueulerie entendrait ton langage,
Toi qu’un juron gaulois n’a jamais fait bouder,
Et qui, ne craignant rien, ne sais rien marchander !
Quel régiment de fous, que de marionnettes,
Quel troupeau de mulets dandinant leurs sonnettes,
Quelle procession de pantins désolés,
Passeraient devant nous, par ta voix appelés !
Et quel plaisir de voir, sans masque ni lisières,
À travers le chaos de nos folles misères,
Courir en souriant tes beaux vers ingénus,
Tantôt légers, tantôt boiteux, toujours pieds nus !
Gaieté, génie heureux, qui fus jadis le nôtre,
Rire dont on riait d’un bout du monde à l’autre,
Esprit de nos aïeux, qui te réjouissais
Dans l’éternel bon sens, lequel est né français,
Fleurs de notre pays, qu’êtes-vous devenues ?
L’aigle s’est-il lassé de planer dans les nues,
Et de tenir toujours son regard arrêté
Sur l’astre tout-puissant d’où jaillit la clarté ?
Voilà donc, l’autre soir, quelle était ma pensée,
Et plus je m’y tenais la cervelle enfoncée,
Moins je m’imaginais que le vieux Mathurin
Eût montré, de ce temps, ni gaieté ni chagrin.
Eh quoi ! me direz-vous, il nous eût laissés faire.
Lui qu’un mauvais diner pouvait mettre en colère !
Lui qui s’effarouchait, grand enfant sans raison,
D’une femme infidèle et d’une trahison !
Lui qui se redressait, comme un serpent dans l’herbe,
Pour une balourdise échappée à Malherbe,
Et qui poussa l’oubli de tout respect humain
Jusqu’à daigner rosser Berthelot de sa main !
Oui, mon cher, ce même homme, et par la raison même
Que son cœur débordant poussait tout à l’extrême,
Et qu’au moindre sujet qui venait l’animer,
Sachant si bien haïr, il savait tant aimer.
Il eût trouvé ce siècle indigne de satire,
Trop vain pour en pleurer, trop triste pour en rire.
Et, quel qu’en fût son rêve, il l’eût voulu garder.
Il n’est que trop facile, à qui sait regarder,
De comprendre pourquoi tout est malade en France ;
Le mal des gens d’esprit, c’est leur indifférence,
Celui des gens de cœur, leur inutilité.
Mais à quoi bon venir prêcher la vérité,
Et devant les badauds étaler sa faconde,
Pour répéter en vers ce que dit tout le monde ?
Sur notre état présent qui s’abuse aujourd’hui ?
Comme dit Figaro : Qui trompe-t-on ici ?
D’ailleurs, est-ce un plaisir d’exprimer sa pensée ?
L’hirondelle s’envole, un goujat l’a blessée ;
Elle tombe, palpite et meurt, et le passant
Aperçoit par hasard son pied taché de sang.
Hélas ! pensée écrite, hirondelle envolée !
Dieu sait par quel chemin elle s’en est allée,
Et quelle main la tue au sortir de son nid !
Non, j’en suis convaincu, Mathurin n’eût rien dit.
Ce n’est pas, en parlant, qu’il en eût craint la suite ;
Sa tête allait bon train, son cœur encor plus vite,
Et de lui dire non à ce qu’il avait vu
Un journaliste même eût été mal venu.
Il n’eût pas craint non plus que sa faveur trahie
Eût fait au cardinal rayer son abbaye ;
Des compliments de cour et des canonicats,
Si ce n’est pour l’argent, il n’en fit pas grand cas.
Encor moins eût-il craint qu’on fût venu lui dire :
Et vous, d’où venez-vous pour faire une satire ?
De quel droit parlez-vous, n’ayant jamais rien fait
Que d’aller chez Margot, sortant du cabaret ?
Car il eût répondu : N’en soyez point en peine :
Plus que votre bon sens ma déraison est saine ;
Chancelant que je suis de ce jus du caveau,
Plus honnête est mon cœur, et plus franc mon cerveau
Que vos grands airs chantés d’un ton de Jérémie.
À la barbe du siècle il eût aimé sa mie,
Et qui l’eût abordé n’aurait eu pour tout prix
Que beaucoup de silence, et qu’un peu de mépris.
Ami, vous qui voyez vivre, et qui savez comme,
Vous dont l’habileté fut d’être un honnête homme,
À vous s’en vont ces vers, au hasard ébauchés,
Qui vaudraient encor moins s’ils étaient plus cherchés.
Mais vous me reprochez sans cesse mon silence ;
C’est vrai : l’ennui m’a pris de penser en cadence,
Et c’est pourquoi, lisant ces vers d’un fainéant
Qui n’a fait que trois pas, mais trois pas de géant,
De vous les envoyer il m’a pris fantaisie.
Afin que vous sachiez comment la poésie
A vécu de tout temps, et que les paresseux
Ont été quelquefois des gens aimés des dieux.
Après cela, mon cher, je désire et j’espère
(Pour finir à peu près par un vers de Molière)
Que vous vous guérirez du soin que vous prenez
De me venir toujours jeter ma lyre au nez.
Non pas que la paresse en moi soit ordinaire ;
Mais, sitôt que je prends la plume à ce dessein,
Je crois prendre en galère une rame à la main. »
Qui croyez-vous, mon cher, qui parle de la sorte ?
C’est Alfred, direz-vous, ou le diable m’emporte !
Non, ami. Plût à Dieu que j’eusse dit si bien
Et si net et si court, pourquoi je ne dis rien !
L’esprit mâle et hautain dont la sobre pensée
Fut dans ces rudes vers librement cadencée
(Ôtez votre chapeau), c’est Mathurin Régnier,
De l’immortel Molière immortel devancier,
Qui ploya notre langue, et dans sa cire molle
Sut pétrir et dresser la romaine hyperbole ;
Premier maître jadis sous lequel j’écrivis,
Alors que du voisin je prenais les avis,
Et qui me fut montré, dans l’âge où tout s’ignore,
Par de plus fiers que moi, qui l’imitent encore ;
Mais la cause était bonne, et, quel qu’en soit l’effet,
Quiconque m’a fait voir cette route a bien fait.
Or je me demandais hier dans la solitude :
Ce cœur sans peur, sans gêne et sans inquiétude,
Qui vécut et mourut dans un si brave ennui,
S’il se taisait jadis, qu’eût-il fait aujourd’hui ?
Alors à mon esprit se présentaient en hâte
Nos vices, nos travers, et toute cette pâte
Dont il aurait su faire un plat de son métier
À nous désopiler pendant un siècle entier :
D’abord, le grand fléau qui nous rend tous malades,
Le seigneur Journalisme et ses pantalonnades,
Ce droit quotidien qu’un sot a de berner
Trois ou quatre milliers de sots, à déjeuner ;
Le règne du papier, l’abus de l’écriture,
Qui d’un plat feuilleton fait une dictature,
Tonneau d’encre bourbeux par Fréron défoncé,
Dont, jusque sur le trône, on est éclaboussé ;
En second lieu, nos mœurs, qui se croient plus sévères,
Parce que nous cachons et nous rinçons nos verres,
Quand nous avons commis dans quelque coin honteux
Ces éternels péchés dont pouffaient nos aïeux ;
Puis nos discours pompeux, nos fleurs de bavardage,
L’esprit européen de nos coqs de village,
Ce bel art si choisi d’offenser poliment,
Et de se souffleter parlementairement ;
Puis, nos livres mort-nés, nos poussives chimères,
Pâture des portiers ; et ces pauvres commères,
Qui, par besoin d’amants ou faute de maris,
Font du moins leur besogne en pondant leurs écrits ;
Ensuite, un mal profond, la croyance envolée,
La prière inquiète, errante et désolée,
Et, pour qui joint les mains, pour qui lève les yeux,
Une croix en poussière et le désert aux cieux ;
Ensuite, un mal honteux, le bruit de la monnaie,
La jouissance brute et qui croit être vraie,
La mangeaille, le vin, l’égoïsme hébété,
Qui se berce en ronflant dans sa brutalité ;
Puis un tyran moderne, une peste nouvelle,
lia médiocrité, qui ne comprend rien qu’elle,
Qui, pour chauffer la cuve où son fer fume et bout,
Y jetterait le bronze où César est debout,
Instinct de la basoche, odeur d’épicerie,
Qui fait lever le cœur à la mère patrie,
Capable, avec le temps, de la déshonorer,
Si sa fierté native en pouvait s’altérer ;
Ensuite, un tort léger, tant il est ridicule,
Et qui ne vaut pas même un revers de férule,
Les lamentations des chercheurs d’avenir,
Ceux qui disent : Ma sœur, ne vois-tu rien venir ?
Puis, un mal dangereux qui touche à tous les crimes,
La sourde ambition de ces tristes maximes
Qui ne sont même pas de vieilles vérités,
Et qu’on vient nous donner comme des nouveautés ;
Vieux galons de Rousseau, défroque de Voltaire,
Carmagnole en haillons volée à Robespierre,
Charmante garde-robe où sont emmaillotés
Du peuple souverain les courtisans crottés ;
Puis enfin, tout au bas, la dernière de toutes,
La fièvre de ces fous qui s’en vont par les routes
Arracher la charrue aux mains du laboureur,
Dans l’atelier désert corrompre le malheur,
Au nom d’un Dieu de paix qui nous prescrit l’aumône
Traîner au carrefour le pauvre qui frissonne,
D’un fer rouillé de sang armer sa maigre main,
Et se sauver dans l’ombre en poussant l’assassin.
Qu’aurait dit à cela ce grand traîneur d’épée,
Ce flâneur « qui prenait les vers à la pipée ? »
Si dans ce gouffre obscur son regard eût plongé,
Sous quel étrange aspect l’eût-il envisagé ?
Quelle affreuse tristesse ou quel rire homérique
Eût ouvert ou serré ce cœur mélancolique ?
Se fût-il contenté de nous prendre en pitié,
De consoler sa vie avec quelque amitié,
Et de laisser la foule étourdir ses oreilles,
Comme un berger qui dort au milieu des abeilles ?
Ou bien, le cœur ému d’un mépris généreux,
Aurait-il là-dessus versé, comme un vin vieux,
Ses hardis hiatus, flot jailli du Parnasse,
Où Despréaux mêla sa tisane à la glace ?
Certes, s’il eût parlé, ses robustes gros mots
Auraient de pied en cap ébouriffé les sots :
Qu’il se fût abattu sur une telle proie,
L’ombre de Juvénal en eût frémi de joie,
Et sur ce noir torrent qui mène tout à rien
Quelques mots flotteraient, dits pour les gens de bien.
Franchise du vieux temps, muse de la patrie,
Où sont ta verte allure et ta sauvagerie ?
Comme ils tressailliraient, les paternels tombeaux,
Si ta voix douce et rude en frappait les échos !
Comme elles tomberaient, nos gloires mendiées,
De patois étrangers nos muses barbouillées,
Devant toi qui puisas ton immortalité
Dans ta beauté féconde et dans ta liberté !
Avec quelle rougeur et quel piteux visage
Notre bégueulerie entendrait ton langage,
Toi qu’un juron gaulois n’a jamais fait bouder,
Et qui, ne craignant rien, ne sais rien marchander !
Quel régiment de fous, que de marionnettes,
Quel troupeau de mulets dandinant leurs sonnettes,
Quelle procession de pantins désolés,
Passeraient devant nous, par ta voix appelés !
Et quel plaisir de voir, sans masque ni lisières,
À travers le chaos de nos folles misères,
Courir en souriant tes beaux vers ingénus,
Tantôt légers, tantôt boiteux, toujours pieds nus !
Gaieté, génie heureux, qui fus jadis le nôtre,
Rire dont on riait d’un bout du monde à l’autre,
Esprit de nos aïeux, qui te réjouissais
Dans l’éternel bon sens, lequel est né français,
Fleurs de notre pays, qu’êtes-vous devenues ?
L’aigle s’est-il lassé de planer dans les nues,
Et de tenir toujours son regard arrêté
Sur l’astre tout-puissant d’où jaillit la clarté ?
Voilà donc, l’autre soir, quelle était ma pensée,
Et plus je m’y tenais la cervelle enfoncée,
Moins je m’imaginais que le vieux Mathurin
Eût montré, de ce temps, ni gaieté ni chagrin.
Eh quoi ! me direz-vous, il nous eût laissés faire.
Lui qu’un mauvais diner pouvait mettre en colère !
Lui qui s’effarouchait, grand enfant sans raison,
D’une femme infidèle et d’une trahison !
Lui qui se redressait, comme un serpent dans l’herbe,
Pour une balourdise échappée à Malherbe,
Et qui poussa l’oubli de tout respect humain
Jusqu’à daigner rosser Berthelot de sa main !
Oui, mon cher, ce même homme, et par la raison même
Que son cœur débordant poussait tout à l’extrême,
Et qu’au moindre sujet qui venait l’animer,
Sachant si bien haïr, il savait tant aimer.
Il eût trouvé ce siècle indigne de satire,
Trop vain pour en pleurer, trop triste pour en rire.
Et, quel qu’en fût son rêve, il l’eût voulu garder.
Il n’est que trop facile, à qui sait regarder,
De comprendre pourquoi tout est malade en France ;
Le mal des gens d’esprit, c’est leur indifférence,
Celui des gens de cœur, leur inutilité.
Mais à quoi bon venir prêcher la vérité,
Et devant les badauds étaler sa faconde,
Pour répéter en vers ce que dit tout le monde ?
Sur notre état présent qui s’abuse aujourd’hui ?
Comme dit Figaro : Qui trompe-t-on ici ?
D’ailleurs, est-ce un plaisir d’exprimer sa pensée ?
L’hirondelle s’envole, un goujat l’a blessée ;
Elle tombe, palpite et meurt, et le passant
Aperçoit par hasard son pied taché de sang.
Hélas ! pensée écrite, hirondelle envolée !
Dieu sait par quel chemin elle s’en est allée,
Et quelle main la tue au sortir de son nid !
Non, j’en suis convaincu, Mathurin n’eût rien dit.
Ce n’est pas, en parlant, qu’il en eût craint la suite ;
Sa tête allait bon train, son cœur encor plus vite,
Et de lui dire non à ce qu’il avait vu
Un journaliste même eût été mal venu.
Il n’eût pas craint non plus que sa faveur trahie
Eût fait au cardinal rayer son abbaye ;
Des compliments de cour et des canonicats,
Si ce n’est pour l’argent, il n’en fit pas grand cas.
Encor moins eût-il craint qu’on fût venu lui dire :
Et vous, d’où venez-vous pour faire une satire ?
De quel droit parlez-vous, n’ayant jamais rien fait
Que d’aller chez Margot, sortant du cabaret ?
Car il eût répondu : N’en soyez point en peine :
Plus que votre bon sens ma déraison est saine ;
Chancelant que je suis de ce jus du caveau,
Plus honnête est mon cœur, et plus franc mon cerveau
Que vos grands airs chantés d’un ton de Jérémie.
À la barbe du siècle il eût aimé sa mie,
Et qui l’eût abordé n’aurait eu pour tout prix
Que beaucoup de silence, et qu’un peu de mépris.
Ami, vous qui voyez vivre, et qui savez comme,
Vous dont l’habileté fut d’être un honnête homme,
À vous s’en vont ces vers, au hasard ébauchés,
Qui vaudraient encor moins s’ils étaient plus cherchés.
Mais vous me reprochez sans cesse mon silence ;
C’est vrai : l’ennui m’a pris de penser en cadence,
Et c’est pourquoi, lisant ces vers d’un fainéant
Qui n’a fait que trois pas, mais trois pas de géant,
De vous les envoyer il m’a pris fantaisie.
Afin que vous sachiez comment la poésie
A vécu de tout temps, et que les paresseux
Ont été quelquefois des gens aimés des dieux.
Après cela, mon cher, je désire et j’espère
(Pour finir à peu près par un vers de Molière)
Que vous vous guérirez du soin que vous prenez
De me venir toujours jeter ma lyre au nez.
La nuit d'août
La muse
Depuis que le soleil, dans l'horizon immense,
A franchi le Cancer sur son axe enflammé,
Le bonheur m'a quittée, et j'attends en silence
L'heure où m'appellera mon ami bien-aimé.
Hélas ! depuis longtemps sa demeure est déserte ;
Des beaux jours d'autrefois rien n'y semble vivant.
Seule, je viens encor, de mon voile couverte,
Poser mon front brûlant sur sa porte entr'ouverte,
Comme une veuve en pleurs au tombeau d'un enfant.
Le poète
Salut à ma fidèle amie !
Salut, ma gloire et mon amour !
La meilleure et la plus chérie
Est celle qu'on trouve au retour.
L'opinion et l'avarice
Viennent un temps de m'emporter.
Salut, ma mère et ma nourrice !
Salut, salut consolatrice !
Ouvre tes bras, je viens chanter.
La muse
Pourquoi, coeur altéré, coeur lassé d'espérance,
T'enfuis-tu si souvent pour revenir si tard ?
Que t'en vas-tu chercher, sinon quelque hasard ?
Et que rapportes-tu, sinon quelque souffrance ?
Que fais-tu loin de moi, quand j'attends jusqu'au jour ?
Tu suis un pâle éclair dans une nuit profonde.
Il ne te restera de tes plaisirs du monde
Qu'un impuissant mépris pour notre honnête amour.
Ton cabinet d'étude est vide quand j'arrive ;
Tandis qu'à ce balcon, inquiète et pensive,
Je regarde en rêvant les murs de ton jardin,
Tu te livres dans l'ombre à ton mauvais destin.
Quelque fière beauté te retient dans sa chaîne,
Et tu laisses mourir cette pauvre verveine
Dont les derniers rameaux, en des temps plus heureux,
Devaient être arrosés des larmes de tes yeux.
Cette triste verdure est mon vivant symbole ;
Ami, de ton oubli nous mourrons toutes deux,
Et son parfum léger, comme l'oiseau qui vole,
Avec mon souvenir s'enfuira dans les cieux.
Le poète
Quand j'ai passé par la prairie,
J'ai vu, ce soir, dans le sentier,
Une fleur tremblante et flétrie,
Une pâle fleur d'églantier.
Un bourgeon vert à côté d'elle
Se balançait sur l'arbrisseau ;
Je vis poindre une fleur nouvelle ;
La plus jeune était la plus belle :
L'homme est ainsi, toujours nouveau.
La muse
Hélas ! toujours un homme, hélas ! toujours des larmes !
Toujours les pieds poudreux et la sueur au front !
Toujours d'affreux combats et de sanglantes armes ;
Le coeur a beau mentir, la blessure est au fond.
Hélas ! par tous pays, toujours la même vie :
Convoiter, regretter, prendre et tendre la main ;
Toujours mêmes acteurs et même comédie,
Et, quoi qu'ait inventé l'humaine hypocrisie,
Rien de vrai là-dessous que le squelette humain.
Hélas ! mon bien-aimé, vous n'êtes plus poète.
Rien ne réveille plus votre lyre muette ;
Vous vous noyez le coeur dans un rêve inconstant ;
Et vous ne savez pas que l'amour de la femme
Change et dissipe en pleurs les trésors de votre âme,
Et que Dieu compte plus les larmes que le sang.
Le poète
Quand j'ai traversé la vallée,
Un oiseau chantait sur son nid.
Ses petits, sa chère couvée,
Venaient de mourir dans la nuit.
Cependant il chantait l'aurore ;
Ô ma Muse, ne pleurez pas !
À qui perd tout, Dieu reste encore,
Dieu là-haut, l'espoir ici-bas.
La muse
Et que trouveras-tu, le jour où la misère
Te ramènera seul au paternel foyer ?
Quand tes tremblantes mains essuieront la poussière
De ce pauvre réduit que tu crois oublier,
De quel front viendras-tu, dans ta propre demeure,
Chercher un peu de calme et d'hospitalité ?
Une voix sera là pour crier à toute heure :
Qu'as-tu fait de ta vie et de ta liberté ?
Crois-tu donc qu'on oublie autant qu'on le souhaite ?
Crois-tu qu'en te cherchant tu te retrouveras ?
De ton coeur ou de toi lequel est Le poète ?
C'est ton coeur, et ton coeur ne te répondra pas.
L'amour l'aura brisé ; les passions funestes
L'auront rendu de pierre au contact des méchants ;
Tu n'en sentiras plus que d'effroyables restes,
Qui remueront encor, comme ceux des serpents.
Ô ciel ! qui t'aidera ? que ferai-je moi-même,
Quand celui qui peut tout défendra que je t'aime,
Et quand mes ailes d'or, frémissant malgré moi,
M'emporteront à lui pour me sauver de toi ?
Pauvre enfant ! nos amours n'étaient pas menacées,
Quand dans les bois d'Auteuil, perdu dans tes pensées,
Sous les verts marronniers et les peupliers blancs,
Je t'agaçais le soir en détours nonchalants.
Ah ! j'étais jeune alors et nymphe, et les dryades
Entr'ouvraient pour me voir l'écorce des bouleaux,
Et les pleurs qui coulaient durant nos promenades
Tombaient, purs comme l'or, dans le cristal des eaux.
Qu'as-tu fait, mon amant, des jours de ta jeunesse ?
Qui m'a cueilli mon fruit sur mon arbre enchanté ?
Hélas ! ta joue en fleur plaisait à la déesse
Qui porte dans ses mains la force et la santé.
De tes yeux insensés les larmes l'ont pâlie ;
Ainsi que ta beauté, tu perdras ta vertu.
Et moi qui t'aimerai comme une unique amie,
Quand les dieux irrités m'ôteront ton génie,
Si je tombe des cieux, que me répondras-tu ?
Le poète
Puisque l'oiseau des bois voltige et chante encore
Sur la branche où ses oeufs sont brisés dans le nid ;
Puisque la fleur des champs entr'ouverte à l'aurore,
Voyant sur la pelouse une autre fleur éclore,
S'incline sans murmure et tombe avec la nuit,
Puisqu'au fond des forêts, sous les toits de verdure,
On entend le bois mort craquer dans le sentier,
Et puisqu'en traversant l'immortelle nature,
L'homme n'a su trouver de science qui dure,
Que de marcher toujours et toujours oublier ;
Puisque, jusqu'aux rochers tout se change en poussière ;
Puisque tout meurt ce soir pour revivre demain ;
Puisque c'est un engrais que le meurtre et la guerre ;
Puisque sur une tombe on voit sortir de terre
Le brin d'herbe sacré qui nous donne le pain ;
Ô Muse ! que m'importe ou la mort ou la vie ?
J'aime, et je veux pâlir ; j'aime et je veux souffrir ;
J'aime, et pour un baiser je donne mon génie ;
J'aime, et je veux sentir sur ma joue amaigrie
Ruisseler une source impossible à tarir.
J'aime, et je veux chanter la joie et la paresse,
Ma folle expérience et mes soucis d'un jour,
Et je veux raconter et répéter sans cesse
Qu'après avoir juré de vivre sans maîtresse,
J'ai fait serment de vivre et de mourir d'amour.
Dépouille devant tous l'orgueil qui te dévore,
Coeur gonflé d'amertume et qui t'es cru fermé.
Aime, et tu renaîtras ; fais-toi fleur pour éclore.
Après avoir souffert, il faut souffrir encore ;
Il faut aimer sans cesse, après avoir aimé.
La muse
Depuis que le soleil, dans l'horizon immense,
A franchi le Cancer sur son axe enflammé,
Le bonheur m'a quittée, et j'attends en silence
L'heure où m'appellera mon ami bien-aimé.
Hélas ! depuis longtemps sa demeure est déserte ;
Des beaux jours d'autrefois rien n'y semble vivant.
Seule, je viens encor, de mon voile couverte,
Poser mon front brûlant sur sa porte entr'ouverte,
Comme une veuve en pleurs au tombeau d'un enfant.
Le poète
Salut à ma fidèle amie !
Salut, ma gloire et mon amour !
La meilleure et la plus chérie
Est celle qu'on trouve au retour.
L'opinion et l'avarice
Viennent un temps de m'emporter.
Salut, ma mère et ma nourrice !
Salut, salut consolatrice !
Ouvre tes bras, je viens chanter.
La muse
Pourquoi, coeur altéré, coeur lassé d'espérance,
T'enfuis-tu si souvent pour revenir si tard ?
Que t'en vas-tu chercher, sinon quelque hasard ?
Et que rapportes-tu, sinon quelque souffrance ?
Que fais-tu loin de moi, quand j'attends jusqu'au jour ?
Tu suis un pâle éclair dans une nuit profonde.
Il ne te restera de tes plaisirs du monde
Qu'un impuissant mépris pour notre honnête amour.
Ton cabinet d'étude est vide quand j'arrive ;
Tandis qu'à ce balcon, inquiète et pensive,
Je regarde en rêvant les murs de ton jardin,
Tu te livres dans l'ombre à ton mauvais destin.
Quelque fière beauté te retient dans sa chaîne,
Et tu laisses mourir cette pauvre verveine
Dont les derniers rameaux, en des temps plus heureux,
Devaient être arrosés des larmes de tes yeux.
Cette triste verdure est mon vivant symbole ;
Ami, de ton oubli nous mourrons toutes deux,
Et son parfum léger, comme l'oiseau qui vole,
Avec mon souvenir s'enfuira dans les cieux.
Le poète
Quand j'ai passé par la prairie,
J'ai vu, ce soir, dans le sentier,
Une fleur tremblante et flétrie,
Une pâle fleur d'églantier.
Un bourgeon vert à côté d'elle
Se balançait sur l'arbrisseau ;
Je vis poindre une fleur nouvelle ;
La plus jeune était la plus belle :
L'homme est ainsi, toujours nouveau.
La muse
Hélas ! toujours un homme, hélas ! toujours des larmes !
Toujours les pieds poudreux et la sueur au front !
Toujours d'affreux combats et de sanglantes armes ;
Le coeur a beau mentir, la blessure est au fond.
Hélas ! par tous pays, toujours la même vie :
Convoiter, regretter, prendre et tendre la main ;
Toujours mêmes acteurs et même comédie,
Et, quoi qu'ait inventé l'humaine hypocrisie,
Rien de vrai là-dessous que le squelette humain.
Hélas ! mon bien-aimé, vous n'êtes plus poète.
Rien ne réveille plus votre lyre muette ;
Vous vous noyez le coeur dans un rêve inconstant ;
Et vous ne savez pas que l'amour de la femme
Change et dissipe en pleurs les trésors de votre âme,
Et que Dieu compte plus les larmes que le sang.
Le poète
Quand j'ai traversé la vallée,
Un oiseau chantait sur son nid.
Ses petits, sa chère couvée,
Venaient de mourir dans la nuit.
Cependant il chantait l'aurore ;
Ô ma Muse, ne pleurez pas !
À qui perd tout, Dieu reste encore,
Dieu là-haut, l'espoir ici-bas.
La muse
Et que trouveras-tu, le jour où la misère
Te ramènera seul au paternel foyer ?
Quand tes tremblantes mains essuieront la poussière
De ce pauvre réduit que tu crois oublier,
De quel front viendras-tu, dans ta propre demeure,
Chercher un peu de calme et d'hospitalité ?
Une voix sera là pour crier à toute heure :
Qu'as-tu fait de ta vie et de ta liberté ?
Crois-tu donc qu'on oublie autant qu'on le souhaite ?
Crois-tu qu'en te cherchant tu te retrouveras ?
De ton coeur ou de toi lequel est Le poète ?
C'est ton coeur, et ton coeur ne te répondra pas.
L'amour l'aura brisé ; les passions funestes
L'auront rendu de pierre au contact des méchants ;
Tu n'en sentiras plus que d'effroyables restes,
Qui remueront encor, comme ceux des serpents.
Ô ciel ! qui t'aidera ? que ferai-je moi-même,
Quand celui qui peut tout défendra que je t'aime,
Et quand mes ailes d'or, frémissant malgré moi,
M'emporteront à lui pour me sauver de toi ?
Pauvre enfant ! nos amours n'étaient pas menacées,
Quand dans les bois d'Auteuil, perdu dans tes pensées,
Sous les verts marronniers et les peupliers blancs,
Je t'agaçais le soir en détours nonchalants.
Ah ! j'étais jeune alors et nymphe, et les dryades
Entr'ouvraient pour me voir l'écorce des bouleaux,
Et les pleurs qui coulaient durant nos promenades
Tombaient, purs comme l'or, dans le cristal des eaux.
Qu'as-tu fait, mon amant, des jours de ta jeunesse ?
Qui m'a cueilli mon fruit sur mon arbre enchanté ?
Hélas ! ta joue en fleur plaisait à la déesse
Qui porte dans ses mains la force et la santé.
De tes yeux insensés les larmes l'ont pâlie ;
Ainsi que ta beauté, tu perdras ta vertu.
Et moi qui t'aimerai comme une unique amie,
Quand les dieux irrités m'ôteront ton génie,
Si je tombe des cieux, que me répondras-tu ?
Le poète
Puisque l'oiseau des bois voltige et chante encore
Sur la branche où ses oeufs sont brisés dans le nid ;
Puisque la fleur des champs entr'ouverte à l'aurore,
Voyant sur la pelouse une autre fleur éclore,
S'incline sans murmure et tombe avec la nuit,
Puisqu'au fond des forêts, sous les toits de verdure,
On entend le bois mort craquer dans le sentier,
Et puisqu'en traversant l'immortelle nature,
L'homme n'a su trouver de science qui dure,
Que de marcher toujours et toujours oublier ;
Puisque, jusqu'aux rochers tout se change en poussière ;
Puisque tout meurt ce soir pour revivre demain ;
Puisque c'est un engrais que le meurtre et la guerre ;
Puisque sur une tombe on voit sortir de terre
Le brin d'herbe sacré qui nous donne le pain ;
Ô Muse ! que m'importe ou la mort ou la vie ?
J'aime, et je veux pâlir ; j'aime et je veux souffrir ;
J'aime, et pour un baiser je donne mon génie ;
J'aime, et je veux sentir sur ma joue amaigrie
Ruisseler une source impossible à tarir.
J'aime, et je veux chanter la joie et la paresse,
Ma folle expérience et mes soucis d'un jour,
Et je veux raconter et répéter sans cesse
Qu'après avoir juré de vivre sans maîtresse,
J'ai fait serment de vivre et de mourir d'amour.
Dépouille devant tous l'orgueil qui te dévore,
Coeur gonflé d'amertume et qui t'es cru fermé.
Aime, et tu renaîtras ; fais-toi fleur pour éclore.
Après avoir souffert, il faut souffrir encore ;
Il faut aimer sans cesse, après avoir aimé.
Je ne me suis pas fait écrivain politique,
N'étant pas amoureux de la place publique.
D'ailleurs,il n'entre pas dans mes prétentions
D'être l'homme du siècle et de ses passions.
C'est un triste métier que de suivre la foule,
Et de vouloir crier plus fort que les meneurs,
Pendant qu'on se raccroche au manteau des traîneurs.
On est toujours à sec quand le fleuve s'écoule.
Que de gens aujourd'hui chantent la liberté,
Comme ils chantaient les rois ou l'homme de brumaire!
Que de gens vont se pendre au levier populaire,
Pour relever le dieu qu'ils avaient souffleté!
On peut traiter cela du beau nom de rouerie,
Dire que c'est le monde et qu'il faut qu'on en rie,
C'est peut-être un métier charmant,mais tel qu'il est,
Si vous le trouver beau,moi,je le trouve laid.
Je n'ai jamais chanté ni la paix ni la guerre ;
Si mon siècle se trompe,il ne m'importe guère:
Tant mieux s'il a raison,et tant pis s'il a tort;
Pourvu qu'on dorme encore au milieu du tapage,
C'est tout ce qu'il me faut,et je ne crains pas l'âge
Où les opinions deviennent un remord.
LA COUPE ET LES LÈVRES
N'étant pas amoureux de la place publique.
D'ailleurs,il n'entre pas dans mes prétentions
D'être l'homme du siècle et de ses passions.
C'est un triste métier que de suivre la foule,
Et de vouloir crier plus fort que les meneurs,
Pendant qu'on se raccroche au manteau des traîneurs.
On est toujours à sec quand le fleuve s'écoule.
Que de gens aujourd'hui chantent la liberté,
Comme ils chantaient les rois ou l'homme de brumaire!
Que de gens vont se pendre au levier populaire,
Pour relever le dieu qu'ils avaient souffleté!
On peut traiter cela du beau nom de rouerie,
Dire que c'est le monde et qu'il faut qu'on en rie,
C'est peut-être un métier charmant,mais tel qu'il est,
Si vous le trouver beau,moi,je le trouve laid.
Je n'ai jamais chanté ni la paix ni la guerre ;
Si mon siècle se trompe,il ne m'importe guère:
Tant mieux s'il a raison,et tant pis s'il a tort;
Pourvu qu'on dorme encore au milieu du tapage,
C'est tout ce qu'il me faut,et je ne crains pas l'âge
Où les opinions deviennent un remord.
LA COUPE ET LES LÈVRES
AMVH
Il faut, dans ce bas monde, aimer beaucoup de choses,
Pour savoir, après tout, ce qu'on aime le mieux,
Les bonbons, l'Océan, le jeu, l'azur des cieux,
Les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses.
Il faut fouler aux pieds des fleurs à peine écloses ;
Il faut beaucoup pleurer, dire beaucoup d'adieux.
Puis le coeur s'aperçoit qu'il est devenu vieux,
Et l'effet qui s'en va nous découvre les causes.
De ces biens passagers que l'on goûte à demi,
Le meilleur qui nous reste est un ancien ami.
On se brouille, on se fuit. Qu'un hasard nous rassemble,
On s'approche, on sourit, la main touche la main,
Et nous nous souvenons que nous marchions ensemble,
Que l'âme est immortelle, et qu'hier c'est demain.
Il faut, dans ce bas monde, aimer beaucoup de choses,
Pour savoir, après tout, ce qu'on aime le mieux,
Les bonbons, l'Océan, le jeu, l'azur des cieux,
Les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses.
Il faut fouler aux pieds des fleurs à peine écloses ;
Il faut beaucoup pleurer, dire beaucoup d'adieux.
Puis le coeur s'aperçoit qu'il est devenu vieux,
Et l'effet qui s'en va nous découvre les causes.
De ces biens passagers que l'on goûte à demi,
Le meilleur qui nous reste est un ancien ami.
On se brouille, on se fuit. Qu'un hasard nous rassemble,
On s'approche, on sourit, la main touche la main,
Et nous nous souvenons que nous marchions ensemble,
Que l'âme est immortelle, et qu'hier c'est demain.
A MADAME N. MÉNESSIER
qui avait mis en musique des paroles de l'auteur
Madame ,il est heureux,celui dont la pensée
(Qu'elle fut de plaisir,de douleur ou d'amour )
A pu servir de soeur à la vôtre un seul jour.
Son âme dans votre âme un instant est passée ;
Le rêve de son coeur un soir s'est arrêté,
Ainsi qu'un pèlerin sur le seuil enchanté
Du merveilleux palais tout peuplé de féeries
Où dans leurs voiles blancs dorment vos rêveries.
Qu'importe que bientôt,pour un autre oublié,
De vos lèvres de pourpre il se soit envolé
Comme l'oiseau léger s'envole après l'orage ?
Lorsqu'il a repassé le seuil mystérieux,
Vos lèvres l'ont doré,dans leur divin langage,
D'un sourire mélodieux.
Novembre 1831
qui avait mis en musique des paroles de l'auteur
Madame ,il est heureux,celui dont la pensée
(Qu'elle fut de plaisir,de douleur ou d'amour )
A pu servir de soeur à la vôtre un seul jour.
Son âme dans votre âme un instant est passée ;
Le rêve de son coeur un soir s'est arrêté,
Ainsi qu'un pèlerin sur le seuil enchanté
Du merveilleux palais tout peuplé de féeries
Où dans leurs voiles blancs dorment vos rêveries.
Qu'importe que bientôt,pour un autre oublié,
De vos lèvres de pourpre il se soit envolé
Comme l'oiseau léger s'envole après l'orage ?
Lorsqu'il a repassé le seuil mystérieux,
Vos lèvres l'ont doré,dans leur divin langage,
D'un sourire mélodieux.
Novembre 1831
Lire un extrait
Videos de Alfred de Musset (57)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Alfred de Musset (132)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)
Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?
Paris
Marseille
Bruxelles
Londres
10 questions
1220 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poèmes
, poètesCréer un quiz sur ce livre1220 lecteurs ont répondu